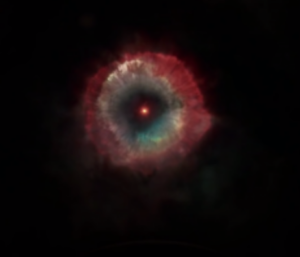Knock at the Cabin, M. Night Shyamalan
Au commencement était le Verbe
« La certitude est, pour ainsi dire, un ton de voix dans lequel on déclare comment sont les choses, mais on ne conclut pas de notre propre ton de voix qu’il est fondé. [… ] Celui qui voudrait douter de tout n’arriverait jamais au doute. Le jeu de douter présuppose lui-même la certitude. »
Ludwig Wittgenstein, De la certitude (§30, §115)
« In the day-to-day trenches of adult life, there is actually no such thing as atheism. There is no such thing as not worshipping. Everybody worships. The only choice we get is what to worship. […] On one level, we all know this stuff already. It’s been codified as myths, proverbs, clichés, epigrams, parables; the skeleton of every great story. The whole trick is keeping the truth up front in daily consciousness. »
David Foster Wallace, This is Water
Il y a des films dont on aimerait écouter la bande sonore, non pour la musique, mais pour les voix – comme on peut écouter celle de Nouvelle Vague ou des Histoire(s) du Cinéma de Jean-Luc Godard (éditées par ECM), comme on voudrait écouter celle des films de Marguerite Duras. En sortant de Knock at the Cabin nous entendons encore certaines de ces voix, elles rebondissent sur les parois du crâne comme des souvenirs entêtants. Le dernier exemple de ces voix mémorables était dans un film imparfait : Crimes of the future de David Cronenberg et ses voix féminines rauques, au bord de l’extinction (celle de Kristen Stewart) ou du hurlement désespéré, de la lamentation (celle de Léa Seydoux). Ici, c’est bien sûr celle de Dave Bautista, dont la douceur triste contraste avec la masse du corps dont elle provient, mais aussi celle de Jonathan Groff : il a d’abord la voix chevrotante et hésitante de tant de personnages de Shyamalan (l’ahurissement extatique de Joaquin Phoenix dans Signes en est peut-être l’exemple le plus mémorable), puis devient affirmée, définitive, sûre d’elle-même, au moment même où elle réclame sa propre extinction. Le commencement, et la fin.
Knock at the Cabin nous présente quatre personnages ayant reçu en visions l’annonce de la fin du monde. Ces visions exigent qu’ils prennent en otage une famille venue passer ses vacances dans une cabane au milieu des bois : seul le sacrifice volontaire d’un des membres de cette famille, qui devra être tué par les siens, pourra éviter la catastrophe. En attendant que la famille cède ou que l’humanité entière soit condamnée, ces tortionnaires contraints se sacrifient à leur place, alors que des événements cataclysmiques semblent en effet se dérouler partout dans le monde. Un récit qui, comme toujours avec Shyamalan, évoque des formes primitives ou anciennes : le conte, le théâtre classique, le récit mythologique. Tous les films du cinéaste ressemblent à des contes pour enfants, mais qui seraient particulièrement francs dans la représentation de la violence traditionnelle des contes (on est toujours frappé, en lisant par exemple les frères Grimm, par la cruauté de certaines punitions), et de plus en plus, puisque Old et Knock at the Cabin sont à mon sens ses œuvres les plus violentes et angoissantes. Il y a quelque chose du théâtre, bien sûr, par l’unité de temps, de lieu, d’action ; Knock at the Cabin a précisément quelque chose à voir avec la tragédie classique, sa fatalité, son rapport à la mise à mort et au rite funéraire (on détruit les corps et on les cache loin des regards des personnages et des spectateurs). Mais ce n’est pas d’Œdipe ou d’Antigone qu’il s’agit : Shyamalan ne met pas en scène les mythes grecs, mais le récit biblique.
Il y a une drôle de pudeur à refuser d’appeler certains cinéastes « religieux » et à préférer les qualifier de « spirituels » ou « spiritualistes » (la même pudeur qui fait que l’on préfère parfois « éthique » à « moral »). C’est par exemple ainsi que l’on décrit l’œuvre de deux cinéastes a priori très éloignés de Shyamalan mais que son cinéma, pourtant, convoque par moments : Rossellini (dans une manière de faire rimer croyance au pouvoir du cinéma et croyance religieuse) et Tarkovski (Knock at the Cabin est manifestement une réécriture du Sacrifice sous forme de home invasion, dont il reprend les principes de sacrifice humain censé sauver l’humanité, et d’incendie du foyer en conclusion). Pourtant, comme eux, Shyamalan ne croit pas seulement en une force divine cachée derrière les choses matérielles, mais bien en une signification, une direction du monde, et va même jusqu’à affirmer que c’est en croyant enfin aux signes, sans plus en douter, que l’on trouve le sens de sa vie et que l’on accède à la plénitude (si la moitié de ses films, notamment Phénomènes ou Incassable, ont des fins assez glaçantes, les conclusions des autres ont parfois quelque chose d’un peu niais, celle d’After Earth par exemple) – ce sont tout simplement des films sur la nécessité de la foi. Croyance assez magnifique quand on pense que c’est probablement le rapport qu’il a au cinéma : que faire des films le rend infiniment heureux et qu’il croit être né pour ça – et de fait Shyamalan était une sorte de jeune prodige qui a commencé à réaliser et écrire très jeune. Les fameux « twists » sont aussi à interpréter dans ce système religieux : ils sont, au sens propre, des révélations, des instants où les signes que l’univers nous a donnés sont interprétés comme des signes divins résultant d’une intentionnalité et d’un plan divin. Ces instants sont plus que des retournements de situation, ce sont des instants où tout le récit et toute l’économie esthétique se synthétisent (flashbacks ahurissants, emphase musicale, fixation du temps) pour nous rappeler que tout était là depuis le début, une évidence en même temps qu’une surprise, l’invraisemblable en même temps que le nécessaire – Malcolm ne pouvait qu’être déjà mort, la femme de Graham ne pouvait que lui fournir, mourante, la clé pour sauver leurs enfants, et évidemment que le vieux couple de The Visit n’est pas ce qu’il semble être. Comme la Genèse annonce déjà l’Apocalypse.
Knock at the Cabin est une nouvelle variation sur cette idée de « révélation », en prenant cette fois le mot en son sens religieux ; les traductions de la Bible en langue anglaise préfèrent en effet le titre de « Book of Revelations » pour parler de ce que nous appelons en français l’Apocalypse. À ce titre, il s’agit du film le plus religieux (le plus chrétien) de Shyamalan depuis Signes et Le Village – et si Phénomènes et After Earth parlaient déjà de la fin du monde, ce n’était pas en citant explicitement le dernier livre de la Bible. Knock at the Cabin toque cependant à la porte du paradoxe que cela implique : le fait de réunir une œuvre profondément religieuse et un plaidoyer pour la tolérance – comme le christianisme peut professer l’amour du prochain et pratiquer le prosélytisme le plus violent. Knock at the Cabin fait ainsi le portrait d’un couple homosexuel victime de violences homophobes et traumatisé par celles-ci, pris en otage par des tortionnaires tragiques ; comme s’il fallait trouver un « terrain d’entente » entre les deux, une égalité des souffrances, ou même transcender la souffrance personnelle au profit d’une vérité plus grande. Paradoxalement, Shyamalan est aussi ouvert au monde qui l’entoure qu’il est enfermé dans les schémas narratifs qu’il tire de son interprétation du christianisme ; l’Apocalypse passe moins par les sauterelles du premier plan que par des maux bien contemporains (catastrophes écologiques, pandémie, terrorisme…) et ses récits témoignent d’un projet de société plutôt progressiste, où les quatre cavaliers de l’Apocalypse sont d’humbles fonctionnaires et où la famille nucléaire au centre du projet divin peut être un couple homosexuel et leur fille adoptive. C’est à dire qu’après un passage par le doute, le déterminisme reprend toujours ses droits, trouvant même une place pour ses apparentes contradictions (on pense aux erreurs d’interprétation des personnages d’Incassable ou de La jeune fille de l’eau, qui apparaissent encore dans Knock at the cabin, lorsque les tortionnaires eux-mêmes se mettent à mettre en doute leurs visions). Les films de Shyamalan sont en quelque sorte des plaidoyers crédules, des œuvres de tolérance radicale et d’amour sans limite (y compris pour les personnages qui voudraient y échapper), volontairement aveugles à elles-mêmes – peut-être aveuglées par leur propre lumière, comme Eric est aveuglé par celle qui traverse la cabane lors de la première mise à mort, dans laquelle il aperçoit la figure qui déterminera son choix final.
L’œuvre de Shyamalan, si singulière et claire lorsque l’on prend chaque film individuellement, étonne aussi par sa cohérence globale ; Knock at the Cabin reprend la fin du monde de Phénomènes et After Earth, la logique conceptuelle d’un « ordre cosmique » auquel appartiennent les personnages dans La jeune fille de l’eau ou Signes. Et à chaque fois que l’on annonce la crise de son cinéma (cela arrive à peu près à chaque film depuis Signes), on est surpris de voir que cette crise ne consiste pas en l’érosion de ses principes fondateurs, mais en une affirmation toujours plus grande de ceux-ci (Le Dernier maître de l’air, le seul film que Shyamalan vraiment adressé à un jeune public, est peut-être la seule exception). Au fond c’est cela qui le rend « clivant » : les films de Shyamalan sont de plus en plus avares de détails extérieurs et ressassent les mêmes idées, les mêmes signes, jusqu’à la caricature et surtout jusqu’à faire de la défense même de son œuvre une sorte d’acte de foi – une religion ? En tout cas, une certitude.
Et je crois qu’il y a, dans Knock at the Cabin, des signes donnés pour nous rappeler que Shyamalan est bien un grand cinéaste. À l’exception de Spielberg (comme il l’a encore prouvé avec The Fabelmans, dont la sortie est prévue fin février), quel cinéaste américain est encore capable d’un tel investissement dans sa mise en scène, de faire un geste signifiant narrativement à chaque plan ? Ainsi de ces travellings horizontaux incessants qui mettent en image la recherche d’équilibre et de justesse qui sous-tend tout le film, ou, au contraire, ces cadrages déséquilibrés, classiques et en même temps très audacieux, qui font plus que créer de la tension, incarnant la violence intérieure des personnages forcés de faire un acte horrible dont ils savent qu’il est cependant le bon… On reproche parfois à Shyamalan d’être un bon metteur en scène dont les scénarios ne seraient pas à la hauteur. Or les deux se synthétisent dans un style remarquable par son univocité, à la conclusion toujours sans appel ; les résonances religieuses n’aboutissent pas à un principe ou une esthétique de la duplicité, mais de l’évidence. Le principe de révélation et de twist que décrit ci-dessus est donc bien plus qu’un réflexe scénaristique, il est la colonne vertébrale, la fondation ontologique de son cinéma. Dans ce film fermé, cru, proche de la série B, Shyamalan persiste dans son discours sur l’ordre cosmique de l’univers, le même que dans Incassable, Signes et Le Village. Il ne se réinventera heureusement jamais.
Scénario : M. Night Shyamalan, Steve Desmond, Michael Sherman, d'après le roman de Paul Tremblay / Image : Jarin Blaschke, Lowell A. Meyer / Montage : Noemi Katharina Preiswerk / Musique : Herdís Stefánsdóttir
Durée : 1h40.
Sortie française le 1er février 2023.