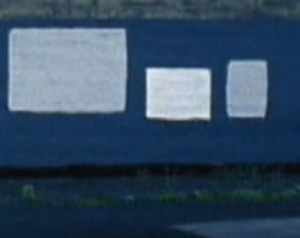L’autre côté de l’espoir, Aki Kaurismäki
Déjà les chiens
Dans la cale d’un cargo, une silhouette émerge d’un amas de sable noir et fin qui scintille au clair de lune. Sans doute est-ce un homme mais son attitude sème le doute. Il ne tousse ni ne s’époussette. Il ne râle pas ni ne se lamente, regardant simplement autour de lui. Le voilà qui se met à marcher imperturbablement, du port jusqu’à la gare, de la nuit jusqu’à l’aube. Là, il demande qu’on lui indique les douches où il se débarrassera de la poussière qui recouvre sa peau. Une nuée noire, emportée par l’eau et le savon, serpente vers le siphon. Ressort alors un homme, propre comme un sou neuf, métamorphosé peut-être. Il ressemble du moins à vous et à moi. Il a même un prénom : Khaled.
De l’autre côté de l’espoir commence comme un film de science-fiction. Peu s’en faut d’ailleurs pour que cette première scène n’évoque celle, dans Terminator 2, où l’autrichien Arnold Schwarzenneger débarquait dans un parking de Los Angeles, nu comme un ver. Dans un cas comme dans l’autre, l’étrange a tout à voir avec l’étranger, et Khaled, comme bon nombre d’immigrés ayant fuit les guerres du Moyen-Orient, se fera vite rappeler qu’il peut être perçu ici comme une sorte de huitième passager – de centième, de millième. Citoyen syrien en exil, le voilà qui se retrouve, indépendamment de sa volonté, en Finlande. Pas n’importe laquelle, cependant – celle d’Aki Kaurismäki, perdue dans le temps mais qui subit en permanence les assauts du monde contemporain. Ici, on tape toujours des rapports de police sur des machines à écrire mais on ne fait pas l’économie des technologies les plus en pointe en matière de reconnaissance d’empreintes digitales. On ne s’embarrasse pas de contrats et de formulaires administratifs, et cependant on sait falsifier informatiquement des permis de séjour. Ainsi, on s’est équipé pour affronter une époque où l’identité des individus et le territoire dans lequel ils évoluent semblent des problèmes essentiels.
Chez Kaurismäki, on ne s’est jamais trop empressé d’emboîter le pas à la frénésie du monde moderne, à ses désirs de contrôle et de performance. Ces choses-là s’invitent d’elles-mêmes, comme un courant d’air sous une porte, perturbant sans cesse un quotidien qui n’en demandait pas tant. Le capitalisme, dans ses films, y est une folie plus grave qu’heureuse mais dont les misérables oripeaux possèdent un ridicule qui fait irrémédiablement sourire. Il y a quelque chose de drôle à voir, comme dans Au loin s’en vont les nuages (1996), quelqu’un commander dans un troquet finnois une escalope dite « hawaïenne » sans que personne ne cille. C’est que la recette, visiblement, a fait du chemin. Elle s’est même complètement égarée, et si elle nourrira toutefois son homme (un grand échalas qui a le physique de quelqu’un se contentant de peu), on ne nous fera pas avaler que sa présence sur la carte n’a rien de déplacé. Au contraire, tout est affaire de déplacement. C’est une carte du monde réduite en carte de restaurant. C’est un plat de résistance portant bien mal son nom qui montre qu’on ne résiste plus vraiment aux puissances de la mondialisation.
De l’autre côté de l’espoir a justement été réalisé vingt ans après Au loin s’en vont les nuages. Il est difficile de ne pas penser à l’un lorsque l’on a vu l’autre. Dans les deux films, il est question d’un restaurant en faillite et de ses employés qui ensemble – ils ne se dispersent jamais tout à fait – tentent moins de s’en sortir que d’y rester. Premier écart, toutefois, d’un film à l’autre : dans Au loin s’en vont les nuages, on tentait de sauver doublement la cuisine et les apparences. Certes on opérait un ravalement de façade pour rendre l’établissement présentable, mais on entendait aussi le rendre recommandable. Le filet de sandre y était préparé sérieusement, cuit et assaisonné avec un professionnalisme certain. Chaque membre de l’établissement nouvellement ouvert attendait alors fébrilement les premiers clients. Il faut dire qu’ils avaient liquidé leurs maigres économies pour ouvrir ce restaurant renommé bien à propos « Le Travail ». Dans L’autre côté de l’espoir, un commercial joue toutes ses économies au cour d’une partie de poker miraculeuse – chez Kaurismaki on gagne aussi vite qu’on perd tout – pour s’acheter un restaurant en décrépitude. L’établissement présente assez bien (assez…) mais est totalement vide. Des araignées ont eu le temps de tisser leur toile sur le cuistot accoudé à ses étagères. On croirait alors voir, vingt ans après, ce que « Le Travail » est devenu : les apparences sont à peine sauvées. C’est une ruine, presque un cénotaphe et l’argent qui manque, tout l’argent, semble quant à lui circuler autour de tables de pokers où jouent une poignée de fortunés. Se demander où sont passés les clients revient à se demander, plus directement, où est passé le fric. Au-dessus de nos têtes, répond Kaurismäki à la fin d’Au loin tandis que ses personnages tournent leurs visages vers le ciel. Manière de dire qu’il est passé de banques en acquisitions foncières sans plus pleuvoir dans les bourses de ceux qui travaillent ou souhaiteraient travailler.
Aki Kaurismäki filme des milieux où le travail importe. Même lorsqu’il n’y a plus rien à faire, que des trousseaux entiers de clés auraient dû être jetés sous les portes, on continue d’occuper la fonction, de porter le costume, d’avoir un métier. Moins qu’un attrait pour la « valeur-travail », c’est le souhait de prendre part physiquement à l’économie – de la palper – qui importe. On paye et on se paye en liquide, on perçoit des taxes sur des transactions se faisant de main en main. La préférence de Kaurismäki va souvent aux métiers où la rémunération tinte en tombant dans un chapeau ou un tiroir-caisse. L’économie est une chose aussi sérieuse que concrète. Rien n’est jamais donné et tout à un coût. Cette précision n’est pas une manie, pas même une précaution. Elle indique plutôt l’importance qu’il y a à ce que l’argent soit encore physiquement là ; qu’il nous appartienne et qu’on se l’échange nous-mêmes. Dans L’autre côté de l’espoir, les personnages n’en finissent plus de se couper les cheveux et le bouc en quatre pour savoir où diable l’argent est parti (loin, forcément – en Asie ?) et comment le ramener. Alors au coin d’une table on imagine un plan. Celui-ci donnera lieu à la scène la plus drôle du film. Transformé en bar à sushis de bas-étage, le restaurant sert cette fois des filets de sandre crus tartinés copieusement de wasabi industriel. Qu’importe que cette tambouille ait l’air infâme, la clientèle afflue déjà, accueillie par des serveurs grimés en Japonais de carnaval. C’est qu’en effet un bus entier de touristes ou d’hommes d’affaires asiatiques vient d’arriver comme par enchantement, bondant la salle. Ils auront le malheur de goûter à cette piteuse cuisine-du-monde mal digérée avant même d’être servie, et de se faire saouler aux frais de la maison par conséquent (il faut bien quelque tord boyaux pour faire passer les couleuvres). Nous ne sommes alors pas loin du Ray Ruby’s Paradise de Go Go Tales (Abel Ferrara, 2007). Lui aussi était au bord de la faillite et ses salariés sans le sou avaient compris que toute l’économie avait viré à l’est. Si le marché mondial est ouvert, il faut croire que la culture et l’argent y circulent bien trop mal et bien trop vite.
Ces histoires de circulations propre à un monde grand ouvert touchent nécessairement le cinéma particulier de Kaurismäki, étiqueté – et par conséquent vendu – comme étant un monde en soi, un genre à part. Ses gueules (cassées), ses couleurs (bleu, rouge, jaune), ses cadres bressoniens (dit-on), son humour (noir) et ses musiques (tango, rocks des sixties). On a tôt fait de désigner ce cinéma comme étant alors un folklore, un genre en soi. Les films de Kaurismäki sont des films-étrangers tout désignés. Ils montrent quelque chose de fondamentalement autre. Pourquoi pour la seconde fois consécutive, et alors qu’il traite de la question des migrations, Kaurismäki a-t-il recours à une scène de genre pour débuter ses films ? Dans Le Havre (2009), un homme menotté à sa mallette était attendu dans le hall d’une gare par deux hommes (manteaux, chapeaux, verres fumés) avant d’être abattu. Film noir. Il y a une façon de citer, de faire référence au cinéma pour doublement le tenir à l’écart (on discerne les guillemets) et le convoquer – comme pour rappeler que l’on y est, en plein dedans, d’entrée de jeu. A l’instar de Claude Lanzmann à Cannes dans son discours d’ouverture en 2008, Kaurismäki clame qu’il n’y a qu’un seul cinéma[11][11] « […] De même qu’il n’y a qu’une humanité et que je peux pleurer ou rire en voyant un film de Ozu, des frères Dardenne ou d’Almodovar, de même il n’y a qu’un seul cinéma. Vive la diversité interminable du cinéma ! Vive l’unité indestructible du cinéma ! » Claude Lanzmann, discours d’ouverture du 61ème Festival de Cannes.. Pas de genres mis à part, pas de films étrangers. Grande préoccupation d’un cinéaste dont l’œuvre fait monde et système[22][22] De films en films, on croit reconnaître certains personnages, comme cet homme venant lire la nouvelle carte du « Travail » (Au loin s’en vont les nuages) et qui ressemble trait pour trait à l’inspecteur des finances joué par Jean-Pierre Daroussin dans Le Havre. : comment y accueillir l’étranger ? Comment y recueillir l’autre ? Khaled et Idrissa avant lui passent beaucoup de temps à observer, à écouter, comme s’ils se donnaient d’abord le temps de repérer, de s’acclimater à cet univers de drôles. Très vite cependant, ils en reviennent à ce qui les meut vraiment : partir. Ainsi prennent-ils part au théâtre kaurismakien où les personnages, eux aussi depuis le début, aspirent à s’en sortir – financièrement. Les deux volontés sont différentes et pourtant entrent en résistance. Ici l’on veut rester chez soi mais la guerre contraint à l’exil. Là on veut rester sur son lieu de travail mais le marché oblige à ce que l’on vire. Ici on veut rentrer au pays. Là on veut retourner bosser. Chacun en ce bas monde, petit comme grand, ne sait plus s’il doit retourner à sa place ou s’en sortir.
Trouver un peu de bon sens devient alors un travail à plein temps pour les personnages de Kaurismäki, et toujours ils prennent un peu de temps pour réfléchir à la bonne marche à suivre, à quelle direction prendre. Dur labeur dans un monde qui n’a ni queue ni tête. À moins que. Les chiens occupent une place de peu, plutôt que de choix, dans les films du réalisateur. Dans L’autre côté de l’espoir, on en découvre un en cuisine. Dans Au loin, c’est celui du couple au bord de se retrouver à la rue. Les fidèles compagnons n’ont rien d’autre à offrir que leur présence bienveillante. On les promène. Ils se promènent. Ils attendent. Ils reniflent. On n’attend rien d’eux sinon qu’ils soient là. Ils vivent au rythme des aléas du dérèglement général auxquels ils ne prennent pas part. Un raccord dans Au loin s’en vont les nuages est plus qu’éloquent à cet endroit. Le maître, se levant de table, dit à sa femme qu’il va sortir les poubelles. On ne le verra pas faire cette menue corvée. Dans le plan suivant, il sort son chien. Comme chez Ferrara – encore lui – Kaurismäki accorde une attention particulière aux êtres sortis de la chaîne du travail (ses rebuts, ses clochards) et ceux qui sont pris dedans malgré eux (les animaux, compagnons ou ripaille). Ils sont les spectateurs impuissants de la grande machine qui tourne à vide mais continue de produire des déchets à n’en plus finir. Khaled est trouvé par son futur employeur dans un local à poubelle qu’il a désigné comme étant son logis. La demeure des rejetés. Tel est le devenir déchet de l’humain, celui que l’on veut sortir hors de chez-soi comme on sort les poubelles. Le chien de L’autre côté de l’espoir s’en souviendra, lui qui semble revenir d’Au loin s’en vont les nuages, arrachant en un petit coup de langue sur sa joue, un sourire à l’homme à terre, celui retombé à la rue.
Photographie : Timo Salminen / Monteur : Samu Heikkilä / Costumes : Tiina Kaukanen
Maquillage : Tiina Kaukanen / Assistant réalisateur : Eevi Kareinen
Durée : 98 mn
Sortie : 15 mars 2017
Les images proviennent de films d'Aki Kaurismäki : L'autre côté de l'espoir / Au loin s'en vont les nuages (1996).