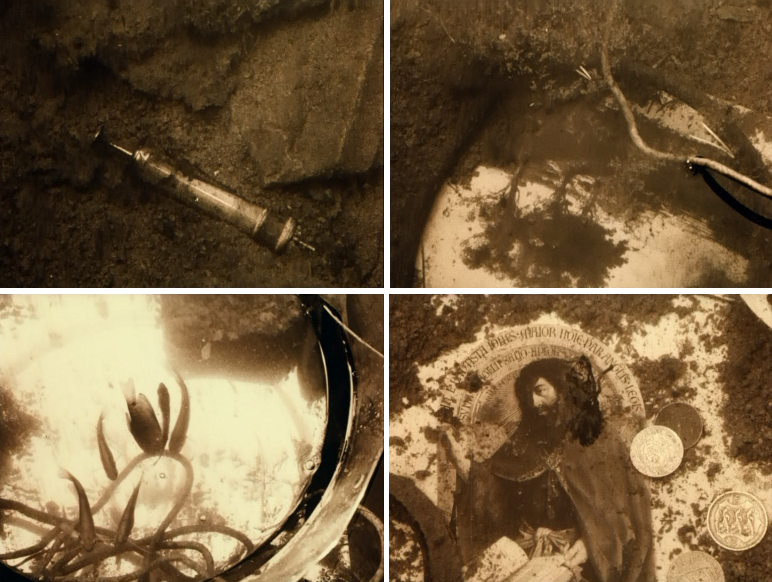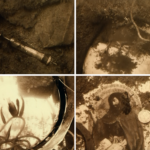L’invention de la figure humaine
La traversée des ruines
Contrairement à plusieurs des amis qui m’ont précédé à cette tribune, je ne crois pas que l’humain et l’inhumain soient la même chose ou même soient réversibles, en dépit du lien qui inévitablement les unit ; plus spécifiquement, je ne crois pas qu’ils s’incarnent dans les mêmes figures cinématographiques, dans les mêmes images en général. Pour indiquer d’entrée de jeu comment l’inhumain sera évoqué ce soir, je vous propose une phrase d’Adorno, que voici : “Je citerai simplement ce mot de Paul Valéry prononcé avant la Première Guerre, et selon lequel l’inhumanité aurait un grand avenir” ; cette phrase est tirée d’un article qui s’intitule “Éduquer après Auschwitz”[11][11] Theodor W. Adorno, “Éduquer après Auschwitz”, conférence radiodiffusée en 1966, tr. fr. in Modèles critiques, Payot, 1984, p. 213..
1.
Donc, j’en viens à Orphée, de Jean Cocteau, qui sera mon point de départ et mon guide. Voici comment, présentant ce film durant l’été de 1950, le cinéaste Chris Marker a fait part de son émotion : « L’admiration même ne venait qu’en second, les incroyables beautés formelles d’Orphée n’apparaissaient qu’à la réflexion. L’essentiel était que le film commençait d’opérer : nous avions pénétré dans la zone radio-active, nous étions atteints, il ne dépendait plus de nous d’y céder ou d’y résister. Et certains avaient peur[22][22] Ch. Marker, « Orphée », Esprit, vol. 18, n° 11, novembre 1950, p. 694.. »
Cet effet de peur pourtant ne va pas de soi. Dans un cinéma français de l’après-guerre qui se caractérise par son goût du « noir », par sa recherche de l’image expressive et des situations voulues désespérées, le film de Cocteau tranche par sa simplicité. Si l’on admet les conventions du genre merveilleux, le récit frappe même par sa linéarité, tandis que le filmage, malgré l’abondance des trucages, insiste sur les vertus réalistes de l’image cinématographique. Comme Buñuel, dont il s’était toujours senti proche, Cocteau pratique ici un cinéma dont le style, narratif et figuratif, ne cherche aucunement à se singulariser, sinon par l’élégance et ce qu’elle implique d’économie. Son film est presque un manifeste des pouvoirs documentaires du cinéma – rejoignant un principe esthétique ancien chez lui, puisque dans la dédicace de la pièce Orphée, en 1926, il déclarait déjà qu’il ne voulait pas être admiré, mais cru. Quant à la figure d’Orphée, Cocteau la produit comme une figure superlative du Poète, engagé entièrement et pleinement dans son art, c’est-à-dire selon la version tardive du mythe qu’a popularisée Ovide (Orphée, dans le mythe primitif, était un prêtre du culte de Dyonisos, le dieu-Soleil). En même temps, de la légende grecque, il ne reste que bien peu dans l’histoire du film, peut-être pour mieux retrouver les vrais thèmes du mythe : le Poète et l’au-delà ; le Poète et le pouvoir oraculaire (dans la mythologie, la tête d’Orphée, après qu’il a été déchiré par les Ménades, émet des oracles) ; le poète et les femmes (condamnant les débordements des Ménades, Orphée avait prêché l’homosexualité)[33][33] J’emprunte cette dernière indication à Robert Graves, Les Mythes grecs (1958), tr. fr., Fayard, 1967, §28 – qui cite comme source Ovide et les Narrations de Conon..
Les figures les plus nombreuses de ce film riche en images sont celles du passage d’un monde à un autre ; il y en a de trois types, conférant chacune un sens nouveau à l’idée de traversée, de passage :
Première figure, l’entrée dans le reflet ou traversée des apparences, concrétisée par celle du miroir. Quatorze traversées du miroir – sans doute les images les plus célèbres du film, souvent imitées depuis[44][44] Voir, de façon inattendue et purement épisodique, la reprise de l’un de ces trucs (le “miroir” liquide) dans Evil Dead, un film du sous-genre “horreur / morts-vivants” (Sam Raimi, 1982). – sont réalisées au moyen de quatorze procédés différents de trucage, dont aucun en laboratoire : on identifie le goût de Cocteau en général pour la performance, qui souligne, ici, l’attachement de l’auteur à cette figure particulière ;
Deuxième figure, la marche dans les ruines ou traversée de la mémoire. Processus d’anamnèse ou au contraire, stagnation dans l’oubli, figurée à trois reprises, elles aussi variées ; le commentaire insiste sur la différence entre la deuxième et la première fois, et la troisième est effectuée à reculons, ce qui la souligne encore davantage ;
Troisième figure, la rencontre brutale avec les messagers et les messages de l’au-delà : émissions cryptées de la radio infernale, transports télékinésiques, passage par le négatif (une idée reprise de Nosferatu, et dont une variante plus subtile est le passage du noir au blanc de la robe de Maria Casarès dans la scène de la mort d’Eurydice) – le tout réalisant une véritable traversée de l’être. Ici les procédés sont variés, les occurrences, nombreuses : à vrai dire, tout le film, par contamination, en relève.
Cette insistance sur la traversée ou plutôt sur le traverser me paraît être le vrai sujet d’Orphée. Elle mène forcément à considérer la limite de toute traversée : le non-retour, l’incapacité à inverser les trajets, la perte ou l’abandon à l’ “autre côté”, la traversée radicale et définitive dont on ne revient pas.
– Le miroir absorbe, parce que l’homme y “marche dans l’image“, pour reprendre une phrase célèbre et mystérieuse du Psaume 39, qui a été glosée par saint Augustin et aussi par Jacques Lacan et Pierre Legendre : “Quamquam in imagine ambulat homo, tamen vane conturbatur ; et nescit cui congregabit ea” : bien qu’il marche dans le faux-semblant, dans l’image (ou mieux : en image), l’homme pourtant s’agite en vain[55][55] Psaume 39, verset 7. “Ce mode du connaître, indéfini et limité, nous en avons quelque idée par le thème de la traversée du miroir, thème latent dans la théologie mystique et devenu explicite dans les arts modernes depuis Carroll. Le film de Cocteau Le Sang d’un poète introduit au cœur de ce qui se joue, par ce dialogue entre la statue et le poète […]. Voilà ce dont il s’agit dans le travail d’identification selon la formule de l’Écriture “L’Homme se promène dans l’image”, – dont les arts traduisent de façon si poignante l’errance et les tâtonnements.” P. Legendre, Dieu au miroir, Fayard, 1994, p. 244. Le commentaire d’Augustin est dans la Trinité, livre XIV, 4, 6 ; Lacan a proposé l’inversion ironique de la formule : “Bien qu’il s’agite en vain, cependant l’homme marche dans l’image.” Noter que toute cette glose vaut uniquement pour la traduction latine, le texte hébreu disant plus sobrement : “Selon l’image [ou : comme image] marchera l’homme, selon la vanité il s’agitera, il amassera et ne saura pour qui.“. Celui qui traverse le miroir s’identifie ou risque de s’identifier à son image, à son autre imaginaire, à son double, à cette figure dont la raison me dit qu’elle n’existe que pour autant que j’existe, mais dont un autre sentiment (que matérialise le mythe de Narcisse), un sentiment de l’opacité du réel, m’informe qu’elle existe plus que moi – et que de nous deux, c’est elle, l’image, qui me survivra[66][66] Clément Rosset, Le Réel et son double, Gallimard, 1976, 1984.. Le cinéma en général a cultivé cette figure de l’autre spéculaire, sans doute parce que la peinture, la littérature, la philosophie l’avaient tant cultivée avant lui (Léon Bloy, mai 1908 : “Idée effrayante […] à propos du texte Per speculum in ænigmate : les plaisirs de ce monde pourraient bien être les supplices de l’enfer à l’envers dans un miroir[77][77] Cité in Borgès, “Le Miroir des énigmes” (1952), Enquêtes, tr. fr., Gallimard, 1957, p. 180..”) L’Orphée de Cocteau n’a pas plus tôt traversé un miroir qu’il devient autre, aimant un autre objet.
-De même, celui qui traverse la frontière séparant la mort de la vie doit s’attendre à rencontrer ce qu’il n’est pas prêt à rencontrer, un inimaginable ou un innommable. Cocteau justement se garde bien d’imaginer cet au-delà, il le figure avec des ressources absolument humaines, faute de vouloir présenter quoi que ce soit qui fasse visiblement imaginé. Quant à nommer, le film habilement joue de la possibilité qui en est toujours laissée, mais elle est devenue vide de sens : nommer “tribunal” cette congrégation anonyme, qui tient sa légitimité d’on ne sait qui, est à la fois exact et trompeur, pour décrire ces juges qui jugent les juges et sont eux-mêmes jugés sans cesse.
-Enfin, celui qui traverse la mémoire (“sa” mémoire : mais en quoi sienne, si elle est destinée à l’oubli ?) s’expose à pire : à tout perdre de son histoire, ou au contraire, à retrouver l’historial, le mémorial à travers le mémoriel. C’est pour parler de cela, de ce danger ou de cet espoir, que Cocteau se sert de la figure d’Orphée, le prêtre instruit des mystères, qui savait calmer les Enfers, mais n’avait pas assez de mémoire personnelle pour être assuré même que sa femme le suivait. Ce sont ces figures de traversée-là qui nous mettent d’abord face à l’inhumain dans ce qu’il a de plus anonyme : le temps, l’histoire, l’éternité. C’est d’elles que j’ai fait partir mon commentaire aujourd’hui, parce qu’il me semble qu’on peut en voir un prolongement, deux ou plusieurs prolongements, dans le cinéma depuis la guerre.
[Projection d’Orphée : la première traversée de la zone]
La zone que traverse Orphée guidé par Heurtebise, le messager, l’ange, est un environnement inhumain ; on n’y vit pas en homme. La zone est le lieu où l’on erre, en reproduisant sans fin les gestes les plus banals de la vie, pour en perdre l’habitude et aussi le mot “habitude” lui-même, puisque, comme beaucoup de nos mots, celui-ci est un mot de vivant, le mot de qui habite le temps, donc contradictoire avec l’éternité.
Cette zone est peuplée d’êtres indifférents, sortis non seulement de toute passion, mais hors de toute situation précise. Orphée se rendant aux enfers pour remporter une victoire sur la mort coïncide avec une figure christique, et la zone pourrait aussi évoquer ce que la mythologie chrétienne a appelé les “limbes” : ce qui n’est plus vivant mais pas vraiment mort, puisque, dans la perspective chrétienne, la mort coïncide avec la rencontre de Dieu. Les limbes sont le lieu où les hommes ne sont ni absous, ni condamnés, mais “perdus”, selon le mot de Bernanos, oubliés de Dieu et l’oubliant eux-mêmes ; d’où que le “châtiment le plus grand – la carence de la vision de Dieu – se retourne ainsi en joie naturelle : ils ne savent, ils ne sauront jamais rien de Dieu[88][88] Giorgio Agamben, “Idée de la politique”, Idée de la prose (1985), Christian Bourgois, 1988, pp. 59-61..”
Il y a un peu de cet air d’ignorance dans les ombres ou les figures qui hantent la zone de Cocteau, mais pas beaucoup de joie, et infiniment de perte. Aussi bien, la zone n’est pas vraiment les limbes. D’abord, parce qu’il n’y a ici aucune perspective divine, ou presque (s’il est un dieu dans cet outre-monde, il est plus caché que le maître du château de Kafka, ou alors, il n’existe que disséminé en mille entités – ou peut-être dans leur rapport, comme le laisse à penser le discours du “juge”). Ensuite, et surtout, parce que, au contraire des limbes, qui sont faits pour y demeurer éternellement, la zone, en principe, se traverse (en principe seulement : les figures que vous avez vu errer y sont peut-être pour toujours : il semble y avoir assez peu de rapport entre des morts comme Cégeste, Eurydice ou Orphée, et le vitrier). La zone est donc cette figure d’un espace paradoxal qui est fait pour être traversé, mais où le temps est destiné à être aboli : or, comment imaginer une traversée qui ne se fasse pas avec et dans le temps ? Par conséquent, si la zone n’est pas dans les limbes, c’est que ce qui y manque structuralement (ce qui “manque à sa place”) n’est pas Dieu, c’est le Temps. La zone est une figure de l’éternité, comme abolition du temps – figure terrifiante, on comprend avec Chris Marker que cela ait fait peur.
Dans Le Testament d’Orphée, le Poète (joué par Cocteau lui-même) meurt aussi, d’une mort atroce, soulignée par la répétition d’une phrase parmi les préférées de Cocteau (“Quelle horreur !“). Mais c’est une mort rapide, presque instantanée ; décidée très vite, elle est aussitôt obtenue ou produite, sous la forme du javelot lancé par Athéna. Cette mort elle aussi a lieu dans des ruines, mais les ruines ne sont que son décor, comme une gigantesque projection, un peu expressionniste, du trouble du poète au moment de franchir un pas symbolique, angoissant et lourd. La mort alors n’est qu’un instant, presque pas un passage mais un saut : Robert Bresson l’a qualifiée de “gag fantastique” (l’opposant à la mort de Jeanne dans Procès de Jeanne d’Arc, où c’est le corps qui disparaît), et l’on pourrait aussi bien la rapprocher de l’idée pasolinienne de la mort comme gag tragique[99][99] Pier Paolo Pasolini, “Le “gag” chez Chaplin” (1971), in L’Expérience hérétique, tr. fr., Payot, 1976, p. 230..
Dans Orphée, au contraire, la mort (le fait de mourir) n’en finit pas – parce que c’est moins de la mort comme geste, comme acte de montage (pour reprendre une autre formule de Pasolini) qu’il est question, que de la mort comme effacement progressif, donc, comme rapport à la mémoire. J’enchaîne donc en vous montrant autre chose.
[Projection de Stalker : le stalker dans la flaque d’eau]
Zone pour zone, vous l’aurez pensé tout seuls, mais ce n’est guère qu’un jeu de mots, tant l’inspiration est différente. La “zone” du film de Tarkovski n’est pas celle de la mémoire des individus, c’est celle d’une autre mémoire, anonyme, et dont personne ne veut. Le “stalker” (qu’il faudrait traduire par “traqueur”, et qui métaphorise trop évidemment le poète) est étendu dans l’eau, comme dans un liquide amniotique et primordial où se répand, malgré qu’il en ait, une sorte de mémoire qui n’est pas la sienne mais de l’inconscient, du ça, de l’au-delà, du passé aussi bien. Au lieu que chez Cocteau on traverse la zone pour perdre ses souvenirs, lentement et difficilement (ils résistent à s’effacer), chez Tarkovski on y pénètre, difficilement et lentement, pour que de la mémoire arrive à se constituer. L’espace est donc filmé comme une figure du temps : c’est tout le sens de la lenteur et des mouvements d’appareil (cf. le début de la partie en couleurs, l’arrivée dans la zone, avec les restes de la guerre) – et j’ajoute qu’à mon opinion, c’est cela et cela seul qui est intéressant dans ce cinéma.
La zone de Tarkovski est dotée de qualités complexes : elle donne le plus grand bonheur imaginable, mais aussi elle “châtie” (vocabulaire dostoïevskien, répété), elle appelle mais se défend sans cesse, d’ailleurs elle est essentiellement changeante ; en même temps, elle est d’une nature simple, une image de l’au-delà divin, avec ses puissances dispensatrices de biens et de maux exactement proportionnés et adéquats à notre “nature”, à notre “être” : elle n’exauce que le vœu le plus “sincère”, le plus “vrai”, fût-ce même contre celui qui le formule, et qui ne sait qui il est ; il y a une prédestination dans la zone, par une sorte de swedenborgisme dont on aurait accentué la tendance “mélancolique” pour concevoir le ciel comme une récompense et l’enfer comme un châtiment – perdant ainsi tout espoir de parler avec les anges comme au contraire se le proposait Swedenborg. Cette espèce de théâtre métaphysique assez sinistre qui semble une parodie poussiéreuse de Beckett, et qui infiltre les pénibles scènes dialoguées du film, est donc contredit par les avancées du regard, qui sont autant d’images de la mémoire ou de la pensée, dans son essentielle difficulté à se constituer.
On peut lire Stalker de bien des façons, dont la chrétienne-swedenborgienne est la plus plate. Il serait tout aussi facile, par exemple, d’y trouver l’illustration d’une proposition célèbre de Heidegger, dans un texte daté de 1954 : “À notre époque critique [bedenklich], le point le plus critique se montre en ceci que nous ne pensons pas encore. Nous ne pensons pas encore, parce que Ce qu’il faut penser se détourne de l’homme, et nullement pour l’unique raison que l’homme ne se tourne pas suffisamment vers Ce qu’il faut penser. Ce qu’il faut penser se détourne de l’homme : il se dérobe à lui, se retenant et se réservant. Mais le réservé [das Vorenthaltene] nous a toujours été déjà, et nous reste, présenté [vorgehalten]. Ce qui se dérobe en se réservant ne disparaît pas. Comment, néanmoins, pouvons-nous avoir seulement l’idée de le nommer ? Ce qui se dérobe refuse sa venue. Cependant… se retirer n’est pas rien. Se retirer est ici se réserver et pour autant – advenir[1010][1010] Heidegger, “Que veut dire “penser” ?” [1954], Essais et Conférences, tr. fr., Gallimard, 1958, p. 158..”
L’après-guerre, dans sa littérature comme dans ce qui s’appela alors le “nouveau théâtre”, cultiva l’absurde, et c’est aussi, avec trente ans de décalage, la tonalité du film de Tarkovski. L’homme de cette époque a du mal à savoir qui il est, parce qu’il a du mal à savoir de quelle étoffe sont faits, non ses rêves, comme dans Shakespeare, mais sa mémoire et sa pensée. La troisième traversée de la zone, dans Orphée, a lieu à l’envers : or, c’est celle qui ramène, non vers le souvenir, mais vers l’oubli le plus parfait, puisque c’est l’oubli de l’oubli. Il y a chez Leibniz un apologue assez frappant à ce sujet, destiné à souligner que la mémoire est partie intégrante et nécessaire de la “substance” – nous dirions, en termes freudiens, du Moi : “Supposons que quelque particulier doive devenir tout d’un coup roi de la Chine, mais à condition d’oublier ce qu’il a été, comme s’il venait de naître tout de nouveau ; n’est-ce pas autant dans la pratique, ou quant aux effets dont on se peut apercevoir, que s’il devait être anéanti et qu’un roi de la Chine devait être créé dans le même instant à sa place ? Ce que ce particulier n’a aucune raison de souhaiter[1111][1111] Leibniz, Discours de métaphysique (1686), Vrin, 1994, p. 88..” Orphée, revenu dans ses meubles, est-il encore Orphée ? Symétriquement, le professeur Professeur, l’écrivain Écrivain de Stalker, ne seraient-ils pas devenus de pareils “rois de la Chine” s’ils étaient entrés dans la chambre qui exauce les vœux ?
La traversée des ruines est donc donnée comme la perte de “soi”, en tant que telle forcément accompagnée d’un gain d’illusion quant au réel : c’est en pantoufles que finit Orphée, des pantoufles qu’il n’avait jamais portées avant de “revenir” de sa mort. La mémoire, cette mémoire que l’institution de la zone vise à défaire, à destituer – la mémoire n’existe pas, ou elle est infiniment fragile, elle peut effectivement se perdre, se défaire, devenir comme si elle n’avait pas existé. Bien sûr, c’est le temps qui est en cause, puisque sans la mémoire, je ne connais que le pur présent, lequel n’a aucune dimension temporelle (il n’en acquiert une qu’imaginaire, par ma mémoire et mes attentes).
Le temps est la dimension la plus mystérieuse de ce que nous appelons le réel (et qui coïncide, ici, avec l’inhumain). Bresson, encore : “Le surnaturel, c’est du réel précis (dont on s’est approché pour le voir vraiment)[1212][1212] Entretien avec François Weyergans, pour l’émission réalisée par ce dernier dans la série “Cinéastes de notre temps”, en 1966..” Qu’on me permette d’inverser les termes, pour souligner : si l’on s’approche du réel, si on le regarde avec précision, il devient surnaturel. Orphée donne un des moyens de regarder le réel avec précision, et la zone est l’un des noms de la ruine du temps.
2.
Cette image, bien d’autres films par la suite la reprennent.
[Projection : Garrel : La Cicatrice intérieure, troisième plan : Philippe Garrel marchant, Nico, loin derrière, ne peut le suivre.]
Cet héritier d’Orphée ne se retourne pas, mais s’il se retournait qu’adviendrait-il ? Qu’est-ce que cette marche sur une route de sable, dans des collines de sable, tandis que la jeune femme (Nico, la chanteuse) peine à le suivre ou ne peut même marcher ? Et pour quelle épreuve vaut cette vaine traversée d’un paysage vain, d’une terre vaine, d’un wasteland ? On est en droit de songer à une anecdote que Borges extrait d’une biographie de Kierkegaard : ” Les curés danois auraient déclaré en chaire que participer à des expéditions [au pôle Nord] est utile au salut éternel de l’âme. Ils auraient toutefois admis qu’il est difficile de parvenir au Pôle, peut-être impossible, et que tous ne peuvent pas se risquer à l’aventure. Finalement, ils auraient annoncé que n’importe quel voyage, par exemple du Danemark à Londres sur le bateau régulier, ou une promenade en fiacre, sont, considérés comme il faut, de véritables expéditions au Pôle Nord[1313][1313] Borges, “Les Précurseurs de Kafka”, Enquêtes, op. cit., p. 149..” Marcher dans le sable de la Californie, surtout si, comme dans le film de Garrel, il semble être possédé de l’intérieur par des reflets de lumière qui le transforment en glace, marcher veut-il signifier une quête spirituelle ? Que peut donc chercher ce garçon qui n’avance vers rien (au plan précédent, il tournait longuement autour de la femme, la caméra le suivait en panoramique incessant, bien davantage que 360°) ? Pour moi, il cherche évidemment d’abord à perdre toute mémoire, puisque c’est sur le fondement de cette perte que pourra advenir toute une alchimie d’images (la suite du film – La Cicatrice intérieure -, tournée en grande partie dans des paysages terribles de l’Islande, est un récit des origines qui déplace en territoire viking les mythologies chrétiennes).
Peut-être commencez-vous à trouver que je trace, de la postérité des ruines effrayantes du film de Cocteau, un portrait abstrait, anhistorique. L’impossible pensée d’Hiroshima, d’Auschwitz, n’aurait-elle produit que cette fuite dans la réflexion la plus abstraite sur le temps, sur l’être, sur le réel, aurait-elle contraint à parler si abstraitement de la mémoire ? Je voudrais donc corriger ce sentiment, par cette simple remarque, que le cinéma n’a pas besoin de parler des événements pour en parler. Il lui suffit d’en montrer la trace visible : soient les ruines, qu’est-ce qui les cause sinon la guerre ? Et la guerre induit-elle autre chose que l’errance ? Ou pour le dire autrement, le film de Garrel parle-t-il d’autre chose que ceci ?
[Projection de Quelque part en Europe : la constitution du groupe d’enfants errants, au début du film – de 10 à 15 mn]
Avec ce film, réalisé en 1948 par le Hongrois Géza Radvanyi – et notamment, comme scénariste-dialoguiste, Béla Balázs -, on est aux antipodes du film de Garrel. La présence, voulue documentaire, aux évènements “historiques” eux-mêmes, est aussi grande que possible ; l’errance n’est plus psychique ni métaphysique mais l’une des conséquences les plus matérielles de la guerre ; et si l’on marche sur ces routes poudreuses, c’est que les villes sont dévastées, ne sont plus que ruines. Le film est, selon mon opinion, fort mauvais, généralement pavé de bonnes et lourdes intentions, qui informent toute sa seconde partie (la “réhabilitation”, attendue et programmée, des jeunes voyous) ; c’est probablement à ce titre des bonnes intentions, et aussi de la supposée valeur documentaire de quelques-uns de ses plans, qu’il a eu dans toute l’Europe, autour de 1950, une sorte de prestige de film d’art historique-politique, à l’égal des Rossellini par exemple (bien sûr, vous auriez préféré revoir Allemagne année zéro, le petit Edmund dans les ruines de Berlin : j’ai supposé que ces images étaient, ce soir, dans votre mémoire). Du film de Radvanyi, je vous ai montré la partie la moins pavée, celle où les chemins sont pleins de poussière, où se constitue, par agrégations successives, cette espèce de caravane de pionniers d’une drôle de “nouvelle frontière”. M’y intéresse principalement la traversée du désert, métaphore grossière mais assez puissante, qui m’apparaît comme l’une des variantes, ou mieux, l’une des sources de l’image inhumaine que je vous présente ce soir : la traversée des ruines.
Quelque part en Europe est contemporain d’Orphée, comme Stalker l’est de la Cicatrice intérieure, et vous sentez combien le cinéma, en un quart de siècle, a exploré sa difficulté à parler de l’histoire, sur le mode de ce qui paraît une fuite.
3.
Ici – et le premier titre sous lequel était annoncé cette conférence (“Le brouillard, la nuit”) l’avait promis – il faudrait parler plus directement des camps, et aussi de la mémoire et du mémorial, ce que, vous le voyez, j’ai choisi de ne faire qu’indirectement ou tangentiellement, ne serait-ce que parce qu’il m’aurait été impossible de jamais montrer une seule image de camp de concentration (s’il n’y a plus d’œuvre d’art – ou de grand art ? – possible après Auschwitz, selon la forte expression d’Adorno, toutes les images du cinéma sont frappées de fausseté, même celles de Resnais ; les seules vraies images seraient peut-être celles de Samuel Fuller dans son reportage en 16 mm). Dans l’histoire du monde, les camps sont ce qui mettent la mémoire en péril, parce que l’ “effort de mémoire”[1414][1414] “Effort de mémoire” fait évidemment allusion à Dionys Mascolo commentant Robert Antelme. qu’il a fallu faire a toujours été trop violent, presque inhumain lui-même. Nuit et brouillard de la mémoire, auquel a participé le cinéma aussi, en produisant les figures qui permettront de ne pas avoir de mémoire. Pour aller vite, je cite encore Giorgio Agamben (dans un petit texte intitulé Collants Dim, et qui n’est pas sans répondant dans le film Tout va bien, de Godard et Gorin) : “Ainsi, le corps glorieux de la publicité est devenu le masque derrière lequel le corps humain fragile, menu, continue son existence précaire, et la splendeur géométrique des girls couvre les longues files des corps nus anonymes menés à la mort dans les camps ou les milliers de cadavres martyrisés par les carnages quotidiens sur les autoroutes[1515][1515] Agamben, La Communauté qui vient, Ed. du Seuil, 1990, p. 54..” Pour un Godard, qui filme les morts de la route dans Week-end, combien de nouveaux Busby Berkeley (auquel peut-être Agamben ne pensait pas spécialement, mais qu’il évoque) ? Les camps, c’est ce dont on ne veut pas se souvenir – et le cinéma depuis le Nazisme au moins est complice de cet oubli comme il l’a été des camps ; je semble peut-être répéter trop uniment une des leçons des Histoires du cinéma de J.L.G., mais elle est incontestable, et les Nazis eux-mêmes savaient qu’il ne faisaient autre chose que du cinéma[1616][1616] Voir la description par Goebbels de l’enterrement d’un Hitlerjunge, comme une succession d’images de film : “Dans le giron maternel de la terre. Une image fantastique dans le brouillard gris et nocturne de la grande ville, Etc.”, K. Kreimeier, Une histoire du cinéma allemand : la Ufa, tr. fr., Flammarion, 1994, p. 309.. La zone d’Orphée, c’est donc en quelque sorte le no man’s land où la mémoire est conservée (et d’où, entre autres, elle a pu se déplacer, se reprendre, se retrouver dans d’autres films) – mais conservée sous une forme possible au cinéma à partir du moment où le document brut avait été refoulé.
Voici comment, en 1970 encore, un autre auteur du cinéma d’art filme la guerre :
[Projection de L 182 (Une passion) : séquence du rêve d’Anna – de 1h10 à 1h13]
Cette séquence, dont vous aurez immédiatement identifié l’auteur parce qu’elle rassemble certains des thèmes narratifs et iconographiques de ses derniers grands films en noir-et-blanc, est censée figurer un rêve, et cela bien sûr n’est pas indifférent : comme s’il était certaines choses que le cinéma ne peut figurer que comme cauchemar. Le “travail” de ce rêve, au sens que Freud nous a appris à donner à ce mot, est exemplaire, sans doute excessivement, un peu comme une étude appliquée (au double sens) de la Traumdeutung. Déplacements, condensations, y abondent, mais cette logique trop démonstrative ne laisse pas d’être signifiante. Le déplacement majeur est celui qui fait se croiser le destin individuel d’Anna – elle revit à la fin du rêve l’accident qui a coûté la vie à son mari Andreas et à son enfant – et un destin plus anonyme, celui de ces femmes qui s’entassent dans une barque à la dérive, et que l’on retrouve (sont-ce les mêmes ? en tout cas, c’est le même anonymat) dans la scène de l’incendie et du repentir. Perdre un enfant, un homme aimé, c’est comme la guerre : l’affect est le même, et c’est pourquoi l’incendie et la femme prostrée dans sa haine qui attend, assise, l’exécution de son enfant, sont, cette fois, une énorme condensation ; l’on y sent moins pourtant le poids d’un mythe christique (l’inévitable figure de Pietà de la mère en noir) que l’écho de situations historiques, le fils résistant tué pour cela, et la présence presque physique des bombardements ; le feu qui apparaît d’abord sous la forme d’un modeste feu de bûches, peut-être juste pour se chauffer, devient soudain (et en deux temps : à l’image, puis sur la bande-son, avec l’irruption sonore du bruit des flammes) un gigantesque brasier, dégageant une fumée noire. Anna pourra alors prendre la couleur de cette fumée, pour porter par avance le deuil de ses amours et le deuil du monde : tout est ravagé.
Entre ces deux évènements, la barque des émigrées d’une part, la vie ruinée par les bombes d’autre part, prend place la marche sur le chemin, dont tout le dialogue est à double ou triple entente. “On ne peut plus recevoir les étrangers.” “On a changé les serrures” (mais les clefs sont bien là, a-t-on envie d’ajouter). “Je ne sais pas où je suis.” Brouillage de la mémoire, comme si Anna était devenue quelqu’un d’autre, sans souvenirs. Bien sûr, dans l’ensemble du film, cette perte de mémoire vaut aussi pour mensonge : le personnage ment, tous les personnages mentent ; le film d’ailleurs est une théorie du personnage de film comme menteur et comme mensonge. Mais plus encore, c’est une perte de mémoire généralisée, qui atteint tout le film. Il n’y a plus de mémoire précise, seulement une mémoire générique, comme celle des atroces boîtes grises où le photographe enferme, sous des noms de codes chiffrés (comme celui qui donne son titre au film, L 182), les restes mortels et photographiques de ceux qui ont disparu – idée bête, comme souvent chez Bergman, mais visualisation puissante dans la concentration carcérale du gris des boîtes. La séquence du rêve enchaîne sur une autre, où l’on apprend comment Johan, le berger solitaire, a été contraint au suicide par une foule fasciste, qui l’a humilié et traité en sous-homme. Ces sévices parachèvent le tableau du rêve : malgré l’image du Viêt-Nam citée encore une fois par Bergman dans une scène antérieure, c’est bien le lager qui est figuré.
4.
Le cinéma tout entier est ou a été Orphée, cherchant à ramener quelque chose, ou quelqu’un, de la mort. C’est le thème d’un compte rendu, souvent cité, de la première soirée du Salon Indien : “On recueillait déjà et l’on reproduisait la parole, on recueille maintenant et l’on reproduit la vie. […] Lorsque ces appareils seront livrés au public […] la mort cessera d’être absolue[1717][1717] Article paru dans Le Radical, cité in Lo Duca et M. Bessy, Lumière l’inventeur, Prisma, 1948, p. 47..” Mais le cinématographe n’a rien sauvé de la mort. Avec toutes ses vertus esthétiques, immenses, avec son pouvoir d’inventer des figures invues, il a donné la vie à quelques grandes formes ou incarné quelques grands principes de l’image – le mécanique, l’animal, le lumineux, le disséminé, le fragmenté; etc. – mais il n’a rien ou presque rien sauvé d’historique. Le paradoxe est que c’est dans une autre voie, touchant davantage à la magie, que ce sauvetage a eu lieu.
La ruine est la destruction rendue visible de la mémoire, comme l’avait reconnu Freud en prenant au contraire pour métaphore de la vie psychique, laquelle ne perd, n’efface, n’oublie jamais rien, la conservation éternelle des monuments – comme si, dit-il, “à la place du Palazzo Caffarelli, que l’on ne serait pourtant pas obligé de détruire pour cela, s’élev[ait] de nouveau le temple de Jupiter Capitolin, et non seulement sous sa forme définitive, celle que complétèrent les Romains de l’Empire, mais aussi sous sa forme étrusque primitive“[1818][1818] Sigmund Freud, Malaise dans la civilisation (1929), tr. fr., PUF, 1971, p. 13..
La fin de l’histoire, c’est donc le cinéma devenu mémoire-du-siècle (pour reprendre l’un des clichés les plus accablants dont abonde cette accablante année du centenaire) – mais aussi et surtout, le cinéma devenu mémoire de lui-même.
En 1989, Jean-Luc Godard tourne un film de huit minutes, l’Enfance de l’art. La guerre y est représentée mais non située. Les bâtiments en ruines ne sont aucune ville particulière, aucune des villes où il y a la guerre ; l’affrontement est encore déréalisé par la bande-son, avec ses rafales d’armes automatiques et ses sifflements d’obus (on pense au travail dans le même sens d’un hyperréalisme sonore, dans Les Carabiniers) ; l’un des deux personnages d’adultes, l’homme au bazooka, avec sa mèche romantique, pourrait être un héros des barricades de 1848, auxquelles fait allusion le texte de Victor Hugo qui est lu. Pourtant – comme dans Les Carabiniers, justement – cette représentation voulue générique de la guerre (civile, étrangère ?) est bien notre contemporaine, on y reconnaît sans peine Beyrouth, Sarajevo, la Palestine de l’intifada.
Comme cela a déjà été remarqué ailleurs (par Alain Bergala)[1919][1919] Cahiers du cinéma, N° Spécial, Godard, trente ans depuis, 1991, p. 129., bien des traits de ce film évoquent aussi avec insistance l’épisode florentin de Paisà ; j’ajoute pour ma part que dans cet épisode du film de Rossellini, on a plus qu’un vague écho de la quête orphique, puisque c’est l’histoire d’un homme à la recherche de son épouse peut-être morte, et qui traverse alternativement des ruines et des monuments miraculeusement conservés. Dans Paisà, pourtant tourné en 1946, les personnages n’avaient pas encore le temps de réaliser l’ampleur des dégâts de la guerre, qui étaient encore trop frais : on traversait les ruines mais sans y prendre garde, on ne faisait que passer, comme on ne faisait que passer dans ces témoins du passé plus lointain que sont les monuments. Dans le petit film de Godard, on est dans les ruines avec l’air d’y être pour toujours ; ces ruines-là ne sont pas faites pour être traversées mais pour qu’on s’y installe : la jeune femme, les jeunes hommes peuvent bien courir, ils n’iront nulle part, c’est un cul-de-sac définitif.
La clef de ce lieu, elle est donnée par l’enfant. Je dis “l’enfant”, au singulier, parce qu’il n’y en a manifestement qu’un seul, qui passe son temps à se dédoubler (dans l’image filmée tête-bêche comme une carte à jouer) ou à permuter avec lui-même (dans l’image où il joue au ballon en deux endroits à la fois) – même s’il y a deux acteurs. L’enfant est évidemment installé dans les ruines, dans la zone, il y a toujours vécu (c’est presque le message explicite du film, qui est – ne l’oublions pas – un film militant) : c’est le petit frère du vitrier adolescent qui hante la zone dans Orphée. En même temps, il connaît toutes les affaires de violence du siècle, depuis la guerre justement jusqu’au football (le shoot dans le ballon en gros plan, avec son de fusillade, est à monter forcément avec les plans du “Heysel” dans Soigne ta droite).
C’est encore une zone, un endroit ruiné, mais cette fois, elle ne se traverse plus, parce qu’elle n’est ni une image de la mémoire à perdre ou à conquérir, ni une image de cauchemar mais la remontée telles quelles des images de guerre contemporaines de la guerre. La traversée des ruines s’arrête ici, non pas parce qu’il n’y a plus de ruines mais parce que la traversée de l’histoire et de la mémoire se figure autrement : juste avant et juste après ce film, Godard réalise ses Histoires du cinéma.
[Projection de Godard : L’Enfance de l’art]
Images : Orphée (Jean Cocteau, 1950) / Stalker (Andreï Tarkovski, 1979) / La Cicatrice intérieure (Philippe Garrel, 1972) / Quelque part en Europe (Géza Radvanyi, 1948) / Une passion (Ingmar Bergman, 1969) / Paisà (Roberto Rossellini, 1946) / L'Enfance de l'art (Jean-Luc Godard, 1989).
Nous remercions amicalement Jacques Aumont de nous avoir confié cet article.