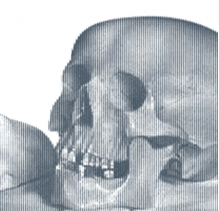La Montagne, Thomas Salvador
Mille-Pierre
La Montagne c’est avant tout une promesse. Celle de substituer au quotidien aseptisé une aventure intrépide. Une irrépressible pulsion pousse Pierre (Thomas Salvador), après un exposé commercial au pied du Mont Blanc, à prolonger son séjour. Ingénieur, il est venu présenter un bras robotique notamment capable de reproduire une trajectoire effectuée à vide. Le mouvement que lui a indiqué la main humaine s’inscrit dans sa mémoire, et il ne lui reste plus qu’à tournoyer. Mais le regard de Pierre s’absente, se perd à contempler par la fenêtre des hauteurs plus attrayantes que les espaces modernes et ternes qu’il traverse (cuisine, train, hôtel, salle de réunion). Les sommets enneigés fonctionnent comme un point d’attraction au coin du cadre, une lueur qui le happe doucement. Avec une grande fluidité, les premières séquences du film énoncent son programme : s’éloigner, sans trop savoir pourquoi, des sentiers battus. S’il s’inscrit parfaitement dans cet environnement froid, avec sa grande silhouette imperturbable, son sourire discret et son air propret, Pierre se laisse tenter par une excursion alpine qui ne cessera de le dépasser.
« Je résiste pas », souffle-t-il à ses collègues en partance pour le train. Mais la parenthèse skiée qu’il s’accorde se transforme peu à peu en idée fixe. Arrimé à cette nouvelle lubie, il se fait porter malade et part, équipé de matériel de spécialiste, poser son campement dans la poudreuse, sur des plateaux que seuls quelques téméraires explorent. Si cette nouvelle vie de montagnard est une réelle respiration en miroir de sa routine de mécanique et de PowerPoint, le film nous fait la gageure de rapidement dépasser le postulat de la crise existentielle d’un cadre venu recharger ses batteries. À l’image de l’absence d’explication rationnelle qu’il offre à frères (Laurent Poitrenaux et Andranic Manet) et mère (Martine Chevallier), venus le ramener à la raison et à la maison. L’envie de disparaître ou d’être hors d’atteinte est transcendée par une attraction invisible, que le changement de dimension ne semble pas avoir rassasiée. C’est cet appétit discret, auquel l’interprétation de Thomas Salvador donne tout son relief, qui hypnotise le spectateur, dans un mouvement parallèle à la fascination opérée sur le personnage par la montagne. Cette expérience à l’unisson dessine un véritable éloge de l’attention, où il s’agit d’être réceptif aux signaux qui pourraient advenir dans les moindres recoins du cadre.
Or, cet exil se déploie aussi comme un circuit tout tracé, car explorer un tel territoire requiert un minimum de préparation. Pierre fait d’ailleurs appel, dans un premier temps, à un guide de montagne. Ce dernier est son premier rideau de protection, un éclaireur qui prévient des chutes, le dirige sur son itinéraire. Avant de se lancer dans des péripéties plus picaresques, et ainsi se défaire des bornes et autres passages obligés, il faut mettre sa sécurité et ses rêves entre les mains d’une personne plus compétente. Ces moments avec les guides et les autres alpinistes ne restreignent pas l’aventure entre neige et ciel qu’il s’est imaginé, car c’est aussi la leur qui prend vie à travers lui. La beauté du premier temps du film se niche dans ce nouvel air, ce monochrome blanc irradiant, ces plaines enneigées qui emplissent le cadre. Par cette incitation permanente à accroître nos sens, à rester sur nos gardes d’un sentier à un autre, notre attention est toujours plus exacerbée, car ne sachant quand elle sera pleinement satisfaite.
Avec son air de ne pas y toucher, Pierre/Thomas fait ressurgir le souvenir de la grande figure alpine et obsessionnelle du cinéma français, à savoir Luc Moullet, « l’homme des roubines ». Sans doute moins disruptif, bavard et jusqu’au boutiste que son prédécesseur, Pierre va néanmoins s’accrocher coûte que coûte à son nouveau fief. Non pour ratisser en long en large et en travers le secteur, comme Moullet a pu le faire de Terres noires à La Terre de la folie, mais pour, au nom de cette imperceptible force qui l’a attiré en ces lieux, ne plus jamais quitter sa vigie. Avec son gardien de phare scrutant chaque événement rocailleux, La Montagne révèle une vertigineuse politique de l’impossible descente. Son héros, loin de tout immobilisme ou rejet de la civilisation, s’y refuse, ne serait-ce que pour poster une carte postale ou faire quelques courses, missions qu’il confie à Léa (Louise Bourgoin), cheffe du restaurant en altitude. Son désir de se confronter au danger prend constamment le pas. Une menace qui se manifeste lors d’une avalanche due à la fonte des neiges, impulsion qui pousse Pierre à prendre d’assaut le versant. Peu importe la chute, physique et géographique, qui le contraint à être ramené à la ville en hélicoptère, il faut toujours repartir. Ce goût du franchissement et du départ permanent fait toute la qualité de La Montagne, qui s’astreint à ne pas trahir la hauteur conquise, à s’y maintenir car elle est la condition même de son existence.
Par une triple mise en danger corporelle, celle de l’acteur, du personnage et du réalisateur, la démarche de Thomas Salvador s’apparente à celle des cinéastes acteurs du burlesque, de Buster Keaton à Jerry Lewis. Une prise de risque qui, après les exploits aquatiques de Vincent n’a pas d’écailles, a de quoi détonner dans le paysage du cinéma français, surtout que celle-ci n’a de cesse de s’intensifier. Une fois la couche de neige évanouie, il n’est plus question de marcher sur un sol feutré mais de se confronter au roc. C’est le revers de cette démarche obsessionnelle : voir son corps possiblement céder, se replier jusqu’à la désintégration. À force d’escalader avec témérité, l’apprenti grimpeur touche du doigt la pierre mise à nu. L’infirmière qui le recueille après son rapatriement lui explique ce qui a provoqué l’avalanche : la montagne est semblable à un mille-feuille qui ne tient que par la glace, son ciment. Quand celle-ci fond, l’édifice est forcément plus fragile. C’est désormais un mille-pierre que nous avons sous les yeux, rencontre frontale avec les désirs sous-jacents qui habitent le bien nommé Pierre.
Sur les lieux de l’effondrement, il fait la découverte d’un nouveau point de fixation, d’une lueur qui parachève sa quête de spectateur. Cette chose, si elle est à l’opposé de la monumentalité des paysages arpentés, irradie de son improbabilité. Ces limaces de magma ou roches mouvantes fascinent par leur irréalité, impression accentuée par la distension de nos sens effectuée par le film. Mais elles renvoient également, par leur allure de papier cadeau métallisé, à un aspect plus prosaïque. Au plus profond du massif se loge donc un spectacle intime, qui par contraste nous fait passer du jour blanc à la nuit rouge. Mais Pierre, devenu incandescent au contact de ces étranges créatures rocheuses, ne peut rester indéfiniment un observateur passif. Lorsqu’il pénètre la couche glacière, il passe une forme d’échographie qui le révèle en aurore boréale, le laisse éclater en une multitude de faisceaux lumineux. Il devient la forme même du merveilleux, non pas grâce à ses talents de survivaliste, mais par son inépuisable et patiente curiosité. N’ayant plus comme devenir que le mouvement, il s’incorpore à cette chorégraphie de fluides ébaubissant.
L’autre possible écueil de cette trajectoire solitaire, qui innerve tout le long-métrage mais prend corps dans les dernières séquences, c’est celui de voir l’échappée se muer en volonté de s’ostraciser. Pierre n’accomplit pas seulement une traversée minérale lewisienne, celle-ci est aussi temporelle. C’est à travers une ellipse que nous saute aux yeux le gouffre dans lequel il a chuté, les nombreux jours qui se sont écoulés. Cet onanisme, ou du moins cet enivrement rocailleux est déjoué par un autre besoin compulsif. Ce trip sensoriel n’a de raison d’exister que s’il se transmet, et pas simplement au spectateur, qui ne sait tout à fait s’il observe depuis l’intérieur de la roche ou à travers la paroi d’un aquarium. C’est donc la voix de Léa, inquiète de cette absence qui s’éternise, qui arrache l’ingénieur à son sommeil tantrique, l’extirpe nu comme un ver de la glace. Une fois les êtres de lumières, cailloux qui peuvent évoquer la bienveillance de certaines créations miyazakiennes (les boules de suie du Voyage de Chihiro ou les esprits de la forêt de Princesse Mononoké), ayant aidé la montagne à le régurgiter, Léa le ramène du côté de la chair et des vivants. Ce souvenir de l’éblouissement, visible à travers son bras luminescent, Pierre le lui partage. Dans une étreinte subjuguante de délicatesse, où le don acquis en songe dessine sur leurs peaux de splendides cartographies étoilées, l’expérience de reclus cède le pas à un ballet conjoint.
Le soin qui nous aura été accordé tout au long du film, afin d’appréhender patiemment ce nouvel espace au romanesque et au fantastique démesurés, reste le même une fois les pieds sur terre. Quand on est monté si haut, il faut profiter de la douce adrénaline de la redescente. Refouler le sol, passer sa main dans les hautes herbes, cet autre régime de sensations tout aussi euphorisant. Avec en soi l’excitation secrète de gravir de nouveaux sommets, ou de retrouver ceux qui nous ont enivrés.
Scénario : Thomas Salvador, Naïla Guiguet / Image : Alexis Kavyrchine / Son : Yolande Decarsin, Benoît Hillebrant, Olivier Dô Hùu / Montage : Mathilde Muyard
Durée : 1h52.
Sortie le 1er février 2023.