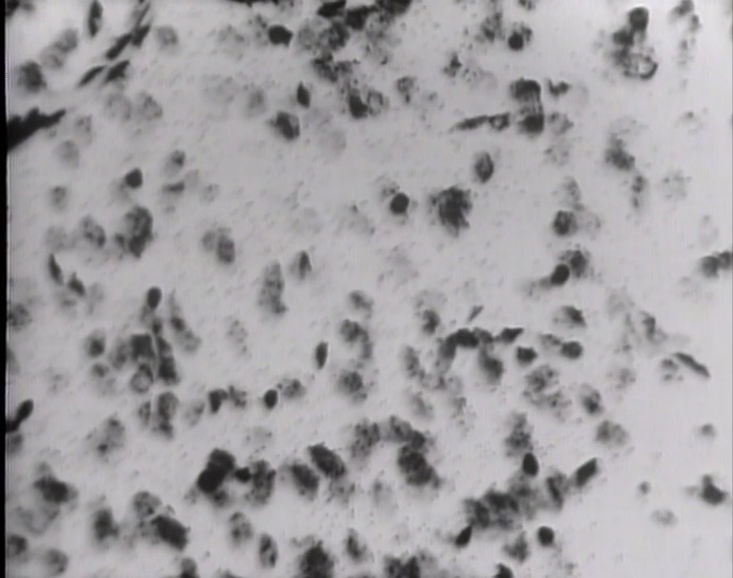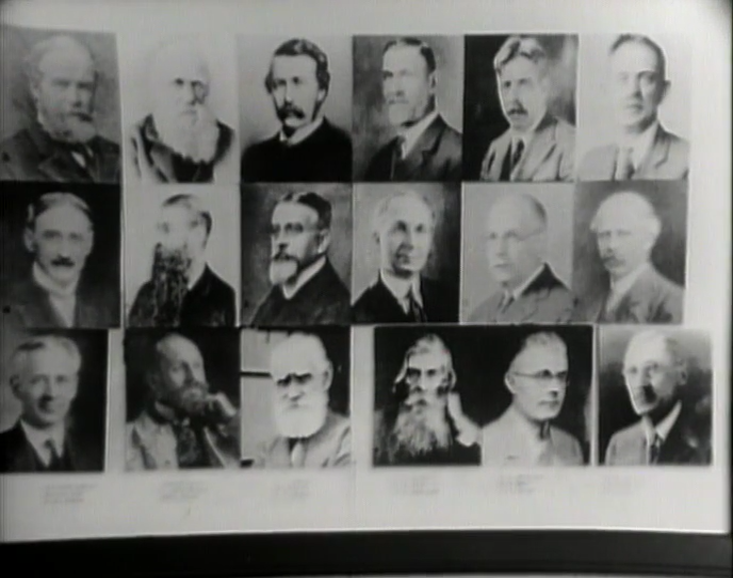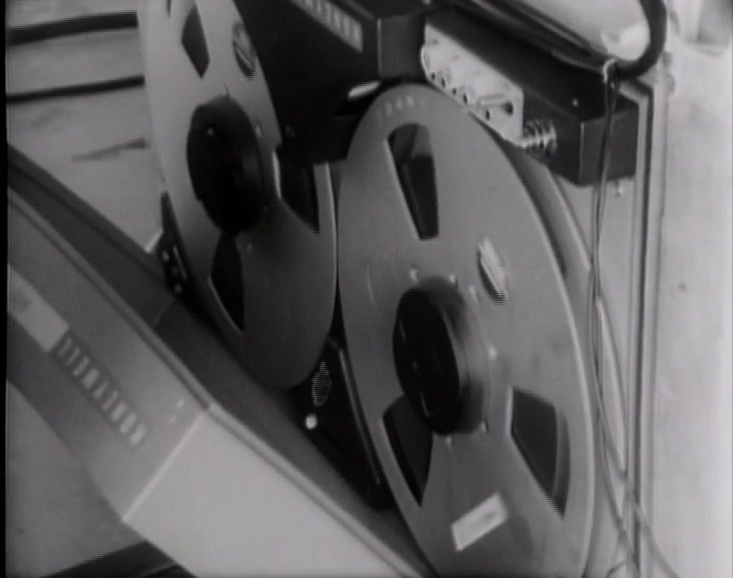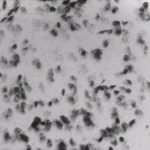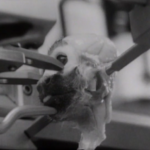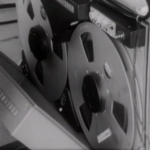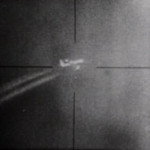Le cinéma, invention de grands singes
Dans Primate (1974), sans plus de commentaire que les discussions entre savants et les tumultes variés des animaux, Frederick Wiseman filme les pratiques du centre régional de recherche sur les primates Yerkes, rattaché à l’université Emory d’Atlanta[11][11] Le centre Yerkes a été fondé en 1930 à Orange Park (Floride), en association avec l’université de Yale, par le psychologue comparatiste Robert Yerkes.. On rencontrera des chimpanzés, mais aussi d’autres espèces : orangs-outans, gorilles, et des singes plus petits (macaques, capucins). Ils s’appellent John, Bert, Flora ou Rebecca. La plupart des scènes montrent la douloureuse – et parfois insupportable – réalité des expérimentations menées sur les singes. Le directeur Geoffrey Bourne comptait sur le film pour faire connaître ses travaux et attirer les investisseurs et les mécènes : le résultat fut tout à l’opposé.
C’est que la réception du film – et sans doute encore plus aujourd’hui avec le péril écologique, la déforestation, la reconnaissance de la condition animale, l’extinction annoncée de nombreuses espèces – a, en grande partie, échappé aux intentions de Wiseman, pour lequel Primate n’a rien d’un documentaire militant contre la vivisection. Le ton n’est jamais dénonciateur ni ne joue délibérément sur la corde lacrymale. Le cinéaste est très clair – du moins a posteriori : « L’essentiel n’est pas de faire du “sentiment” avec l’expérimentation des pauvres animaux, l’essentiel est simplement d’observer les savants d’aussi près qu’eux-mêmes en observant les singes. Le sujet est en fait non seulement l’institution de la recherche scientifique, mais le modèle social que reflète cette institution et les individus qui l’animent[22][22] Frederick Wiseman, « Propos », recueillis par Yves-André Delubac., Positif, n° 190, février 1977. p. 25.. »
Scruter les savants d’aussi près qu’ils interviennent sur les animaux. C’est-à-dire comme les singes les voient. Primate est « une étude du comportement humain dans un milieu scientifique[33][33] Alice Leroy, « Spécimen, cobaye et viande : l’animal selon Wiseman », Images documentaires, vol. 1, n° 84, 2015, p. 43. » : compétitivité, désir de reconnaissance, espoirs et déceptions en tout genre. Pas d’accusation : elle est toujours le fait de l’homme. J’aurai l’occasion d’y revenir plus amplement par la suite : il s’agit avant tout de ne pas singer le singe ni de se prendre pour un homme (ainsi que le fait l’un des assistants lorsqu’il montre à un orang-outan, rasé comme la peau humaine est nue, comment utiliser un trapèze de gymnastique). Ce petit texte y trouve son hypothèse principale : avec Primate, nous allons voir que faire du cinéma, c’est témoigner de ce que nous n’avons inventé le cinéma que pour la raison que nous sommes des grands singes et à des fins animales[44][44] En écho, cf. Giorgio Agamben, Image et mémoire, « Le cinéma de Guy Debord », trad. fr. Gilles A. Tiberghien, Paris, Hoëbeke, coll. « Arts & esthétique », 1998, p. 66 : « L’homme est un animal qui s’intéresse aux images une fois qu’il les a reconnues en tant que telles. C’est pour cela qu’il s’intéresse à la peinture et va au cinéma. Une définition de l’homme de notre point de vue spécifique pourrait être que l’homme est l’animal qui va au cinéma. ».
Primate est un film sur la fabrication des faits scientifiques – puisque rien ne nous est donné sans passer par le prisme de notre regard théorique, y compris les êtres naturels (la nature et la culture ne sont pas séparées : la distinction entre culture et nature ne passe pas entre la culture et la nature mais dans la nature et dans la culture) –, sur « la structure de l’observation[55][55] Donna J. Haraway, Primate Visions. Gender, Race, and Nature in the World of Modern Science, New York/Londres, Routledge, 1989, p. 117. Toutes les traductions sont de l’auteur. » et l’inscription d’une telle ingénierie du vivant parmi les autres ingénieries contemporaines de l’organisation sociale. Si ulcération devant les pratiques des savants il y a, elle ne saurait être tout au plus – dans l’esprit de Wiseman – qu’un effet collatéral induit.
Dont acte ? Sans aller jusqu’à faire du film ce qu’il n’est pas (mais un film peut évidemment devenir tout à fait autre chose que ce qu’en a prévu son signataire), un autre regard sur le film est possible, qui en dégagera un sens latent, virtuel et camouflé, qui n’est en mesure de précipiter que dans des conditions bien spécifiques : c’est le propre des grandes œuvres que de voir leur richesse à chaque fois partiellement actualisée et accrue par les temps postérieurs. Comme le voulait William James, analyser un texte, ou ici un film, ce n’est pas revenir au présent de sa production (« se présenter à lui[66][66] J’emprunte cette formule et celles qui suivent à Thierry Drumm, « Le réticulaire et le tentaculaire », in Isabelle Stengers et Thierry Drumm, Une autre science est possible ! [2013], Paris, La Découverte, 2017, coll. « Poche sciences », p. 147-148. »), ni non plus le tirer vers le seul présent de sa réception (« le présenter à nous ») – ce qui n’est jamais que remplacer le contexte de l’œuvre par le nôtre – mais c’est construire le contexte de la relation entre l’œuvre et le spectateur : « Non pas : que pensait l’auteur ? ni : que pensons-nous ? Mais : que fait-il penser ? » Regarder un film n’est rien qui serait du rapport d’un sujet percevant à un objet perçu, extérieurs l’un à l’autre, mais relève de l’expérience d’une relation ; cette relation, ce sont les images elles-mêmes, et rien d’autre. Drumm – suivant James – écrit encore très justement qu’une « philosophie des circonstances concrètes » (toute œuvre est située par rapport à un dehors), relevant de l’érudition, ne doit pas empêcher une « philosophie de la “permission” », qui seule garantit l’exercice de la pensée.
Ces pages iront un peu plus loin en proposant que ce circuit de percepts est, avant toute autre modulation, intrinsèque au film lui-même : les objets sont les premiers centres de perception sur eux-mêmes (même si nous ne pouvons que tout en ignorer). Le film, apte à se sentir lui-même[77][77] Sur ce que j’entends par perception des images, je renvoie à Jean-Michel Durafour, Cinéma et cristaux. Traité d’éconologie, Sesto San Giovanni Mimésis, coll. « Images, médiums », 2018., infléchit les orientations intellectuelles voulues par le cinéaste : si la réception a fini par insister sur une autre manière de voir Primate, non plus accommodée sur l’institution de la recherche scientifique mais sur le traitement réservé aux animaux de laboratoire, c’est que ce sens est bel et bien présent dans le film, par le film. En laissant traîner d’autres images dans celles voulues par un homme (Wiseman), Primate exhibe une particularité de l’image photographique (en regard du dessin ou de la peinture) : peut toujours s’inviter dans l’image ce que nous n’avions pas désir d’y mettre. Dans En lisant, en écrivant, Julien Gracq avait souligné cette « singularité du monde brusquement captée qui émerge seule, étrangère et toute puissante[88][88] Julien Gracq, En lisant, en écrivant, Paris, José Corti, 1980, p. 234. », à l’œuvre dans le cinéma ou la photographie. Cinéma et animaux partagent ici une même communauté sensible : on verra comment.
Autre remarque : on s’éloignera donc de l’homme, pour y mieux revenir. Parler du film à partir des singes, c’est parler avec Haraway du centre Yerkes comme « appareil de production du corps primate textualisé[99][99] Haraway, Primate Visions, op. cit., p. 117, et citations suivantes. » : les machines et les implants transforment les singes en « cyborgs », en êtres « techno-organiques » ; la nature à laquelle nous avons affaire n’est qu’un « artefact culturel », dont les enjeux sont ici la reproduction et la communication (les deux postes principaux de la recherche scientifique) ; la jungle (d’où les singes proviennent) et l’espace (où ils sont envoyés à la fin du film) sont à titre égal « la condition de l’ordre des Primates dans les dernières décennies du second millénaire ». Haraway d’ajouter : « À travers l’objectif de Wiseman, la primatologie parle des choses premières et des choses dernières. » La référence à Humain, trop humain de Nietzsche est ici explicite.
Je ne me lancerai pas dans l’exercice qui consiste à répéter ce que d’autres ont dit mieux que moi en m’attachant exclusivement à la dimension « sociologique » (j’emploie ce mot faute de mieux) du travail de Wiseman : en l’occurrence, les rapports sociaux aux États-Unis, qui plus est inscrits dans un environnement historique déterminé (expériences sur l’insémination artificielle/droit à l’avortement, envol d’un chimpanzé en apesanteur/programme de recherche spatiale/guerre du Vietnam, etc.). Cette question traverse toute la filmographie de Wiseman et permet d’y consigner Primate comme un élément (certes singulier) d’un ensemble plus vaste, chaque film déclinant dans une direction particulière (hôpital, mannequinat, commerce de la viande, tribunaux, université, etc.) les ramifications en étoile de mer d’une idée germinale. Va plutôt m’intéresser une manière d’envisager Primate comme un « singleton » : un ensemble à un seul élément non rattachable à d’autres. C’est également à ce titre que la question de la réception – c’est-à-dire de la forme – du film est intervenue tout à l’heure. Elle nous conduira à formuler un certain nombre d’hypothèses sur l’homme comme primate dénaturé et sur le cinéma comme invention de grands singes. C’est peut-être un reste à penser – ses commentateurs lui font dire généralement tout autre chose – de la fameuse phrase de Wiseman : « Primate est un documentaire de science-fiction[1010][1010] Frederick Wiseman, cité in Barry Keith Grant, Voyages of Discovery.The Cinema of Frederick Wiseman, Urbana/Chicago, University of Illinois Press, 1992, p. 119.. »
*
Pan (Oken, 1816) : espèce africaine de singes de la famille des Hominidae – à l’instar de l’être humain – composée du chimpanzé commun (Pan troglodytes) et du chimpanzé nain ou bonobo (Pan paniscus). Les chimpanzés présentent des caractéristiques physiologiques, émotionnelles et mentales, mais aussi des comportements sociaux voire moraux, particulièrement remarquables dans leurs ressemblances et leurs écarts avec ceux des êtres humains. Robert Yerkes a fondé son concept de « génie anthropoïde » et écrit Presque humain en 1925 à partir de l’étude d’un jeune bonobo qu’il avait pris pour un chimpanzé plus empathique (le bonobo fut seulement identifié en 1929).
Pan : divinité grecque de la nature représentée sous les traits d’une créature mi-homme mi-bouc. Pan appartient au cortège de Dionysos, dieu de l’ivresse, de la démesure et des excès. C’est en l’honneur de Dionysos (les mystères d’Éleusis) que les anciens Grecs ont inventé la tragédie, littéralement « le chant du bouc ». Par l’homme, les singes de Pan sont voués à un sort d’autant plus tragique, d’autant plus panique, que les dieux ont techniquement déserté le monde. Si le « dionysiaque » nietzschéen glorifie la souffrance, il s’agit de celle qui fait partie de la vie, le revers de la joie dans « la grande sympathie panthéiste » (La Naissance de la tragédie) : la souffrance des singes au centre Yerkes est tragique parce qu’elle n’a plus rien de dionysiaque.
pan- : « tout » en grec ancien. Il sert notamment de préfixe pour nommer les théories dans lesquelles l’univers (ou telle de ses régions) est tenu pour une vaste unité où ce qui est pensé est envisagé à l’aune de la même propriété définitionnelle – vie, beauté, etc. : panthéisme, pancalisme, panafricanisme. On le rencontre également dans le panoptique ou le panorama. Chez Nietzsche, le « dionysiaque » désigne la cohésion de l’individu avec le tout de la nature. En destinant les animaux à la désolation – ici pour des raisons scientifiques, médicales – l’homme moderne s’exclut humainement, c’est-à-dire simiennement de l’univers. Il pousse jusqu’à l’absurde et le sabordage l’empan par lequel il se croit séparé du reste du règne animal, y compris de son propre clade taxinomique. La civilisation humaine devient un Pandémonium sur Terre.
pan ! : onomatopée de la détonation d’une arme à feu.
Au début du film, tout va bon train : les chercheurs du centre Yerkes paraissent proches de leurs animaux – par la caresse, la parole. Prévenants. Bienveillants. Chez Wiseman, nous entrons dans l’horreur progressivement : la montée en effroi va aller avec le déroulement du film. Plus de film, plus de répulsion.
Les expériences menées sur les singes semblent d’abord relativement inoffensives : on y relève essentiellement des exercices classiques de conditionnement « béhavioriste » (renforcement positif, apprentissage programmé). On voit des mères avec leurs nouveau-nés. L’équipe a l’air hospitalière, il y a une nurserie [Fig. 1]. L’éthologie animale ressemble à une sorte de jeu, de délassement reposant sur la récompense et les stimulations agréables. « Joueur [playfull] » est d’ailleurs l’adjectif employé, dès la première phrase du film, par un chercheur pour qualifier un gorille dans sa cage. Mais plus le temps passe, plus le film avance, et plus le film – sinon Wiseman – va nous donner à voir la manière dont les animaux sont en réalité torturés, suppliciés, martyrisés.
Fig. 1
Très vite, en effet, le climat initial va s’assombrir, s’installe le malaise. Au vrai, le film n’a jamais cessé d’être angoissant sous le vernis. On y prélève à tout-va : du sang, du sperme. Les caresses des infirmières détendent les singes mais c’est avant l’insertion anale des thermomètres. Le ton sexuel – mieux : génital – du départ cache mal une profonde tristesse : mesure des éjaculations des chimpanzés, masturbation d’un gorille endormi. Certaines expérimentations font intervenir des excitations cérébrales électriques : on implante à des cercopithèques éveillés un dispositif récepteur dans le crâne [Fig. 2]. On regarde des singes endurer mille tourments ou copuler entre eux ; on en fait fumer d’autres. La nouvelle proximité génétique (scientifique) entre le singe et l’homme sert de facto une idéologie séculaire (théologique, philosophique) et sans cesse renouvelée de la distance incommensurable entre l’être humain et l’animal.
Fig. 2
Le centre Yerkes travaillait à l’époque dans trois directions : la reproduction, le sevrage et l’expérimentation médicale (drogues, alcool, vaccination). Trois types de séquences ressortent particulièrement du film : « les expériences sur la localisation cérébrale des comportements sexuels ou agressifs, sur les effets de la gravité et sur l’insémination artificielle[1111][1111] Haraway, Primate Visions, op. cit., p. 118. ». Les machines à test, qui viennent fusionner avec les corps des singes, sont tout autant filmées comme des instruments archaïques de géhenne (manivelles, panneaux en bois, bras métalliques) que comme formant avec les animaux des composés cybernétiques, des « chimères, hybrides de machines et d’organismes théorisés puis fabriqués[1212][1212] Donna J. Haraway, Manifeste cyborg et autres essais. Sciences – Fictions – Féminismes, éd. Laurence Allard, Delphine Gardey et Nathalie Magnan, Paris, Exils, coll. « Essais », 2007, p. 31. ». Les hommes en blanc portent l’uniforme des tortionnaires et vivent au milieu de câbles poulpesques et d’appareils futuristes. L’insoutenable culmine avec l’opération chirurgicale d’un singe dépecé. La caméra enregistre la routine implacable de scientifiques consciencieux éviscérant l’animal, puis le décapitant, débitant son cerveau en « magnifiques » (dixit) échantillons observés au microscope [Fig. 3].
Fig. 3
L’atrocité est d’autant plus à son comble que rien de ce que nous voyons – ici ou ailleurs – n’est fait par perversion ni cruauté. Nul affect ne vient, quel qu’il soit d’ailleurs, troubler le professionnalisme positiviste de nos savants. Les motivations humaines sont peut-être nobles ; elles ne sont, en tout cas, pas données (à part peut-être au détour d’un entretien : identifier des divergences d’évolution). Une chose est sûre, nous ne sommes jamais conduits à douter de leur rationalité, quand bien même celle-ci est elle aussi maltraitée à l’écran : activités fragmentaires incompréhensibles, accumulation ridicule de chiffres et de statistiques, réduction du réel à des courbes mathématiques, informations perlées. Si Primate est d’abord une enquête sur le comportement de l’animal humain, il convient de neutraliser tout ce que par quoi l’être humain entend se distinguer des autres animaux. Pas plus qu’il ne condamne, Wiseman ne justifie. Comme Meat en 1976 (l’élevage intensif et les abattoirs à la chaîne), Racetrack en 1983 (les courses hippiques) puis Zoo en 1993 (le jardin zoologique), Primate se contente de montrer comment notre regard industriel façonne notre rapport à la nature, c’est-à-dire invente l’animal dans nos sociétés occidentales productivistes et néolibérales. Il n’est pas anodin que ce soit le cinéma qui s’en charge, lui dont Étienne Souriau a rappelé combien il s’était imposé, non seulement par la décomposition archéologique du mouvement animal (chez Muybridge et Marey), mais comme divertissement de masse à une époque où l’animal, pour des raisons diverses, commençait à disparaître de notre vie quotidienne, quand nos rapports à l’animal se sont distendus, qu’est survenue « la cessation brusque et presque totale du cheval comme force motrice, comme procédé pratique de locomotion, comme moyen de combat[1313][1313] Étienne Souriau, « L’univers filmique et l’art animalier », Revue internationale de filmologie, n° 25, janvier-mars 1956, p. 53. ».
Nous sommes dans Primate, indépendamment encore une fois des desseins avancés par Wiseman, dans ce que le philosophe italien Giambattista Vico avait appelé dans La Science nouvelle (1725, 1744) la « barbarie de réflexion » : à côté de la « barbarie première » de l’époque préhistorique, d’avant la civilisation, et de la « barbarie seconde » caractéristique des périodes historiques de transition (diachronique), il existe une troisième forme de barbarie (synchronique) exprimant les formes dégénératives de la science contemporaine, à l’intérieur d’une organisation sociale donnée, quand la raison austère et autiste – mauvais emploi, épuisement ou germe fatal ? – n’est plus capable de reconnaître la complexité de la réalité (qu’elle se fixe pourtant comme programme de penser), et que s’annonce la nécessité d’un nouvel ordre culturel[1414][1414] Cf. Giambattista Vico, La Science nouvelle, trad. fr. Alain Pons, Paris, Fayard, coll. « L’Esprit de la cité », 2001, par exemple p. 507..
Les savants, pris un par un, ne sont pas malintentionnés. Ils sont même parfois touchants de naïveté : par exemple quand ils se plaignent de la résistance opposée par les singes. L’absence d’explication de leur comportement accentue l’impression d’incohérence de leurs actes. Choix discutable, sans doute, sûrement, mais qui a pour conséquence de renforcer le transfert émotionnel entre le spectateur et l’animal plongé dans la détresse, la panique et l’incompréhension. Comme on le verra, il n’y a rien là d’anthropomorphique : à l’écran, les singes font preuve d’un altruisme et d’une sollicitude envers leurs congénères qu’ils partagent avec l’espèce humaine. L’être humain a juste la possibilité supplémentaire, morale, d’entrer en empathie avec les membres d’une autre espèce que la sienne[1515][1515] Sur l’empathie chez les grands singes, cf. Frans de Waal (l’actuel directeur du Living Link Center du centre Yerkes), Le Bonobo, Dieu et nous. À la recherche de l’humanisme chez les primates, trad. fr. François et Paul Chemla, Paris, Les Liens qui libèrent, 2013. En 2014, J. B. Harrod développera, dans « The Case for Chimpanzee Religion », Journal for the Study of Religion Nature and Culture, vol. 8, n° 1, p. 89-118, l’idée qu’il existe un sentiment religieux chez les chimpanzés constructeurs de cairns.. L’émotion qui nous gagne est humaine en ce qu’elle nous amène à éprouver de la compassion pour des singes, mais simienne en ce qu’elle nous fait aussi ressentir de la compassion pour d’autres primates. C’est elle que le film stimule. C’est exactement la même commisération que nous pouvons également ressentir à l’endroit des chercheurs – dans un rapport de primates à primates – tels que nous les voyons se comporter dans le film.
*
panel (anglicisme) : groupe de personnes interrogées régulièrement sur leurs opinions ou leurs attitudes. Les singes du centre Yerkes constituent un panel. Ils sont questionnés. Soumis à la question.
bouc émissaire : en hébreux, « bouc à Azazel » (dieu archaïque, montagne). Il s’agit d’un animal portant sur lui les péchés d’Israël et offert en sacrifice purificateur. Les traducteurs grecs de la Septante, c’est-à-dire de la Torah juive (ou Pentateuque chrétien), ont lu « ez ozel » : en partance. Les bonobos ont recours à un bouc émissaire pour résoudre certains conflits au sein d’un groupe.
pan : partie tombante d’un vêtement. « Se pendre aux pans de » : chercher à profiter de quelqu’un de manière insistante. Les scientifiques du centre Yerkes se pendent aux pans de ceux, du genre Pan ou autre, qui se pendent à des branches, ils se pendent à leurs dépends.
panser : soigner une plaie ou une blessure en appliquant des topiques permettant la guérison. Le centre Yerkes – malgré le début trompeur avec les infirmières qui prennent soin des nourrissons – n’est pas un lieu où l’homme panse.
L’homme pense. Passé le titre, le film s’ouvre sur une galerie de portraits parmi lesquels on peut reconnaître Charles Darwin, le père de la théorie moderne de l’évolution [Fig. 4]. (Primate prolonge d’ailleurs à sa manière les nombreux films courts sur des singes tournés au début de l’histoire du cinéma, à une époque où « compte tenu de la manière dont les images de primates se tiennent au centre des idées de Darwin, pratiquement toute image, disons d’un orang-outan, produite après 1859 ne pouvait pas ne pas contenir un message sur l’évolution[1616][1616] Oliver Gaycken, « Early Cinema and Evolution », in Bernard Lightman et Bennett Zon (éd.), Evolution and Victorian Culture, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, p. 98. »). Aux côtés du « grand homme » (tout le contraire du « grand singe »), le montage va rapidement isoler en gros plan plusieurs experts en psychologie comparative, Yerkes mais également, par exemple, George John Romanes, l’auteur de L’Évolution mentale chez les animaux (1883). Non sans malice, Wiseman décide d’ouvrir son film sur un mode représentationnel emprunté à l’anthropométrie de Cesare Lombroso, de sinistre mémoire, quintessence raciste du darwinisme social mais très à la mode chez nombre de scientifiques de la fin du XIXe siècle, d’autant que la radicalisation de la naturalisation des conduites déviantes s’inscrit dans un processus déjà mis en place chez des psychologues comme Prosper Lucas, Bénédict-Augustin Morel ou Jacques Moreau de Tours. Ironie de Wiseman : Lombroso soutenait que l’on pouvait reconnaître les criminels à leur apparence physique. Les premiers singes à l’image sont des êtres humains (et pas n’importe lesquels : les mâles fondateurs de la primatologie[1717][1717] Haraway est revenue sur l’organisation professionnelle du centre Yerkes où des hommes blancs (et barbus) donnent des ordres à des femmes blanches et des hommes noirs, infirmières et agents d’entretien (Haraway, Primate Visions, op. cit., p. 118 sqq).) – c’est une réalité biologique : notre espèce appartient au clade de Linné –, mais inexpressifs, figés dans la mort (littérale et photographique), mis en cases. L’aberration qui suivra n’en sera que plus sensible : nous verrons des primates en faire souffrir d’autres (le singulier du titre insiste : il ne s’agit pas d’individus – nous voyons des primates, êtres humains ou singes – mais du taxon : l’ordre de la classe des Mammalia). Tous dans le même panier. Ou la même cage.
Fig. 4
Aucun singe ne torture un autre singe, même si certains d’entre eux – les chimpanzés notamment – peuvent faire preuve d’une extrême violence à l’encontre de leurs congénères, jusqu’au meurtre. Les singes du centre Yerkes forment un panel. En formant panel, en devenant paniques, tragiques, ils deviennent des boucs émissaires. Des « singes émissaires » (à défaut d’être éminents et de figurer au tableau d’honneur, qui est un tableau de chasse, de la science) : ils portent sur eux, dans l’image, dans leur chair, les stigmates du péché de connaissance de l’espèce humaine.
Le destin des singes du centre Yerkes montre ce qu’un primate est capable de faire à d’autres primates. En filigrane : la capacité qu’a l’homme d’annihiler son semblable, de le réduire à des matériaux plastiques, d’en faire un objet d’expériences « inhumaines » (en réalité ce type d’expériences est tout ce qu’il y a de très humain), c’est-à-dire non simiennes. Parler des singes – on y reviendra par la suite – c’est avant tout parler des hommes. C’est-à-dire parler des hommes in-humainement. Plus exactement (c’est moins une question de morale que, plus fondamentalement, une question de perception) : le comportement des hommes à l’égard des singes va ouvrir à la possibilité, à partir du moment où il sera filmé, d’un regard non anthropomorphique sur les singes, mais surtout sur les hommes.
Il en va des primates comme des aliénés de Titicut Follies en 1967, qui très souvent sont nus (sans que l’on sache vraiment pourquoi). Dans chacun de ces cas, et d’autres sur lesquels Wiseman se penchera par la suite, nous avons affaire à la même idéologie de l’alliance de la science et du gouvernement politique (commune au capitalisme et au totalitarisme : bien que le film n’en dise rien – Meat sera plus explicite – il est difficile de ne pas penser aux camps hitlériens d’extermination : on se débarrasse des corps simiens comme de déchets dans une poubelle), c’est-à-dire à un sadisme d’État, à une cruauté institutionnelle (la politique gouvernementale en matière de recherche est explicitement discutée lors d’une réunion de travail entre savants), lesquels commençaient à être largement contestés au moment du tournage des films au nom des singularités (le mouvement antipsychiatrique, la dénonciation de la souffrance animale). Il y a du singe dans la singularité. Erving Goffman – on l’a souvent convoqué à propos de Wiseman[1818][1818] Wiseman lui-même ne semble guère convaincu : Frederick Wiseman et Laetitia Mikles, « Filmer la mise en scène du quotidien », L’Homme et la société, n° 142, 2004/1, p. 153-169. – a proposé de parler d’« institution totale » pour désigner tout « lieu de résidence et de travail où un grand nombre d’individus, placés dans la même situation, coupés du monde extérieur pour une période relativement longue, mènent ensemble une vie recluse dont les modalités sont explicitement et minutieusement réglées[1919][1919] Erving Goffman, Asiles. Études sur la condition sociale des malades mentaux et autres reclus, trad. fr. Liliane Lainé, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Le Sens commun », 1979, p. 41. ».
Une « institution totale » est autarcique, bureaucratique et limite les contacts à des rituels très encadrés. Sous couvert d’un discours utilitariste, elle brutalise ceux qui sont tenus pour appartenir à des catégories symboliques inférieures sans prendre en compte la souffrance infligée : les animaux, les handicapés. Il s’agit d’un cas élargi de ce que Jean-François Lyotard avait appelé un « différend » : l’excès de différenciation conduit au différend en ce que les torts subis par les uns ne sont pas formulables dans la logique ou le langage des autres. « Il est d’une victime de ne pas pouvoir prouver qu’elle a subi un tort[2020][2020] Jean-François Lyotard, Le Différend, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Critique », 1983, p. 22.. »
Adorno rappelle que toute l’entreprise rationaliste – postcartésienne – de maîtrise de la nature se caractérise par une animosité envers l’animal envers l’animal réduit à la bestialité ou à la bêtise ; envers l’« animot » pour parler comme Jacques Derrida : l’animal nié dans la « singularité générale[2121][2121] Jacques Derrida, L’animal que donc je suis, Paris, Galilée, coll. « La Philosophie en effet », 2006, p. 65. » d’une abstraction, privé de mots, accablé de maux. Il affirmait déjà à demi-mot que les animaux sont à l’idéalisme philosophique, mettant le sujet humain au centre du monde, ce que les Juifs sont au nazisme. Aux uns comme aux autres il manque un visage. « L’obstination avec laquelle celui-ci [l’homme] repousse ce regard – “ce n’est qu’un animal” – réapparaît irrésistiblement dans les cruautés commises sur des hommes dont les auteurs doivent constamment se confirmer que “ce n’est qu’un animal”, car même devant un animal ils ne pouvaient le croire entièrement[2222][2222] Theodor W. Adorno, Minima moralia. Réflexions sur la vie mutilée [1951], trad. fr. Eliane Kaufholz, Paris, Payot, 2003, p. 142. ». Claude Lévi-Strauss ne dit pas grand-chose de très différent lorsqu’il affirme que c’est « en quelque sorte d’une seule et même foulée » que l’homme a tracé une frontière entre lui et les autres espèces vivantes et qu’il a ensuite « reporté cette frontière au sein de l’espèce humaine » en distinguant entre catégories « véritablement humaines » et catégories « qui subissent alors une dégradation conçue sur le même modèle qui servait à discriminer entre espèces vivantes humaines et non humaines [2323][2323] Claude Lévi-Strauss, « L’idéologie marxiste, communiste et totalitaire n’est qu’une ruse de l’histoire » entretien avec Jean-Marie Benoist, Le Monde, 21-22 janvier 1979, p. 14. ».
Chez Wiseman, les singes sont filmés dans la calamité infinie des victimes [Fig. 5]. Ils sont une pratique par le cinéma de ce que Giorgio Agamben appellera bien plus tard la « vie nue », « le simple fait de vivre, commun à tous les êtres vivants (animaux, hommes ou dieux)[2424][2424] Giorgio Agamben, Homo sacer. Le pouvoir souverain et la vie nue [1995], trad. fr. Marilène Raiola, Paris, Éditions du Seuil, coll. « L’Ordre philosophique », 1997, p. 9. ». En rendant visible leur calvaire, en l’exposant, en cassant la structure cryptique de l’institution, le cinéma photographique est capable – il est le seul : ce sont bien ces singes qui ont souffert et qui sont morts dont il témoigne – de rendre exprimables les supplices vécus par les primates, d’une expression qui ne passe nécessairement plus par les mots refusés aux animaux. L’image, inarticulée, est la loyauté à l’animal désarticulé. Mais aussi de rendre exprimable ce que l’homme, le savant, sans le recul nécessaire, n’était pas en mesure d’exprimer sur lui-même. Le film ne fait-il pas avec le centre Yerkes ce que le dépècement du singe fait avec son anatomie : en divulguer l’intérieur ésotérique ? En ce sens, il est erroné de voir en Wiseman, à la suite du documentariste Errol Morris, « le roi du cinéma misanthrope[2525][2525] Errol Morris, « La sordide horreur de la réalité », in Marie-Christine de Navacelle et Joshua Siegel (dir.), Frederick Wiseman, Paris/New York, Gallimard/MoMA, 2010, p. 67. ».
Fig. 5
Le savant – sans « sommaire procès de la connaissance[2626][2626] Maurice Darmon, Frederick Wiseman. Chroniques américaines, Rennes, PUR, coll. « Le Spectaculaire », 2013, p. 99. » – n’est qu’un singe plus évolué, comme n’importe quel homme, capable de se comporter d’une manière insensée en nuisant à d’autres animaux, en particulier ici ses plus proches parents sur la même branche évolutive. Il n’y a pas de pensée digne de ce nom sans capacité à panser, mais seulement de l’évaluation (un des maîtres-mots du métrage) – je cite : « techniques d’observation », « tests », « pointage », « études électro-myographiques ». La science-fiction (adepte du jargon crypto-scientifique pour rendre crédibles ses fantaisies) de Wiseman est celle – finalement conventionnelle par bien des points (on pense à Alphaville, une aventure de Lemmy Caution [1965] de Jean-Luc Godard ou à La Jetée [1962] de Chris Marker) – d’un monde de corridors sans fin, de cris incessants, clinique, machinique, protocolaire, qui est déjà le nôtre (à la même époque, on pique des électrodes dans des cerveaux humains). L’homme ne pense pas parce qu’il ne panse pas. Panser est, en revanche, le trait récurrent de l’attitude des singes les uns envers les autres.
Constante de la mise en scène : les techniciens et chercheurs commencent par être filmés à côté ou de l’autre côté de grillages, tandis que les premiers plans sur les singes sont plein cadre, avec une caméra qui essaie d’effacer le plus possible les intermédiaires et veut se placer – sinon toujours physiquement, du moins imaginairement (on repère ici ou là quelques reflets de vitre) – dans leur milieu immédiat, au lieu des singes. Dans tous les sens, contradictoires, qu’une telle expression a en français : dans leur lieu, mais aussi en leur lieu et place. On est un peu dans une variante du chat de Schrödinger : les singes sont dans une cage, la cage est dans une pièce, mais le centre est aussi une cage pour les hommes, et l’ensemble est mis en boîte dans une caméra, puis projeté dans cette autre cage qu’est la salle de cinéma. Primates : s’agit-il des singes du centre, des savants qui les étudient, du cinéaste qui enregistre les comportements des uns et des autres, des spectateurs qui regardent le film ? Tous à la fois, évidemment de manières différentes.
Bien que le film ne l’évoque jamais – un scientifique défend même la thèse contraire d’une scission dans la lignée des ancêtres communs aux hommes et aux grands singes (le centre de gravité des premiers est au bassin, des seconds vers le torse) – on ne peut manquer de songer en regardant Primate à la théorie de la néoténie. La néoténie désigne la conservation chez les adultes de certaines espèces animales (axolotl, ver luisant) de caractéristiques juvéniles. Cette théorie a été appliquée – sur un mode hypothétique – à l’homme (Louis Bolk, Desmond Morris) : celui-ci constituerait un cas très particulier de néoténie en ce que sa forme accomplie présenterait des traits infantiles d’autres espèces (les grands singes), disparaissant quand les gorilles ou les chimpanzés grandissent : par exemple la capacité à se tenir debout. L’homme peut être considéré comme un singe bloqué au stade infantile. Il n’est pas capable de panser, de penser, car il est celui qui a besoin de soins, d’être guéri de son arrogance.
*
panégyrique : discours d’apparat, dans l’Antiquité grecque, prononcé devant le peuple lors des grandes fêtes religieuses et vantant les avantages de telle ou telle entreprise, voire les mérites d’un individu illustre. Par extension : éloge enthousiaste d’une personne ou d’une chose.
panoplie : armure complète d’un chevalier au Moyen Âge. Par extension : jouet d’enfant composé d’un déguisement et d’accessoires singeant l’équipement lié à un métier ou aux activités d’un personnage réel ou imaginaire.
panoramique : mouvement de prise de vue cinématographique consistant en un pivotement horizontal, vertical voire diagonal de la caméra autour d’un axe fixe.
Le cinéma permet aux hommes de retrouver une forme de pensée qui soigne. Primate est le panégyrique du cinéma envoyé par un singe à d’autres singes. La bobine de film est d’abord un pansement. Au terme de Primate, quand celui-ci sera entièrement déroulé, un singe est lancé dans la stratosphère (écho peut-être aux lycéens astronautes de High School en 1968), hors perception ordinaire (terrestre), en gravité lunaire. Cette scène, sur laquelle tout se clôt, associe très étroitement ce qui arrive au macaque avec le vocabulaire visuel du cinéma et sa mise en abyme : plan sur des bandes enregistreuses, avion capturé dans un viseur de radar, boîte noire où l’on enferme le singe, image du singe sur un moniteur, etc. [Fig. 6-8]. Ce qui arrive au singe est le film. Au fur et à mesure de Primate, les hommes ne peuvent plus regarder les singes que sur des écrans. Des scènes antérieures – la préparation au vol en laboratoire occupe en réalité la totalité du film – avaient commencé à mettre en place cette ultime scénographie.
Fig. 6-8
La fin du film accentue ce que le début avait déjà mis en place avec les photographies des scientifiques illustres, la discussion sur la copulation devant une photographie de gorilles [Fig. 9] ou le surcadrage des cages pour les observateurs : il n’y a pas de vision immédiate, toute vision est appareillée. Le corps est le premier des appareils. Au bout du film, cette perspective aura achevé son destin de bobines et d’images animées.
Fig. 9
Contrairement à ce qu’affirment nombre de commentateurs, Primate n’incite jamais le spectateur à anthropomorphiser les singes, à s’identifier émotionnellement avec eux, à voir les singes « “comme” des gens[2727][2727] Grant, Voyages of Discovery.The Cinema of Frederick Wiseman, op. cit., p. 118. ». C’est même tout le contraire. Le film nous place devant l’ambiguïté de la présence animale au cinéma : celui-ci témoigne-t-il d’une émotion humaine envers l’animal qui existerait indépendamment de lui ou – puisque nous n’avons jamais connu un temps où le cinéma n’existait pas et ne représentait pas les animaux – n’est-ce pas le cinéma qui a largement contribué à construire une image empathique de l’animal en lui attribuant des caractères humains dès le plus jeune âge des spectateurs (dessins animés, films pour enfants, etc.)[2828][2828] Cf. Jonathan Burt, Animals in Film, Londres, Reaktion Books, 2002, p. 10-11. ? Il faut dépasser la logique de l’anthropomorphisme.
Le film retrouve ici une certaine idée du cinéma comme cérémonies organiques des métamorphoses, c’est-à-dire contrats d’incartades à l’anthropocentrisme. Le cinéma, comme le darwinisme – mais aussi la psychanalyse, la philosophie de Nietzsche ou la mécanique quantique, dont il est l’exact contemporain –, appartient à un paradigme historique de décentrement de l’être humain (au centre du monde depuis la Renaissance : perspectiva artificialis, Cogito cartésien, sujet transcendantal kantien, etc.). En cinéma, les prédécesseurs de Primate sont illustres : Epstein ou Vertov, par exemple, ont tous deux fêté la perception « inhumaine » de la machine. Chez le premier : « Pourquoi ne pas saisir avec empressement une occasion presque unique d’ordonner un spectacle par rapport à un autre centre que celui de notre propre rayon visuel. L’objectif est lui-même[2929][2929] Jean Epstein, Écrits sur le cinéma, « L’objectif lui-même » [1926], tome 1 (1921-1947), Paris, Seghers, coll. « Cinémaclub », 1974, p. 129.. »
Primate procède différemment, à peine différemment : par décorrélation de l’animal (entité linguistique) de sa relation à l’être humain, mais rattrape pareillement une animalité de la machine qu’Epstein avait notamment soulignée (la comparaison entre la caméra et les antennes de l’escargot, par exemple[3030][3030] Jean Epstein, Écrits sur le cinéma, « Le monde fluide de l’écran » [1950], tome 2 (1946-1953), Paris, Seghers, coll. « Cinémaclub », 1975, p. 146.). Au fond, cela revient au même. Non-humanité de l’animal (en amont) et non-humanité de la machine (en aval) fusionnent dans la nouvelle perception des appareils de filmage, de montage et de projection. Dire de la caméra qu’elle est une machine à percevoir et la comparer à des yeux de gastéropodes montés sur cornes rétractiles ou à des yeux d’insectes à facettes, c’est dire la même chose. Devant les singes, les savants interrogent les animaux qu’ils ne sont pas encore : il n’est pas anormal, dès lors, qu’un macaque finisse par devenir l’émissaire du prochain stade de développement de l’espèce humaine envoyée dans l’espace. L’homme de demain, c’est le singe. Le cinéma – comme l’écrit Jean Louis Schefer – a accéléré le temps[3131][3131] Jean Louis Schefer, Du monde et du mouvement des images, Paris, Cahiers du cinéma, coll. « Essais », 1997, p. 15 : « Les images cinématographiques ont d’abord porté des signes de vieillesse. » : en réalité, l’animal n’est pas en deçà mais au-delà de l’humain. Dans la mesure où toute perception est théorique, le cinéma nous donne pour la première fois une perception animale. Raymond Bellour, qui a beaucoup écrit sur les relations intimes entre cinéma, émotions et animalité, rappelle qu’« il n’existe dans l’univers du cinéma pas de thème anthropologique plus aigu que celui de la définition mutuelle et croisée entre l’homme et l’animal[3232][3232] Raymond Bellour, « Homo Animalis Kino », in Emmanuelle André, Oliver Cheval et Luc Vancheri (dir.), Questions de cinéma, problèmes d’anthropologie, Écrans, vol. 1, n° 7, 2017, p. 98. Voir également Raymond Bellour, Le Corps du cinéma. Hypnoses, émotions, animalités, Paris, P.O.L, coll. « Trafic », 2009. ». Rejouant le programme figuratif des Métamorphoses d’Ovide passé au crible de la nouvelle théorie darwinienne des espèces (qui s’intéresse moins aux tableaux, aux transcriptions naturalistes qu’à l’évolution, c’est-à-dire aux transitions naturelles), le cinéma est d’emblée un art de l’instabilité des espèces, des transformations ductiles et des transferts de proportions. Des espèces « mutantes[3333][3333] Cf. notamment Jean Louis Schefer, Images mobiles. Récits, visages, flocons, Paris, P.O.L, 1999, p. 141. ». Dès Marey et Muybridge, la locomotion humaine n’intéresse l’image animée que parce que l’homme y devient exemplairement visible comme un animal.
Primate n’incite pas à anthropomorphiser les singes (au contraire des infirmières qui les nourrissent au biberon) : il permet aux singes de revêtir la panoplie du cinéma. Dans Chérie, je me sens rajeunir (Monkey Business, 1952) de Howard Hawks, un chimpanzé concocte par hasard une potion de jouvence, joue au docteur, « fait » de la science : rien de tel n’arrive aux singes de Primate qui ne passent jamais de l’autre côté de la barrière (et où le cinéaste n’a pas eu à avoir la « patience » de diriger les animaux dont parle Jean-Claude Biette dans « Le cinéma descend du singe » : celle qui « produit une figure de rhétorique qui est aussi une qualité morale dévalorisée : la litote »[3434][3434] Jean-Claude Biette, « Le cinéma descend du singe », Cahiers du cinéma, n° 391, janvier 1987, repris in Poétique des auteurs, Paris, Cahiers du cinéma, coll. « Écrits », 1988, p. 155.). Ils ont mieux : ils « font » du cinéma. Ils le bricolent dans leurs images filmées. C’est que le cinéma est l’une des techniques par laquelle l’homme cherche à se projeter vers des régimes animaux de sensibilité. Un singe a inventé le cinéma. Le cinéma est une invention de Pan. Et à notre tour : regarder un film, c’est toujours expérimenter le singe en nous. C’est la magnifique leçon de la fin de Holy Motors (2012) de Leos Carax, qui s’était ouvert par l’entrée en scène du cinéaste lui-même, suivi par son chien, dans une salle de cinéma où courrait un enfant nu dans une allée, lorsque M. Oscar rentre chez lui, sa journée bien remplie, et retrouve sa famille de chimpanzés au son de la chanson « Revivre » de Gérard Manset (« Se sentir si loin, si loin de son enfance… ») – embrasse les enfants de l’espèce. C’était déjà celle de Primate quarante ans auparavant.