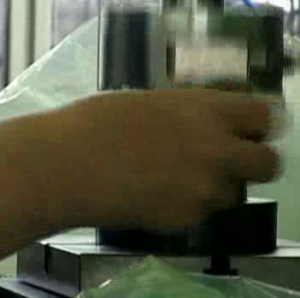Le Deuxième acte, Quentin Dupieux
Sans faire acte

Désormais, chaque saison a son Dupieux. Cet hiver, Débordements avait pris au sérieux la démarche de Daaaaaali !, pastiche de film biographique consacré au peintre andalou. Moins de trois mois après, au printemps, Le deuxième acte fait l’ouverture de la 77e édition du Festival de Cannes. Une telle productivité peut légitimement entraîner des soupçons de facilité ou de superficialité. Le texte sur Daaaaaali ! opposait aux détracteurs – et aux adorateurs – du cinéaste une lecture fine de l’idée de mort dans le cinéma de Dupieux. Pourtant, le cinéaste et DJ s’enfonce petit à petit dans une forme traditionaliste, survivance de ce vieux cinéma français que l’on croyait mourant. Le deuxième acte déçoit : l’humour du film, qui espère révéler les hypocrisies de notre temps, consiste en fait en des blagues récurrentes sur des sujets réputés touchy (les femmes trans, #Metoo, le handicap,…). Ainsi, laissons à Daaaaaali ! l’esprit de finesse et optons pour un esprit de géométrie afin d’élucider le rapport qu’entretient Quentin Dupieux avec cet air du temps qu’il veut tourner en dérision.
Le deuxième acte suit quatre acteurs, Florence-Seydoux, David-Garrel, Willy-Quenard et Guillaume-Lindon, censés tourner un film entièrement conçu par une intelligence artificielle dont le scénario consiste en une sorte de marivaudage : Florence veut présenter David, son amant, à son père Guillaume, mais David a invité Willy, son ami d’enfance, censé séduire Florence pour le débarrasser de cette femme qu’il n’aime pas. Ce schéma narratif est expliqué au début du film lors d’un plan séquence en travelling latéral dans lequel David et Willy avancent vers un restaurant où ils rejoignent Florence et Guillaume. David, très actif dans cette scène d’exposition, se voit sans cesse interrompu par des « dérapages » de Willy : le jeune homme, prétendument issu des classes populaires, ne comprend pas les raisons qui empêchent David d’être attiré par Florence. Ainsi postule-t-il qu’il s’agirait d’un « travelo » (sic.), terme jugé transphobe par David qui rabroue immédiatement Willy. Ces longs travellings de marche à pied citent l’une des influences majeures de Quentin Dupieux : Le Charme discret de la bourgeoisie de Luis Buñuel. Dans ce film où deux couples bourgeois tentent à plusieurs reprises de s’inviter à dîner sans y parvenir pour des motifs toujours plus ubuesques, certaines séquences sont entrecoupées de plans dans lesquels on suit tous les personnages errer sur une route de campagne. La bande-annonce du Deuxième acte, réunissant tout le casting rend cette référence explicite. Dans Le deuxième acte, la linéarité du travelling, disposé sur des rails, rapproche plus ces séquences de marche de la balade que de l’errance. Il s’agit bien de se rendre à un point précis, celui de la fiction, auquel on n’arrive jamais, à cause d’un récit dédalique dans Le Charme discret de la bourgeoisie, à cause de disputes politiques dans Le deuxième acte.
Comme souvent, Dupieux construit son film dans une logique de mise en abyme permanente, voulant rendre ambigus les achoppements entre le récit et le méta-récit. Aussi les pauses des acteurs, leurs écarts avec le script n’interrompent-elles jamais le tournage. Toujours montées selon un découpage classique, ces séquences ne révèlent jamais « d’envers du décor » : nous n’apercevons ni caméra ni réalisateur. En ce sens, l’enjeu du film se noue plutôt autour des comédiens qui se définissent à partir des personae des acteurs qui les incarnent. Au début du film, Guillaume, exaspéré, part marcher, trouvant comme prétexte pour quitter le tournage la vanité de jouer dans un film si mauvais alors que « le monde va mal », suivi par Florence qui lui répond en vantant « la magie du cinéma ». Alors que la caméra filmait David et Willy sur le même plan, elle fait ici des va-et-vient séparant Florence et Guillaume à l’image. Guillaume finit par rentrer dans le rang quand son agent l’appelle pour lui proposer un rôle chez Paul Thomas Anderson. Ici, le gag repose sur un effet d’intertextualité évident entre Guillaume et l’image d’acteur engagé de Vincent Lindon. Parfois, Dupieux essaie de prendre à rebrousse-poil l’image publique de ses comédiens à l’instar de Florence-Léa Seydoux qui finit par craquer à un moment et à appeler l’entièreté de ses proches, tous hermétiques à son effusion de larmes. Sa mère, chirurgienne placide, n’a rien en commun avec la famille Seydoux : l’actrice, personnage artificiel, s’oppose, dans le film, à un entourage banal, en apparence. Dans une dernière partie du film, ces personnifications s’inversent : après le clap de fin, Vincent Lindon se change, s’habille d’une veste en cuir rouge, se pare d’une moustache postiche, part marcher avec Raphaël Quenard et les deux acteurs s’embrassent. Le rideau tombé, les deux hommes incarnant précédemment une hétéromasculinité toxique se révèlent être homosexuels.
Ainsi reconnaît-on les ressorts narratifs habituels du cinéma de Quentin Dupieux : récit en deux parties, rapport à la mise en abyme. Mais cette fois-ci la frontière entre réalité et fiction se recoupe autour d’un certain nombre d’effets de réel, essayant de faire la satire d’une nouvelle hypocrisie. Aux blagues transphobes, misogynes et handiphobes de Willy, David répond : « Ne dis pas ça devant la caméra ! Tu vas nous mettre dans la merde. » Lorsque Willy tente d’embrasser de force Florence dans les toilettes, celle-ci le repousse et le menace de le « cancel ». Si les saillies misogynes de Willy et Guillaume se voient toujours contredites, il n’en demeure pas moins qu’elles relèvent à la fois d’un humour de connivence et d’une vision relativiste de l’hypocrisie. Revenons au terme « travelo » initiant le film : le rire naît précisément du malaise de David, du fait que Willy persiste à répéter ce qui ne doit pas être dit. Il se joue de fait une distinction intertextuelle entre Raphaël Quenard et le reste du casting : Seydoux, Garrel et Lindon sont des fils de et, en ce sens, ont intériorisé les règles de leur milieu – faisant de Quenard un relais spectatoriel, seul personnage dans la première partie du film à ne partager ni le langage ni l’origine sociale des trois autres comédiens.
Cette connivence masculine revient lorsque Guillaume et Willy se moquent ouvertement d’un figurant qui ne parvient pas à servir du vin et en renverse partout pendant vingt longues minutes. Ce figurant, joué par Manuel Guillot, ouvre le film et le restaurant qui lui sert de décor. Les quatre comédiens se disputaient déjà bien assez mais la maladresse de ce personnage, due à l’anxiété d’apparaître enfin à l’écran, finit de faire éclater le tournage : Florence va téléphoner à sa famille, David va séduire les figurantes quand le figurant continue de servir le vin en essuyant les quolibets de Guillaume et Willy. Dans la suite de Yannick, le figurant incarne en partie l’idée que se fait Dupieux du spectateur, à tout le moins de la normalité. Aussi les quatre acteurs – Quenard y compris – finissent-ils par se détacher des figurants et du personnage de Manuel Guillot. Lorsque les quatre comédiens entrent dans le restaurant, plusieurs plans de coupe saisissent les discussions des figurants où ils abordent les choses de leur vie quotidienne, des grands événements qui scandent une vie à l’écart du show-business. Plus tard, la fille de Florence lui parle de la mère d’une amie qui, elle, fait un « métier normal ». Il se dessine, dans le film, une certaine vision populiste opposant au mépris des acteurs une forme de naïveté de l’homme ordinaire. Cette distinction renvoie les débats sur l’air du temps dans l’ordre de la fiction : les préoccupations de David et Florence sont celles d’un certain milieu et leur malaise à l’égard des blagues de Willy et de Guillaume relève en fait d’une stratégie personnelle.
À force d’être brimé, le figurant finit par s’enfermer dans sa voiture, se saisit d’un pistolet et se tire une balle dans la tête. Après un cri de Léa Seydoux, un clap de fin intervient : le tournage s’avérait en fait être un film réalisé par une intelligence artificielle. L’œuvre de fiction se retrouve objet de normes : par exemple, le personnage de Manuel Guillot, se voit subir une retenue de salaire pour avoir grossi entre le casting et le tournage. Au sein du film, l’IA, l’art normé par excellence, s’oppose à une vision romantique de l’artiste dont l’imagination libre serait bridée par une sorte de contrat à remplir pour ne pas vexer le public. Cependant, la rupture entre le film et le non-film marque une continuité : Dupieux revient aux plans séquences du début, alternant les personnages, mais surtout, la direction d’acteurs ne semble pas changer. Or, si les comédiens semblent être le sujet du film, il convient d’abord de noter que, la plupart du temps, leur jeu sonne faux et que l’alchimie des dialogues ne prend pas : hormis le délire verbal de Lindon, les quatre comédiens récitent une partition, attitude paradoxale vis-à-vis de la liberté de ton promue par Dupieux. On peut aussi faire remarquer que, dans cette seconde partie, l’hypocrisie demeure, quand Lindon et Quenard refusent avec embarras lorsque Manuel Guillot leur propose de rester en contact. Après le clap de fin, le figurant reste un figurant, la star reste une star, constat qui conduit le personnage de Guillot à se suicider une seconde fois.
La brièveté des films de Dupieux est toujours apparue comme un aveu de faiblesse [11][11] En conférence de presse à Cannes, Quentin Dupieux dit lui-même : “Je fais des films d’une heure qui ont l’air de durer trois heures.” : son absurde très systématique tourne vite en boucle, ses films sont vite redondants. Pour autant, la volonté réaliste, censée renouveler son style, se heurte à un autre mur : une vision du monde hyper-conventionnelle, symptôme d’un cinéaste incapable de penser à l’épreuve du réel et non à partir de l’idée stéréotypée qu’il s’en fait. Les luttes sociales, féministes et LGBTI+ deviennent pour lui l’apanage d’une classe supérieure déconnectée, participant ainsi d’une conception réactionnaire du public et de la société. À travers sa révérence pour le cinéma de Bertrand Blier, une sorte de goût des dialogues à la Michel Audiard, Dupieux devient le garant d’un cinéma français traditionnel, masculiniste, un cinéma de papi. Concentré sur le monde du cinéma, le film observe une sorte de ghettoïsation. Dupieux s’enferme dans une grille référentielle spécifique et, incapable de se défaire d’une perception univoque du monde social, préfère se rattacher au champ qu’il a toujours connu : l’entre-soi artistique, du cinéma et de la musique. Le dernier plan du film, présentant les rails de travelling ayant servi au tournage, passe en force le geste du film, comme pour pallier une incapacité à faire acte de cinéma. La préoccupation pétrie de conventions de Quentin Dupieux pour son époque rend son art encore plus verbeux et démonstratif. La mise en scène passe au deuxième plan, comme une gageure auto-réflexive, celle que Quentin Dupieux demeure cinéaste, si bien qu’il en vient à oublier (mais y a-t-il déjà pensé ?) qu’il suffit parfois d’un seul travelling pour évacuer le verbe et faire figure de morale.

Scénario : Quentin Dupieux / Image : Quentin Dupieux / Montage : Quentin Dupieux
Durée : 1h20.
Sortie française le 14 mai 2024.