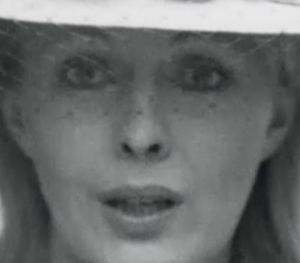Le personnage confisqué
Le cinéma à l’épreuve de l’épilepsie
L’épilepsie est un trouble neurologique dont l’étymologie latine epilepsia signifie « interruption, arrêt soudain. » Nous avons tous en tête des images d’attaques tonico-cloniques, parfois spectaculaires, au cours desquelles les malades sont pris de perte de connaissance, de convulsions, de raideurs musculaires et d’éructation de salive[11][11] La crise « tonico-clonique » est la forme la plus représentée de la maladie. Notons cependant qu’il existe un ensemble très vaste d’attaques épileptiques et des symptômes souvent plus discrets. Il peut s’agir d’absences, d’hallucinations, de troubles de la motricité, de crises au cours desquelles les malades chantent, dansent, sifflent ou s’expriment de façon a-signifiante. Le large spectre des manifestations du trouble fait dire à Pierre Jallon qu’il ne faudrait pas parler de l’épilepsie, mais des épilepsies. Voir JALLON, Pierre, L’épilepsie, Presses Universitaires de France, coll. Que sais-je, Paris, 2002, p.4.. Ces crises, (particulièrement liées au cinéma puisqu’un type d’épilepsie dit « photosensible » est déclenchée par des effets proprement cinématographiques) sont régulièrement mises scène par des auteurs tel Gus Van Sant (Drugstore Cowboy, 1989), Bruno Dumont (La vie de Jésus, 1997), Jeff Nichols (Take Shelter, 2011), Joachim Trier (Thelma, 2017) ou Gaspar Noé (Climax, 2018). Bien souvent, ces cinéastes font de la pathologie un instant non seulement critique pour le personnage, mais pour le film lui-même. Nous pensons donc que cette détonation dans l’architecture de l’œuvre posera de nombreuses questions théoriques au cinéma. À commencer par celle du rapport entre le personnage et le corps de l’acteur depuis lequel il se désincarne le temps de la crise.
La découverte de la maladie remonte à Hippocrate. Elle prend alors le nom de morbus divinus[22][22] JALLON, Pierre, ibid., p. 5. (maladie divine). Cependant, malgré le diagnostic précis du savant antique, la maladie n’en demeure pas moins en grande partie mal connue par la communauté scientifique. Reconnue désormais comme une maladie neurologique, elle a longtemps été frappée du sceau de l’infamie, considérée comme un fléau démoniaque durant le Moyen Âge occidental, ou comme une maladie psychique associée à l’hystérie jusqu’à la fin du XIXe siècle (Jean-Martin Charcot, au XIXe siècle la nommait encore « hystéro-épilepsie »). Les malades ont régulièrement été victimes de déclassements, d’excommunions, de stérilisations, voire d’exterminations.
Donnant lieu à des spéculations mystiques, c’est ce « mal sacré » que met en scène Raphaël dans son ultime œuvre picturale, La Transfiguration. Nous y voyons le Christ en lévitation dans une lumière bleutée, tandis qu’au premier plan, un jeune épileptique fait le lien entre l’espace miraculeux et l’espace prosaïque. Le maître italien fait le choix d’associer deux épisodes consécutifs de la Bible, celui de la transfiguration (bref moment de la révélation divine du corps de Jésus) et celui de l’épisode de la « guérison d’un démoniaque ». Le neurologue René Soulayrol montre dans son livre sur l’enfant épileptique que la posture de l’enfant est celle d’un malade en crise, dépeinte avec une fidélité scientifique[33][33] SOULAYROL, René, L’enfant foudroyé. Comprendre l’enfant épileptique, Odile Jacob, Paris, 1998., ce que montre également Guillaume Cassegrain dans son texte sur la représentation de la vision en peinture[44][44] Voir CASSEGRAIN, Guillaume, Représenter la vision. Figuration des apparitions miraculeuses dans la peinture italienne de la Renaissance, Actes Sud, Paris, 2017.. Or, c’est cet enfant au regard divergeant qui fait le lien entre ces deux mondes qui ne cohabitent pas, le sacré et le profane. Ici, au lieu d’être racontée, la transfiguration est le sujet d’une vision ésotérique, dont le personnage épileptique est le médium, au double sens de visionnaire et de moyen de la représentation. L’artiste italien insiste alors déjà sur le lien entre la maladie et les processus de formation des images, ce que nous retrouvons chez des cinéastes qui conjuguent dans leurs films ésotérisme et épilepsie, comme Joachim Trier (Thelma, 2016) ou Gaspar Noé (Lux Aeterna, 2019).
De la même manière que l’œuvre de Raphaël rompt avec les conventions de la storia de son époque en usant du motif de l’épilepsie, les cinéastes figurant cette atteinte neurologique, par un phénomène de contagion, font de l’œuvre elle-même un objet critique. Le figuré trouvant un écho dans sa figuration, le film « sort du silence de sa normalité » pour introduire dans l’œuvre ce qu’Hubert Damisch repère concernant la tache, un dysfonctionnement « pathologique[55][55] DAMISCH, Hubert, Théorie du /nuage/, pour une histoire de la peinture, Seuil, Paris, 1972, pp. 47-49. ». En créant une dysharmonie dans la structure narrative, l’épilepsie, va révéler les éléments du film comme interdépendants dans un réseau symbolique grippé. Cette détonation dans l’architecture de l’œuvre posera de fait des questions théoriques au cinéma. Celle qui nous occupera ici concerne le personnage dans les œuvres narratives. Lorsque vu comme une entité métaphysique, s’incarnant dans le corps de l’acteur le temps de la fiction, qu’en reste-il lorsque celui-ci est pris d’une attaque épileptique ? Où passe-t-il le temps de son absence ? Et que faire de ce corps rendu illisible par ce temps suspendu du protagoniste, où le corps de l’acteur apparaît dans toute sa tessiture matérielle ?
La polyphonie du terme anglais qualifiant la pathologie épileptique : a seizure, nous aidera à répondre. Alors que l’épilepsie ne renvoie, en français, qu’à la maladie neurologique, dans la langue anglo-saxonne, a seizure renvoie tout autant à la « capture », la « confiscation », la « saisie » ou « l’arrestation ». Le terme qualifie une suspension, une dépossession de soi qu’on ne trouve pas en français. Il nous semble justement que le rapport du cinéma à l’épilepsie est construit à l’aune d’une confiscation en vue d’une remise au monde. En effet, la crise, même simulée, nous présente un corps dont on retire l’incarnation le temps d’une crise. C’est un esprit qui est confisqué, saisi, qui ne laisse derrière lui qu’un organisme d’autant plus visible que son comportement se fait erratique, en dehors de l’entendement. Le personnage ne disparaît cependant pas définitivement. Il est simplement confisqué, en attente d’une réincarnation prochaine.
Robert Bresson, dans Mouchette (1967), sa seconde adaptation d’un roman de George Bernanos (après Journal d’un curé de campagne (1951) ), met en scène les malheurs d’une adolescente mal-aimée, marginalisée et souffre-douleur de la communauté rurale à laquelle elle appartient. Agressée à plusieurs reprises sans que personne ne la défende, la protagoniste, rejetée, mettra fin à ses jours par noyade à l’issue du long métrage. Dans une scène au milieu du film, Mouchette qui, cachée dans un fossé en bord de route, vient de maculer de boue[66][66] Remarquons que le surnom du personnage renvoie au verbe moucheter, qui signifie faire des taches, ce qu’elle fera tout le film durant. les camarades qui la martyrisent, envisage de rentrer chez elle, non pas par les routes traditionnelles (qui semblent n’appartenir qu’à la bonne société), mais en passant par les chemins tourbeux de la forêt. Surprise par la nuit tombante et par une pluie diluvienne, elle trouve un temps refuge sous un arbre. Arsène, braconnier à la mauvaise réputation, paria (comme elle) du village, trouve la jeune fille et la recueille dans son cabanon en pleine forêt. Avant de croiser Mouchette, celui-ci vient d’avoir une altercation avec un garde forestier. Après avoir abrité la jeune fille, ivre, il ressortira et assassinera le représentant de l’ordre à l’issue d’une nouvelle rixe au bord de l’eau. Coupable et sous le choc, poussé à la confession par l’adolescente, il sera pris d’une crise épileptique « généralisée », incluant une perte de connaissance, des raideurs musculaires, des spasmes et une éructation involontaire de salive.
Nous pourrions penser que la crise est provoquée par la culpabilité et le souhait d’échapper aux aveux. Nous remarquons en effet que, dans d’autres œuvres narratives, l’épilepsie intervient dans un contexte de culpabilité et permet au personnage, tout en demeurant physiquement présent, d’échapper aux accusations. Chez Dostoïevski, auteur épileptique et inspiration majeure de Robert Bresson, le trouble ponctue les romans. Il y sert bien souvent aux personnages à s’échapper ou disparaître, lorsqu’ils sont confrontés à leurs responsabilités. La pathologie, réellement vécue par les protagonistes ou singée, permet aux protagonistes d’esquiver leur culpabilité, de demeurer présents, tout en prétendant l’absence. C’est ce qu’on retrouve dans Les Frères Karamazov quand Smerdiakov tente d’échapper à toute accusation en ayant une crise qu’il anticipera, ou préméditera, et qui lui sert d’alibi. Il existe alors un doute que nous retrouvons dans différentes manifestations artistiques de l’épilepsie, sur la vraie nature de la crise[77][77] Voir DOSTOIEVSKI, Fiodor, « Livre V – Pro et Contra. Chapitre VI : Où l’obscurité règne encore », Les frères Karamazov, Gallimard, Paris, 1997, pp. 368-378. Tout un arc narratif de l’ouvrage, du chapitre tourne autour de l’anticipation par Smerdiakov de la crise qu’il aura le lendemain, jour du crime de Fiodor Pavlovitch Karamazov. . Ce soupçon quant à la véracité de la crise semble alors faire écho au paradoxe de jouer une crise, qui implique le jeu d’un événement qui met en lumière la soustraction, bien que ponctuelle, de l’incarnation. On retrouve ici la « confiscation », comprise dans l’acception du terme seizure, chez ces personnes happées hors de la fiction et ne pouvant alors affronter ce dont ils sont accusés, à l’instar du volte-face du présumé voleur de bicyclette dans le film éponyme de Vittorio De Sica (1948) [88][88] Le protagoniste, Antonio Ricci, lorsqu’il retrouve l’homme lui ayant confisqué son bien, ne saura obtenir de réparation. En effet, celui-ci fera volte-face, ayant (ou en jouant) une crise, alors qu’il est confronté par le personnage central. Antonio Ricci ne peut alors réclamer son dû à cet homme gisant dans les bras de ses proches, présent et pourtant rendu abstrait à la narration. Il est alors impossible de s’en prendre à un être dont seul le corps subsiste dans la foule. Le cinéaste nous indique ici que le film ne peut suivre la route d’une résolution. L’auteur du forfait, s’il apparaît dans la diégèse n’atteindra pas le statut de personnage. Son rôle ne pourra être que celui d’un figurant, et non pas celui d’un actant. Or, un figurant ne peut être tenu responsable, puisque son rôle se confine à celui d’apparaître et non à celui d’agir., ou de la diversion permise par la crise dans Drugstore Cowboy.
De la même manière, dans Mouchette, l’épilepsie permet au personnage du braconnier de s’évader un temps hors du récit. Venant de commettre un crime, celui-ci ne peut répondre de ses actes, une crise venant interrompre son récit. Mais, à la différence des exemples cités précédemment, la crise, chez Robert Bresson, n’apparaît pas de façon brève ou au seul service d’une démarche narrative. La crise, dans le film de Robert Bresson, est à l’image du temps suspendu. Elle permet de rendre visible un temps mort, ou un temps creux, de la fiction. Il s’agit d’une pause, d’une percée temporelle dans la narration, où le corps, confisqué de son personnage, demeure, dans sa tessiture matérielle et dans sa durée. En l’attente de sa réincarnation par le protagoniste invisible, son rôle se borne à celui de figurant, et non pas celui d’un actant.
Alors même que plus rien ne peut avoir lieu, il s’agit, paradoxalement, comme le propose Tom Gunning, d’une scène purement « attractionnelle ». C’est un moment dans la fiction où la narration devient secondaire et où la contemplation fascinée du corps prime. La narration s’interrompt pour renouer avec le cinéma des premiers temps qui, comme le note le théoricien « ne disparaît pas avec la période de domination du récit, mais deviendrait plutôt souterrain à partir de ce moment-là, intégrant certaines pratiques d’avant-garde et certains films narratifs[99][99] GUNNING, Tom, « Le cinéma d’attraction : le film des premiers temps, son spectateur et l’avant-garde », Mille huit cent quatre-vingt-quinze, 1895, n°50, Paris, 2006, p. 55-65. ». Le film, dans ces moments de pure contemplation fait ressurgir le souvenir du cinéma antérieur, selon l’auteur, à 1906, où la fable, même chez Méliès, ne servait souvent que de prétexte au spectacle des corps.
Plus précisément, le film de Robert Bresson perpétue dans cette scène l’usage attractionnel de l’imagerie médicale des premiers temps. Nous pensons plus particulièrement aux films scientifiques de Walter Chase qui, en 1905, a filmé, sur fonds neutres, des patients pris par des crises épileptiques. Figurés nus et face à une toile tendue, les corps sont mis en valeur de manière à apporter le plus haut degré de visibilité possible au corps pris dans une phase critique. Sur cette scène médicale apparaîtront même, dans certains cas, des praticiens qui viendront sur scène articuler le corps de façon à le replacer dans le meilleur angle de vue pour la caméra, quand celui-ci basculera du côté invisible de la prise de vue. De la même manière, le film de Robert Bresson entretient un rapport ténu à la spectacularisation de la maladie. La séquence de l’évanouissement d’Arsène permet de montrer avec pléthore de détails cet événement qui vient interrompre la fiction dans une scène de pure visibilité. Ainsi, le film élabore une mise en spectacle du corps malade, tout en ayant soin de retranscrire le phénomène de la crise avec une fidélité clinique, en le disséquant de manière à rendre compte de l’événement comme de la somme d’une multitude de chainons qui aboutissent au point culminant de l’attaque.
Filmé en clair-obscur, Arsène, saoul, après avoir fait tomber la gourde qui annonce sa chute à venir, se passe la main sur le front, souffrant visiblement de vertiges. Il décrit cette première étape de la crise, qui consiste en une sensation qui précède l’attaque, qui portait le nom « d’aura[1010][1010] JALLON, Pierre, op. cit., p. 31. » avant d’avoir été remplacée par l’expression de « signal symptôme[1111][1111] Idem. ». Cette étape de la crise est particulièrement décrite dans les romans de Dostoïevski, qui lui attribue des vertus divinatoires. Il s’agit d’une phase, où seul le malade entrevoit les signes imperceptibles de sa pathologie[1212][1212] Il s’agit donc d’une phase où l’épileptique entre dans un état d’hypersensibilité, auquel on prête des pouvoirs de perception accrue, comme c’est le cas dans Take Shelter, (Jeff Nicols, 2011), où le thème de la prédiction est associé au motif de l’épilepsie qui frappera le protagoniste.. Arsène complétera sa sensation de malaise par les paroles annonciatrices qu’il articule péniblement : « ne t’inquiète pas, ça m’arrive souvent. Des absences. ». Tandis que la jeune fille et l’assassin scénarisent leur alibi (leur fausse absence sur les lieux du drame), le personnage finit par dissimuler de sa main son œil droit alors qu’il continue de parler. Il se masse le visage, dont la déformation progressive répond au trouble qui s’empare et donne une image à sa dépersonnification progressive. Tandis que Mouchette continue de s’exprimer, les mots d’Arsène deviennent confus, son corps vacille. De sa main, il se masse une nouvelle fois la tempe puis la nuque avant que la bave ne commence à écumer de sa bouche. Il bredouille : « Petite je n’y vois plus clair. Ma nuque me prend. Je vais avoir ma crise. ».
L’homme s’effondre et, en frappant le sol, se blesse l’arrière de la tête tandis qu’écume une bave mousseuse de sa bouche entr’ouverte, à laquelle vient se mélanger un filet de sang noirâtre. La silhouette sombre de l’homme se dessine sur le sol blanc. Arsène s’y tortille. Incapable d’articuler, il ne produit plus que de faibles gémissements qui se confondent dans un devenir-bruit avec le crépitement du feu[1313][1313] Sur la non distinction entre ce qui est dit et les bruitages cf : DANEY, Serge, « L’orgue et l’aspirateur (Bresson, le diable, la voix off et quelques autres) », La rampe, Cahiers du cinéma, Paris, 1983, pp. 162-176.. Pour accentuer le trouble et marquer l’évasion du personnage dans un espace alternatif, le cinéaste renversera l’image. L’homme sera figuré, comme dans une œuvre de Georg Baselitz, le visage vers le bas, accentuant l’étrangeté et l’illisibilité de son faciès. Alors que ce visage est filmé en gros plan, siège des émotions, l’expression se fait opaque, siège d’une souffrance muette. Est décrite dans ce second temps de la crise, ce qu’on appelle la « phase clonique », étape de perte de conscience au cours de laquelle apparaissent les mouvements convulsifs des membres. Cette scène se présentera comme le miroir de la scène de meurtre que le braconnier aura décrit quelques instants plus tôt – « il était là, il tenait dans l’eau. Il a tricoté les jambes, d’abord très vite puis lentement et après il n’a plus bougé. L’eau est devenue rouge. » – et qui se redoublera plus tard dans le film dans les scènes de mise à mort des lapins et qui eux aussi sont pris de spasmes nerveux des membres. Ainsi la scène entre dans une continuité de motifs, caractérisés par les secousses, qui tous renvoient à une mise à mort définitive. Lui aura droit au Salut, et sa mort ne sera qu’un épisode, car enfin, le personnage revient progressivement à lui dans ce qu’on nomme l’ultime phase de la crise, la phase postcritique.
L’intermédiaire du regard de Mouchette recadre l’image dans son sens ordinaire. Le braconnier se réveille mais demeure fébrile et désorienté à l’issue de son attaque épileptique. Alors qu’Arsène gît au sol, entouré du halo formé par ses fluides déversés, la jeune fille, accompagnera sa résurrection par la comptine apprise à l’école, dont les paroles sont : « Espérez ! Plus d’espérance ? / Trois jours leur dit Colomb / En montrant le ciel immense / Le fond de l’horizon / Trois jours et je vous donne le monde / À vous qui n’avez plus d’espoir / Sur l’immensité profonde / Ses yeux s’ouvraient pour le voir. ». Cette chanson est selon toute vraisemblance une réécriture du poème « trois jours de Christophe Colomb » de Casimir Delavigne[1414][1414] Le poème « Trois jours de Christophe Colomb » de Casimir Delavigne commence de cette façon « En Europe ! En Europe ! – Espérez ! Plus d’espoir ? / Trois jours, leur dit Colomb, et je vous donne un monde / Et son doigt le montrait, et son œil, pour le voir, / Perçait de l’horizon l’immensité profonde. ». DELAVIGNE, Casimir, Les Mésseniennes, Livre III., qui décrit, après l’errance en mer, l’abordage vers la terre nouvelle. Comme l’explorateur dont le voyage est incertain, critique, le personnage aborde la vie de nouveau, après avoir essuyé la tempête. La jeune fille invite de son chant l’homme à revenir parmi les vivants. Elle amorce sa résurrection.
Convalescent auprès de Mouchette, revenant à lui, le corps matériel retrouve peu à peu son personnage. Comme un nourrisson dans les bras de sa mère, Arsène renaît. Mouchette adopte ici la posture de fille-mère, qu’on retrouve dans les scènes où celle-ci donne le lait à son frère nouveau-né, tout en lui chantant la fameuse comptine. Elle endosse l’attitude de la mater dolorosa, pleurant le martyr dans une composition proche des piéta. Enfin, l’homme revient tout à fait à lui, ses yeux s’ouvrent de nouveau sur le monde. Toujours vulnérable, son corps réintègre en lui le personnage. Celui-ci reprend chair et, en retour, la chair redevient personnage. Son organisme redevient signifiant et la fiction, après son absence, peut reprendre.
Les matières organiques qui marbraient le visage du personnage rappellent cette intériorité physique qui est celle du corps du « modèle » bressonnien[1515][1515] BRESSON, Robert, Notes sur le cinématographe, Gallimard, Paris, 1975. non-professionnel et qui jaillit, du dedans vers l’extérieur du visible. Ils permettent d’envisager le corps, non plus dans son rôle (au double sens de personnage et d’utilité), mais la matière concrète dont sont faits les personnages de cinéma, visible au lieu de lisible. Guillaume Cassegrain dans son ouvrage sur le motif de la coulure dans l’Histoire de la peinture rappelle le caractère phénoménologique de son objet d’études, « entre le signe (« c’est ça ») et la matière (« c’est ça »)[1616][1616] CASSEGRAIN, Guillaume, La coulure. Histoire(s) de la peinture en mouvement, XIe-XXIe siècles, Hazan, Paris, 2015, p. 57.», « renvoyant à une antériorité de l’image » et du sujet avant que l’artiste ne le façonne. Ainsi le modèle (terme issu de la peinture) revient-il à son état liquide de pré-façonnage, à son état de pure matière d’avant incarnation et donc, de figuration. Tandis que la crise renvoie au sensationnalisme d’un cinéma attractionnel, le corps et le « cinémonde » tout entier, pris d’un devenir-fluide[1717][1717] Le film thématise la liquéfaction du monde dès son premier plan, dans lequel la mère pleure d’épaisses larmes face caméra. Par la suite, nous retrouverons ponctuellement des pleurs, de l’alcool, du café, du lait, de la pluie, de la boue ou encore l’eau du fleuve dans lequel l’adolescente met fin à ses jours. L’œuvre, qui renouvelait les formes « attractionnelles » du cinéma d’avant 1907, semble d’ailleurs ici, réactiver une logique du cinéma de la première avant-garde française où le motif de l’eau est omniprésent, en particulier en conclusion des films. Voir à ce sujet THOUVENEL, Éric, Les images de l’eau dans le cinéma français des années 20, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2010., retrouve ses origines liquides le temps de l’attaque qui confisque le personnage pour rendre le monde matériel.
Cette scène est emblématique des questions soulevées par l’épilepsie au cinéma. En interrompant le flux de l’action, le corps se fait purement matériel. Il se liquéfie comme le monde qui les entoure. Robert Bresson, peintre et cinéaste rappelle la fluidité de ces corps qu’il compose pour l’œuvre et décompose dans cette scène qui met en valeur la plasticité du corps. C’est le corps de l’acteur non professionnel, du figurant fait personnage qui apparaît. Mais le personnage, lui, est confisqué dans un ailleurs interdit aux images. Il demeure virtuel jusqu’à ce que la fiction reprenne, jusqu’à ce que la fiction ne le reprenne. Nous voyons que chez Robert Bresson, l’épilepsie est filmée de manière distante, scientifique. D’autres cinéastes, au contraire, s’évadent avec le personnage dans cet ailleurs chimérique que compose Raphaël dans la Transfiguration. Comme dans la toile du maître italien, se confrontent un monde prosaïque et un univers fondé à partir des images qu’induisent les crises. C’est par exemple le cas dans Thelma de Joachim Trier, où la psyché du personnage victime d’attaques neurologiques est inductrice de visions. Ces films, contrairement à celui de Robert Bresson, sont plus enclins à user d’artifices cinématographiques ayant eux-mêmes la faculté de susciter des crises chez les spectateurs, comme c’est le cas avec les effets stroboscopiques. Car si nous avons vu que l’attaque épileptique entraînait un rapport singulier à l’incarnation, et donc, à la question de l’union entre personnage et acteur, qu’en est-il du corps de l’audience ? Le septième art entretient un lien viscéral à la chair des spectateurs. Plus qu’un contact émotionnel, c’est l’individu physique qui est touché par les films. Les crises épileptiques le montrent bien en faisant du corps « une surface d’inscription des évènements[1818][1818] “If we provisionally accept Foucault’s supposition that the body is “an inscribed surface of events”, then the body itself becomes addressable by media epigraphy. A seizure, then, can be viewed as one of such events, inscribed on the body by compressed moving images.” « Si nous acceptons provisoirement l’hypothèse de Foucault selon laquelle le corps est “une surface inscrite d’événements”, alors le corps lui-même devient adressable par l’épigraphie médiatique. Une crise d’épilepsie peut donc être considérée comme l’un de ces événements, inscrit sur le corps par des images compressées en mouvement » (traduction personnelle). JANCOVIC, Marek, Misinscriptions: a media epigraphy of video compression, Thèse de doctorat en philosophie et philologie, Université Johannes Gutenberg- Universität Mainz, Mayence, 2020, p. 181. », où se composent et se vivent les images.