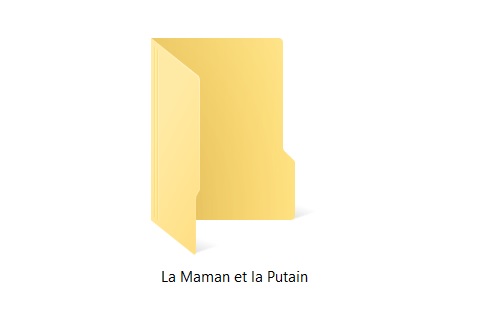Le rendez-vous manqué
Voir La Maman et la Putain au cinéma (1)
Le samedi 6 mai 2017, je prends un bus depuis Lille pour aller voir, à la Cinémathèque française, La Maman et la Putain de Jean Eustache, projeté à l’occasion d’une rétrospective de l’œuvre du cinéaste. Je n’ai jamais vu le film, j’ai 19 ans, je suis étudiant en licence d’études cinématographiques, c’est la première fois que je vais à la Cinémathèque. La projection a lieu à 14h30, j’arrive vers midi ; à mon arrivée à Bercy, les places sont toutes achetées. Avec le camarade qui m’accompagne, nous n’avons pas pris la peine d’acheter nos places en avance : nous aurions dû. On attend quelques minutes en espérant que des places se libèrent, ce n’est pas le cas, on manque la projection. Je crois que nous n’avons pas trouvé le courage d’aller voir un autre film : nous avons pris le métro pour aller dans le dixième arrondissement faire un petit tour cinéphile, probablement acheter des DVDs ou des livres. Le soir même, nous rentrons à Lille.
Premier rendez-vous manqué, avec un film que l’on aimait décrire à l’époque comme « inaccessible », pourtant un film que tous les cinéphiles, d’une manière ou d’une autre, ont pu voir : des copies pirates circulent depuis fort longtemps, encore plus depuis 2013, où un passage sur Arte a permis au monde entier de conserver et de distribuer un fichier en haute définition ; j’avais moi-même téléchargé le film plusieurs mois plus tôt, sur un célèbre tracker privé dont le titre bizarre s’abrège en deux consonnes, mais je l’avais conservé au fin fond d’un disque dur, sans y toucher, en attendant d’avoir envie. La séance à la cinémathèque devait régler le problème : pas besoin d’avoir envie si le film « passe », on va le voir, un point c’est tout. Justement, il est passé.
Je ne devais pas être le seul à attendre d’avoir envie, puisque la séance était pleine – probablement pleine des habitués de la Cinémathèque, cette faune que l’on voit à toutes les séances, mais également de cinéphiles plus intermittents, qui y voyaient l’occasion de voir le film « sur grand écran », d’affronter son poids et sa durée dans le confort relatif de la salle de cinéma (face à celui, absolu, du lit ou du canapé – mais où on risque encore plus l’endormissement…). Souvent je pense que, traînant dans ces espaces quand même pas très bien agencés, j’ai dû croiser des cinéphiles qui ont croisé ma vie, peut-être même certains qui sont devenus, plus tard, des amis – à moins qu’ils n’aient préféré se rendre à une des deux autres séances, programmées dans les semaines qui suivaient. Malgré l’agonie de notre réseau ferroviaire, le trajet province-Paris pour voir des films reste un évènement déterminant de la cinéphilie française, et une bonne raison de lutter contre son sabotage institutionnel…
Mais si ce film était accessible pour tous les cinéphiles qui étaient prêts à « fouiller un peu », pourquoi la salle était-elle pleine ? Par coquetterie peut-être ? Car nous n’avons pas attendu internet et le peer-to-peer pour écrire et lire des textes qui affirmaient qu’on pouvait tout à fait voir un film chez soi ; les nuances que chaque écrivain de cinéma apporte ne sont que des nuances, du « chez soi c’est pour re-voir les films » au « tout de même ce n’est pas la même chose » et autres querelles de dispositifs. Peut-être par esprit de contradiction, peut-être parce que la déception était trop grande, j’ai, pour ma part, fait durer la coquetterie : je n’ai pas regardé le film dans les mois ni dans les années qui suivaient, alors que j’ai regardé d’autres films de Jean Eustache – ses magnifiques court-métrages, la version restaurée d’Une sale histoire (restauration assurée par Potemkine en 2017), la copie sortie des limbes de Numéro Zéro, version longue d’Odette Robert (miraculeusement apparue il y a quelques mois sur le tracker dont je parlais plus haut)… Mais pas « son chef d’œuvre », le chef d’œuvre invisible du cinéma français, pourtant tout à fait visible sur un disque dur, attendant patiemment mes double-clics. Aujourd’hui, le film est restauré, un accord avec les ayant-droits est signé, et La Maman et la Putain aura finalement droit, ce mercredi 8 juin, à une sortie nationale.
Si je n’ai pas vu le film avant, c’est après tout parce que je n’en ai jamais ressenti le désir – je veux dire, le désir de cliquer, de m’asseoir devant mon ordinateur pendant plus de trois heures et de faire cette expérience qui ressemble quand même à un rite de passage cinéphilique. Pourtant j’avais bien un désir de voir ce film, ne serait-ce que parce que le monde entier s’accorde aujourd’hui à dire que c’est un des plus beaux films jamais faits, un témoignage inestimable du monde qui suit Mai 68 (il est amusant de remarquer que L’Amour fou de Jacques Rivette, témoignage inestimable du monde qui précède Mai 68, est aussi de ces films français invisibles-visibles – il est d’ailleurs lui aussi en cours de restauration). Et après tout la quasi-intégralité de ma cinéphilie s’est faite via des .mkv et des écrans d’ordinateurs…
Mais j’ai cette croyance, que certains trouveraient superstitieuse, qu’il vaut mieux voir un tel film dans une salle de cinéma, en faire l’expérience dans le noir, sans pouvoir regarder ailleurs (ou en ne pouvait voir autour de soi qu’une salle de cinéma, des sièges, des rambardes, d’autres spectateurs et spectatrices), sans pouvoir fractionner ou interrompre le visionnage (je sais que c’est une habitude très courante pour beaucoup mais moi ça ne m’arrive jamais, de mémoire ça ne m’est arrivé que quatre fois ces dernières années [11][11] Puisque je me souviens des détails et qu’ils ont à mon avis un fort potentiel comique, autant les partager : j’ai interrompu au bout de quelques minutes le visionnage d’En avant, jeunesse (finalement vu quelques mois plus tard), de La Taupe (jamais terminé) et de Flight (idem), et fractionné en deux celui de A. I. Intelligence Artificielle. Inutile de préciser que ces mises en pause ont moins à voir avec les films mêmes qu’avec d’intenses états de fatigue… ). Pourquoi ce film méritait-il, spécifiquement, ce traitement ? Probablement parce qu’il cumule tous les aspects que j’ai déjà cité : durée, piédestal cinéphile, importance historique. Et puis, c’était aussi peut-être une manière de respecter le mythe de son invisibilité ; comme si regarder cette copie, ce « rip » floqué du logo « Arte », était une sorte de blasphème.
Il faut aussi dire que voir un film chez soi, mais c’est seulement en ce qui me concerne, cela me demande au fond bien plus d’investissement personnel que prendre le métro pour aller le voir au cinéma : choisir, décider, (s’)installer, appuyer sur la barre espace – sans même parler de la lourdeur pénible d’un « support physique », de l’inconfort d’un disque que l’on sort de sa boîte. C’est peut-être cela qui me charme dans la salle de cinéma (qui est, pour le dire clairement, de loin la manière par laquelle je préfère voir un film) : paradoxalement, sa légèreté. Plus léger qu’un DVD ou un Blu-Ray, plus léger qu’un disque dur, plus léger qu’une clé USB, plus léger même qu’un site de streaming (légal ou pas), la salle de cinéma nous permet de regarder les films sans jamais les garder. On voit le film, sans poids, sans action de notre part, qui s’étale sur l’écran, simple projection de lumière et donc sans épaisseur – les photons ne sont pas de la matière. En manquant ma séance de La Maman et la Putain, en 2017, j’ai au fond fait l’expérience ultime de la salle de cinéma : je n’ai même pas eu à voir le film.