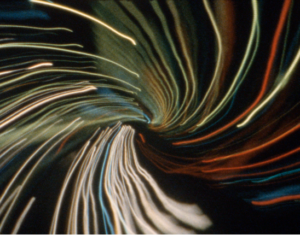Mar del Plata, 2016
Transmissions
Cannes, Berlin, Locarno, New York, Busan, Le Caire,… – des quatre coins du monde, des rayons lumineux s’élancent. Entrés en fusion, ils achèvent bientôt leur course sur la côte argentine, où ils forment alors les différentes facettes d’un lion de mer. L’animal, familier en cette région, est devenu le symbole de Mar del Plata, et de son festival. Dans la ville, deux imposantes sculptures de pierre le montrent moustaches tendues vers le ciel, dominant une volée de marches menant à la plage. C’est sous l’auguste protection de l’un d’eux qu’Olivier Assayas, venu en coup de vent présenter Personal shopper, se fera d’ailleurs photographier pour la Une du supplément culture du quotidien local, La Capital. Néanmoins, plus que le blason lui-même, ce sont les trajectoires lumineuses qui importent dans cette bande-annonce réalisée pour la 31 édition du Festival International du Film de Mar del Plata. Y apparaît de façon limpide l’esprit d’un événement qui se veut d’abord, au niveau de la programmation, une synthèse, voire un concentré.
Bien qu’étant l’un des plus importants festivals d’Amérique du Sud, Mar del Plata n’a pas la prétention de rivaliser avec les barnums européens. Les « premières mondiales » ne sont guère sa priorité. Aussi ne faut-il pas être surpris de croiser, en compétition internationale, Nocturama ou Aquarius, ni de découvrir, dans le « panorama des auteurs », Rester vertical, La Mort de Louis XIV ou encore Le Cancre. La donne est certes différente en ce qui concerne le cinéma argentin, et plus généralement latino-américain, qui bénéficient chacun d’une compétition. Ces productions, globalement peu visibles hors du sous-continent, trouvent là une vitrine d’importance – d’autant que le festival offre une large place aux jeunes réalisateurs. Comme une manière de boucler la boucle, il ne fut pas rare que ces derniers, parmi les remerciements d’usage, évoquent le festival comme un lieu formateur de leur cinéphilie – notamment parce qu’il leur avait permis de découvrir les grands auteurs étrangers.
Pour le spectateur débarqué de France, le souci est alors de se frayer dans l’opulent programme un chemin qui, pour n’être pas exclusivement déterminé par le critère bien relatif de la nouveauté, n’en réponde pas moins à une forme d’actualité. A regret, l’impasse fut faite sur les rétrospectives consacrées à Masao Adachi, au film noir ou à Peter von Bagh. Un compte-rendu de festival n’est jamais que l’esquisse d’une trajectoire parmi les mille possibles.
Un mot encore, avant de s’attacher aux films : il est de coutume que les festivals invitent les journalistes et les critiques. Cela peut se traduire par un aller-retour en TGV et deux nuits dans un hôtel coquet en face de la gare. Il est plus rare de se voir offrir un vol transatlantique et une semaine dans un Cinq étoiles avec vue sur l’océan. En termes de déontologie, le problème ne change pas de nature – pas même de degré, puisque ce qui peut apparaître comme la contrepartie (les publications) demeure souvent identique. Il est en tout cas plus saillant. Faute de solution, on se contentera de savourer l’ironie voulant que la critique, dévalorisée comme métier, jouisse encore de quelque prestige en tant que fonction.
Quel rapport entre L’Odyssée de l’espace et la violente crise économique et institutionnelle ayant éclaté en Argentine au tournant du millénaire ? La question, incongrue, portait en elle les germes de bien des rêveries. Hélas, la réponse de Gabriel Nicoli tient surtout au hasard d’une date, 2001. Point anecdotique, mais non dénué d’importance : 2001 : Mientras Kubrick estaba en el espaciao fut présenté (pour une raison que j’ignore) en version non sous-titrée. S’il est toujours curieux de découvrir un film dans une langue étrangère, cela l’est d’autant plus lorsqu’il s’agit d’une comédie reposant essentiellement sur les dialogues, et que le réalisateur s’est assis par hasard juste à côté de vous. Coincé au milieu d’une salle hilare, j’étais donc le seul à garder le silence. Heureusement, Nicoli lui-même, d’abord tendu sur son siège, se passant sans cesse la main sur le menton et le front, se mit peu à peu à rire pour deux.
Sans la béquille, ou le masque des dialogues, la mise en scène et la structure narrative apparaissaient dans leur nudité. Nicoli se montre particulièrement habile à reconstruire une atmosphère de crise, jouant du hors-champ et de son surgissement métonymique. Il lui suffit de faire entendre les sirènes de police et les hélicoptères, ou de montrer la fermeture précipitée de la grille d’un magasin pour que le bouillonnement d’une époque se matérialise. C’est d’ailleurs la meilleure idée du film que de présenter ses trois personnages ne rencontrant l’Histoire qu’accidentellement, au gré d’une trajectoire qui précisément cherche à échapper à la puissance de son attraction. La limite vient de ce que celle-ci est trop souvent réduite à un décor plus ou moins spectaculaire – comme lorsque le trio traverse, dans une antique voiture rose, une ville en ruines.
Pour le reste, le film souffre à la fois de sa grammaire trop élémentaire (le plan d’ensemble précède le champ-contrechamp lorsqu’il s’agit de se concentrer sur les dialogues ; le suit lorsqu’il s’agit de révéler un paysage ou une situation surprenante), et de ses effets trop appuyés. De façon révélatrice, 2001 partage en outre son schéma narratif avec un autre film d’un jeune cinéaste argentin. Pinamar, de Federico Godfrid, raconte une histoire d’héritage – deux frères, un appartement à vendre, un passé avec lequel rompre ou au contraire se réconcilier. L’ainé est taciturne donc mystérieux, le cadet est un joyeux drille qui semble avoir davantage compris le sens de la vie. C’est au premier que reviendra la fille – les deux films s’achevant sur un baiser, ici sur fond d’océan, là avec Buenos Aires en arrière-plan. Aussi a-t-on le sentiment que le récit se résout contre le personnage qui en était le moteur, l’essentiel des effets se jouant au niveau comique. Prolétaire de la fiction, le rigolo n’aura été que l’adjuvant d’une figure – le beau ténébreux – narcissiquement plus satisfaisante. Voilà bien une injustice dont on fait les drames.
Jeune lui aussi, mais déjà aguerri (six longs et un court réalisés depuis 2007), Matías Piñeiro manifestait avec Hermia & Helena un art de la narration bien plus abouti. La circulation – des êtres, des objets, des affects – est la grande affaire de cette nouvelle variation autour de Shakespeare, et plus particulièrement du Songe d’une nuit d’été. Ce qui marque surtout, dans cette histoire située entre New York et Buenos Aires, est la façon dont Piñeiro varie les vitesses, étire des moments a priori mineurs et en court-circuite d’autres où semblent se jouer le sens d’une existence. Ainsi les ruptures sont-elles souvent brutales, comme une soudaine révélation contenue dans une variation de l’atmosphère, et les cheminements très longs. De ce point de vue, l’une des belles idées du film est cet assemblage de cartes postales venant, État après État, dessiner la trajectoire d’une rencontre vouée à l’échec, puisque l’autre est déjà parti. Tout l’effort est dans le glissement, la translation – à entendre aussi comme traduction, puisque c’est à cela que s’attelle l’un des personnages -, mais c’est l’impulsion qui règne.
Pas de film argentin sans orage, telle pourrait être par ailleurs la maxime (très partielle) de cette édition.
Constituée de treize longs-métrages, la section « Cine sobre cine » offrait un panorama des films récents consacrés au cinéma. La richesse de celui-ci tenait autant à la diversité des formes convoquées – de l’enquête biographique au portrait hagiographique, en passant notamment par l’entretien rétrospectif – que des sujets. Les figures célèbres (Fritz Lang, Toshiro Mifune, Abbas Kiarostami,…) y côtoyaient d’autres plus méconnues, comme le cinéaste argentin Raúl Perrone. Au jeu des découvertes, la plus surprenante fut sans aucun doute celle de ces films produits en Allemagne de l’est par des exilés chiliens. Après avoir fui la dictature de Pinochet, ils s’étaient décidés à en raconter l’histoire – recréant au passage les plateaux andains dans les steppes de Bulgarie. Si Película Escondidas est loin d’être sans défaut – que l’on songe à son didactisme parfois pataud, voire moralisateur -, il a le grand mérite de redonner une visibilité à ces films et à leurs créateurs, et par-là même à un moment historique que d’aucuns voudraient oublier. Pour Claudia Sandberg et Alejandro Areal Vélez, l’entreprise est d’ailleurs davantage politique que cinéphile. Il s’agit de transmettre une mémoire – personnelle, collective – que le processus de démocratisation / libéralisation du pays a eu tendance à occulter.
Parmi les six films que j’ai eu l’occasion de voir dans cette section, deux étaient consacrés à David Lynch. Blue Velvet Revisited, de Peter Braatz, est un étrange objet – moins par le genre auquel il peut se rapporter, celui du making-of, que par son destin. Jeune étudiant allemand, Braatz écrit au cinéaste pour lui proposer de filmer le tournage de Blue Velvet. Lynch vient d’essuyer avec Dune un échec commercial important, et les aventures de Jeffrey Beaumont sont pour lui une manière de renouer avec un type de production, si ce n’est artisanal, du moins plus léger. D’une ligne, il donne son accord à Braatz. Celui-ci débarque alors avec 60 bobines de Super-8 : une par jour de tournage. Entamé à la mi-août 1985, ce dernier va se révéler un moment de joie pour toute l’équipe, et pour Lynch en particulier, qui ne cesse de répéter à quel point il est heureux. Cela donne à Blue Velvet Revisited son air de film de vacances ou de famille. Il n’y a rien d’épique ici, que le travail, la complicité et l’attente. Étonnamment, Braatz aura laissé dormir ces documents durant presque trois décennies – manquant d’ailleurs de les perdre. Plutôt que de suivre un découpage quotidien, le montage se fait thématique, abandonnant la stricte relation des faits pour glisser entre les motifs, les lieux, les figures. Lynch y apparaît à la fois méticuleux et disponible, semblant toujours prêt à répondre aux questions parfois approximatives de Braatz. Annonçant d’une certaine manière son recours au numérique pour Inland empire, le cinéaste exprime au passage son souhait d’un matériel qui ne nécessiterait plus de longue mise en place, notamment pour la lumière. Et pourtant, il écrira lui-même à l’adhésif blanc, avec une minutie infinie et tandis que l’équipe s’affaire autour de lui, le nom de « Lumberton » sur un bus scolaire. Plus tard, il accordera le même soin à fabriquer le masque porté par Dennis Hopper. Le rêve de cinéma de Lynch aura sans doute toujours été du côté du bricolage.
Peut-être est-ce pour cela que David Lynch : The Art Life, de John Nguyen, Rick Barnes, Olivia Neergaard-Holm, est le plus beau portrait que l’on puisse imaginer du cinéaste en artiste, et de l’artiste en cinéaste, quand bien même il ne cite pas le moindre plan postérieur à Eraserhead. Fruit d’un tournage étalé sur trois ans, le film montre Lynch dans son atelier, étalant la peinture à pleine main, tordant des fils de fer ou tripatouillant toutes sortes de matériaux à la consistance organique. Fumant, aussi, le regard perdu dans le lointain. On le sait, il se sera passé plus d’une décennie entre Inland empire et la troisième saison de Twin Peaks, durant laquelle Lynch a sorti des disques ou conçu des clubs privés. C’est surtout aux arts plastiques qu’il a néanmoins consacré l’essentiel de ses journées. La première qualité du film est de nous faire découvrir cette part plus négligée de son travail. Tantôt en cours de fabrication, tantôt achevées, les œuvres s’entrelacent – avec des archives familiales ou personnelles – au récit en voix-off que Lynch fait de son enfance et de ses débuts de peintre. Le montage son / image s’avère d’une grande intelligence et d’une rare vivacité, cherchant moins à illustrer les propos qu’à suggérer la manière dont une expérience a pu se déplacer, se condenser, jusqu’à trouver un écho déformé quelques décennies plus tard sur une toile. Ces souvenirs ne sont d’ailleurs pas sans évoquer les films eux-mêmes. Le sentiment que le monde entier est contenu dans le pâté de maison de la prime jeunesse ; l’apparition d’une femme nue et blessée à la nuit tombée devant David et son frère ; la tentation de devenir un mauvais garçon en découvrant une autre ville : le scénario de Blue Velvet semble s’écrire au fur et à mesure. Reste que The Art Life, en ne s’aventurant pas au-delà des premiers courts et d’Eraserhead – c’est-à-dire au-delà du cinéma le plus « artiste » de Lynch, le plus directement lié au travail maniaque de la matière – produit un effet ambivalent : il nous place au seuil d’une histoire évidemment plus connue, qu’il appelle et dérobe tout à la fois. En nouant les deux extrémités de la vie de Lynch à travers la peinture même, le film pourrait suggérer que le cinéma (de fiction) fut comme une parenthèse. Cela, évidemment, serait une manière d’oublier l’impossibilité dans laquelle s’est trouvé Lynch de financer ses derniers projets. Une autre hypothèse est néanmoins envisageable : en montant les toiles du cinéaste les unes avec les autres, en les « animant », le film réalise à sa manière son désir ancien d’un cinéma à la fois narratif et « plastique », cheminement solitaire définitivement débarrassé des lourdes structures de tournage.
Souvent très pointu dans sa programmation, le festival de Mar del plata a ceci de particulier, et de réjouissant, qu’il parvient à réunir un public nombreux et surtout divers. Cela tient sans doute pour partie aux lieux mêmes des projections – moitié des « institutions » culturelles à la splendeur parfois un peu fanée (la salle Astor Piazzolla du Teatro Auditorium, le Cine Ambassador, le Teatro Colón), moitié des salles de centres-commerciaux flambant neufs. Ainsi, il n’était pas rare de voir des familles les bras chargés de pop-corn s’asseoir devant un film de Ruth Beckermann (le très beau Die Geträumten, dont il a déjà été question dans le compte-rendu du Cinéma du Réel 2016) ou de Wang Bing. Ce qui semblerait ailleurs une anomalie, voire un blasphème, apparaissait ici comme le fruit d’un joyeux hasard. Évidemment, des spectateurs ne manquaient pas de s’éclipser durant la projection. Mais que les lignes aient pu être brouillées et qu’une rencontre, même brève, même inaboutie, ait pu avoir lieu, est une chose dont peu de festivals peuvent se vanter.
A travers l’histoire des techniques de projection, c’est aussi en creux celle des lieux du cinéma que Peter Flight raconte dans The Dying of the light, depuis les « nickelodeons » jusqu’aux multiplexes automatisés, en passant par les Palaces. Comme souvent dans ce genre de récit, Flight néglige trop les aspects culturels, sociaux et économiques qui auront abouti, à partir des années 1920, à la construction de ces temples que furent les Palaces. Contraint d’en observer la magnificence depuis les ruines qu’ils sont pour la plupart devenus, il mythifie l’époque où les salles offraient aux spectateurs une expérience esthétique totale – voire un dépaysement, celles-ci pouvant par exemple se parer des atours d’un Orient imaginaire. Non sans raison, peut-être, mais c’est oublier un peu vite que les industriels du 7ème art ont rarement été guidés par autre chose que l’intérêt bien compris. Son projet néanmoins se situe ailleurs, dans ce lieu secret qu’est la cabine de projection. Il en retrace la généalogie, en suit les métamorphoses, jusque dans les détails les plus techniques. Les projectionnistes, interrogés dans les lieux mêmes où ils ont travaillé, ou travaillent encore, se montrent toujours d’une grande précision lorsqu’il s’agit d’évoquer des gestes maintes fois répétés – l’allumage du projecteur, le maniement de la pellicule, les changements acrobatiques de bobines, la lourdeur invraisemblable des copies en 70 mm. Sous leurs doigts, des machines abandonnées reviennent même à la vie. C’est bien là que se situe The Dying of the light : au point historique où un savoir-faire risque de se perdre. Ainsi que l’explique un projectionniste retraité, ses connaissances lui venaient directement d’un homme ayant commencé sa carrière en 1913. Mais que peut-il lui-même transmettre à quelqu’un qui n’a plus qu’à programmer un serveur informatique ? Ce risque d’une rupture entre les générations tient donc à la manière dont le travail – ici comme ailleurs – se trouve de plus en plus délié du corps, et en particulier des mains. La projection en pellicule avait quelque chose d’éminemment érotique – c’est à l’oreille que pouvait s’entendre la justesse du toucher, comme l’explique une témoin. Ce souci de la matérialité est partout présent dans un film qui ne se veut ni tout à fait une élégie, ni tout à fait un tombeau. La lumière ne meurt pas, elle se réfracte, se diffracte et poursuit sa course.
***
Dans Écorces, Georges Didi-Huberman écrivait : « Auschwitz comme Lager, ce lieu de barbarie, a sans doute été transformé en lieu de culture, Auschwitz comme « musée d’État », et c’est tant mieux. Toute la question est de savoir de quel genre de culture ce lieu de barbarie est devenu le site exemplaire. » En posant sa caméra dans le camp de concentration de Sachsenhausen, c’est précisément à cette question que s’affronte le cinéaste ukrainien Sergei Loznitsa. Et la réponse semble sans appel. Comment en effet ne pas être sidéré par ce flux incessant de touristes en short, posant devant ou derrière la grille dans laquelle est forgé « Arbeit macht frei » ? Comment ne pas être révolté par cet homme qui, passées les explications de la guide, demande à son amie de le prendre en photo tandis qu’il feint d’être pendu à la potence ? Comment ne pas être désespéré par l’humaine banalité de ces hommes et de ces femmes qui, même là, ont besoin de croquer dans leur sandwich ?
Austerlitz est sans doute un film important – il faudra le revoir, le laisser revenir. Pourtant, il incite aussi à quelque facilité. Celle, en premier lieu, qui consiste à opposer le spectateur au visiteur, à moraliser la position de l’un pour mieux suggérer l’immoralité de l’autre. La mise en scène de Loznitsa, avec ses longs plans fixes, son gris et blanc sans apprêt, se donne de fait l’air d’un retrait, d’une absence. La caméra, bien souvent posée comme une pierre au milieu du courant, laisse les corps glisser jusqu’à elle, s’y noyant même. Cette neutralité apparente est bien évidemment encore une manière de juger – la plus hautaine, probablement. Loznitsa a bien compris qu’il était inutile de chercher à signifier trop volontairement quand tout, de toute manière, faisait signe, et même injure. Dans l’un des premiers plans apparaît ainsi un adolescent sur le tee-shirt duquel s’étale un « cool story bro ». Soudain, nous ne voyons plus que cela – l’ironie de la formule se retournant contre celui qui la porte, et qui le marque comme la preuve de son inconséquence et de son irrespect.
Comment alors quitter cette posture d’indignation auquel le film en partie invite ? En prêtant attention à tout ce que Loznitsa laisse advenir par la durée d’un plan, la rigueur d’une composition, la puissance soudaine d’un contraste lumineux. Si les groupes se meuvent comme des vagues implacables, les plans sont assez longs pour accueillir l’individu rendu à sa solitude, qui dérive en dehors des clous imposés par la visite guidée. Austerlitz ne manque pas de ses écarts faits à la rationalité du tourisme, d’où sourdent l’affection et le recueillement. La structure même du film, construit comme un tour du camp, ne se démarque pas du cheminement des visiteurs. Elle se coule dans l’organisation d’une expérience, dans les conditions de transmission d’une histoire – à ce titre, il faudrait décrire précisément le mixage sonore, la façon dont les langues diverses des guides émergent du murmure de la foule et du crissement des graviers. Néanmoins, supposer que le film dépasse son opposition spectateur / visiteur par d’autres oppositions – entre l’individu et le groupe, l’expérience singulière et le tourisme de masse – est encore une façon d’aller trop vite en besogne. Ces partages sont au fond trop rassurants. La seule véritable évidence d’Austerlitz a peut-être été chantée par Leonard Cohen dans The Captain : « There is no decent place to stand in a massacre. » Que nous soyons blessés en voyant des gens se prendre en photo dans un camp n’indique qu’une chose : un massacre a eu lieu qui ne passera pas. Aussi est-on condamné à vivre dans l’indignité. Importe seule la conscience de cette indignité.