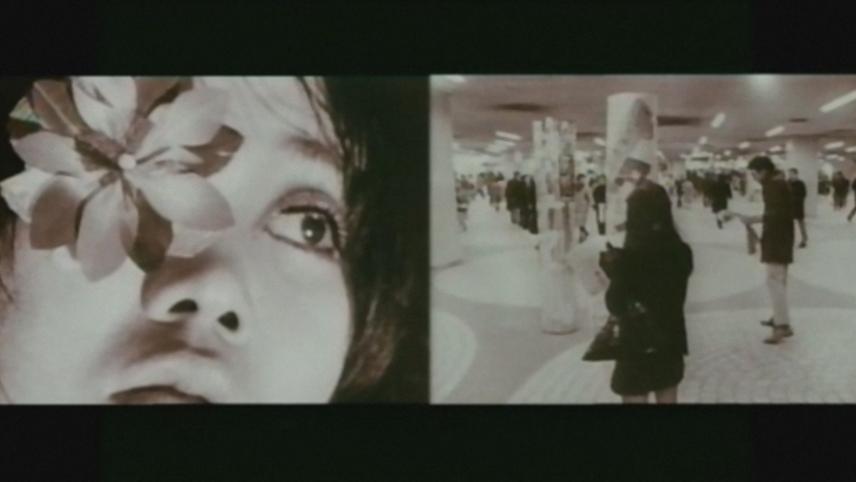Mathieu Capel
En ordre dispersé (du cinéma au Japon)
La dernière décennie a remis à l’honneur Wakamatsu Kōji et Yoshida Kijū, figures marquantes d’un moment historique dont le gros reste à réexplorer, tant l’histoire du nouveau cinéma japonais des années soixante reste dominée par l’axe Ōshima-Imamura. Le travail critique concernant les noms demeurés dans l’ombre de ce duo avait jusqu’ici surtout procédé de façon ad hoc, d’article en article. Manquait une approche plus globale. Les quatre cents pages d’Évasion du Japon, publié par Mathieu Capel aux Prairies ordinaires, entendent combler ce vide, tout en rebattant les cartes historiques (pour par exemple redorer le blason de Hani Susumu, jusqu’alors relativement marginalisé, ou démembrer des idées reçues comme celle d’une « nouvelle vague japonaise »).
Son mérite ne s’arrête pas là. Il a aussi su échapper à la forme canonique du déroulé des dates, faits et formes, élaborant à la place un quadrillage plus complexe de la carte sinueuse offerte par la décennie. C’est que sa méthode emprunte plus à la géographie qu’à l’histoire – de même, elle parle plus de pôles que d’écoles, et remplace les « faits de civilisation » par la trame des discours. L’objet premier du livre, dont les coordonnées sont données en introduction par les trois axes que représentent Adachi, Imamura, et Yoshida, ce sont les transformations du paysage japonais telles qu’elles se laissent saisir et théoriser par son cinéma. Tension au cœur du projet, donc, que ce pas-de-deux entre volonté de parler de cinéma, d’histoires des formes, et outillage intellectuel permettant avant tout de s’attaquer à l’histoire des espaces sociaux et économiques ; tension riche en potentialités comme en pièges, qui nous a donné l’envie d’explorer plus avant, avec l’auteur, ses partis pris analytiques et les débouchés de sa méthode.
Débordements : Vous ouvrez votre livre sur trois “scènes primitives” narrant les aventures d’Adachi, Yoshida et Imamura loin du Japon. Ces histoires d’exil racontent aussi la réalisation de documentaires, alors que le reste de l’ouvrage se concentre surtout sur des fictions. Faut-il en induire quelque chose quant à une fibre documentaire ayant innervé la production antérieure de ces cinéastes (ou d’autres) ? Et sinon, pourquoi cette légère marginalisation du documentaire, alors que le tournant des années soixante/soixante-dix en marque une certaine apothéose (avec Ogawa Shinsuke, Tsuchimoto Noriaki et Hara Kazuo) ?
Mathieu Capel : Déjà, le partage entre fiction et documentaire ne se constitue pas de la même façon pour les trois cinéastes dont il est question (Adachi, Imamura, Yoshida). Si l’on voulait distinguer très superficiellement, pour Adachi, documentaire = propagande ; pour Imamura, ce partage met en jeu l’intégralité de sa pratique cinématographique, de manière essentielle, viscérale ; pour Yoshida, c’est plus anecdotique et il ne se privera pas, dans des films tardifs, de recourir à des formes proches de ce qu’on nomme aujourd’hui « docu-fiction ».
En tout état de cause, le « documentaire » occupe une place centrale. Il est comme une forme « idéale » au cœur des théories développées par Matsumoto et Yoshida, entre autres. Pour eux, le cinéma se doit d’être documentaire, ce qui à aucun moment ne disqualifie la fiction dans la mesure où être « documentaire » signifie faire droit à la part éminemment subjective de l’acte créatif dans sa confrontation avec le « dehors ». On retrouve là le souci de Hanada Kiyoteru, théoricien capital, de proposer une forme d’art capable de subsumer naturalisme, abstraction et surréalisme. C’est aussi, en somme, ce que dit Adachi dans son journal libanais : on n’est « documentaire » qu’à rendre compte de ses incapacités devant le réel. Je ne crois pas, en conséquence, qu’on puisse invoquer la sortie d’un régime de fictions – pas de manière massive en tout cas, mais au cas par cas.
Par ailleurs, j’aimerais relativiser votre idée d’une apothéose du documentaire dans les années soixante et soixante-dix, avec Ogawa, Tsuchimoto, Hara, et Sato Makoto, les gens de Siglo, les anciens d’Iwanami, tant d’autres… De manière provocante, l’apothéose du documentaire, on pourrait aussi la situer pendant la guerre, sous le régime militariste, très volontariste en cette matière. Le nombre de documentaires produits alors, quelle que soit la qualité qu’on leur accorde (mais la figure d’un Kamei Fumio suffit à dire qu’il ne faut pas tout jeter), est non seulement colossal, mais défini au niveau étatique comme un réquisit (dans le cadre de la « loi sur le cinéma » de 1939). Soit dit en passant, le terme de « documentaire », utilisé de manière générique, n’est pas forcément idoine, parce qu’il n’est pas employé tel quel avant quelque temps.
Cela dit, vous mettez le doigt sur l’un des points douloureux de mon argumentaire. J’aurais voulu accorder une plus large part aux films d’Ogawa, Tsuchimoto, Tokieda, Kuroki, même Hani. Ce qu’il faut bien appeler une lacune (même si Ogawa, Tsuchimoto et Hani apparaissent dans l’ouvrage, à des places qui me semblent importantes) est lié à l’historique du livre. Quand j’ai commencé d’imaginer tout ça, leurs films n’étaient pas à ma disposition, même si je les avais vus pour beaucoup. Je suis tout à fait conscient de cette absence, c’est d’ailleurs ce pourquoi je travaille actuellement dessus, en m’intéressant aux films de promotion des années cinquante, dont sont issus ces cinéastes. Cela permettra, je pense, de qualifier d’une manière un peu différente l’émergence des théories « néo-documentaristes » de la fin des années cinquante – ces films de promotion sont bien plus importants qu’on pourrait le croire au premier abord.
D : Comment entendre ce titre, Évasion du Japon, qui d’ailleurs est aussi celui d’un film de Yoshida que vous évoquez sur la fin ? De quoi les cinéastes s’évadent-ils, et comment ? Parce qu’en dehors des trois scènes primitives, tous les films convoqués ont été réalisés sur le territoire national, qu’ils scrutent, arpentent, déconstruisent, au lieu de le congédier – surtout que l’idée de cadastre cinématographique, la cartographie du territoire et des lieux (paysages ou immeubles) semblent orienter l’essentiel de l’analyse.
M. C. : Ce titre est à la fois hommage, clin d’œil, vœu pieu et programme. L’emprunt à Yoshida est évident et revendiqué. C’est Yoshida qui, depuis le début, me fait courir, et il est pour beaucoup dans ce que j’ai tâché de développer. Au premier chef, d’ailleurs, par son exaspération (que je rejoins moi-même quant à ma position de « spécialiste » – là est le clin d’œil) vis-à-vis de ce « japonais » trop pesant, trop directif, trop biaisé. S’évader du Japon, c’est dire qu’il s’agit avant tout d’un pan de l’histoire mondiale du cinéma, de sa théorisation, de ses options ou développements esthétiques. Et que l’on soit dans une sphère japonaise ne prendra d’importance qu’à la condition expresse de n’être pas synonyme de déterminisme culturel. C’est un point important de ma thèse : inclure sa filmographie dans un cadre japonais, s’en réclamer (Imamura), revendiquer l’influence de son histoire des arts (Mizoguchi), est un mouvement aussi peu naturel que le mouvement inverse (s’en extraire à toutes forces). Ce sont des options volontaires, des positions esthétiques et politiques conscientes. On s’est trop souvent laissé aller à penser le cinéma japonais (intègre et unitaire) du point de vue d’une essence, au détriment d’une actualité japonaise. Quand tout un contingent de cinéastes, de penseurs et d’artistes se réclame de Sartre, il faut savoir en rendre compte sans supposer aucun procès d’« occidentalisation » dommageable pour je ne sais quelle « pensée spécifiquement japonaise ».
Pour répondre à la deuxième partie de votre question, je dirais que c’est aussi le cas d’Evasion du Japon, le film de Yoshida : jamais son héros ne quitte le sol japonais. Qu’est-ce à dire ? Que ce film est un formidable diagnostic du Japon en 1964. Regardez de nombreux films d’« évasion » (au sens carcéral). Pour vous échapper de votre prison, vous commencerez par établir un plan, vous tâcherez de savoir qui sont vos gardiens, vous noterez l’horaire des rondes et des relèves, vous tâcherez de savoir où la terre est plus meuble pour creuser. S’évader, c’est diagnostiquer, aller au plus près de ce qui enferme.
D : Au cœur de votre propos, il y a une critique du découpage générationnel, avec son lyrisme de la jeunesse quelque peu pénible, auquel vous opposez, sur les pas de Foucault, un argument épistémique, l’idée d’une « configuration épistémologique » ou d’un « espace discursif » permettant de comprendre autrement la rupture. Argument extrêmement séduisant, mais qui soulève plusieurs questions. D’abord celle du lien entre cette configuration et l’idée de « haute croissance » qui définit plus ou moins les bornes de cette époque ; cela ne revient-il pas à poser une détermination économique « en dernière instance », ou du moins à mettre les schémas esthétiques à la remorque des évolutions socio-politiques ? Et sinon, comment comprendre la solidarité de ces deux tendances ? Ensuite, de quelle cohérence est pourvue cette constellation ? S’agit-il d’un système réglé, homogène, ou d’un nexus plus flottant ? Comment concevoir l’unité de l’ensemble, et sa différenciation interne ? Quels seraient alors les traits marquant l’appartenance d’un film à cette épistémé ?
M. C. : Permettez-moi de commencer par la référence à Foucault, pour qui j’ai une admiration profonde sans en être spécialiste. Les Mots et les choses ont eu pour moi une importance capitale en tant que stimulation théorique ou « fiction heuristique ». Mais je crois que mon type de propos se situe justement dans ce que Foucault condamne dans les pages assassines que L’Archéologie du savoir réserve à « l’histoire des idées ». Je parle de Weltanschauung, de vision du monde, de ce qu’il récuse. Me réclamer de sa pensée serait illégitime. C’est peut-être pourquoi je n’ose pas trop employer ce mot d’épistémè. Mais avec cette idée d’espace discursif, j’ai voulu élaborer quelque chose qui tende dans cette direction, à défaut de s’en approcher.
De fait, j’emprunte l’expression à Karatani Kôjin, dont Les Origines de la littérature japonaise moderne a aussi été déterminant. Mais de cet « espace discursif », il ne donne pas de définition très claire, ce qui m’a laissé la possibilité de proposer quelque chose d’un peu libre. L’hypothèse me permettait surtout de contrecarrer l’idée de mouvement ou d’école, qui me semble très déficitaire en regard de la diversité et de la complexité du renouvellement du cinéma japonais, et qui obligerait à compter ceux qui en sont (ou non). L’espace discursif contourne cela en proposant une autre forme de groupement, élargi et divers.
Parce que tous les cinéastes font face aux mêmes phénomènes, ceux que je rassemble sous ce label de « haute croissance », qui certes renvoie à des considérations économiques ou socio-politiques, mais tout aussi bien intellectuelles, philosophiques et esthétiques. Pourquoi ces termes, qui, de mon point de vue, sont interchangeables avec l’idée d’« entrée dans une société de consommation et de communication de masse » ? Déjà parce que, tout bonnement, ils sont ancrés dans le lexique historiographique du Japon. Ensuite parce qu’il fallait me délester de ces « années soixante » (pourtant en couverture du livre), périodisation pratique mais arbitraire, et ignorante des dynamiques à l’œuvre. Le label propose donc un autre découpage que ce compte en décades auquel recourt trop souvent, et trop facilement, l’histoire du cinéma.
Par ailleurs, on ne peut pas négliger la compénétration des phénomènes économico-socio-politiques (et autres -co) et de la création cinématographique, surtout à l’heure des médias de masse – le cinéma ne fournit pas à lui-même ses propres lois. Je dois être un matérialiste, ce qui ne veut pas dire que je congédie l’analyse esthétique. Le but n’est pas de placer le cinéma à la remorque de l’évolution des mœurs ou de l’urbanisme, mais de penser un ensemble. Le philosophe Nakai Masakazu ne dit pas autre chose, d’ailleurs, avec ses « espaces-schémas » : le cinéma in-forme le monde en même temps qu’il en est in-formé. Le problème, alors, est celui de la cohérence de cet ensemble qui ne forme pas pour autant un système stricto sensu.
Problème lié à celui du nombre et de la représentativité. Entre 1958 et 1960, la production cinématographique japonaise compte environ 1500 films. Sur la période qui m’occupe, on dépasse les 8000 – que je suis bien sûr loin d’avoir tous vus. Que faire, dès lors, de tout cela ? Abandonner toute ambition, ou bien s’engager dans les chemins minés des « grands maîtres », des « cinéastes les plus japonais » ? Ni l’un ni l’autre : essayons de penser un modèle opérant, dynamique, mais ouvert, indéfiniment augmentable et susceptible d’accueillir chaque film, du meilleur au plus mauvais, du plus progressiste au plus réactionnaire. Indéfiniment augmentable, sauf en ses « pôles » : je crois qu’il y en a trois, tout en ayant le soupçon d’un quatrième, sans pouvoir encore l’affirmer.
Ces trois pôles correspondent schématiquement à Adachi, Imamura, Yoshida, qui ont porté ces logiques à leur extrémité, au moment où elles deviennent véritablement irréconciliables entre elles (certains les réconcilient, c’est tout l’intérêt de la synthèse de Hani dans Elle et lui). Pour les résumer :
1/ une logique d’espaces « clos », décrivant le monde sous le schème général d’un affrontement binaire, dual : ce peut être le schéma reconduit de la lutte des classes, mais aussi une armée déployée contre une mite géante ou un samourai venu venger le suicide contraint et cruel de son gendre. Motif de la lutte et de l’oppression, de la menace, de la protestation, de la résistance, de la révolte.
2/ des espaces « forclos », exclus, ségrégués, refoulés : des ghettos, mais aussi des pulsions incontrôlées de violence, du désir, tout un ensemble irrationnel au regard de ce qu’on définit alors par rationalité.
3/ des espaces « ouverts », déconnectés les uns les autres, qu’il faut assembler, « agencer ».
Ces pôles sont aussi des modes de signification. L’espace clos des affrontements déploie une logique allégorique, puisque tel combat singulier s’avère en réalité faire signe vers un combat symbolique contre une entité autrement plus englobante. Les espaces forclos appellent plutôt un schéma conique : le présent est la pointe apparente d’un volume enfoui, originaire, qu’il faut excaver pour saisir le pourquoi et le comment de cet affleurement – stratégie « herméneutique », exégétique, pour laquelle il y a un code, une origine cachée à débusquer. Les espaces ouverts enfin, renverrait à une ligne brisée dont il faudrait joindre les bouts pour produire du sens de manière intensive et différentielle, pour redonner du relief à ce qui se feuillette et s’aplanit à perte de vue.
La haute croissance se définit ainsi, et définit sa cohérence, en tant que « contemporanéité » : contemporanéité de tendances contradictoires, avec leurs logiques et leur temporalités propres. Jameson en parle dans L’Inconscient politique quand, à propos de Poulantzas, il déclare que toute formation sociale consiste en la superposition, la coexistence structurale de plusieurs modes de production, dont certains plus anciens, d’autres latents, anticipatoires. Ce qui implique qu’il est impossible de rendre compte d’un état du cinéma à une période donnée sans faire cas de cette multiplicité en constante dispersion. La haute croissance, ce sont, en même temps, des novateurs (Matsumoto) et des vieux barbons (Kurosawa), des anciens toujours révolutionnaires (Ozu) et des jeunes réacs (Yamada), des nouvelles vagues et du cinéma de papa, des visionnaires et des aveugles. Et tous sont en discussion, tous sont sommés, qu’ils le veuillent ou non, de se positionner par rapport à ces pôles qui indiquent dans quelles directions ils se dispersent tendanciellement les uns les autres.
Les « pôles » sont, encore une fois, des positions limites, pas des emblèmes, et en cela ils se trouvent au-delà de toute représentativité : je connais très peu de films parents d’AKA Serial Killer, par exemple. Je ne prétends donc pas faire système, bien au contraire, mais dessiner un plan (au sens géométrique). Et pour cela, il faut un minimum de trois points, à ceci près qu’ils sont autant de bornes traçant les limites en-deçà desquelles adviennent les films. Mais ce sont des pôles parce qu’ils sont « magnétiques », réglant la tension générale de la trame sans qu’aucun film échappe à leur champ (ce pourquoi j’envisage tout de même qu’il puisse y avoir d’autres pôles, que je cherche encore sans succès – peut-être les films expérimentaux, « stroboscopique », de Matsumoto).
D : D’ailleurs, au vu du corpus le plus central (de Imamura, né en 1926, à Wakamatsu, né en 1936), le concept de génération ne risque-t-il pas de faire retour ? Et ne permet-il pas d’expliquer pour partie les spécificités de la galaxie ATG au sein d’un environnement où des grands maîtres (Kurosawa, Uchida) continuent à s’emparer de sujets sociaux de façon critique ?
M. C. : Il fait retour, mais de manière subordonnée. L’importance d’Oshima, c’est d’affirmer cela (avant de revenir dessus) : qu’on est jeune tant qu’on est révolté, ce qui lui permettait de dire qu’à quarante ans il était plus jeune que tous les gosses de vingt ans. L’appartenance à telle génération se décide donc sur les bases d’un ethos et non en fonction de classes d’âge. Ce pourquoi Miyuki, l’héroïne des Contes cruels de la jeunesse, passe grâce à Kiyoshi d’une génération à l’autre sans attendre le nombre des années. Quant à ceux passés par ATG, je ne les considère à aucun moment de manière unitaire. Shinoda et Yoshida n’ont rien à voir ensemble. Et si Imamura contribue à définir avec Evaporation d’un homme le fonctionnement d’ATG au moment où ils commencent à produire des films (en répartissant les frais entre eux et les cinéastes), il n’a par la suite pas tourné dans ce cadre. Aussi ne suis-je pas certain de l’intérêt de parler d’une « galaxie ATG ».
D : Dans la chaîne des synonymes, vous privilégiez celui d’« espace discursif ». Expression étrangement logocentrée pour un écrit sur le cinéma. Foucault l’utilisait pour désigner le champ du pensable dans une configuration donnée ; comment traduire ce schéma dans le domaine cinématographique ? Serait-ce à dire que cet espace circonscrit les possibles audiovisuels à une époque spécifique ? Que, donc, le filmable obéirait aux mêmes principes que ceux délimitant la pensée ? Quels seraient alors les principales caractéristiques, les éléments reconnaissables de cette configuration ?
M. C. : Je pars de l’hypothèse qu’un film produit du discours avec ses propres outils, qu’il produit de la pensée de manière verbale aussi bien que non-verbale. Proposition certes vague, n’en déplaise aux cognitivistes, sémioticiens et autres gens sans doute plus rigoureux sur ces questions. En disant cela, j’entends suggérer que ce qui met un film en tension, ce avec quoi il converse, ce peut être un film, mais pas forcément : un livre aussi, ou une théorie, une pièce, une performance, une installation, un programme politique, une configuration urbaine, un plan d’architecte (inversement et par exemple, la Théorie du drone de Chamayou n’en dit-il pas plus sur le cinéma contemporain que d’autres ouvrages de cinéma ?). Bref, j’imagine qu’un film prend place dans « la vaste trame des discours », pour soutenir, modifier, s’inscrire en faux, etc., contre, avec ou à l’inverse d’autres discours qui s’énoncent via d’autres langages ou médias. Et que c’est cette communauté-là, en tant que « discours », qui leur permet de s’enclencher les uns les autres. Ne pas vouloir voir, pour raison de cohérence disciplinaire, ce que la tour Nakagin de Kurokawa, avec ses capsules amovibles, partage avec Teshigahara ou Yoshida, c’est se priver de quelque chose d’essentiel. Il faut donc imaginer cela – et c’est peut-être une violence théorique –, qu’un « discours », une pensée de pellicule réponde, avec son propre chant, à un « discours », une pensée de béton et d’armatures métalliques, selon des fréquences qui peuvent être les mêmes, ou pas.
D : On comprend que c’est pour ces raisons que vous confrontez sans cesse les films aux textes philosophiques de l’époque. Par contre, les autres arts n’ont de présence qu’en sourdine. Pourquoi ? Est-ce parce que leur temporalité propre fait qu’ils n’ont pas connu à la même époque cette « rupture épistémique » que vous analysez ? N’y avait-il aucun lien solide entre le milieu du cinéma et les autres champs ?
M. C. : Sans doute l’importance (légitime) que j’accorde à Nakai crée-t-elle une illusion d’optique. Je n’ai pas l’impression d’avoir tant sollicité la philosophie que ça. Par exemple, Yoshimoto, que j’évoque au détour d’une page, est, en termes de reconnaissance, un philosophe bien plus important que Nakai, qui reste mineur. Karatani est lui aussi reconnu, et j’en ai plus d’usage que Yoshimoto. Mais on ne saurait dire qu’Evasion du Japon donne un aperçu des pensées philosophiques d’après 1950. Les nombreux textes que je cite – avec la volonté revendiquée de « documenter », pour compenser notre ignorance des penseurs du Japon – ressortissent pour la plupart au cinéma (écrits de cinéastes ou de critiques). Comme je le dis très vite au début du livre, il s’agit d’établir un diagnostic de la haute croissance du point de vue de la création cinématographique : et de ce point de vue-là, justement, il y avait déjà beaucoup à faire, à dire et à analyser.
Mais j’essaie d’ouvrir ce diagnostic à d’autres disciplines : ce sont notamment les « extrapolations » de la toute fin. De même qu’en faisant dialoguer Yoshida avec le critique d’art Miyakawa Atsushi, Imamura avec l’ethnologue Yanagita Kunio, Hani avec la sociologie (dans une version antérieure, il dialoguait aussi avec l’architecte Tange Kenzô), Naruse et Shinoda avec la critique littéraire, j’essaie de faire signe à ces autres champs d’expression : parce qu’il y a des échos évidents entre l’idée de « granularité » et les pièces de Kusama ou Nakanishi, comme il y a un décalage intéressant, sans doute fertile, entre les espaces domestiques, professionnels et médians de la sociologie, et les espaces clos/forclos/ouverts du cinéma. Mais je n’ai pas assez arpenté ces champs-là pour en avoir une connaissance suffisante. En tout cas, les liens sont évidents, très visibles – au moins autant, si ce n’est plus qu’en France. Les pratiques de Matsumoto, Teshigahara, Oshima ou Adachi revendiquent une profonde diversité, qui se nourrit d’un incessant commerce avec les arts plastiques, la danse, la littérature, la philosophie. Et la musique : Takemitsu, Ichiyanagi, Takahashi, Yuasa… ces compositeurs des musiques de très nombreux films sont tous à la pointe de la création expérimentale.
En tout état de cause, des lieux comme le Sôgetsu Art Center et la salle principale du réseau ATG, le Shinjuku Bunka Hall (avec au sous-sol, le petit Sasoriza), suffisent à montrer que l’effervescence des années soixante traverse tous les arts, et je crois à une circulation réelle entre les champs, au-delà même des collaborations que le cinéma, par sa nature collective, entraîne volontiers.
D : Comment, armé de ces principes, avez-vous organisé la composition de l’ouvrage ? Parce qu’il ne suit en rien une progression linéaire, fonctionne plutôt par séries divergentes de cases ou fragments.
M. C. : Le mouvement de l’ouvrage est indiqué par l’intitulé de ses grandes parties ; soutènement, serpentement, dispersion. On dame le terrain, on prend son élan, on saute. Serpenter : visiter de manière arbitraire, rhapsodique, au petit bonheur la chance, les films disponibles, les trier mais pas trop, en sacrifier certains, afin de rassembler un ensemble de motifs convergents et/ou récurrents : oppression néo-féodale, déterminisme, road-movie, médias de masse, nudité érotisée, fluidité, etc. Sans vouloir m’en tirer à trop peu de frais, « serpenter » ainsi, n’est-ce pas ce que font nombre d’ouvrages « synthétiques » sur les filmographies nationales ? Ouvrages qui oscillent entre un inventaire dénervé, la juxtaposition d’une diversité de films qu’on va classer par dates, studios de production, thèmes et genres (Sato Tadao), et un système clos souvent essentialiste rapportant tout à des « spécificités » nationales (Noël Burch).
Bref, après avoir serpenté, il fallait innerver tout ça. Ce pourquoi j’ai introduit l’idée de dispersion. Il y a très longtemps, j’envisageais de procéder par motifs – par exemple le road-movie –, contre toute idée auteuriste. Mais je me suis retrouvé à devoir payer un tribut à ce genre d’approches : l’événement de cet ensemble cinématographique, ce n’est pas la multiplication des road-movies, c’est que le road-movie s’impose selon trois axes. Il y en a un qui part rencontrer les frontières physiques du Japon pour dire : au terme du voyage, je découvre une limite homothétique de celle sur laquelle je butais au départ (Le Petit garçon d’Oshima). Un autre voyage pour trouver une forme de vérité originaire (Imamura, I Hate but love de Kurahara). Un autre enfin voit le territoire se disloquer à mesure qu’on taille la route (Evasion du Japon de Yoshida). Et c’est pareil pour le nu érotisé, ou le sexe, si vous préférez. Pour certains, le sexe est l’exercice d’une domination, l’aveu d’une inégalité foncière, voire d’une exploitation : sévices unilatéraux de L’Embryon de Wakamatsu. Pour d’autres, la pulsion sexuelle répond d’un traumatisme originel, il est atavique, c’est une tare zolienne : Imamura et ses incestes, ses cicatrices, ses débiles légers. Pour d’autres enfin, faire l’amour c’est se perdre, se dissoudre et découvrir là où je rencontre autrui une aire (un terrain d’entente) sans mesure avec l’espace mondain (Yoshida). A partir de ce moment-là, il m’a semblé opportun de rétrograder ces motifs à une place subalterne, en tant qu’ils sont déterminés par des fractures plus profondes – clos, forclos, ouverts, donc.
D : Un des passages les plus forts pose l’idée d’une nouvelle « granularité » cinématographique. Désigne-t-elle un régime sensible, un modèle théorique ? L’ensemble de ce cinéma y appartient-il ? Que vous aide-t-elle à penser ?
M. C. : La haute croissance se définit de mon point de vue par la « coexistence structurale » de logiques coercitives ou d’exploitation (certains disent néo-féodales), de logiques d’exclusion (forme de coercition relevant plus d’une volonté d’éradication que de l’exploitation), et donc d’une instance « granulaire ». C’est cette instance qui est nouvelle, fondamentalement : elle exprime le capitalisme urbanisé de la société de consommation/communication de masse. C’est en ce sens qu’il faut parler de « temporalités » différentes : les logiques coercitives sont millénaires, tandis que les séries, les panoplies du granulaire, sont jeunes et se diffusent à grande vitesse. Dès lors, elle reconditionnent les logiques coercitives et exclusives, qui existaient déjà avant, mais trouvent une place nouvelle. Relativement, elles n’ont pas la même signification qu’après-guerre, ni que, à plus forte raison, pendant la guerre. On change d’espace discursif dès que s’impose cette instance granulaire, condition nécessaire mais jamais suffisante pour décrire ce qui arrive. Car il faut faire droit aux vieilles analyses, qu’on les juge valides ou non : peu importe, tant qu’elles ont cours.
Cela étant, j’aimerais souligner quelque chose que je n’ai pas assez souligné dans le livre. J’ai adopté cette idée de « granularité », d’après Teshigahara, pour dire la série, la panoplie, le numéraire, la superficialisation, l’uniformisation. Pour dire aussi la fractalité du monde, et la disqualification (de facto, pas de jure) de l’idée de transcendance. Mais fondamentalement, ce dont je voulais rendre compte – effroi, effarement – c’est le stade où nous sommes et qu’affrontaient déjà les cinéastes de l’époque : un stade de réversibilité infinie. C’est Le Sang séché de Yoshida : une tentative de suicide en signe de protestation devient une martingale publicitaire. C’est la fin de l’affaire Kim Hiro, qui gagne une tribune médiatique pour ses idées, mais se fait prendre par des policiers déguisés en journalistes. C’est l’un, le hapax, qui se retrouve dans une série de hapax. Le cul libertaire et transgressif, qui est exploitation et manne financière. Etc. Ceux qui liront ce livre seront peut-être déçus, et trouveront que je ne fais pas assez de place aux irrévérences du pink, à la libéralisation des mœurs, aux combats contre censure et réaction : mais c’est que pour moi, l’avènement incontestable du nu érotisé dans les années 1960 est fatalement bifrons (non : trifrons).
D : Votre livre avance sur deux fronts: d’un côté, un axe porté par la cinéphilie, avec une concentration sur certains auteurs, et une exploration des théories de l’époque qui mettent l’accent sur le rapport entre film et subjectivité du spectateur ; de l’autre, une approche plus “japonisante”, qui consiste à s’intéresser à un film moins pour les affects qu’il induit que pour ce qu’il nous dit de la société japonaise et des antagonismes qui la traversent. Comment s’articule pour vous la relation entre ces deux modes de lecture très différents, l’un cinéphile, l’autre « civilisationnel » ?
M. C. : Pour moi, c’est au plus loin de l’analyse structurale du film, lorsqu’on atteint à ce qui semble être sa mécanique fondamentale, parfois secrète, apparemment déprise de toute considération historique ou contextuelle, que se livrent paradoxalement les clés pour lui donner la place qui lui revient dans les paysages cinéphilique et culturel. Si comme je l’avançais plus haut, le cinéma ne fournit pas à lui-même ses propres lois, cela ne signifie pas pour autant qu’un film ne puisse obéir à des règles propres. Par exemple, on s’est doublement mépris sur Ozu, d’une part en pensant que son cinéma dépendait d’invariants « civilisationnels » alors qu’il était en train de ménager pour lui-même, dans l’histoire et la pratique cinématographiques, un espace sans pareil ; d’autre part, en ignorant que la « combinatoire » de ses films dès Printemps précoce en 1956, ce fonctionnement apparemment très autarcique, fournissait en fait un diagnostic pénétrant des évolutions en cours avec l’avènement d’une société de consommation de masse. Cette intrication est délicate à situer, j’ai l’impression que chaque film s’inscrit comme il l’entend dans son contexte, selon des modalités chaque fois très différentes.
Ce pourquoi aussi le genre est trompeur : comme je le suggère en guise d’« extrapolation » finale, les films de yakuza de Fukasaku n’obéissent pas du tout aux mêmes principes que ceux de Suzuki, leur proximité thématique et générique est un leurre. Mais c’est donc une fois qu’on a dégagé leur structure propre, et pas avant, qu’il est possible de les entendre résonner avec certaines données contextuelles. Articuler ces deux extrêmes de l’analyse permet d’affiner le crible des différences. Le rythme de l’ouvrage répond de ce principe, me semble-t-il, entre traits historiques et culturels, et plongées au cœur des films.
En tout cas, ce sont les films eux-mêmes qui me guident dans le vaste labyrinthe culturel du Japon, jamais l’inverse : comme a pu le dire Roland Barthes, dans l’expression « cinéma japonais », le fait « cinéma » est beaucoup plus important que le fait « japonais ».
Images : Eros + Massacre (Yoshida Kijū, 1969) / Le Chant des pierres (Toshio Matsumoto, 1963) / Go, Go Second Time Virgin (Wakamatsu Kôji, 1969) et A.K.A. Serial Killer (Adachi Masao, 1969) / For My Crushed Right Eye (Matsumoto Toshio, 1968) / Jetons les livres, sortons dans la rue (Terayama Shūji, 1971).