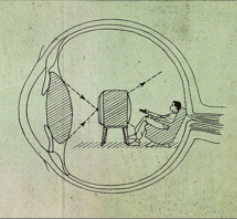Nomadland, Chloé Zhao
Sans histoire
Nomadland commence par un carton : après la fermeture de sa mine, au début des années 2010, la ville d’Empire, Nevada, s’est vidée de ses habitants et a été rayée de la carte. Une année durant, nous suivrons alors Fern (Frances McDormand), veuve et quinquagénaire mise au chômage, forcée de sillonner les États-Unis à bord de son fourgon, errant d’emplois temporaires en petits boulots saisonniers.
D’emblée, le film s’attache à mettre en avant les contingences matérielles, aussi bien physiques, climatiques et mécaniques de cette vie itinérante. L’un des premiers plans nous montre Fern uriner en bord de route, se tenant à une clôture. Lors d’un rassemblement de nomades, une vieille routarde insiste sur ce point : l’une des clefs de la réussite, c’est de savoir « gérer sa propre merde ». À deux reprises, Fern est filmée assise sur son seau, et c’est tantôt l’odeur, tantôt l’irruption d’un gêneur importun qui la dérange sans son minuscule habitacle. Au sein de celui-ci, elle devra aussi faire avec le froid et le manque d’espace qui oblige à optimiser le moindre rangement, ou à dormir recroquevillée sur elle-même. De même que The Rider, le précédent film de Zhao, s’ouvrait sur les blessures inscrites dans la chair à spectacle de l’industrie du rodéo, Nomadland s’attarde sur ce que le néo-libéralisme fait aux corps de ces salariés perpétuellement en transit, qui « choisissent » leur prochaine destination en fonction du parking que l’employeur leur met à disposition[11][11] Sur les difficultés récentes du syndicat de la grande distribution, Retail, Wholesale Department Store Union (RWDSU), à s’implanter à Amazon, on lira avec intérêt Maxime Robin, “Pourquoi les syndicats américains ont perdu face à Amazon”, Le Monde Diplomatique, Mai 2021..
Mais à la différence de Brady, cavalier traumatisé voyant sa main lui désobéir de plus en plus après son accident, les corps malmenés ici ne sont plus des corps jeunes, mais des corps usés par une vie de labeur : les voyageurs regroupés à Quarkzsite sont pour la plupart des personnes âgées, n’ayant pu épargner suffisamment pour prendre leur retraite, et contraintes de vivre en mobile-home de fortune. Une visite de Fern et de ses amies lors d’un salon du tourisme souligne d’ailleurs l’écart entre leur mode de vie imposé par la nécessité économique, et l’idéal du camping-car américain. Lors de ces rencontres, Bob Wells, défenseur de cette existence minimaliste, la présente d’emblée comme « un canot de sauvetage », une manière de rebondir face à la « tyrannie du marché » qui, en l’absence de filet de sécurité, les a menés à cette précarité.
Ces rassemblements sont aussi un moyen pour ces individus isolés de former une communauté, en partageant des connaissances empiriques et en refondant une culture de la route, notamment autour d’un feu de camp. Récurrents chez Zhao, ces moments de sociabilité et de discussion collectives permettent aux personnages de retisser des liens avec leur passé, en consolidant une mémoire commune : dans Les chansons que mes frères m’ont apprises (2015), une grande fratrie s’assoit autour des flammes et dessine à travers ses souvenirs épars le portrait fragmentaire du père disparu ; dans The Rider, dont l’un des acteurs fait d’ailleurs une apparition fugace, les cow-boys évoquent leurs blessures, et les souvenirs du plus intrépide (et plus grièvement blessé) d’entre eux. Ici, un premier feu de camp sera l’occasion de faire le deuil de sa vie d’avant, de présenter le parcours de ces migrants d’un nouveau genre. Fern, quant à elle, porte le deuil de son mari, et contemple régulièrement les photos de leur vie passée.
Notons que cette communauté ne dure qu’un court moment, chacun repartant de son côté, vers d’autres promesses salariales. En l’absence de travail, le corps social se délite – à l’image de la mal nommée Empire – et l’histoire ne fait plus sens. L’histoire nationale, à l’image de ce Mont Rushmore en carton pâte devant lequel Fern se prend en photo ou du dinosaure synthétique, mascotte d’une chaîne de fast-food, n’est plus qu’argument publicitaire pour attirer le chaland, histoire de pacotille que mettait déjà en scène les rodéos. De la même manière, la sœur de Fern se trompe doublement quand elle la compare aux pionniers et inscrit son existence dans la tradition américaine : d’abord parce qu’elle fait de sa sœur une conquérante, alors que celle-ci ne peut que louer ses bras aux véritables conquérants que sont Amazon et consorts ; ensuite, parce que son rapport au territoire n’est pas celui de la prédation, mais de la contemplation, à l’image de ce bison croisé par hasard, source d’émerveillement pour la conductrice.
Le film semble indiquer une autre parenté, lorsque Fern, en robe blanche, traverse une ville fantôme : on pense immédiatement aux devantures de Walker Evans, et plus généralement aux productions de la Farm Security Administration. C’est alors moins l’histoire glorieuse de la colonisation de l’Ouest que celle des victimes de la crise de 1929 (celle de 2008 est d’ailleurs explicitement citée par les personnages) qui remonte à la surface. Comme chez Evans, la cinéaste s’attache à filmer les visages, la vaisselle, les objets et les intérieurs des camions de Swankie, de Linda May, et des autres, qui jouent ici leur propre rôle.
Et pourtant, c’est encore vers une autre direction que Zhao nous emporte. L’un des enjeux du film semble en effet de nous faire passer de l’urgence caractéristique de la vie prolétaire – le temps de la reconstitution journalière de la force de travail -, à la quête d’un absolu immémorial. Au début, Fern croise par hasard une ancienne élève dans un magasin de sport, qui lui récite une citation de Macbeth : « — Demain, puis demain, puis demain — glisse à petits pas de jour en jour — jusqu’à la dernière syllabe du registre des temps : — et tous nos hiers n’ont fait qu’éclairer pour des fous — le chemin de la mort poudreuse. Éteins-toi, éteins-toi, court flambeau ! »[22][22] William Shakespeare, Macbeth, Acte V, Sc. 2.
Commençant comme une succession de « demain » sans autre fin que la quête de sa subsistance, la trajectoire de l’héroïne s’élève ensuite pour côtoyer une autre temporalité, au-delà de l’histoire des hommes. Plus le récit avance, et plus Fern tend en effet à faire corps avec le territoire, en son sens le plus géologique. Lors d’une soirée autour d’un télescope, un astronome explique que les atomes des météorites de Jupiter tombées sur terre font désormais partie d’eux ; et au cours d’un autre feu de camp, on rendra hommage à Swankie en jetant en son nom des pierres dans le foyer, la caméra panotant pour suivre les étincelles montant vers le ciel. Qu’elle regarde le monde au travers des trous d’un caillou, ou qu’elle s’échappe d’une visite guidée pour se perdre au milieu des concrétions rocheuses, Fern oppose au devenir-flux du marché du travail un devenir-pierre, une mise en jeu de son corps et de son esprit qui la rendent particulièrement disponible à éprouver son environnement sensible.
La force des longs métrages de Zhao est ainsi de tenir une dialectique entre déterminismes sociaux, débrouille inhérente à une condition précaire, et élévation spirituelle, par la découverte d’un autre sensible. Le couturier tatoué des Chansons perpétuait à sa manière, dans un art pauvre, les traditions et la culture de ses ancêtres ; le dilemme de Brady repose sur la tension entre la plénitude éprouvée en chevauchant les grands espaces, la transmission familiale d’un talent pour le dressage, et le risque que ces vocations passionnelles font peser sur sa vie. Ici, le goût pour la liberté et l’indépendance de Fern se heurtent aux caprices de son fourgon décati ou à sa santé défaillante. Peut-être est-ce là que la filiation avec Evans se fait la plus prégnante : de même que les fermiers photographiés pouvaient témoigner d’un sens artistique indissociable de leur environnement et de leur pratique, Fern développe un autre rapport au sensible, apprenant à jouir d’un paysage, du contact d’un sequoia, ou de l’immersion dans une source d’eau. Pour autant, contrairement aux œuvres de Malick par exemple, le saut dans l’absolu n’est jamais qu’une parenthèse, et le mérite de Nomadland est peut-être de parvenir à cet équilibre entre immanence et transcendance, aussi instable que la vie matérielle de son personnage.
C’est au prix de cet exercice de funambulisme que Fern parviendra à prendre le contre-pied du Sonnet 18 de Shakespeare, qu’elle récite à un jeune hobo croisé en chemin : dans ce poème, l’auteur oppose à la fugacité de l’été l’éternité de son amour, dont les souvenirs demeureront à jamais, du fait d’avoir été traduit en poésie. À l’inverse, Fern, qui a déclamé ces vers à son mariage, parvient à surmonter les souvenirs de son mari défunt, pour mieux épouser la beauté du monde, par-delà les saisons qui passent, par-delà « le cours changeant de la nature ». Et, à défaut d’y construire une maison, d’en faire tout entier son foyer.
Sortie le 9 juin 2021
Scénario : Chloé Zhao, d'après l’œuvre de Jessica Bruder / Image : Joshua James Richards / Montage : Chloé Zhao / Musique : Ludovico Einaudi.
Durée : 108 minutes.