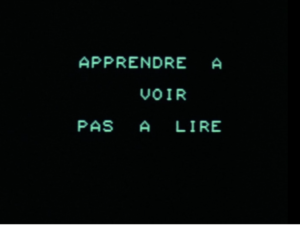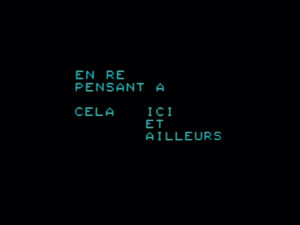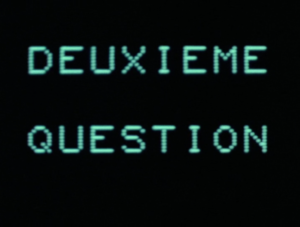Oui, Nadav Lapid
Oui ? Non ? Peut-être ?
Avant que le film ne prenne une telle ampleur médiatique et alimente les discussions avec beaucoup de contradictions, nous avions le projet d’évoquer Oui, dernier long-métrage de Nadav Lapid. Lors de sa sortie, le film a bénéficié d’une couverture médiatique inédite pour son auteur, salve critique qui laissait présager d’un succès public. Entre-temps, Oui a cristallisé un certain nombre de tensions, au cœur desquelles plusieurs appels au boycott relayés par le Festival Ciné-Palestine et le collectif La Palestine sauvera le cinéma, rappelant que le film a été produit par l’Israeli Film Fund et sert l’influence culturelle d’Israël. Ce para-texte a finalement réduit les possibilités d’échanger sur le film lui-même, dont les principes soulèvent déjà un certain nombre de questions.

Élias Hérody : Dans la culture internet, une mauvaise blague portant sur des sujets graves se voit régulièrement reprochée qu’elle arrive trop tôt, « too soon » en anglais, cela pour dire que la formule et le contenu de la boutade importe moins que le contexte dans lequel elle est exprimée. Du contexte, Oui en est forcément tributaire, en l’occurrence, le contexte du génocide à Gaza et les traumatismes de l’offensive du 7 octobre 2023 en Israël. Too soon pourrait cependant se dire de cette société israélienne farcesque, décrite dans le film, qui semble ignorer le traumatisme du 7 octobre pour se satisfaire de débauches et d’excès. Oui est un film qui arrive indéniablement trop tôt, après le 7 octobre, mais surtout, too soon me semble la locution appropriée pour situer Oui dans l’œuvre de Nadav Lapid, un film finalement peu surprenant, où le réalisateur israélien réitère des automatismes de mise en scène (novateurs si on ne les avait jamais vus auparavant) qui ne lui permettent aucunement de s’extraire des limites structurelles de son regard, de sortir de ses oeillères. Quatre ans séparent Le Genou d’Ahed de Oui, entre lesquels le style de Nadav Lapid, radical en 2021, devient presque un réflexe – sous couvert de montée en puissance.
En effet, Nadav Lapid se dirige de plus en plus vers un sentiment d’urgence. Dans le cas de Oui, le cinéaste a abandonné un projet de film pour lequel il avait obtenu des subventions avant le 7 octobre 2023 – c’est la raison pour laquelle, parmi les financeurs, figure l’Israel Film Fund. Tourné dans l’année suivant l’attaque du Hamas, entre avril et juin 2024, le film est dès lors habité par son contexte immédiat, l’hyper-présent d’un territoire, Israël, qui se conjugue désormais au passé pour Lapid (le réalisateur a fait le choix d’immigrer en France au début des années 2020). Là où son cinéma était jusqu’alors peuplé d’alter egos (Yoav dans Synonymes, Y. dans Le Genou d’Ahed) attachés à ses traits biographiques, à commencer par sa relation avec sa mère, Nadav Lapid est plus loin d’Y., le personnage principal de Oui, sorte de clown-escort pour les élites israéliennes, incarnation d’une validation totale du régime à qui on propose d’écrire le nouvel hymne pour un Grand Israël.
D’emblée, par le prisme d’un recueil de caricatures du peintre allemand Georges Grosz, le film tend à la société israélienne un miroir déformant, poussant les curseurs de son propre cinéma à l’extrême : la caméra libre devient une sorte de shaky cam qui, additionnée à une musique techno tonitruante, bouscule les vues de la paisible Tel Aviv, important le conflit comme un tremblement de terre. De même, les annonces des victimes gazaouies de bombardements israéliens sont accompagnées de sons assourdissants. Tous ces procédés, finalement assez simples et grossiers, participent d’une même dynamique : celle d’une haine absolue d’Israël qui, chez Nadav Lapid, prend la forme d’une laideur hyperbolique, exagérée. C’est là l’enjeu de toute cette débauche : le pays ne s’apparente désormais plus qu’à cette grande galerie de monstres, que Lapid habille de vulgarité comme si c’était en termes esthétiques qu’il fallait abjurer Israël.
En trois parties, le film observe une trajectoire dialectique et, plantant son décor à Tel Aviv pour sa première heure, donne son envers dans une deuxième située dans les territoires occupés et au bord de Gaza bombardée. C’est comme si le film suivait les lieux du projet colonial israélien, s’installant dans sa dernière partie sur l’île de Chypre, convoitée par le régime. Ces trois actes observent ainsi des ruptures de ton : à la succession de scènes de danse du premier mouvement succède une lenteur où priment les dialogues, voire les monologues à l’instar de celui de Leah, amour de jeunesse d’Y. devenue propagandiste sur les réseaux sociaux qui liste les crimes commis par le Hamas lors du 7 octobre et en singularise les morts. En résulte une structure formelle et thématique en oui-non-peut-être, comme pour appuyer la portée philosophique d’un film pénétré de réflexion morale.
À cela s’ajoute une forte charge provocatrice qui explose au milieu du film, lorsque Leah et Y. se rendent à la « Colline de l’Amour » où ils profitent d’une vue imprenable sur Gaza. D’abord seul, habité par une rage intense, Y., à qui son amour de jeunesse a récité les méfaits du Hamas, se met à chanter son hymne génocidaire – repris d’un chant propagandiste de 1948 que Nadav Lapid a fait chanter à une chorale d’enfants, peu de temps après le 7 octobre. En contrechamp, la ville est filmée de loin, mais muette, des fumées noires éparses s’échappant des immeubles bombardés. Au bout d’un panoramique, revenant à la colline, nous finissons par entendre les ébats d’Y. et Leah, absents à l’image, ignorant le miroir tendu par la mise en scène.
Dans un sens, Lapid narre le parcours d’Y. en focalisation interne, collant tout à fait à sa perception des choses où Gaza et son génocide incarnent dans le film non une réalité mais un défi moral. C’est comme une énigme qu’apparaît l’enclave. Plus généralement, la Palestine est affaire, dans Oui, d’effets de seuils (une Tel Aviv intacte, un checkpoint passé plus vite que ses voisins, jusqu’à la possibilité de contempler Gaza) révélés par une liberté de déplacement, de privilèges intenables traduits par un aveuglement face à l’horreur qui s’y joue. Mais si Y. se refuse à outrepasser ces frontières, Lapid ne semble pas non plus les traverser. Et la subjectivité de Lapid rejoue l’affreuse phrase de Golda Meir selon laquelle “ Les Palestiniens n’existent pas ”. C’est du côté d’Israël, et des israéliens, que se tourne le film.
En cela, levons un malentendu autour de Nadav Lapid : contrairement à Avi Mograbi ou Eyal Sivan, sa dénonciation d’Israël ne s’exprime pas en termes politiques mais moraux. En quelque sorte, Oui fait fi de l’histoire, du principe d’autodétermination, de l’action militante, pour n’incarner Gaza que comme dilemme. Le fait d’être israélien se construit alors comme une impossibilité morale, celui d’être citoyen d’un pays sans être habitant de sa terre (en témoigne cette séquence où Y. se soulage dans un champ aux abords de Gaza), être colon en somme. C’est pourquoi l’exil, auquel va finir par se résoudre Yasmine dégoûtée par les outrances de son mari, devient la solution privilégiée des films de Nadav Lapid : ses personnages n’appartiennent pas à leur terre de naissance. On pourrait regretter alors que les Palestiniens aient eu tendance à disparaître de son cinéma depuis Le Policier (2011) comme si l’enjeu de ses films ne se posait plus qu’à l’égard d’Israël et, a fortiori, de l’Occident. En un sens, Nadav Lapid est le plus anti-israélien des cinéastes de son pays mais en aucun cas le plus pro-palestinien.

Hugo Kramer : La légère prise de distance auto-biographique – quoique le lien à la mère reste fort – permet avant tout un changement de subjectivité, si ce n’est courageux du moins salvateur : passer du contestataire au lâche. Me paraît plus périlleuse l’écriture du Y. de Oui, figure suprême de la passivité face au massacre des palestiniens, que celle du Y. du Genou d’Ahed, artiste contestataire hurlant dans le désert. Oui déjoue la mécanique du « cri de haine » – ou plutôt le redirige d’Israël vers Gaza, perversion suprême –, prive Lapid de relais immédiat vis-à-vis de son irrésistible pulsion à dire sa haine, ce besoin « d’oublier Israël », comme il n’a cessé de le dire au fil des interviews et des avant-premières. Dire l’urgence en passant du côté de « l’ennemi », c’est aussi, potentiellement, se draper du déni. Car continuer à regarder consiste, d’une certaine façon, à ne rien percevoir de la faillite de son environnement, du point de non-retour atteint – les protagonistes de Oui regardent beaucoup mais ne voient rien ou s’en dédouanent, font mine de diriger leur regard vers les bombardements alors qu’ils leur tournent le dos. En captant ce présent qui s’effrite et en lui offrant un ultime écrin, Lapid acte qu’il n’y reviendra plus. Mais ce geste implique un autre abandon : ceux qui n’ont pas d’échappatoire ne bénéficient pas de cette clôture. De là vient toute la beauté tragique des images « documentaires » de Tel-Aviv, comme captées à travers un œil à la marche chahutée. Elles fixent la ville en un adieu, non sans ambivalence : en extraire la part de vie tout en ramenant au dehors sa dimension chaotique, celle en-deçà de l’image. Cette horreur qui fait rétention au milieu du brouhaha du couple.
Pour retranscrire l’impossibilité d’être là, Lapid passe par la nécessité de s’y trouver : Y. a une femme, un bébé ; aucun autre ailleurs n’est envisageable que cet ici et maintenant – on peut d’ailleurs penser à La Zone d’Intérêt de Jonathan Glazer, raccord impossible entre paradis et enfer, en dépit du quoiqu’il en coûte. Les effets de mise en scène lapidiens viennent alors souligner cette instabilité spatiale, non sans être poussés à leur paroxysme, et ce dès l’ouverture, qui annihile immédiatement toute possibilité de prise de repères. Mais je dois dire que c’est précisément cette forme d’extrême et de répétition (le bruit des explosions, la danse, certains gestes comme celui de lécher) qui finit par me fasciner, par ce qu’elle génère d’absurdité et de mise à mal des corps – subie ou désirée. L’une des séquences de la première partie (indéniablement la meilleure et la plus forte des trois) montre le couple danser sur un remix techno de The Ketchup Song (déjà un choix extrême), tandis que le cadre se renverse et s’agite à la verticale. Tout est saturé (les corps en mouvement, le son) et nous plonge dans une boucle qui pourrait s’étirer jusqu’à la fin des temps. De là vient le trouble des passages dansés : ils pourraient renfermer toute l’existence, la chute des corps inertes ayant valeur de conclusion pour le mouvement comme pour la vie ; mais même dans ce cas-là, les angles de prise de vue seraient en mesure de les ressusciter. Tout ignorer, non pour eux, au fond, qui savent, lisent les notifications sur leur téléphone, mais pour le « couple », l’« enfant », entités pour lesquelles il s’agit de créer un espace protégé. Il faut donc mettre la musique encore plus fort, condition minimale pour vivre comme si.
Je ne suis pas tant intéressé par le fait que Lapid fasse un film pro-palestinien, mais plutôt par la manière dont il met en scène cette capacité d’aveuglément, celle de ses personnages – et, pour schématiser, des israéliens pas entièrement assujettis à l’idéologie coloniale la plus radicale et sanguinaire. Avant d’arriver sur la « Colline de l’Amour », il y a donc ce trajet en voiture pour franchir le seuil, tu l’as dit, où l’amour de jeunesse de Y. conduit en racontant, dans une interminable séquence (étirement permanent, motif premier du film), la quasi-totalité des récits des victimes et des otages du 7 octobre. Qu’est-ce que raconte la mise en scène ? Deux corps qui regardent la route derrière un pare-brise sale. Deux personnages à la vision obstruée et qui s’enferment dans une caverne de chagrin, ont besoin du 7 octobre – l’argument, l’excuse qui justifie tout – pour construire leur propre champ de vision. De fait, il ne peut rien se passer là-bas. L’aveuglément qu’ils ont alimenté, et auquel ils retournent par le biais de leur récit clé en main d’adolescents attristés, ne vient que renforcer l’horreur qui se joue en temps réel devant eux. Le déni n’est plus simplement celui de ce qui se passait en périphérie, qui pouvait d’une certaine façon se soustraire à l’image, mais bien de ce qui a envahit l’espace.

ÉH : Une idée centrale dans le discours que Lapid et ses laudateurs portent sur Oui prend pour métaphore le miroir. Dans C ce soir, le cinéaste parlait d’un « miroir gros comme le soleil » que chacun devait tendre à Israël. C’est ainsi que se perçoit la séquence face à Gaza : un miroir rendu à l’aveuglement de Y. La stratégie dialectique du film se déploie alors dans des enjeux de visions et de regards. Pour à nouveau paraphraser son auteur, « Je regarde Gaza mais Gaza me regarde. » (N’a-t-elle que cela à faire ?)
Si l’on reprend la structure en trois actes du film, Oui renvoie immédiatement au théâtre athénien, à la tragédie d’Euripide comme à la comédie d’Aristophane : l’idée d’une mise en scène de la cité et de ses limites comme un miroir grossissant. Il s’agit bien du même masque expressif que revêtent Ariel Bronz et son sourire grimaçant. C’est d’ailleurs là que s’achève le film, dans un théâtre antique chypriote, où Yasmine rompt définitivement avec Y. Mais chez Lapid comme pour les Grecs, la question de l’adresse reste insoluble : comme pour les trente mille citoyens d’Athènes, Lapid exclut de fait les étrangers, les Palestiniens. Pis, son film se construit par contraste avec le théâtre grec : il n’y a là aucune dimension collective – démocratique – qui s’incarnait auparavant dans le chœur. C’est Y. qui seul porte la cité israélienne.
Le miroir se retrouve dans le rapport que Oui entretient avec Le Mépris (comparaison soulignée brillamment par Raphaëlle Pireyre dans AOC), c’est-à-dire au sein du couple. Comme Bardot, Y. passe du brun au blond. En un sens, dans l’incommensurable écart qui va séparer Yasmine d’Y., il y a une fission, comme la famille nucléaire (Yasmine, Y., leur enfant) finit par se scinder. Oui et non, protons et électrons, des entités jusqu’alors réunies deviennent étrangères à l’autre. En clair, le reflet, chez Lapid, présente ou bien un « vrai visage » ou bien un autre état de soi-même (l’individu est ici à l’image du peuple israélien). Il est, en ce sens, le produit d’une subjectivité. C’est ainsi que se comprend la thématique de l’exil, chère à Nadav Lapid, qu’il concrétise par cette caméra libre qui fait la sève de son cinéma : être colon, c’est s’exiler à soi-même, d’avoir une identité en conflit entre l’appartenance et l’étrangeté.
Ce parallèle avec Jean-Luc Godard, revendiqué par un Nadav Lapid qui imite l’orgie achevant Sauve qui peut (la vie), met cependant en lumière les limites de l’autre vis-à-vis de l’un. Beaucoup ont rappelé la citation célèbre de Notre Musique opposant fiction et documentaire, Israël et Palestine. Certes, mais peut-être n’est-ce pas là que se loge le problème principal. Ailleurs dans Notre Musique, Mahmoud Darwish déclare : « Savez-vous pourquoi nous, Palestiniens, sommes célèbres ? Parce que nous sommes vos ennemis. » Comme l’on se souvient des Troyens pour avoir affronté Pâris, Agamemnon, Ulysse et Achille, les Palestiniens incarnent, dans Oui, une entité abstraite, celle de « Gaza », la ville sous les bombes ou une simple notification d’information. Gaza est dépossédée de son corps, les Palestiniens restent invisibles.
On a dit que cet aveuglement était le sujet-même du film. Dans mon cas, j’y vois la limite structurelle du cinéma de Nadav Lapid. Je ne refuse pas au film sa cohérence mais son principe. A-t-on besoin d’un miroir ou bien d’une caméra ? On sent par ailleurs que ce qui faisait la réussite de Synonymes ou du Genou d’Ahed s’épuise ici. Sans doute est-ce dû à la grandiloquence d’un projet dont la seule force documentaire est celle de son propre tournage. Nathan Devers reprochait à Nadav Lapid, dans C ce soir, de ne décrire que partiellement la société israélienne : lapalissade dont l’ancien chroniqueur de Pascal Praud n’a pas l’air de mesurer la portée. De fait, le portrait lapidien de la société israélienne s’est resserré sur des archétypes, sur des caricatures. Là où Road, La Petite amie d’Émile ou Ammunition Hill se nourrissaient d’une complexité, la simplification progressive – et la subjectivation – des films de Nadav Lapid aboutit à une négation de l’altérité constitutive de son territoire. Oui, Gaza est à une heure de voiture mais le cinéma de Nadav Lapid nous a déjà démontré que l’apartheid et la colonisation commençaient en bas de chez soi. Le montrer donnerait un autre film.
HK : La rencontre entre Y. et Yasmine, racontée par cette dernière, est à l’image du film : alors qu’il s’étouffait au milieu d’une soirée, elle plongea sa main dans sa gorge pour lui retirer un bout de gras de charcuterie coincé. Oui est un film mal dégraissé, mal dégrossi, aux pointes saillantes et irrespirables mais, de fait, souffrant de longueurs et de redites (le retour amoureux, le théâtre, les fêtes). Un quasi-geste d’autodestruction : anéantir son cinéma autant que le pays qui l’abrite. Tu le dis, nous sommes peut-être arrivés à une forme de point limite dans la caricature sensuelo-carnavalesque – dont je peux entendre le reproche de simplification, mais qui porte en elle une dimension retorse et peu arpentée – et la limitation du point de vue. En cela, l’après Oui interroge encore plus qu’à l’accoutumée, comme si Lapid était arrivé au dernier degré de l’expérience d’être israélien, et qu’elle ne pouvait que s’étudier de cette façon, en repoussant toute altérité hors du champ de vision et des capacités de compréhension.
Qui dit aveuglement dit également pleine conscience et abandon, jusqu’à une forme de plénitude dans ses derniers instants. Et si les hauts-commandants de la société israélienne se réfugient derrière cette figure, plus dominante encore, du milliardaire venu des grands empires (russe ou américain, on ne sait plus), il n’en reste pas moins que le corps israélien n’a besoin de personne pour être une forme de monstre organique auto-suffisant. Dès le début, Y. et Yasmine jouent les gigolos de luxe et lèchent leur hôtesse, enfonçant leur langue jusqu’au fond de ses oreilles. Personne ne s’échappe de cette entité, où chacun colle à l’autre par la salive, jusqu’à ce plan, trop long mais édifiant, où se forme une chenille de soumission, human centiped de léchage de pieds.
Lors d’une réception, Y. apparaît avec un canard juché sur son épaule. Une apparition qui m’a évoqué, par son ambition de prise de hauteur malgré tout partie prenante, Toni Erdmann et son dentier (hasard qui n’en est évidemment pas un, Maren Ade et Komplizen Films co-produisant le film). Si Y. s’imagine sans doute surplomber les huiles israéliennes, aucun doute n’est permis sur sa compromission et sa bassesse morale – Toni était toutefois plus souverain, avec l’ambition, en bon usurpateur burlesque, de renverser la table et l’esprit de sérieux. Malgré sa posture parfois en retrait des soirées orgiaques, Y. ne s’oppose jamais moralement et ne résout aucun cas de conscience : dans le désert, il subit la foudre céleste, pluie rocailleuse envoyée par sa mère. La mise à mal du corps ne fait jamais dérailler la voie vers l’abjection, qui se poursuit et se termine avec l’acceptation par Y. de cette commande gouvernementale.

Un nouveau cri dans le vide, en plein théâtre athénien. Plus aucun collectif, si ce n’est cette idéalisation romantique qui vient mettre en échec la fission conjugale – on peut mettre en miroir, qui garde malgré tout son pouvoir de révélation, ce désir de survie amoureuse avec celui d’Israël vis-à-vis de sa propre existence. Mais malgré tout y résonne un chœur, qui, derrière son apparence juvénile, porte en lui une force de secousse comparable aux chorégraphies du début. C’est l’autre image documentaire du film : des chorales d’enfants israéliens qui, les visages floutés dans un montage projeté en pleine scène antique, entonnent l’hymne composé par Y., réelle composition post 7 octobre. Que peut-il rester d’individualité et de résistance au milieu de cet appel à anéantir Gaza ? Le collectif n’est plus que ce résidu univoque et préfabriqué, ce pseudo-chœur confortablement installé, avec l’aval des protagonistes – qui ont soigneusement laissé Gaza où il était, sans son corps –, dans ce lieu du débat et de la représentation. Eux ont besoin de crier et de chanter, et personne ne viendra leur confisquer cet espace.
Scénario : Nadav Lapid / Shai Goldman / Montage : Nili Feller / Musique : Sleeping Giant, Omer Klein
Durée : 2h30.
Sortie française le 17 septembre 2025.