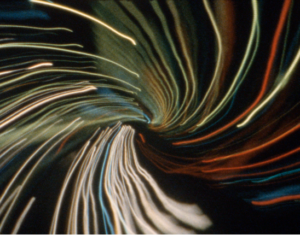Pascal Plante
Des coupes et la longueur
De l’œuvre naissante de Pascal Plante, on pourrait dire qu’elle témoigne d’un goût de l’intermédiaire. Hors de toute démonstrativité ou d’ostentation (Pascal Plante exprime ici sa méfiance envers l’esbroufe), ses deux premiers longs-métrages, Les Faux tatouages et Nadia, Butterfly, se déploient en effet sur une ligne fine et subtile, tant au niveau narratif que visuel. À travers une rencontre amoureuse ou la dernière épreuve d’une carrière de nageuse, ses films parviennent à saisir les étapes d’une vie en évitant les gros traits ou les parcours trop univoques, offrant des portraits délicats de personnages oscillant entre l’enfermement (dans un milieu ou ses propres travers) et l’ouverture. Le style, pour sa part, laisse apercevoir des partis pris affirmés : à une tendance à privilégier le plan-séquence, qui porte l’accent sur les interactions entre les corps des personnages, s’adjoignent ainsi des ruptures nettes avec le régime réaliste (Nadia, Butterfly est ponctué de moments oniriques, où le ralenti se conjugue avec l’éclairage artificiel). Discuter avec Pascal Plante, c’est mettre à jour la sensibilité et les réflexions précises qui ont guidé les choix qui font la singularité de Nadia, Butterfly, de la considération pour les personnages au choix d’un format d’image en 1.5/1. Mais c’est aussi voir se dessiner une méthode de travail intelligente et souple, permettant de s’accommoder d’un budget limité et d’accueillir des acteurs non-professionnels (toutes les nageuses du film sont de véritables athlètes, à commencer par Katerine Savard, interprète du rôle titre qui était aussi en lice aux Jeux Olympiques de Tokyo). Sans oublier la place faite au risque : filmer la nage comme une danse de Fred Astaire.
Débordements : Quel a été ton parcours avant de réaliser Nadia, Butterfly ?
Pascal Plante : Avant d’aller vers le cinéma, j’avais un pied dans le monde du sport : j’ai nagé au niveau national avant d’arrêter à 19 ans. Mais j’étais déjà un peu le cinéphile et l’artiste parmi les nageurs. Cela dit j’ai pendant longtemps voulu être bédéiste, faire des romans graphiques (ce qui n’est pas si éloigné du cinéma, si on pense au storyboard). J’ai ensuite découvert la photographie, la caméra, et je me suis rendu compte que ce qui me passionnait n’était pas l’acte de dessiner mais le résultat, et le storytelling en images. J’ai alors déménagé de la ville de Québec à Montréal pour suivre des cours à l’université Concordia. Et comme Concordia n’avait pas d’équipe de natation, ça a rendu mon choix de carrière plus simple !
Pendant mes trois ans d’études j’ai fait plusieurs courts-métrages sur des sujets variés, sans rapport avec mon passé d’athlète. Dans les années qui ont suivi j’ai fait à peu près un court-métrage par an, et puis j’ai réalisé mon premier long-métrage, Les Faux tatouages, écrit et tourné en 2016 et sorti en 2017. Nadia, Butterfly est donc mon deuxième long-métrage.
D : Quelles ont été tes premières influences cinématographiques ?
PP : Quand on est à la fin de l’adolescence, il y a des cinéastes qui flashent plus que d’autres. Etant né en 1988, je suis vraiment arrivé au cinéma dans les années Tarantino : quand Kill Bill est sorti, on ne pouvait pas y échapper. Un peu avant ça aurait été Tim Burton, après Wes Anderson : je les appelle des cinéastes « entrée de gamme », des cinéastes un peu tape-à-l’œil, qui te montrent hors de tout doute qu’il y a un auteur derrière le film. Car ça peut être facile de l’oublier : il y a tellement de show Netflix, de produits anonymes dans leur fabrication. C’est donc important ces cinéastes qui, tout en étant mainstream, te montrent qu’il y a une expression unique.
Même si cela n’a rien à voir avec le cinéma que je fais, Kill Bill, quand je l’ai vu à 15 ans, a été un électrochoc : tu sors de là sans vraiment savoir si tu as aimé le film, mais il s’est vraiment passé quelque chose… Et puis après tu passes de Tarantino à Scorsese, puis à Kurosawa, etc. Et puis le cinéma de Cassavetes a été un autre éléctrochoc : Une Femme sous influence reste un des films que j’emporterais sur une île déserte. Il y a quelque chose de tellement animal, viscéral, dans les performances. C’est intelligent sans être intellectuel. Et un des films qui m’accompagne le plus est The Deer Hunter de Cimino, qui est aussi à sa manière un film d’acteurs : épique mais très intime, près de ses personnages. Bien sûr, pour un jeune aspirant cinéaste Cassavetes est particulièrement inspirant parce qu’il donne l’impression qu’il est possible de faire avec peu, en tournant des films chez soi. Ça te ramène à l’essentiel. Kurosawa est sans doute l’un des plus grands cinéastes, mais je ne sais pas si on peut être inspiré par Ran de cette façon…
D : Les Faux tatouages était un film fait avec relativement peu de moyens. Tu disposais pour Nadia, Butterfly d’un budget plus important : est-ce que tu as eu l’impression de passer un étape, ou est-ce que c’était le même type de travail ?
PP : C’était un peu le même type de travail. Quelqu’un a dit un jour « Make your budget your aesthetic » : je trouve cette façon de penser très intéressante. Au lieu d’essayer de battre Hollywood sur son terrain pour arriver à une œuvre cheap, il vaut mieux être conscient des paramètres budgétaires, savoir ce qui est possible ou pas et travailler à partir de ça. Par exemple dans Nadia, on n’a pas tourné la remise des médailles dans la piscine, on a mis une toile de fond dans un gymnase, et ça passe très bien. Il y a des moments où c’est bien que ça soit grandiloquent et d’autres où tu n’as pas besoin de tout montrer : la magie du cinéma fait le travail. Nadia a un budget plus substantiel, mais comme c’est aussi plus ambitieux, plus glouton, il faut avoir les mêmes réflexes de mise en scène, la même manière de penser comme un cinéaste low budget, trouver une manière créative de contourner ou masquer certaines choses, réfléchir à ce qu’on retire de l’équation sans enlever l’impact émotionnel ou la véracité. Je crois vraiment que ce qu’on ne voit pas peut être aussi intéressant que ce qu’on voit. Il y avait de grosses scènes dans Nadia, comme celle de la compétition : il y avait 111 personnes sur la feuille de service ce jour-là. Mais pour des scènes intimes, on était très peu nombreux, comme sur Les Faux tatouages.
D : Je repense à la célèbre réflexion de Bresson : « Chaque fois que je peux remplacer une image par un son, je le fais », même s’il ne pensait pas forcément en termes de budget.
PP : Bresson est en effet génial pour ça. Dans Pickpocket on ne voit jamais les chevaux lors des scènes d’hippodromes, mais on n’y pense même pas, ça marche. Un condamné à mort s’est échappé fonctionne essentiellement au son : chez lui le son relève aussi de la production value. Il avait parfaitement compris qu’il est bon de ne pas être constamment dans le stimuli ou la représentation pour laisser le spectateur faire sa projection mentale.
D : Ce que tu dis me fais penser à ton usage du plan-séquence : on peut se dire qu’en faisant un plan-séquence, en maintenant un cadre large, on en fait moins qu’en surdécoupant, or ça peut aussi produire du « plus ». Cela peut être un choix économique qui a en fin de compte un effet positif. J’ai lu qu’il t’arrivait de te définir comme « un cinéaste de fiction avec un regard de documentariste », est-ce que tu peux revenir sur cette phrase ?
PP : Le regard, oui, mais pas la manière d’utiliser le langage cinématographique. J’ai une rigueur dans la recherche, un respect du monde que je dépeins. En général j’ai une grande tolérance : mon premier réflexe face à différents modes de vie est de comprendre ce qui permet à une personne d’être comme elle est, ce qui renvoie à la société où elle évolue. Ça, je pense que c’est un réflexe de documentariste. Si je fais un documentaire sur quelqu’un de l’alt-right par exemple, je ne peux pas en toute conscience me faire inviter et lui voler son image pour marteler ma thèse, le piéger. C’est éthiquement discutable… J’ai tendance à aimer les documentaires rigoureux sur ce point.
Or en fiction, comme on crée le monde, ça peut être très facile d’inventer un méchant, qui représente les méchantes corporations. Ou d’inventer un martyr pour susciter la sympathie, de placer ses pions comme on veut. Mais j’essaie d’avoir une certaine rigueur. J’avais fait un court-métrage sur les concours de beauté pour enfant, Blonde aux yeux bleus. On a tourné dans un vrai concours, c’était une fiction proche du documentaire. Cependant je me suis toujours dit que ce film serait valable si je pouvais le montrer aux organisateurs du concours et que, sans altérer le montage, il leur paraisse acceptable. Alors que quand je montre le même film à un public opposé à ce type de concours, il trouve que ce qui est montré est abominable. C’est très stimulant de se maintenir sur ce fil, de réussir à parler à des camps qui parfois se heurtent. D’autant plus qu’on a en ce moment tendance à exacerber les oppositions, si bien que les gens restent dans leurs tranchées, sans se convaincre. Une œuvre qui essaie de saisir des zones de gris peut être le point de départ d’une conversation.
Par contre j’utilise à plein le langage de la fiction pour y arriver, en organisant les sons, les transitions, le montage, etc. Cadrer, mettre en scène, mobiliser outils du cinéma pour faire semblant en calquant la forme documentaire m’intéresse moins : je n’aurais qu’à faire un documentaire, dans ce cas…
D : Concernant Nadia, le milieu de la natation est un milieu que tu connais mais tu n’étais pas allé aux Jeux Olympiques, qui servent de cadre au film. Est-ce que tu as mené un travail de recherche particulier en amont ?
PP : Des sports professionnels comme le foot ou, au Canada, le hockey sont médiatisés toute l’année. Mais la natation, le patinage artistique ou la course à pieds, etc., sont seulement mis en avant pendant les Jeux Olympiques. L’olympisme m’intéressait comme toile de fond car c’est un moment où tout est exagéré : tellement qu’on peut tout de même raconter beaucoup en se focalisant sur une petite tranche de vie d’un personnage.
Concernant les recherches, j’en fais beaucoup, mais il faut s’avoir s’arrêter : ça peut devenir de la procrastination. On pourrait passer sa vie à chercher un sujet et ne jamais écrire de scénario… Une fois qu’on a pour ainsi dire « fait ses devoirs », il faut accepter qu’il y aura une part d’imaginaire. Mais j’ai notamment consulté des olympiens et des olympiennes, notamment Sandrine Mainville, qui est aussi la sœur d’Ariane Mainville (qui joue Marie-Pierre dans le film). Elle m’a donné accès à quelque chose d’ultra-précieux car elle filmait beaucoup avec une GoPro pendant les Jeux de Rio, que ce soit son appartement au village olympique, la cafétéria, un meeting avec l’équipe canadienne, des choses que les caméras officielles ne peuvent pas filmer. Pour un film qui voulait montrer l’envers du décor, c’était génial. C’était également formidable pour mettre l’équipe au diapason, car on ne fait pas un film seul. J’ai beau bien connaître le monde de la natation, le défi en tant que cinéaste est que la directrice artistique, la directrice photo, la productrice, que tout le monde devienne un pseudo-expert… Ces images ont simplifié les choses : je les montrais à la directrice artistique, et on s’économisait 8 réunions (rires).
D : Le personnage de Nadia, le choix d’un personnage quittant le milieu, s’est dessiné dès le départ ? Pourquoi ne pas prendre une championne montant vers le succès ?
PP : A travers Nadia, je voulais dire des choses que je n’avais pas ou peu vues dans les fictions sportives. Il y avait l’idée de choisir de prendre sa retraite dans un milieu d’extrême performance. C’est une chose un peu taboue, comme si on débranchait un robot encore fonctionnel. C’est une interrogation née de gens que j’ai observés, notamment d’un athlète de mon âge qui avait fait les Jeux de Pékin à 19 ans en 2008 et a arrêté après. C’était aberrant pour tout le monde, mais lui disait simplement qu’il était peut-être bon mais qu’il n’aimait pas nager. C’est une histoire qui m’avait marqué : des gens qui vivent leur passion avec leur sport, mais d’autres qui sont rentrés dans un tourbillon de performances, au point de se demander pourquoi ils font tout ça. C’est une mentalité un peu capitaliste : tant que ça produit, pourquoi arrêter ?
J’aurais pu choisir un athlète dont le corps ne suit plus, mais cela me semblait moins intéressant. Nadia est un cas unique : ce n’est pas une athlète archétypale. Les autres relayeuses dans le film sont très différentes d’elle. Marie-Pierre ne traîne pas le même boulet, elle a l’air d’assez bien conjuguer sa vie d’athlète de haut niveau et sa vie personnelle. Mais il y avait un potentiel dramatique dans un personnage malheureux dans la performance, qui décide d’arrêter même s’il y a tout un milieu qui lui met la pression pour qu’il continue. Et qui a à la fois un pied dedans et un pied dehors, ce qui permet un recul critique. Par Nadia je pouvais parler du carcan infantilisant de la vie d’athlète, par exemple.
D : Et pourquoi avoir choisi un personnage féminin ?
PP : Dans les films de sport il y a drastiquement moins de personnages féminins, donc pour commencer il y avait une stricte volonté de représentation. Et cela m’apportait plus de munitions, car la femme athlète a globalement plus de pression. Un homme un peu arrogant en interview ça passe, mais une femme… On lui lance des pierres. Le rapport au corps est aussi différent. L’olympien homme ressemble aux mannequins qu’on voit dans les publicités, mais l’olympienne, même si son corps est performant, ne correspond pas à un canon de beauté.
D : Il y a quelques moments qui font directement référence à la féminité de Nadia : le fait qu’elle dise ne pas avoir voulu prendre la pilule, la remarque de l’entraîneur sur la prise de poids…
PP : La femme a en moyenne 7 à 10% de gras en plus que l’homme sur le corps. Mais dans la logique illogique de la performance, il faudrait idéalement qu’elle ne les ait pas. Et la prise de poids est vraiment plus violente pour une femme. La réplique de l’entraîneur renvoie à un machisme ordinaire omniprésent chez les entraîneurs hommes, mais je ne voulais vraiment pas que l’entraîneur franchisse une ligne, qu’on se questionne trop sur l’emprise qu’il aurait sur elle. C’est un sujet important, mais pas dans le propos du film.
D : Le film utilise un format d’image assez inhabituel, de quel format il s’agit ?
PP : C’est un ratio de photographie : le 1.5/1 ou 3/2. C’est en quelque sorte un ratio qu’on invente pour le cinéma : on tourne plus large et on réduit. Mais on tournait vraiment comme ça, avec des caches. C’est un choix qui est venu un peu par élimination : on ne voulait pas le 4/3, qui a à mes yeux un côté un peu rétro. On voulait éviter le 16/9 car dans Nadia tout est mis en œuvre pour faire l’inverse de ce que la télévision fait : quand on regarde les JO on a le HD clean, en 16/9… Concernant le ratio Scope, il n’est pas du tout intuitif pour moi, qui conçoit spontanément des cadrages plus axés sur l’individu que sur l’environnement. Le 1.5/1 était donc un intermédiaire entre le 16/9 et le 4/3, qui a l’avantage de très bien fonctionner pour des cadres avec un seul personnage, mais aussi en two-shots quand deux personnages sont assez proches. Mais, comme je disais, il est contre-intuitif dans les scènes de natation, où on aurait envie de voir le corps en complet, vers l’avant…que le cadre s’élargisse, comme chez Dolan (rires). Le format redoublait ainsi l’état d’esprit de Nadia, la contrainte et l’enfermement subis dans son milieu. C’est un ratio original, mais on ne l’a pas fait pour être original à tout prix !
D : Il y a un plan vers le début où Nadia, après une contre-performance, subit les questions des journalistes qui restent hors-champ tandis que le cadre reste sur elle. Il est clair qu’on ne ressentirait pas la même pression sur le personnage avec un format plus large. Mais, tout en montrant certaines formes de violence subies par les nageuses, le film a aussi une certaine douceur…
PP : Malgré les critiques que je peux faire à ce milieu, mon regard reste bienveillant. Il y a des gens que j’aime dans ce milieu, il faut aussi reconnaître les qualités nécessaires pour être athlète et je suis personnellement en paix avec mon passé de nageur.
D : Théo, le personnage des Faux tatouages a aussi un rapport compliqué à son milieu, mais la famille n’est pas seulement montrée comme un lieu d’oppression avec lequel il faudrait rompre. Il y a un mouvement d’émancipation chez tes personnages, mais il ne s’agit pas seulement d’aller contre un milieu, un passé…
PP : Dans Les Faux tatouages Théo perçoit sa mère comme quelqu’un qui l’oppresse alors qu’elle fait de son mieux. Quand il se plaint à sa sœur du regard de sa mère, on comprend qu’en fait c’est un regard qui lui tend un miroir, car il sait qu’il a fait quelque chose de mal : c’est plus intéressant et complexe quand un personnage perçoit une oppression où il n’y en a peut-être pas car il est ramené à ses propres démons intérieurs (plutôt que de lui coller une mère castratrice et oppressive). Ce sont des choses qui naissent à l’écriture, mais qui découlent aussi de mon rapport au monde, d’une forme d’empathie.
En écrivant j’essaie de me dire que chaque personnage a son histoire, son point de vue. La pauvreté ou la richesse d’un scénario se reconnaît souvent dans les personnages secondaires. Ça peut être relativement facile de faire un personnage principal assez complet, mais parfois les personnages secondaires deviennent des « personnages-fonctions », qui servent uniquement à passer le micro au personnage principal au moment opportun. C’est plus intéressant pour moi de me demander « Est-ce qu’il y a un film pour chaque personnage ? ». La mère a deux scènes dans Les Faux tatouages, mais elle a quand même une charge dramatique. Scénaristiquement, j’aime les films qui donnent l’impression que chaque personne est complète. Asghar Farhadi et Lee Chang-dong sont très bons pour ça.
D : Marie-Pierre a une très belle scène à la fin sur la plage, où elle se confie à Nadia sur ses propres appréhensions…
PP : Oui, elle prend de la profondeur. Tout au long du film, son mécanisme de défense est de faire des blagues, elle fait partie de ces gens sur lesquels tu as l’impression que tout fait rebondit. Mais ça ne veut pas dire qu’ils ne sont pas affectés par les situations. Je voulais que Marie-Pierre transcende son côté sidekick. Plusieurs éléments viennent lui donner de la présence : beaucoup de plans ne terminent pas juste sur Nadia, mais en two-shots avec Marie-Pierre. Ariane a vraiment bien joué cette scène de plage. On l’a travaillée et enrichie ensemble : on a pris une soirée à Tokyo pour en discuter, elle y a mis d’elle-même et on est allés un peu plus loin que ce qu’on avait écrit. On n’a fait que deux prises, et elle était magnifique, très incarnée et fragile dans les deux.
D : Ariane est aussi une nageuse professionnelle. Est-ce que tu peux revenir sur ce choix de caster des nageuses, et sur la manière dont s’est passé le travail avec elles ?
PP : En castant des vraies athlètes, on pouvait éviter toute la backstory : en un coup d’œil on perçoit toutes les heures passées à s’entraîner. C’est vrai relativement à leurs corps, mais c’est doublement vrai concernant leurs compétences dans la piscine. Il y a plusieurs raisons de faire nager le papillon à Nadia : c’est la dernière nage que l’on maîtrise, on ne peut pas tricher. J’aimais l’idée de le montrer de façon ostentatoire, en plan-séquence.
Le film n’était pas écrit pour Katerine et Ariane, mais l’idée de tourner avec de vraies athlètes était là d’entrée de jeu, dès les demandes de subventions. Ça a été questionné par certains bailleurs de fonds, d’ailleurs, il a fallu défendre l’idée. La différence principale dans le fait de travailler avec des gens qui n’ont pas d’expérience de tournage, c’est que ça me met plus de pression en tant que metteur en scène. L’acteur professionnel comprend mieux le rapport entre le corps et la caméra, les échelles de plans, l’éclairage, etc. Les non-professionnels sont moins conscient de la machinerie, et ils sont bons si on rend invisible cette lourdeur. Donc il y avait plus de pression sur moi pour qu’elles aient de leur côté le moins de pression possible, qu’elles aient juste besoin d’être vraies, de ressentir ce que le personnage doit ressentir.
Je ne pourrais jamais diriger un non-professionnel comme un professionnel, en lui donnant tout un tas de consignes sur tel geste à faire à tel moment. Ça le paralyserait : il ne serait pas dans le moment : s’il buvait sa gorgée d’eau trop tard, il penserait qu’il s’est trompé, et on aurait perdu toute la spontanéité. Mon rôle est donc d’assouplir. Et, la plupart du temps, au lieu d’arriver avec une mécanique très élaborée, de faire les mises en place des séquences de concert avec les actrices. On prenait du temps pour que tout ce qu’elles devaient faire leur paraisse motivé, naturel. Mais elles jouaient bien un rôle, sur ce point ça n’était pas différent – et elles arrivaient prêtes, comme pour une course, disciplinées.
D : Il y a une sorte d’adaptation de la méthode de tournage, mais pas d’improvisation ?
PP : Pas vraiment. Mais je les laissais très libres au niveau du phrasé. Je ne suis pas attaché à mes lignes de dialogues telles qu’elles sont dans le scénario. Quand on fait des lectures et qu’une réplique sorte un peu trop écrite, on a l’impression d’une fausse note. On passe alors à ce que j’appelle la phase de déminage : je démine le scénario, dès qu’une réplique sonne bizarrement en bouche, je demande à l’actrice comment elle la dirait. C’est comme ça qu’on assouplissait en répétition, et ensuite je leur disais ce cliché de mise en scène : « Acting is reacting », « Essaie de pas avoir trop en tête ta prochaine réplique, d’être plutôt à l’écoute de l’autre ». C’est un principe de base, mais ça n’est pas si simple. En somme, je faisais tout mon possible pour les ramener dans le moment présent, leur faire oublier la caméra. Pour la scène de la boîte de nuit, Katerine était capable de dire ses huit pages de dialogues tout en faisant semblant d’être pompette, ce que des acteurs de métier auraient eu du mal à faire.
D : Cette scène est en effet longue : on se dit qu’il y avait d’autant plus de choses à préparer ou mettre en place avec les acteurs que tu as tendance à faire des plans assez longs.
PP : Dans Nadia, Butterfly il y a deux sortes de plan-séquences. Il y a les moments sur la terre ferme, comme dans le bar, où il s’agit d’une recherche de temps présent. Pas une recherche à tout prix : j’arrivais sur le plateau de tournage avec un découpage, j’avais par exemple prévu quatre plans pour la séquence de la boîte. Mais je me posais la question « Pourquoi couper ? » en voyant dès la première prise que les filles étaient capables de jouer sur la durée. Donc on a plutôt bien travaillé la scène ensemble, et puis on a fait une dizaine de prises. Il y a trop de films qui coupent par automatisme, alors que le montage peut aussi être expressif. En rallongeant la durée moyenne d’un plan, c’est comme si on reconférait une force au montage. La question c’est : « Qu’est-ce que je gagne à couper si je décide de changer de valeur de plan, de point de vue ? ».
Et puis il y a aussi les plan-séquences qui concernent le côté sportif. Je suis un grand fan des comédies musicales de Fred Astaire et Ginger Rogers, où les danses sont toujours en plan-séquence. Le cinéma prend un recul au profit de la performance au lieu d’avoir une performance générée par le cinéma. Je voulais traiter les scènes de sport de cette manière, pour donner une évidence au fait que ce sont les gens qu’on suit au long du film qui performent. Je comptais aussi que le spectateur entre en empathie avec eux par l’effort physique, en étant en apnée en même temps que Nadia, en ayant mal aux bras en même temps qu’elle.
Quand on y pense, c’est assez rare que les films de sport montrent une performance dans sa continuité. D’autres films réfléchissent à ces problèmes avec d’autres idées, et d’autres budgets : pour Moi, Tonia, ils ont incrusté la tête de Margot Robbie sur le corps d’une vraie patineuse. Mais en natation, avec l’eau qui éclabousse autour c’est aussi beaucoup plus compliqué !
Et puis il y a une adrénaline dans le tournage en plan-séquence. Quand je pense à mon passé d’athlète, c’est l’adrénaline qui me manque le plus. La seule façon de retrouver ça est de mettre en scène des plans kamikazes, qui doivent absolument fonctionner à la première prise. C’était le cas du 100 mètres papillon de Nadia où la caméra est sur une planche, posée sur des poulies. On avait répété mais il y avait quand même un côté aléatoire et chaotique. S’il y avait eu un problème technique, il aurait fallu une heure de récupération à Katerine pour qu’elle renage avec la même énergie L’idée de capter une bulle de temps présent avec le plan-séquence est à la fois stressante et excitante. Mais ça te fait vivre quelque chose en tant que cinéaste : je ne viens pas au boulot pour faire champ-contrechamp, master shot… Je ne pense pas seulement à me donner des options pour plus tard, au montage, quand je tourne – ce qui est la meilleure façon d’avoir un film qui devient très anonyme. La plupart des décisions sont prises au moment du tournage.
D : L’idée que la réduction du montage lui redonne une force d’expression apparaît clairement lors de la soirée chez les athlètes italiens, où on passe de la chanson d’Avril Lavigne à celle de Yasmine Hamdan. On imagine que tu aurais pu tout filmer en un plan mais il y a un moment de basculement qui passe par une coupe, coupe qui permet de mettre l’accent sur le regard que Nadia porte sur Marie-Pierre, de suggérer que la manière dont elle se comporte est influencée par ce que font les autres autour d’elle.
PP : Et après ce plan sur Marie-Pierre et les italiens, on revient à Nadia avec une échelle de plan plus proche, alors qu’on la cadrait plus large tout au long de la scène. Cela crée un petit vertige, qui n’aurait pas pu être obtenu si j’avais fait un panoramique de Marie-Pierre à Nadia. Je pense qu’il fallait vraiment couper, pour voir ce que voit Nadia, mais aussi pour revenir vers elle.
D : On a parlé d’une légère inspiration documentaire, du désir de capter une bulle de temps, mais ce qui caractérise tes films est aussi que tu n’hésites pas à basculer d’un régime réaliste à un régime plus artificiel.
PP : Lorsque je suis pris dans une histoire et qu’un film me rappelle qu’il est l’expression d’un point de vue, une œuvre de fiction, ça ne me dérange pas : j’ai même tendance à aimer ça. Souvent les séquences de rêves servent à mettre un peu d’audace dans un récit, mais parfois tu peux faire une envolée stylistique dans le « réel » même de ton film, partir avec de la musique, du ralenti, etc. Ça devient de l’esbroufe si c’est fait avec excès à des moments inopportuns, mais ça relève la saveur quand ça ponctue avec parcimonie.
D : Dans Nadia ces ponctuations ne sont pas gratuites, il y a un travail visuel sur une forme de contamination de l’image par le milieu aquatique. Par exemple dans la séquence de la soirée dont on parlait auparavant, il y a un travail sur la lumière bleue qui varie, mais l’image, à la fin, est aussi envahie d’un filet d’eau. Comment ça a été fait ?
PP : Pour ce plan, la directrice photo et le chef électro se sont bien amusés. Ils ont construit une sorte de mini-aquarium en plexiglas, et ils l’ont littéralement rempli d’eau devant la caméra. La directrice photo appelait ça son « filtre aquarium ». Plus tard ce sont des taches bleutées qui apparaissent, avant de passer à une séquence onirique : dans ce cas il y avait aussi de l’eau devant la caméra, et on a versé des colorants bleus avec une pipette.
On n’ose parfois pas demander des choses à l’équipe artistique alors qu’elle est très contente quand elle a l’opportunité d’inventer. On finissait en général les jours de tournage à l’heure, il n’y a presque pas eu de dépassement, mais le jour où on a tourné la soirée était intense et on a fini en retard pour une fois. J’ai dit à la directrice photo que cette transition avec l’eau était une bonne idée en théorie, mais que là le temps manquait, qu’on se contenterait d’un fondu enchaîné. Mais elle n’a pas voulu m’entendre ! Elle a rallié ses troupes, qui ont ramené le petit aquarium à vitesse grand V et ça s’est fait un peu à l’arrache. Elle tenait à sa trouvaille. Il faut dire qu’on avait beaucoup discuté avant autour de mon passé d’athlète, de l’impression que ça faisait d’être dans l’eau, avec les lunettes de natation, que ce soit au niveau sonore ou visuel. On a aussi trouvé des objectifs qui avaient des flous un peu imparfaits, qui peuvent évoquer la sensation de l’eau dans les yeux.
D : La musique est importante dans tes films, avec des morceaux qui durent autant que les scènes. Est-ce que tu sais dès l’écriture lesquels tu vas utiliser ?
PP : Oui, même si parfois les aléas font qu’on ne peut pas avoir la chanson prévue. Pour une chanson comme celle d’Avril Lavigne, sur laquelle chantent et dansent directement les personnages, il faut de toute façon s’assurer de pouvoir l’utiliser avant le tournage. Mais j’ai une assez bonne idée de la palette musicale du film, même pour les chansons qui participent moins de la dimension narrative. Au moment de l’écriture j’établis une playlist pour chaque film, ce qui m’aide à me mettre dedans. Je travaille en ce moment sur deux projets à la fois, et ça m’aide : je mets une playlist, et ça me remet dans l’univers de l’un ou de l’autre !
J’écoutais beaucoup Space song de Beachhouse et les musiques de Grouper, c’était donc logique que ça s’intègre à Nadia. Ce sont sans doute ces choix, avec leur côté ambiant, planant, qui donnent au film sa douceur. Cela allait aussi avec la sensation d’apaisement que peut aussi procurer la nage, quand on est enveloppé dans un autre élément. J’aime aussi quand on ne sait pas trop où la musique s’arrête et où le son commence. Il y a eu un travail sonore important pour transcender le réalisme tout en restant dans le réalisme de l’émotion du personnage. Je suis assez impliqué dans le travail du son : j’ai fait le sound design de tous mes films, à l’exception de Nadia, mais j’étais là tous les jours de la conception sonore.
Les Faux tatouages, également distribué par Les Alchimistes, est disponible en VOD depuis mai 2021 : https://www.alchimistesfilms.com/les-faux-tatouages