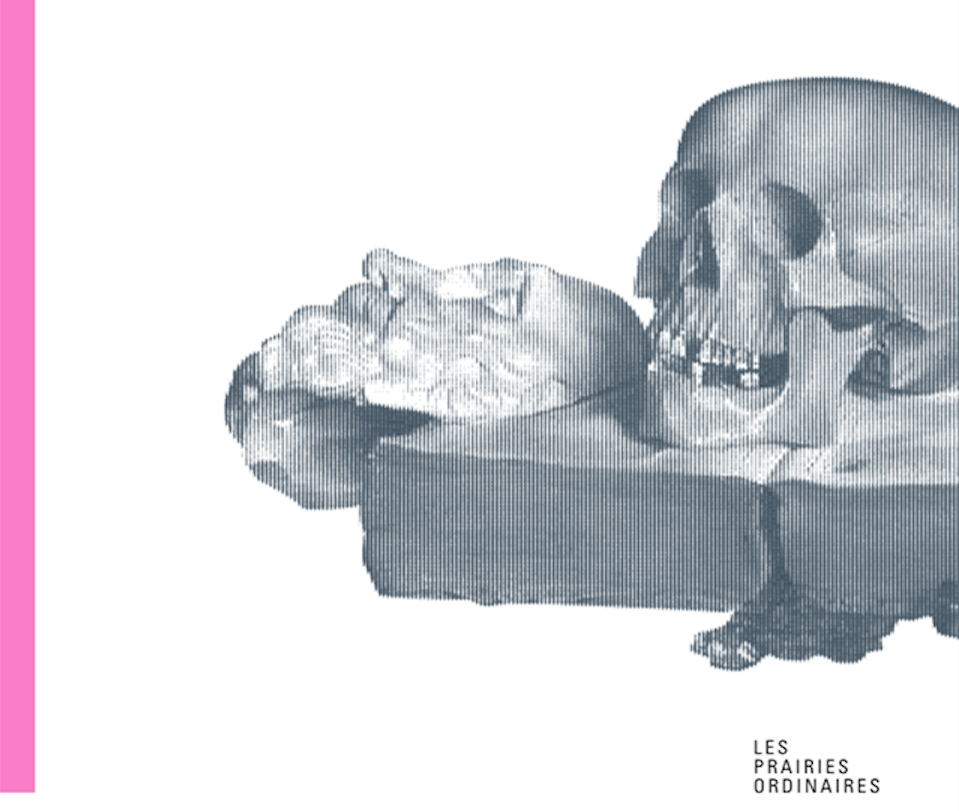Petit manuel critique, Eric Loret
Partage critique
Il est fréquent que des philosophes s’essayent à la critique, il l’est moins que des critiques endossent la chape philosophique. Restes d’un séculaire arbre des sciences qui place en son pinacle l’art du concept et à ses pieds les discours appliqués ? Peut-être, ou plutôt sûrement ; en tout cas, l’événement est heureux, quand un critique transgresse le tabou du méta-discours et jette un peu de clarté sur les pratiques. Car au fond, les critiques ne savent pas ce qu’ils font : ils voient, écrivent, relaient, pérorent, mais sans toujours saisir les ressorts de leurs discours ni la fonction par laquelle ceux-ci s’insèrent dans le socius. La frénésie textuelle, l’intense circulation des avis esquivent souvent les questions du pourquoi, du comment, du à quel titre. Refoulement fondateur du discours, auquel Eric Loret a répondu par une méticuleuse enquête sur ses fondements. Son Petit manuel critique est une méditation prolongée sur le tribunal du goût, en même temps qu’un plaidoyer pour un jugement non judiciaire, rétif aux cruels arrêts. Son titre n’est donc pas sans une dose d’ironie : qui l’ouvrira dans l’espoir d’y dénicher une recette pour parfaire sa plume sera déçu ; ni précis d’écriture, ni abrégé de méthode, ce livre tout empreint du kantisme le plus rigoureux tient plutôt de la critique du verdict gustuel. Son problème est à la fois d’ordre épistémologique – quelles assises pour l’évaluation –, éthique – comment juger sans exclure, en aménageant au contraire l’espace d’un partage des pensées – et politique – quelle communauté faire reposer sur l’échange critique, et, suivant le titre du livre de Schiller qui y est maintes fois cité, pour quelle éducation esthétique de l’homme. C’est dire que cette critique de la critique n’a rien d’une opération de police discursive ; son but n’est pas de promouvoir un certain exercice du jugement pour en invalider un autre ; philosophie de la glose tournée en rêverie sur le vivre-ensemble, le Petit manuel critique, grande somme œcuménique, pense, plus encore que le jugement, son partage.
L’idéal qui le meut est celui, humaniste, des Lumières, et son horizon le projet démocratique d’une humanité mûrie par la contemplation réfléchie des œuvres. De là que Kant en architecture explicitement le dessein. Le livre est au point de jonction des trois grandes critiques (et surtout de la dernière, la Critique de la faculté de juger) et des deux opuscules Qu’est-ce que les Lumières ? et Vers la paix perpétuelle (ouvrages qui articulent achèvement du savoir raisonné et programme d’émancipation). Le problème de Loret est directement hérité du philosophe de Könisberg : comment penser, de juris plus que de facto, une universalité du jugement critique qui ne soit pas totalitaire ? Ou comment édicter une norme du goût qui ne soit pas normative, comment, par la communication, muer la subjectivité des perceptions en objectivité du commun. Hannah Arendt, que Loret ne cite guère (comme, étrangement, il ne cite pas Habermas, dont il est pourtant le voisin théorique), avait tiré des conclusions semblables de ses analyses de Kant : le jugement esthétique est au principe de la communauté ; l’œuvre d’art, plus encore que les institutions, ouvre un lieu dans lequel rassembler les hommes par le truchement du dialogue. La critique, alors, passe pour voie royale vers cette utopie esthético-politique ; c’est à elle qu’il revient d’éduquer le regard et le verbe dans lequel il se renverse, à elle aussi de charpenter la scène du partage. Rôle plus princier que celui d’agent de la circulation dans lequel on cantonne aujourd’hui la critique. Le geste de Loret est d’abord celui d’un retour vers la naissance de la critique, et revenir à Kant, c’est rappeler qu’à l’origine toutes les critiques n’en faisaient qu’une, que la critique des pouvoirs de la raison était aussi une critique du goût et, partant, une critique des possibles politiques. Bref, que la critique n’était pas simplement affaire de production d’opinions, mais de libération.
C’est là toute la générosité animant le Petit manuel critique, livre-don s’il en est, et traité des vertus, à la fois théorisées (« Humilité, circonspection, échange des points de vue semblent donc les vertus cardinales. Être un bon critique ne peut se faire seul. », p. 123) et promues par l’exemple. Ce livre, au-delà du simple ravissement conceptuel, séduit par la bonté qui se dégage de ce style dont la patience pédagogue ne va pas sans l’élégance d’une langue qui, sans chercher l’effet, avance droitement, pétrie dans l’idéal de clarté hérité des siècles classiques. Une érudition pudique y assure la fermeté du sol conceptuel. On portraiture souvent les critiques en pillards ne citant jamais leurs sources. Rien de cette immaculée conception de l’idée chez Loret, qui fait preuve d’une rare hospitalité intellectuelle et tapisse une enquête très personnelle de références multiples – modestie discursive qui ordonne le livre autour de la figure non de l’Auteur, mais de l’Autre. Des autres, à vrai dire, car si Kant trône sur ce conclave, s’agite à ses côtés toute la tradition pragmatiste anglo-saxonne, de Hume à Dewey jusqu’aux tendances les plus contemporaines de la philosophie analytique, quand Deleuze ou Rancière viennent à l’occasion éclairer l’actualité du projet émancipateur. Et Loret cite ici ou là les écrits de collègues critiques, mais ne dit rien de ses propres sécrétions verbales. Double promotion du commun : comme sens commun, comme lieu partagé. A des développements rigoureux n’égarant jamais, dans leur simplicité stupéfiante, un lecteur dont on sent pourtant que la prose présuppose l’intelligence comme bon sens, répond l’idée de l’écriture comme accueil et espace en premier lieu collectif. Contre les Visions prophétiques, promotion d’une pensée ecclésiale.
Ce pluralisme principiel a un ennemi bien ciblé : le libéralisme. Loret excelle à débusquer les avatars intellectuels du capitalisme tardif. Partage et échange comprennnent une double acception : commun et communication, ou division et marchandisation, et là semblent se profiler, pour Loret, les deux pôles du jugement. Lui défend l’idéal d’une critique qui, en son fond, serait toujours faite à plusieurs, produite par le doux commerce des avis et la complémentarité des vues ; idée liée à celle voulant que la délectation esthétique ne vise jamais au quant-à-soi, qu’elle se branche toujours à une altérité seule capable de lui conférer du sens. Mais face à ce communisme critique se dresse la tyrannie des egos libéraux, l’apologie du soi véhiculée par l’adresse sans écoute, critique monadique, étanche au dehors et ne servant qu’à fortifier une individualité consommatrice. Loret décortique les discours prônant une « culture populaire » contre une « culture élitiste », pour montrer que le renversement n’aboutit qu’à enfermer le « populaire » dans une identité en forme de prison, ou détecte derrière la démolition des règles et canons du jugement perpétrée par les zélateurs du « goût du public » la simple institutionnalisation libérale de l’autisme. Combien d’arguments contre l’autorité critique ne visent à défendre, finalement, que l’absence de jugement au nom de l’immédiateté de la consommation ? Le partage s’y perd, et Loret relève bien que si le web 2.0 a démocratisé l’écriture, il a surtout généralisé la guerre de toutes les opinions contre toutes, sans instituer de réel espace de dialogue. On ne verra pas pour autant dans cette charge l’émanation d’un corporatisme qui sait son autorité symbolique en crise et pourfendrait le nivellement égalitaire pour garantir ses prébendes. La déconstruction des trop rapides éloges d’une fausse démocratie des opinions s’accompagne d’une même attaque contre son envers, la position de maîtrise, l’usage dominateur de la critique – une des parties les plus succulentes de l’ouvrage analyse les stratégies théoriques à l’œuvre dans le champ de l’art contemporain, plus tendues vers des formes retorses de légitimation que vers l’éludication collective du sens. L’idée d’une « bonne » critique ne se comprend que moralement : avant même les qualités textuelles importe pour Loret un positionnement éthique compris comme pédagogie sans pouvoir.
Critique pacifique. La référence kantienne dans laquelle s’ancre le Petit manuel critique le pousse parfois à un excès de bienveillance universaliste ; on ne pourra reprocher à ce livre que son trop peu de goût pour la polémique et son acharnement pour une conciliation qui, en plus de son parfum d’utopie, tend parfois à trop gommer la conflictualité propre à toute pensée. Que le libéralisme entretienne nocivement le choc des atomes individuels ne mène pas forcément à la conclusion que la guerre est toujours du côté capitaliste. Le désir d’une universalité négociée à plusieurs et servant à la réconciliation de la société avec elle-même (« Dans le monde réconcilié, il n’y aura plus de critiques, et on ne commentera plus les œuvres que par d’autres œuvres. », p. 184) évacue la dimension agonistique des options intellectuelles. À côté de l’arène libérale, il y a aussi la guerre sociale, qu’on l’appelle « lutte des classes » ou, plus sagement, opposition gauche / droite, et la critique tient une place de choix dans ces affrontements, sans qu’elle y perde son âme en se couplant à des positions idéologiques qu’elle n’est pas obligée de servir docilement. Louable est l’intention de Loret de voir dans la critique le vecteur d’un commun, l’étai théorique d’une harmonie plurielle. Mais c’est au risque d’occulter le fait que, hors de cet horizon radieux, règne le grondement de la bataille. Il y a aussi de l’irréconciliable.
Ce n’est pas là le tout du livre, juste son nerf intime, le credo moral auquel il souscrit et qui en oriente les réflexions. On y trouvera aussi de savants passages sur la perception esthétique, la définition de l’amateur comme artiste ou les paradoxes du goût, comme des interrogations sur l’impossible épuisement de l’œuvre par le discours – divers angles qui tous concourent à la réaffirmation de la nécessité du partage. Central est, à ce titre, le long et bel argumentaire sur l’insuffisance propre à toute critique, qui permet à Loret de dire en conclusion que son livre constitue « une enquête sur le ratage » (p. 179). Que la critique soit essentiellement ratée ne signifie pas qu’elle soit mauvaise. Seulement, le manque est inscrit en son cœur ; regard, elle est toujours une coupe singulière, un axe qui ne révèle une partie qu’en cachant les autres : « Il est en quelque sorte dans la nature de la critique d’être ratée. (…) Toute critique est, à l’aune d’une impossible vérité de l’œuvre, dans l’erreur. Mais comme il faut qu’on s’accorde momentanément sur ce qu’on voit et ce qu’on peut en penser, la seule critique réussie est donc celle qui se fait à plusieurs. » (p. 113).
Plaidoyer pour le partage, le Petit manuel critique est avant tout un livre de philosophie morale. C’est donc aussi une interrogation angoissée sur le rôle que peut encore tenir la critique aujourd’hui. Et on regrette, à ce titre (mais sans le reprocher au livre, puisque là n’est pas son but), la maigreur des références à la situation contemporaine. Loret rappelle d’entrée de jeu que le sort de la critique, désormais, s’identifie à un « vox clamantis in deserto », qu’il s’agit d’un art en grande partie périmé, que s’est dissoute la fonction sociale qui, longtemps, en fit l’infrastructure de l’édifice intellectuel de la modernité. Mais il ne poursuit pas l’enquête vers les racines historiques de ce désamour ni vers les formes de relève qui se profilent à l’horizon. Son problème n’est pas là. Le Petit manuel critique, là encore on ne peut plus kantien, ne se donne pour tâche que de fonder en théorie l’idée d’un jugement universalisable et dirigé vers la paix perpétuelle. Il peut donc se permettre de faire l’économie de l’interrogation « empirique », au sens de l’analyse des circonstances concrètes de l’exercice critique.
Livre complet et autonome, il demanderait à être suivi de deux autres tomes (au moins). L’un serait une sociologie, c’est-à-dire aussi une économie, de la critique contemporaine, et s’attablerait aux questions des usages de la critique, de son rôle symbolique aujourd’hui, de ce qu’elle convoie encore, envers et contre tout. Car certes, son autorité intellectuelle est en chute libre (et c’est tant mieux !), mais en même temps les discours prolifèrent et les lectures avec, sans que tous ces propos ne rentrent dans le régime de la concurrence capitaliste. Internet représente évidemment une refonte de l’exercice, mais qui ne se confond pas seulement avec la généralisation de ce que Loret appelle la « critique domestique » ; la critique du web est protéiforme, entre les forums, les blogs et les revues qui, héritières de la presse papier, n’en réforment pas moins les pratiques. Et de tout cela se déduit une reconfiguration du rapport séculaire de la critique et du capitalisme, puisque la grande transformation en cours est, au fond, une déliaison totale de l’exercice critique et de l’argent (notamment du salaire…). Bref, on criera soit à une « disparition de la critique », soit à une métamorphose de ses visages, et une socio-économie de la critique serait bienvenue pour éclairer ce débat.
À cela devrait s’ajouter une interrogation historique. Il est notable que Loret, attaché à Kant et à Schiller, ne renvoie jamais à leurs héritiers directs que sont les idéalistes allemands, qui ont pourtant scellé le destin moderne de la critique en confondant entièrement œuvre artistique et œuvre critique. Les frères Schlegel surtout, un certain Fichte aussi, Hegel à sa manière ont, en intrônisant l’Histoire gardienne des vérités, couronné la critique comme chercheuse de formes et pilote de l’avenir. Dans Le concept de critique esthétique dans le romantisme allemand, Benjamin a montré, de la manière ésotérique qui le caractérise, que la forme moderne de la critique vient plus de cette ascendance romantique que de Kant qui n’en a posé que les linéaments. Réfléchir sur la désaffection de la critique aujourd’hui ne peut se faire sans penser l’essoufflement d’un certain projet moderniste faisant de la critique, non le simple instrument d’un jugement sub specie aeternitatis, mais le bistouri de l’époque, la clé d’une ontologie du présent et, partant, du futur. La mise en échec contemporaine de la critique n’a rien d’accidentel ; elle est solidaire d’un certain rapport au temps historique, et l’image de celui-ci s’est vue nettement retouchée ces dernières années : pour le dire un peu vite, la chute du Mur de Berlin, c’est aussi la mort d’un projet émancipateur naissant avec la modernité et concevant l’histoire comme suite de révolutions nous acheminant vers un avenir radieux – progrès qui n’était pensable que via l’arme de la critique. Le capitalisme tardif, aussi dit postmodernisme, a déboulonné cette téléologie : la temporalité dans laquelle nous baignons n’a rien d’historique, aime même à proclamer béatement la « fin de l’histoire », et l’absentement de celle-ci, en ce sens, signifierait aussi l’éclipse de la critique. Bref, celle-ci, si elle trouve son origine historique en Kant, risquerait peut-être d’être ensevelie aux côtés du communisme, à moins d’enfourcher un nouveau cheval de bataille que la gauche contemporaine, déjà amochée par les coups de butoir de la Réaction, peine à trouver. Il est certain en tout cas que si la critique périclite aujourd’hui, ce n’est pas en raison d’une mort naturelle, mais d’un assassinat politique. Et donc tout aussi certain qu’on ne peut véritablement la penser sans s’interroger sur les configurations historiques dans lesquelles elle a connu ses heures de gloire, puis d’infamie. Le Petit manuel critique, tout merveilleux qu’il soit, exige ainsi deux extensions idéales : une Petite sociologie de la critique et une Genèse de la critique. Et vu la réussite du premier opus, on a toute confiance en Eric Loret pour en achever le projet.
Éditeur : Les Prairies ordinaires.
186 pages.
Parution : 14 février 2015.