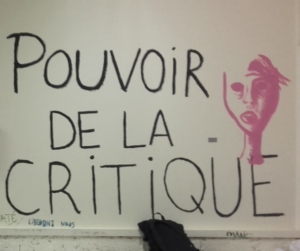Ramener la révolution au port
Sur Napoléon vu par Abel Gance (1927) et sa restauration
Un an après la sortie de la copie restaurée de Napoléon vu par Abel Gance sur les écrans français, Potemkine édite le film en DVD dans un coffret collector qui réunit non seulement la version longue du film d’Abel Gance mais aussi des compléments filmiques et éditoriaux supposés contextualiser le geste gancien et restituer l’ampleur du travail de George Mourier, qui s’est employé pendant vingt ans à restaurer le film.

« Citoyens pour ma part, le drapeau rouge, je ne l’adopterai jamais, et je vais vous dire pourquoi je m’y oppose de toute la force de mon patriotisme : c’est que le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec la République et l’Empire, avec vos libertés et vos gloires, et que le drapeau rouge n’a fait que le tour du Champ de Mars, traîné dans le sang du peuple. »
Alphonse de Lamartine, devant l’Hôtel de ville de Paris le 25 février 1848.
Comment voir Napoléon vu par Abel Gance ? Comment faire la part entre son indéniable intérêt patrimonial et le film, tel qu’on le reçoit aujourd’hui ? À la découverte de la version longue restaurée du maître-œuvre gancien de 1927, il m’a été difficile de m’immerger dans le tourbillon épique du film.
Le spectacle offert par Napoléon vu par Abel Gance résulte de seize années de restauration menées par la Cinémathèque française et le réalisateur George Mourier. C’est avec pour ambition de constituer une « copie officielle » du film que Georges Mourier s’est évertué à trancher entre le vingt-deux versions possibles d’un film dont Abel Gance n’a jamais arrêté la forme : près de trois-cent boîtes réunissaint les bobines des différents films d’Abel Gance sur Napoléon ont dû être recataloguées. Le travail de restauration – dont il ne faut pas minorer la part d’interprétation irréductible – a donc simultanément permis de redécouvrir le film et de clarifier le chaos archivistique qui l’entourait. En outre, l’équipe à l’œuvre s’est trouvée épaulée par le compositeur Simon Cloquet-Lafollye qui a signé une partition de sept heures empruntant aux répertoires classiques, romantiques et modernes, dans une volonté de continuité avec l’environnement musical des années 1920.
Le projet monumental de la restauration de Napoléon se mesure à l’ampleur du geste gancien. Napoléon, dans la tradition romantique, est vu comme son propre démiurge et, achevant son destin, achève celui d’un pays entier, la France. Ce Napoléon qui, dès l’enfance, apparaît comme un stratège magnifique ressemble à l’idée qu’Abel Gance se fait de sa pratique : celle d’un poète nietzschéen assumant sa puissance créative sur la matière elle-même. En ouverture du film, la classique scène de bataille de boules de neige à l’école d’artillerie de Brienne en 1780 transcende le jeu enfantin pour devenir le premier champ d’honneur du petit caporal. Dès son enfance, le Napoléon de Gance apparaît comme une figure figée au cœur de tableaux magistraux, comme si Jacques-Louis David avait accompagné le futur empereur toute sa vie. En réalisant un film à la mesure de Napoléon, c’est-à-dire un grand film, Gance rétablit non seulement une hiérarchie des genres – la peinture d’histoire s’affirme ici comme la consécration de l’artiste – mais se place lui-même au sommet de celle-ci, en tant que démiurge du cinéma de son époque.

L’idéalisation de Napoléon Bonaparte s’appuie cependant sur une certaine fidélité historique. La mention « Historique » est adossée à chacune des citations de Napoléon en intertitres comme pour apposer le sceau du vrai sur ces fulgurances proverbiales. De même, lors du retour en Corse de Napoléon pendant la Révolution française, un intertitre précise la fidélité des décors du film à l’égard de la biographie de Napoléon : ainsi sa maison d’enfance est-elle d’abord présentée comme un musée, passant par une plaque commémorative contemporaine, avant qu’un fondu nous ramène à la fin du XVIIIe siècle. Ces deux dynamiques qui traversent le film se recoupent autour de l’idée nietzschéenne d’un Napoléon qui apporte de la fiction dans l’histoire, qui forge le cours du temps à son image. L’histoire se fait en dépit des sources et trouve sa véracité dans l’affirmation du mythe, de la fiction, comme vérité supérieure. Ainsi, fuyant la Corse, Napoléon dompte-t-il une tempête en maintenant à deux bras un tricolore gigantesque qui sert de voile à une coquille de noix ballottée par les flots. La violence de la tempête, transmise par des mouvements de caméra qui tanguent de gauche à droite ou de haut en bas, est montée en parallèle de la proclamation par Robespierre, Danton et Marat de la Terreur dans une Assemblée nationale en panique. C’est précisément l’une des raisons qui détermine les bornes chronologiques d’un récit qui s’arrête à la Campagne d’Italie, moment à partir duquel, selon l’hagiographie traditionnelle, Bonaparte devient le porte-étendard de la Révolution, son continuateur autant que sa récupération par la figure du futur empereur. Une dialectique traverse le film, celle entre un pays et un homme cherchant tous deux à se déterminer. En cela, le film constitue un tournant pour Gance lui-même qui, jusqu’alors, mêlait le registre épique à des problématiques contemporaines (par exemple, J’accuse sur la Première Guerre mondiale ou La Roue dans le contexte du chemin de fer), se dirige davantage vers la reconstitution historique et, surtout, celle de l’épopée napoléonienne.
Dans la partition de Simon Cloquet-Lafollye, l’arrangement de La Marseillaise par Hector Berlioz résonne au début et à la fin du film et la voix y fait une incursion. Dans un premier temps, c’est Rouget de Lisle lui-même qui, incité par Danton, va chanter l’hymne au peuple réuni au club des Cordeliers et leur distribuer la partition. L’engouement du peuple, traduit par une accélération du montage au rythme de la mélodie, rejoint celui de Bonaparte qui, caché derrière un pilastre, félicitera le compositeur dont l’air exportera mieux la Révolution que n’importe quelle bataille.
Avant la Campagne d’Italie, Napoléon s’arrêtera à l’Assemblée nationale et, jonché sur la tribune, il verra les fantômes de la Révolution s’adresser à lui depuis l’hémicycle : Robespierre et Saint-Just (incarné par Abel Gance lui-même) lui transmettront la flamme d’un mouvement irrépressible qui a besoin d’une autorité pour la guider. Achevée par une seconde Marseillaise, cette séquence s’inscrit dans le récit d’un Napoléon continuateur de la Révolution, celle qui prétend que le Code civil a prolongé le travail législatif du droit révolutionnaire et que les coûteuses campagnes de l’Empereur ont permis aux droits de l’homme de faire le tour du monde. En ce sens, le triple-écran qui advient lors du départ de l’Armée d’Italie se veut la synthèse entre un destin individuel et national : avec Napoléon, la Révolution se fait mondiale et éternelle. Napoléon, accompagné de ses attributs, l’aigle et le tricolore, devient le symbole des idéaux de 1789 tout en les réduisant à sa personne. Joséphine le dit après sa nuit de noces, elle n’a qu’une rivale : « La France ». Gance achève son film au moment où Napoléon achève la Révolution, au moment où il la ramène au port.

Ce qui restera du Napoléon d’Abel Gance, hormis le spectacle visuel du langage gancien, lui-même en partie daté, c’est ce sentiment de contempler Michelet, c’est-à-dire d’observer un roman national auquel plus personne – de sensé – ne croit. Tous les personnages s’y montrent unidimensionnels, correspondant aux caricatures en vogue à l’époque : le visage grêlé de Robespierre, les tics du rachitique Marat ou la beauté de Saint-Just. L’écart de ce spectacle anachronique naît précisément d’une révolution épistémologique globale dans la manière de percevoir l’histoire : une sorte de conscience historiographique s’est généralisée face à ces archétypes romantiques qui se traduit dans les salles par d’inévitables pouffements de rires. Si le monument que constitue le film Napoléon, accompagné de la légende de sa restauration, devrait attirer une vénération, il finit par s’altérer comme s’est altérée l’image de son sujet.
Certes, l’histoire de Napoléon reste conflictuelle : le despote a charrié avec lui une bibliographie si ample et si élogieuse que toute commémoration, en France, ressemble à une célébration. Son tombeau reste l’un des lieux sacrés d’un régime républicain présidentialiste qu’on prédispose d’ailleurs au “bonapartisme” et son épopée rarement contestée par la parole publique. Mais cette figure, pourtant indéboulonnable – hormis par Courbet et les communards –, correspond à une manière de raconter l’histoire qui, elle, appartient à un autre temps. Entre-temps, l’idéal du démiurge législateur (ou créateur) a été démonétisé. Ce qui relevait de l’évidence pour un Gance bercé par Hugo, Stendhal ou Nietzsche, finit par créer un écart, sinon une ironie, c’est-à-dire le conflit entre deux sens. Derrière les prouesses visuelles, il y a cet envers, celui d’une contre-histoire qui a finalement triomphé sur les monuments, comme ce si pompeux style Empire relégué aux galeries les moins visitées du Musée des Arts Décoratifs, comme ces bijoux dont on se souvient de la valeur qu’une fois dérobés. Ce que révèle le revisionnage de Napoléon vu par Abel Gance, c’est que le trône a bien été laissé vide et que les imitateurs du despote ne font au final que se prendre pour Napoléon.
En ce sens, Napoléon vu par Abel Gance a quelque chose du document dont il s’agit de prendre acte et cela, aux dépens, pour ma part, de l’attrait de l’œuvre. C’est d’ailleurs ce qui pêche dans les choix de restauration : la restitution de l’intégralité du film semble parfois desservir son intégrité. Certaines séquences traînent en longueur à force d’aligner des plans de même nature : s’agit-il là de la volonté gancienne ou bien du résultat de difficultés – bien compréhensibles pour un restaurateur – à savoir où couper ? Ces limites formelles semblent recouper l’inclination historiographique du film : Napoléon n’a rien d’éternel mais s’apparente en tout point à un film de son époque. Retrouver Napoléon, monument de l’histoire du cinéma pourtant invisible, c’est une chance un peu rare : contrairement aux autres films de patrimoine sans cesse médiés par un siècle de glose, c’est finalement tel quel qu’on le découvre.