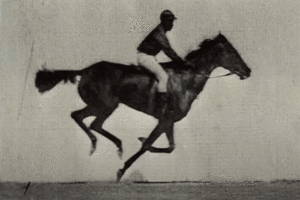Room Temperature, Dennis Cooper et Zac Farley
Au nom du père

La maison s’impose avant même que le récit ne commence : lumière crue, blanche et jaune, éclatant à travers toutes les fenêtres comme un petit big-bang, sons synthétiques et air chargé d’inquiétude – on pense immédiatement à Twin Peaks. Puis, sur le visage d’André (Charlie Nelson Jacobs), en gros plan, apparaissent des éclaboussures de sang : le geste est cru et immédiat, alors qu’il est violemment étranglé. Fragmentaire et répétitive, cette violence graphique évoque un GIF : le geste incomplet est figé en une boucle mentale obsessionnelle. Elle disparaît aussitôt avec le titre, laissant place à un calme plat, interrompu par Paul (Chris Olsen), jeune agent d’entretien dans un lycée, absorbé par le geste banal de laver les toilettes. Dès l’ouverture, le film réactive les motifs chers à Dennis Cooper, écrivain américain dont les récits tissent violence, désir et maltraitance dans des univers clos et étouffants. Un travail poursuivi au cinéma en tandem avec Zac Farley, son co-réalisateur, de près de trente ans son cadet[11][11] Ils ont réalisé ensemble Like Cattle Towards Glow (2015) puis Permanent Green Light (2018). Room Temperature est leur troisième collaboration..
Une famille vit dans cette propriété qui chaque année est transformée en maison hantée : un rituel domestique où chacun doit jouer sa partition dans un simulacre morbide entièrement supervisé par le père (John Williams). Cette année, le spectacle s’intitule Where Is Your God Now?, un intitulé presque bravache, dont la charge tient moins à l’attraction elle-même – qui ne comporte aucun motif religieux – qu’à ce qu’il met à nu du rapport tordu du père au sacré, comme si cette adresse relevait davantage d’une provocation que d’une véritable interrogation. Le dispositif évoque Jerk[22][22] Jerk est d’abord une nouvelle de Dennis Cooper (parue dans Un type immonde, POL, 2010) imaginant David Brooks, complice du serial killer Dean Corll, apprenant la marionnette en prison et y reconstituant les meurtres à l’aide de poupées devant une classe de psychologie. Elle est adaptée en pièce sonore pour France Culture puis en spectacle en 2008 par Gisèle Vienne et Dennis Cooper, avant d’être portée à l’écran en 2022., où le tueur manipulait lui-même les marionnettes pour rejouer son crime : il ne s’agissait pas d’une mise à distance, mais d’une implication totale, où chaque geste était contrôlé par le metteur en scène interne. Room Temperature procède de la même logique. Dans la maison hantée orchestrée par le père, chaque mouvement et chaque parole des enfants est réglée avec précision, non pour atténuer l’horreur mais pour la concentrer, la faire exister dans un cadre entièrement dominé. La répétition ne dilue rien : elle manifeste le pouvoir de celui qui impose le rituel, transformant les enfants en corps-instruments et la maison en théâtre de son emprise.
Le récit s’organise en deux temps. Le premier repose presque entièrement sur un geste d’observation et d’évidement : Paul pénètre dans la maison et découvre les préparatifs de la maison hantée annuelle, encore dépouillée, où tout est à imaginer. Typiquement conçu comme un espace foisonnant et labyrinthique, le domicile est réduit à ses contours essentiels, à son squelette, et devient un lieu à multiples strates, à remplir mentalement. Ce vide concentre la projection spectaculaire et, plus subtilement, le potentiel financier du dispositif : la maison n’existe encore que comme promesse, comme structure à découvrir, où chaque élément de décor est autant de possibilités et d’attentes. Cette économie de présence transforme Paul en architecte mental du parcours, et souligne le décrochage entre l’ambition du père (un tunnel, des murs enduits de graisse, des gerbes de sang, des personnages) et la réalité encore absente de la mise en scène. Tout sonne faux, et le faux finit par devenir la mesure du vrai. Ce glissement est essentiel : le film ne se contente pas de montrer des artifices défaillants, il construit un régime où l’artificialité elle-même devient un principe de réalité. Le ridicule de la démonstration – récit non appris, effets spéciaux inexistants, gestes approximatifs – ne fait que renforcer le caractère inquiétant de la scène. Quand André avoue ne pas connaître son texte, le père, sans détour, explique à Paul qu’il frappe ses enfants. La réplique tombe sèche, plate, sans colère ni honte, comme une simple donnée logistique au milieu des préparatifs.
Tous – parents, enfants, visiteurs, même Paul – semblent se mouvoir dans une densité étrange, comme si chaque geste devait traverser une résistance invisible avant d’atteindre l’image ; la même lenteur dans les déplacements, la même diction trouée de pauses, la même sensation d’un temps retenu. La direction d’acteurs vise une neutralisation affective : une fatigue diffuse, une torpeur qui dit la violence autrement, un jeu réduit à son minimum – mouvements mécaniques, silences qui creusent les répliques, phrases asséchées – sans pour autant effacer les modulations singulières de chacun. Derrière l’apparente neutralité se cache une étonnante incarnation : les avants-bras du père moulinent étrangement, la petite sœur oscille entre nonchalance et brusques sautes d’humeur, Paul tressaille parfois imperceptiblement, et les mouvements imprévisibles du visage d’Extra trahissent une vie intérieure intense. L’évidement de l’expression rend la présence des personnages encore plus saisissante – à l’opposé du ventriloquisme de Jonathan Capdevielle dans Jerk, où la voix blessée surgit par débordement. La question que Marguerite (Virginia Adams) pose à sa mère (Stanya Kahn) – « Pourquoi papa est-il obligé de me tuer deux fois ? C’est comme s’il voulait s’assurer que j’étais bien morte. » – résonne alors comme la pointe émergée de tout ce que le récit a lentement, patiemment disposé autour de lui. Elle n’est ni dramatique ni accusatrice : elle relève de l’étonnement placide, d’une curiosité enfantine, et fissure subtilement la surface de cette composition, révélant le malaise profond qui irrigue ce théâtre familial. C’est dans ce contexte que survient un moment où l’ensemble bascule, concrétise une fatalité qui semblait s’évanouir derrière la petite foire en préparation : le père tue Extra (Ange Dargent), son fils adoptif, réellement, devant tous. La scène provoque des réactions inhabituelles – Paul fuit loin du cadre, André hurle – une déchirure soudaine dans un univers jusqu’ici figé. Puis, immédiatement, tout se referme, et la famille revient au même jeu asséché, comme si l’excès, à peine surgi, avait été refoulé instantanément dans le même calme contraint.

On pourrait dire que Cooper et Farley refusent de remplir leurs images, refusent tout ce qui pourrait densifier le drame. Les plans sont souvent larges, laissant les personnages dans les zones vides. Le hors-champ est autant spatial qu’affectif ; les objets qui devraient produire de la peur n’existent que comme discours – le père les décrit, les promet, les fantasme, sans jamais accéder à une véritable figuration. Ce vide, où l’on perçoit davantage ce qui manque que ce qui est montré, devient la manière même dont s’expriment les relations : gestes répétés jusqu’à l’usure, tensions neutralisées, paroles comme suspendues. La maison hantée qu’ils construisent n’est alors qu’un miroir : ce n’est pas elle qui est hantée, mais la famille, travaillée par ce qu’elle ne peut ni nommer ni affronter, et par un père dont l’autorité ne s’exerce qu’à travers la reconstitution ritualisée de sa propre cruauté. Room Temperature devient ainsi un film sur la température affective du foyer, à niveau glacial et morbide. Cooper et Farley ne cherchent ni l’horreur ni la dénonciation psychologique ; ils construisent un espace de latence où les pulsions, les frustrations et les désirs morts-vivants continuent de circuler, comme des courants d’air à peine perceptibles.
Vient alors le second temps, où la maison hantée est achevée : décor plus riche que prévu, lumières, matériaux, fausses chairs, costumes, couloirs transformés en labyrinthe. La surprise d’un budget conséquent tranche avec la démonstration grotesque du père lors des préparatifs : un marécage artisanal où des crocodiles en plastique resteront immobiles, répond la mère à la demande d’une visiteuse ; deux jeunes, pris dans l’engrenage, incarnent avec une conviction totale deux loups-garous aux masques cheap ; un robot décapité trône à l’entrée, avançant maladroitement les bras comme pour accueillir les visiteurs. Or cette abondance matérielle ne masque rien : le parcours reste inintéressant, incohérent, pauvre – la mère confiant à Paul qu’elle ne saisit pas l’histoire qu’ils jouent ; le père insistant pour que le spectacle reste vague, convaincu que l’indétermination intensifie la peur. Ce bricolage manifeste, là encore, l’écart entre l’ambition et les moyens réels : la famille espère effrayer, mais n’en a pas les moyens, et ne semble pas s’en rendre compte. Chaque choix, du décor à la disposition des objets, est pensé pour provoquer l’effet désiré, mais c’est précisément cette déconnexion entre intention et réalisation qui crée le comique et le grotesque du dispositif.
Alors le surnaturel s’introduit. Extra, revenu sous forme de spectre, traverse les murs et glisse parmi les visiteurs de la maison hantée. Sa présence est immédiatement perçue par un jeune garçon venu visiter la maison avec sa mère, et s’impose comme bienveillante : un « gentil fantôme » qui n’a rien d’effrayant, et dont la présence semble rétablir une forme d’empathie et de continuité dans l’espace du film. Extra avait déjà révélé à André, plus tôt – dans une scène très touchante, tenue dans une grande économie de moyens, un simple champ-contrechamp où le temps et la parole se dilatent suffisamment pour laisser affleurer l’émotion –, sa lecture de la maltraitance : il comprenait pourquoi le père frappait André et Marguerite, mais pas lui, car il avait « toujours été gentil ». Il lui confie également que, toute sa vie, il avait pourtant été frappé, comme si la pureté de sa présence devenait insupportable aux autres. Cette complicité passée projette sur sa forme spectrale une douceur contrastant avec la cruauté domestique, et instaure un rythme étrange où le surnaturel n’est pas source d’angoisse, mais d’une tension émotive subtile. La caméra subjective d’Extra (on pense instantanément à Presence de Soderbergh, sorti plus tôt dans l’année) traverse murs et plafonds, glisse dans les pièces vides ou habitées, observe l’indifférence des visiteurs, et fait affleurer la mémoire de la maltraitance sans jamais l’imposer. La figure du « gentil fantôme » devient alors une mesure morale implicite : Extra n’est pas là pour punir ou effrayer, mais pour montrer la permanence du lien et l’injustice silencieuse qu’il a subie. Sa présence transforme l’espace : le surnaturel devient un indicateur de ce qui a été perdu, de ce qui ne se dit pas, de ce qui persiste malgré tout. Après la soirée, la mère reproche au père d’avoir tué Extra, estimant que cela a plombé l’ambiance entre eux et ruiné le spectacle de la maison hantée. Le père, lui, minimise l’impact : pour lui, c’est plutôt le labyrinthe qui gêne le rythme du malaise – mais finit par acquiescer, le meurtre a bel et bien contribué à cette rupture de ton (alors qu’il espérait au contraire qu’il le donne). Et sur la tombe d’Extra, André déclare que, comme l’année dernière, « ça n’a pas fait peur. » Cette ultime réplique condense tout le sens du film. Ce n’est pas la maison hantée qui est ratée : c’est le dispositif familial lui-même, incapable de faire peur parce que la peur y est la norme et l’atmosphère. Les visiteurs passent sans frémir parce qu’ils entrent dans un espace où la violence est trop froide, trop plate, trop intégrée pour être ressentie. Cooper et Farley assèchent les affects, les cadres, la lumière (malgré les effets stroboscopiques de l’attraction), les dialogues, jusqu’à produire un cinéma où la maltraitance n’a plus l’apparence du drame, mais celle d’une lente érosion du lien, d’une intensité à température ambiante.

Scénario : Dennis Cooper, Zac Farley / Image : Yaroslav Golovkin / Montage : Dennis Cooper, Zac Farley / Musique : Puce Mary
Durée : 1h33.
Sortie française le 26 novembre 2025.