Tatiana Mazú González (V. F.)
« Un film sombre, bruyant et granuleux »
L’édition 2024 du FIDMarseille voit le retour de la cinéaste argentine Tatiana Mazú González, deux ans après la première à Marseille de Río Turbio [Shady River, 2020], avec un nouveau long métrage. Todo documento de civilización [Every Document of Civilization, 2024] est un documentaire expérimental et militant sur la « disparition » de l’étudiant argentin Luciano Arruga (1992-2009), détenu et torturé par la police, et dont les restes n’ont été retrouvés qu’en 2014. Le récit est raconté à travers la voix de Mónica Alegre (la mère de l’adolescent) et une description envoûtante et atypique des lieux de l’événement, filmés de manière obsessionnelle, la nuit, avec des filtres en verre et une bande-son bruyante. Avec Todo documento de civilización, Mazú González remporte, pour la deuxième fois, le Prix International Georges de Beauregard. Cette conversation, enregistrée au lendemain de sa première projection au FIDMarseille, est l’occasion de décrypter sa pratique cinématographique, de mettre en miroir certains choix formels de Todo documento de civilización avec ses autres films et de découvrir la qualité polyphonique de son travail réalisé au sein du collectif Antes Muerto Cine.

Débordements : Qu’est-ce qui est venu en premier, ton intérêt pour le quartier en tant que lieu d’étude ou l’histoire de Luciano Arruga ?
Tatiana Mazú González : Le quartier s’appelle Lomas del Mirador, il est situé dans un district de la banlieue de Buenos Aires appelé La Matanza [matanza signifie massacre en espagnol]. C’est là que ma famille maternelle vit depuis 1960, plus ou moins. Celle-ci était composée de migrants espagnols de l’après-guerre, des paysans, qui sont arrivés dans ce quartier à une époque où il était beaucoup moins urbanisé. L’avenue, l’Avenida General Paz, existait déjà puisqu’elle a été construite à la fin des années 1930. Mais c’était un espace beaucoup plus rural, comme le montre d’une certaine manière la scène avec les documents d’archives, où il y a une idée du passage de la campagne à la ville et comment, à cette époque, le projet de construction de l’État en Argentine n’associait pas la campagne à la barbarie et la ville à la civilisation européenne. C’est le quartier où ma mère a grandi. Ma grand-mère travaillait chez elle parce qu’elle était couturière et mes parents travaillaient à l’extérieur, de sorte qu’ils me laissaient avec elle la plupart du temps pendant les heures de travail.
D’une certaine manière, ce n’est pas mon quartier d’origine, mais c’est le quartier où j’ai grandi en grande partie. Et c’est le quartier où j’ai vécu ces dix dernières années. J’habite à trois rues de l’intersection de l’Avenida que l’on voit dans le film. En 2014, le corps de Luciano Arruga a été retrouvé, il avait été enterré comme inconnu dans le plus grand cimetière municipal de Buenos Aires. Cette nouvelle m’est parvenue au moment où j’envisageais d’emménager dans la maison de ma grand-mère. Les personnes avec lesquelles ma grand-mère vivait, ses frères et sœurs, habitaient une grande maison familiale. Ils sont morts et ma grand-mère est restée seule dans cette très grande maison. Ma mère l’a emmenée vivre plus près de chez elle, et comme la maison était vide j’y ai emménagé. Cela a coïncidé avec le moment historique où, après cinq ans, la famille et les amis de Luciano ont retrouvé son corps. Cela m’a beaucoup affectée, car j’ai commencé à passer devant cet espace tous les jours, et c’est de là que vient cette obsession, qui me poursuit depuis maintenant dix ans. J’ai regardé cet endroit de différentes manières et j’ai vu beaucoup de choses que je n’ai pas pu filmer, et je ne sais pas pourquoi. Mais c’est vraiment une obsession.
D. : Todo documento de civilización a de nombreux points communs, sur le plan esthétique et politique, avec Río Turbio, ton film précédent. À un moment donné, tu as travaillé sur les deux films en même temps, n’est-ce pas ?
T. M. G. : Oui, j’ai travaillé sur trois films en même temps, en fait. Les trois longs métrages que j’ai réalisés jusqu’à présent ont coexisté à un moment donné. Et ils se sont contaminés d’une certaine manière. Surtout par rapport à celui-ci, dont les débuts sont antérieurs à ceux de Río Turbio. Lorsque j’ai commencé à prendre des notes sur Todo documento de civilización, et même lorsque j’ai commencé à tourner une première série de matériaux en 2017, Río Turbio n’existait même pas en tant qu’idée. J’avais bien quelques questions en rapport avec la ville minière de ma famille paternelle, mais cela ne s’était pas encore cristallisé en une idée de film, je pensais que c’était censé devenir autre chose. Mais j’avais commencé à écrire et à filmer pour Todo documento de civilización. Et à ce moment-là, quand le film était plus embryonnaire, c’était, je pense, un film plus dur. Un peu plus comme une enquête médico-légale, pour ainsi dire, avec plus de documents d’archives techniques qui abordaient différentes manières de penser et de représenter cet espace tout en cachant ce qui s’y était réellement passé, c’est-à-dire la disparition forcée d’un adolescent aux mains de la police.
C’était peut-être un film un peu plus farockien. Il se transformait lentement, dès le tournage. Mais certaines des préoccupations et des expériences que je voulais faire par rapport à l’image technique, je les ai mises en pratique quelque temps plus tard, lorsque Río Turbio est apparu comme un film possible. Río Turbio est un film qui comporte beaucoup plus de cartes que Todo documento, ainsi que des graphiques liés à la météorologie et à la géologie. Ces questions techniques ont en quelque sorte été transférées d’un film à l’autre. Avec le temps, j’ai découvert que j’avais envie d’explorer d’autres choses avec ce film, alors que j’avais déjà l’impression d’avoir perdu mon envie d’explorer Río Turbio, par exemple : la question de l’approche de l’image technique, l’idée classique des documents. Dans ce dernier film, l’idée est restée latente dans la deuxième scène, où l’on voit les archives de la construction et de la conception de l’Avenida General Paz. Mais, plus tard, l’idée même de document dans le film s’est transformée : les ordures ou l’asphalte lui-même, ou le son que nous entendons, même la voix féminine, ou même la fantaisie ou l’imagination, tous ces éléments peuvent être considérés comme des documents.
D. : Les deux films ancrent le discours politique dans une description géographique, mais Todo documento de civilización devient vraiment obsessionnel dans la description cinématographique de ce lieu, je pense à la quantité de points de vue qui nous sont présentés de la zone du pont dans l’Avenida.
T. M. G. : Lorsque j’étais adolescente, vers 16 ans, j’ai commencé à réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie. J’avais deux possibilités, l’une était d’être géographe et l’autre d’être cinéaste. En fait, le choix était même entre la géographie et la biologie : je ne savais pas si je devais m’orienter vers l’une de ces sciences ou vers la réalisation de films. J’ai fini par choisir le cinéma parce que je sentais que la vie académique n’était pas faite pour moi. Je suis un agent du chaos, avec mes processus, mes méthodes de travail, je ne peux pas utiliser d’agenda, je suis une catastrophe. Et j’ai senti que le cinéma allait me permettre de respirer en organisant mon travail et mes intérêts de manière un peu plus libre, précisément.
J’ai abandonné la voie de la science, mais c’est quelque chose qui a toujours été dans mon esprit. Et la question de savoir quelles traces de l’humain portent les espaces, ou de la transformation sociale des espaces, est une question qui, évidemment, m’a toujours intéressée et qui devient plus consciente avec chaque film que je fais. Je suis fascinée par les espaces vides, je suis fascinée par les pierres. J’ai une collection de pierres dans mon salon. J’aime observer l’idée de la trace, de ce qui persiste et qui, d’une certaine manière, comme quelque chose de presque inconnu – un hiéroglyphe pour lequel nous devons creuser un peu – peut encore continuer à poser des questions du passé à notre présent et à notre futur. Et oui, j’ai une obsession pour les espaces, pour l’utilisation des espaces, pour les traces qu’ils portent.

D. : La bande sonore est équilibrée entre un design sonore expérimental – avec différentes couches de bruit – et une voix enregistrée qui rappelle une enquête journalistique. Peux-tu m’en dire plus sur ton rapport au son dans le film ?
T. M. G. : Le travail avec lequel je paie mon loyer, ma nourriture et ce genre de choses a plus à voir avec le graphisme, la direction artistique et les costumes dans les films de fiction. J’ai illustré de nombreux livres pour enfants, par exemple. À l’école de cinéma, je me suis orientée vers la photographie. J’ai eu beaucoup plus de formation dans ce domaine que dans celui du son. La question du son est arrivée lorsque j’ai réalisé mon premier film, Caperucita Roja [Little Red Riding Hood, 2019] avec ma grand-mère maternelle, qui m’apprenait à coudre et me parlait de travail et de migration. C’est là que j’ai réalisé que je n’avais aucune formation en matière de son. Je n’ai jamais pris de cours de musique, je ne joue pas d’instrument, j’ai eu des professeurs de son minables.
Voulant en savoir plus, j’ai entamé une collaboration avec Julián Galay. Julián est mon ami depuis que j’ai dix-sept ans et il n’a pas de formation cinématographique, c’est quelqu’un qui a reçu une éducation musicale depuis son plus jeune âge. Nous avons commencé à nous apprendre mutuellement les pratiques que nous maîtrisons le mieux. C’est ainsi que l’expérimentation sonore a fini par être fondamentale pour moi lors de la conception d’un film. Julián réalise actuellement son premier film en tant que réalisateur, et je suis sa cheffe opératrice. Cela fait presque dix ans que nous avons cet apprentissage réciproque, une collaboration son-image qui va de pair avec notre amitié.
En Argentine, il est courant de penser que la formation au son est mauvaise dans le cinéma : on vous apprend à produire un son très mimétique, très préfabriqué et centré sur ce qui apparaît à l’écran. En fait, en Argentine, c’est Lucrecia Martel qui a apporté beaucoup à l’enseignement du son, car elle a été obsédée par ces questions à un moment donné. Après elle, les gens ont commencé à s’intéresser à ça. Mais cette situation a généré plus de questions que de problèmes pour moi, car elle a ouvert un champ de recherche et j’ai commencé à sentir que dans la dichotomie image-son, le son était en quelque sorte opprimé par une culture essentiellement visuelle où, bien que le son nous influence en permanence, nous prétendons que ce n’est pas le cas. Et, pour moi, il y a quelque chose de cela, de marginal, qui m’intéresse toujours en tant que voie alternative.
J’ai également commencé à m’intéresser au son du point de vue du féminisme. Nombre des grandes pionnières de la musique expérimentale sont des femmes, elles ont fait quelque chose qui n’intéressait personne et c’est précisément leur condition de femme qui leur a permis de se consacrer à quelque chose de non productif. Il en va de même pour le cinéma expérimental dans de nombreux cas. Il y a là quelque chose qui m’attire beaucoup, l’art sonore et l’expérimentation sonore, même en termes de genre, ce qui finit par être étroitement lié à la question de l’écoute, l’écoute étant déjà, en termes politiques, davantage lié à la question de l’empathie. D’ailleurs, beaucoup de métaphores dans les œuvres du mouvement féministe ont à voir avec le son, avec le fait d’élever la voix et de se faire entendre, par exemple. J’ai donc l’impression qu’il y a tout un chemin entre l’expérimental et le politique. Cela s’est mis en place pour moi, pas à pas. Et j’aime trouver des moyens de faire coexister ces deux aspects sans qu’ils se marchent dessus. Ce que j’aime dans ce film, c’est qu’il y a un équilibre entre les moments où le son nous permet d’imaginer une autre planète, les profondeurs de la terre ou la violence inscrite sur l’asphalte, et les moments où la seule chose dont nous avons besoin est la simplicité de cette voix.

D. : Comment as-tu abordé le travail d’enregistrement avec la mère de Luciano ? Je te pose cette question aussi par rapport à l’attention que tu portes à l’espace.
T. M. G. : Je suis une personne plutôt timide. Les gens pensent que je ne le suis pas, mais il m’est très difficile d’approcher les gens que je ne connais pas. Et je pense que j’ai également trouvé, à partir de mes préoccupations, de mes intuitions et de mes intérêts, des façons d’approcher les gens par le biais du cinéma, qui sont moins invasives pour les autres et pour moi-même. Par exemple, je me sens très à l’aise lorsqu’il s’agit d’observer les espaces et leur évolution, et d’y rechercher les traces de l’humain et du politique. Je me sens également très à l’aise pour discuter sans enregistrer d’images, par exemple. J’ai l’impression d’être moins envahissante avec l’autre personne, d’être plus sincère lorsque nous nous écoutons l’un l’autre, sans être aussi consciente de la tension que l’objectif génère parfois.
Le monde est plein d’obstructions, d’oppressions et de restrictions et j’essaie, même s’il est impossible de s’isoler de tout ce qui se passe, de prendre des décisions formelles, mais aussi de lier le formel à ce qui a trait à l’artisanat, à la pratique, au partage, au matériel que chaque décision formelle implique, à des situations dans lesquelles je me sens à l’aise et où je sens que d’autres personnes peuvent également se sentir à l’aise.
C’est quelque chose dont je me suis rendu compte au fil du temps : même si le monde est horrible, je vais au moins essayer de construire, dans l’exercice de mon cinéma, une zone aussi temporairement autonome que possible, où nous allons essayer de fixer les règles nous-mêmes. J’aime parler aux gens, comprendre leurs histoires de vie et les lire d’une manière politique. Je n’aime pas les envahir avec une caméra et en même temps je suis obsédée par les espaces et les traces comme forme de connaissance. Je pense donc qu’il y a là quelque chose qui a été tissé d’un film et l’autre.
D. : L’enregistrement était-il prévu comme une interview ou comme une conversation informelle ?
T. M. G. : À l’université, j’ai fait partie de plusieurs collectifs liés à la contre-information de gauche, où j’ai appris beaucoup de choses importantes pour ma vie et mes positions politiques, mais où j’ai aussi eu beaucoup de mal avec les nombreuses façons de converser avec les gens. Cette idée des questions qu’on écrit avant de rencontrer quelqu’un et qu’on lui pose, mais qui signifient en fait « J’ai besoin de cela de votre part ». Pour moi, c’était quelque chose qui n’avait pas de sens et il n’y avait aucune possibilité de savoir ce que j’obtiendrais de l’autre personne, mais j’allais chercher ce que je pensais être utile pour mon discours. Il y avait là quelque chose que je n’aimais pas et que j’ai commencé à éviter.
Mon film d’étudiant El estado de las cosas [The State of Things, coréalisé avec Joaquín Maito, 2012] contenait des conversations, mais il n’y avait pas de questions préparées. Il s’agissait d’un film sur une maison de vente aux enchères d’antiquités, mais nous ne voulions pas parler de cela. Nous voulions explorer la relation que ces personnes entretenaient avec les objets, avec le matériau, la valeur d’usage, la valeur d’échange, la valeur affective. Il y avait des thèmes, des concepts, mais il était ridicule d’interroger les gens sur ces concepts. Il s’agissait donc de conversations très libres, qui m’ont appris que l’on pouvait facilement entrer en résonance avec une autre personne sur les sujets qui l’intéressaient, sans avoir besoin de la forcer à en parler, mais en trouvant des points de contact entre les intérêts, ce qui, après tout, correspond à une conversation.
C’est quelque chose que j’ai poursuivi plus tard dans mes trois films en solo : si je dois enregistrer une conversation avec quelqu’un, je n’y vais jamais avec quoi que ce soit en tête, si ce n’est le désir d’avoir une conversation avec cette personne. Et je ne pose généralement pas de questions. En général, je fais part de mes intentions : J’ai envie de m’asseoir et de discuter avec vous, à cause de ceci, de cela et de ceci, je fais quelque chose en rapport avec cela. Et, en général, je leur laisse un espace pour parler. Et les gens parlent beaucoup.
D. : Cette déclaration d’intention est présente dans Todo documento de civilización. Vous avez laissé cette partie dans la bande sonore.
T. M. G. : Oui, je l’ai laissée. Je voulais la laisser dans Río Turbio. C’est là que les deux films dialoguent. Je voulais laisser plus de traces, ou quelques traces, de cet exemple de communication dans Río Turbio, parce qu’il s’agissait aussi de conversations très intimes. Je veux dire que je n’enregistrerais jamais une conversation aussi fragile avec une équipe de tournage, par exemple. J’ai enregistré celle-ci seule avec elle et un simple enregistreur. Il en va de même pour celles de Río Turbio. J’étais là avec Florencia Azorín – qui est la productrice du film et une grande amie et collaboratrice au sens large – toutes seules, en train de manger des biscuits, quelque chose de très éloigné de l’idée d’un tournage. Et, pour moi, c’est important, car j’ai l’impression que le cinéma est parfois très envahissant. En particulier, dans le cas de Mónica, la mère de Luciano, il s’agit d’une personne qui parle aux médias depuis de nombreuses années. Et évidemment, beaucoup de choses que le film raconte ne sont jamais apparues dans ces interviews, précisément à cause de ce dont nous parlions, parce qu’il y a peut-être parfois une grande incapacité à écouter, dans un sens profond et actif de l’idée d’écoute. Pour moi, c’est une merveilleuse conteuse, elle peut mettre beaucoup de nuances dans une seule phrase, de ton, d’intensité, et cela m’a semblé incroyable quand je pensais que ce serait la première de dizaines de conversations jusqu’à ce qu’elle apparaisse et que je reste là pendant cinq heures pour déjeuner avec elle et que je me dise « Que puis-je demander de plus à quelqu’un que ce qu’elle vient de me donner ? ».

D. : J’aimerais que tu parles de l’utilisation du bruit dans ton film. Je ne parle pas du bruit de la bande sonore, mais du bruit visuel. Et aussi de la façon dont tu as filtré les images avec du verre.
T. M. G. : Dans Río Turbio, en général, l’image numérique est très propre, c’est du 4K, mais il y a aussi de la pellicule. J’ai travaillé sur l’idée de l’opacité et de l’obscurité, et ces éléments apparaissent dans le projet. En travaillant sur Río Turbio, l’image qui me venait constamment à l’esprit était ce que l’on appelle la poussière en suspension, c’est-à-dire cette poussière de charbon dans la mine, brillante et noire. C’est l’une des images qui m’a guidée dans mes décisions formelles. À part cela, la matière numérique de ce film est propre, correcte. En ce qui concerne Todo documento de civilización, l’une des premières choses que j’ai écrites est une phrase : « C’est un film sombre, bruyant et granuleux ».
Parmi les premières intuitions pour ce film, il y avait une idée de texture et de couleur. Pour moi, c’était un film de nuit parce que la disparition de Luciano s’est produite la nuit, parce que c’est la nuit que la police contrôle la rue. Il y a aussi une raison plus douce : j’ai imaginé une femme racontant une histoire à son fils avant de s’endormir, pendant une froide nuit d’hiver à Buenos Aires. Je voulais que le film soit à la fois un document sur la civilisation et un document sur la barbarie, en pensant à la réalité comme à quelque chose qui a des couches, où la netteté n’existe pas vraiment. Et ce qui est montré comme net est en fait opaque. Il y avait une relation conceptuelle et politique avec l’idée de la construction de la vérité ou de la construction de la réalité et ce qu’est un document et comment un lieu de passage est en réalité un lieu de mort. J’étais hanté par le sentiment que me procurait le fait de passer devant cet endroit tous les jours.
J’ai donc commencé à y réfléchir visuellement. C’est ainsi qu’est née une conversation avec Francisco Bouzas, le chef opérateur. Je lui ai dit que j’en avais assez de la netteté au cinéma, que j’en avais de plus en plus marre du 4K, où l’on voit tout et où voir plus, c’est soi-disant voir mieux. Et donc nous avons commencé d’abord, en 2017, à filmer à travers tout ce qui est en un verre avec de la vaseline, en suivant l’idée des couches qui sont cachées. Des années plus tard, après la première de Río Turbio, j’ai commencé à assembler Todo documento de civilización et j’ai commencé à travailler avec ce que j’avais, c’est-à-dire ces images filmées à travers des cristaux et les conversations avec Mónica. J’ai commencé à sentir que lorsqu’elle parlait, je ne pouvais pas voir la ville, j’avais besoin de voir quelque chose qui ressemblait à une image mentale. Et mes images mentales sont floues et granuleuses, elles n’ont pas de contours précis et ressemblent un peu plus à une ombre dans un endroit sombre de ma tête.
En réfléchissant à la manière de photographier ces images mentales, j’ai pensé à l’image analogique, qui est plus organique, qui admet l’erreur, d’autres douceurs et d’autres rugosités que l’image numérique, à première vue, semble ne pas pouvoir nous donner. Mais dans les conditions matérielles d’existence que nous avons connues en Argentine ces quinze dernières années, il est économiquement impossible d’utiliser de la pellicule pour un long métrage. Mais là encore, quelque chose qui apparaît comme un obstacle finit par devenir une opportunité ou un défi : comment résoudre ce problème sans passer à l’analogique ? Nous avons donc utilisé les caméras 4K de manière anormale, en les forçant, en poussant leur sensibilité ISO à la limite, comme 450 000 ISO. Nous avons également changé de modèle de caméra, tout n’a pas été fait avec la même caméra. Il était intéressant de voir qu’avec la vidéo, il était également possible d’obtenir ce qu’on voulait. Nous avons commencé à plaisanter en disant que c’était le film des pauvres.
D. : Le titre du film est une citation de Walter Benjamin : « Il n’est aucun document de culture qui ne soit aussi document de barbarie. ». Mais il y a peut-être aussi autre chose de Benjamin dans ton film, si l’on pense à sa méthode d’assemblage de fragments dans Paris, capitale du XIXe siècle…
T. M. G. : J’ai lu Sur le concept d’histoire – qui est le texte que je cite dans le titre – lorsque j’étais étudiante. À ce moment-là, il a résonné en moi comme un texte sur le cinéma et sur le montage, précisément quand il conçoit l’histoire comme quelque chose qui saute en arrière et en avant, et pas de manière unidirectionnelle. Benjamin parle beaucoup de cette idée de saut, qui pour moi ressemble beaucoup à l’idée de coupe. Il parle également de comment évoquer le passé. Ou encore lorsqu’il parle du souvenir « tel qu’il brille à l’instant d’un danger ». Il me semble qu’il parle, peut-être sans le vouloir, de la narration audiovisuelle et des opérations de montage, ce sont des métaphores du montage cinématographique.
D. : Vers la fin du film, il y a un moment où la narration de ce qui est arrivé à Luciano prend fin : nous savons déjà ce qui s’est passé, plus ou moins. Et à ce moment-là, pour la première fois, nous voyons la mère de Luciano. J’aimerais savoir pourquoi.
T. M. G. : Je me souviens que lorsque j’ai projeté une copie de travail du film, un programmateur m’a dit : « Pourquoi la montrez-vous à la fin ? Dans Río Turbio, vous ne l’avez pas montrée aux protagonistes et cela s’est bien passé. » Il y a beaucoup de choses pour lesquelles j’ai des réponses rationnelles et je défends le fait de les avoir et j’aime les avoir. Et il y a d’autres choses pour lesquelles je n’ai peut-être pas la réponse parfaite. Et je pense que c’est le cas ici. J’ai l’impression que c’est plus de l’ordre de l’intuition ou du caprice. Je ne sais pas si je veux toujours que ça marche bien ou si je veux essayer autre chose et voir ce qui se passe.
Par ailleurs, dans Río Turbio, il y a quelque chose qui m’a beaucoup intéressée, à savoir la création comme une sorte de voix collective. Douze femmes s’expriment dans ce film, alors que dans Todo documento, il n’y a qu’un seul personnage. Au-delà du fait qu’elle rende compte d’une lutte collective, elle parle aussi d’elle-même. L’arc de sa voix, dans ce cas, en plus de raconter l’histoire, comme tu le dis, pour moi, il raconte son histoire. Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un film sur l’affaire de la disparition forcée de Luciano. Je pense qu’il s’agit plutôt d’un film sur l’espace où cela s’est produit, sur son histoire et sur la façon dont elle est passée de cette femme – une mère célibataire, qui n’était pas impliquée politiquement et qui a dit à son fils de baisser les yeux lorsque la police le poursuivait – à ce qu’elle est aujourd’hui, ce que vous pouvez voir à la fin du film.
Pour moi, il y a donc une courbe qui forme un arc. Après l’avoir entendue, on peut peut-être la voir. J’aime beaucoup ce plan où elle apparaît en criant, parce qu’il a été filmé lors d’un confinement dans une toute petite manifestation au centre de Buenos Aires, où il y avait très peu de monde.
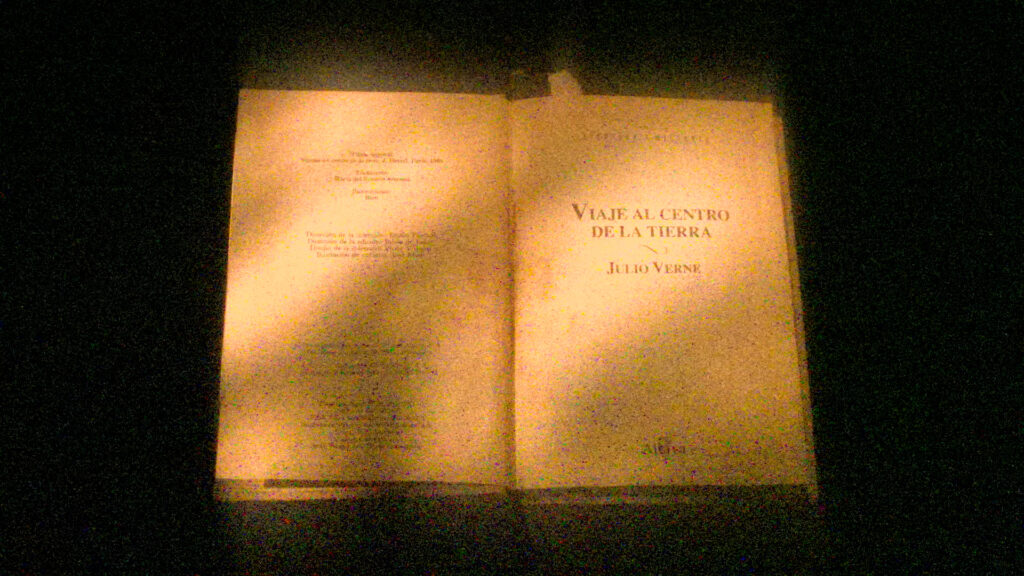
D. : Avec l’apparition de Mónica, le film se tourne vers le futur, vers l’utopie, dans un sens positif. Le film évolue. On voit Mónica, puis des illustrations de livres de Jules Verne représentant une fusée, puis des images d’un soulèvement. Et nous entendons des chansons antifascistes.
T. M. G. : Oui, il y a quelque chose, comme tu le dis, d’un devenir qui pour moi n’était pas seulement narratif, ce n’est pas seulement une question de montage, c’était une étape supplémentaire du processus créatif du film, du dévoilement des couches. Le film, comme je l’ai dit, était au départ un projet d’enquête médico-légale. Puis, en fait, lorsque nous avons commencé à filmer, cette attitude plus observatrice a été déformée par l’usage du verre. Mais lorsqu’un an plus tard, j’ai enregistré la voix de Mónica, c’est devenu autre chose. Et lorsque, deux ans plus tard, j’ai commencé le montage, c’est devenu encore autre chose.
Lorsque j’ai enregistré la conversation et qu’elle m’a fait part de l’intérêt de Luciano pour les romans de Verne, cela a ouvert une nouvelle ligne dans le film qui n’existait pas lors des trois années précédentes. D’une certaine manière, la structure du film reflète le processus que j’ai moi-même suivi pour découvrir de nouvelles limites et de nouvelles strates. Cela m’a également permis d’aborder de nouvelles questions politiques, ainsi que la présence de l’avenir, les possibilités d’un enfant ou d’un adolescent dans les quartiers pauvres de Buenos Aires.
La biographie de Jules Verne est pleine de sujets intéressants, de l’anarchisme à la technologie. J’ai trouvé passionnant de réfléchir aux questions qui trouveraient écho auprès d’un adolescent de mon quartier et à celles qui résonnent auprès de moi aujourd’hui, et d’établir ces liens qui, en fin de compte, ne semblent pas si éloignés de la question benjaminienne sur le progrès. Parce qu’une autre chose que Benjamin apporte au marxisme, qui vient comme déranger par un petit bruit, c’est justement d’ébranler cette idée de progrès qui est présente dans le marxisme le plus orthodoxe du début du siècle. Le film se termine par des images d’une manifestation qui a lieu chaque année dans notre quartier et qui se termine toujours par un incendie. Ils construisent ces voitures de police en carton qu’ils incendient, et ils dansent autour du feu, et c’est le rituel annuel, qui a aussi quelque chose de tribal, qui nous ramène à la dichotomie illuministe de la civilisation et de la barbarie.
D. : L’une des dernières choses que l’on entend dans le film, dans la scène de la manifestation, est un acte de curiosité et de partage : un enfant demande « Qu’est-ce que c’est ? » et l’ingénieur du son lui donne ses écouteurs. Il y a une coupure, et au lieu d’entendre le feu qu’on voit à l’écran, on entend la mer.
T. M. G. : Ce sont les vagues. Il y a une question que je me pose depuis quelque temps, c’est celle de l’imagination. J’ai l’impression qu’une grande partie de la défaite historique que nous vivons, et qui permet aujourd’hui cette nouvelle vague d’ultradroite mondiale, est liée au fait que nous avons perdu la capacité d’imaginer que cet autre monde, aussi diffus, en arrière-plan et à l’horizon qu’il soit, est une possibilité réelle. Il est difficile de trouver quelqu’un qui vous dise : « Oui, je crois qu’à un moment donné, ça va être mieux. J’imagine un monde comme ça ». Il y a un siècle, il était beaucoup plus facile de trouver quelqu’un qui disait : « Nous allons faire la révolution, il y aura le socialisme et nous serons tous égaux ». Je pense qu’il y a quelque chose dans le fait d’imaginer une autre possibilité pour le monde qui, aujourd’hui, est très tronqué. La réalisation de ce film a beaucoup à voir avec la façon de retrouver les moyens d’imaginer, et avec la façon dont la fantaisie ou l’imagination peuvent être un outil politique dont nous avons besoin en tant qu’adultes.
Cette façon de terminer le film est arrivée très tard : jusqu’à la mi-avril, une fois la scène d’incendie terminée, le film retournait au carrefour et il faisait jour. Mais l’image continuait à se brouiller et la vie continuait à se dérouler comme si de rien n’était. Et nous avons eu de longues conversations avec mes collègues du collectif dont je fais partie, Antes Muerto Cine : « Avec quelle question voulons-nous que les spectateur·ices quittent le théâtre par rapport au présent, par rapport à la réalité ? » Essayer des alternatives qui n’étaient pas fermées et qui n’étaient pas un faux arrivisme a été un véritable exercice de groupe. Nous avons trouvé la conversation avec l’enfant en repassant le matériau filmique. Dans un premier test, l’enfant écoute le feu. Mais Julián nous a dit que ce que nous devions écouter devait représenter l’imagination. La curiosité triomphe parce que l’enfant écoute la mer là où il y a du feu. Pour moi, c’était une façon de ne pas perdre complètement l’optimisme, d’embrasser cette possibilité d’avenir à travers l’imagination.



