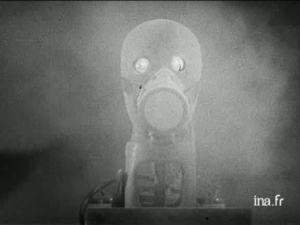The Disaster Artist, James Franco
A real Hollywood movie
L’article que James Franco avait consacré en 2013 au livre de Greg Sestero et Tom Bissell, The Disaster Artist, se terminait sur une allusion au mot de Flaubert sur Emma Bovary : « In so many ways, Tommy c’est moi. » Tommy Wiseau, c’est le réalisateur de The Room, film notoire pour sa nullité, et qui serait simplement risible si n’en émanait une misère affective inversement proportionnelle à l’opulence de son autofinancement. L’identification du golden boy au loser a de quoi étonner : Franco peut difficilement se dire maudit, malgré l’insuccès de ses premiers films. Mais le destin de Flaubert ne ressemblait pas plus à la médiocrité de celui de son héroïne, si bien que l’équivalence revendiquée (« Madame Bovary, c’est moi ») tenait plus aux rêves de vie qu’aux avanies du vécu. Bovary ou Wiseau, c’est la déception d’une existence rapportée à une norme trop inatteignable pour n’être pas cruelle ; ce qu’a inventé Flaubert et répété Franco, c’est l’identification à l’identification, la similitude des souhaits à travers la dissemblance des destins.
Bien sûr, Emma est une créature de papier et Tommy un créateur raté, et il y a un gouffre entre le roman normand (le récit du rien) et le méta-film hollywoodien (l’aventure d’un tournage naufragé). On peut sans peine crier à la récupération de l’échec par la réussite : le vampirisme qui obsède tant le Tommy joué par Franco est aussi bien celui du second à l’égard du premier, même s’il est couvert par les dehors de l’hommage et filtré par le livre qu’il adapte. Il y a bien de l’ironie à voir l’incarnation de la coolitude californienne endosser la peau d’un immigrant hanté par le désir de cette même coolitude (la tristesse de The Room vient de l’aspiration de son auteur à une conformité bien fade et néanmoins hors de portée). Mais peut-être est-ce cela même qui confère à The Disaster Artist ses plus grandes beautés, au-delà des éclats de rire qu’il provoque.
Mettons que le film comprend trois couches, au moins. La première serait le fait mis en fiction, transformé en récit burlesque d’une mégalomanie blessée. Sa matière première est autant le livre de Sestero que le film de Wiseau, dont bien des éléments ont migré vers le récit de sa genèse : nombre d’expressions comme « babyface » et le fameux « chick chick chick chick chick », ou la propension du Johnny de The Room à enregistrer les conversations devenue, dans The Disaster Artist, celle d’un caméraman chargé par Wiseau de filmer les messes basses de ses collaborateurs. De cette intrigue, l’emblème serait la cuvette que le cinéaste désigne comme son trône réservé et le moteur son accent mal placé, qu’il peine à mettre en sourdine dans The Room et que Franco amplifie pour faire de son drame une affaire d’articulation : le malheur de Wiseau est de ne pas bien parler une langue (l’anglais, mais aussi le cinéma) que pourtant il connaît presque trop, au point qu’elle l’étouffe ; ce n’est pas un hasard si, lors de la première scène, son « monologue » consiste en une suite de grognements, tandis le texte initialement lu par Greg est tiré d’En attendant Godot (c’est-à-dire l’antithèse du récit hollywoodien, mais aussi le signe d’une ambivalence entre tragique et comique sur laquelle s’appuie le film). Hilarante, cette première couche doit l’essentiel de ses méthodes à Judd Apatow, qui dans le film joue le producteur rembarrant un Tommy importun.
La seconde consiste en un documentaire sur James Franco, d’un côté sur sa relation avec son frère Dave, qu’il a lancé dans l’industrie comme Tommy a voulu le faire avec Greg, de l’autre sur son besoin de convertir son aura de jeune premier en celle de créateur tourmenté. C’était déjà le scénario de son premier film, The Ape, dont le comique suivait une pente moins indirecte. Depuis, il avait demandé à ses compères de ravager sa figure trop nacrée par des rôles de couillon (Pineapple Express, The Interview, Why Him ?) ou par un scénario de l’autodérision (This is the End). En changeant de registre comique, The Disaster Artist déplace cette mise à distance vers son travail – bien moins connu – de réalisateur ; s’il s’agit encore de gagner en perdant, c’est d’une toute autre façon : les rôles à ridicule lui permettaient de se faire acteur en jouant sur une coolitude au carré, tandis que celui de réalisateur en échec l’autorise enfin à passer pour un cinéaste réussi. Cette seconde couche renseigne donc d’abord sur le désir de Franco, échapper à un rêve préfabriqué (l’industrie des sourires normatifs) pour accéder au songe lucide (l’art comme onirisme critique).
Elle utilise pour cela le vaccin que lui procure la troisième, qui apparaît comme un morceau d’écologie de l’imaginaire. The Disaster Artist a pour ultime objet la pollution de l’esprit par des clichés comportementaux ; plus précisément, il enquête sur le désir d’être Américain ou, c’est tout comme, d’être conforme à ce que véhicule Hollywood. À ce compte, le comique et le tragique reposent sur le même mécanisme d’écart produit par l’aspiration à la ressemblance. Le premier est explicite dès le moment où les nouveaux amis jouent à ce « great american game » (Tommy) qu’est le football yankee (là encore, la scène vient de The Room) ; le second éclate lorsque Wiseau refuse catégoriquement d’incarner un villain, qui le renverrait à ses origines étrangères (il décrira plus tard le personnage qu’il s’invente comme « a true american hero »). Les deux trouvent leur formule condensée dans ce passage où le cinéaste en herbe explique vouloir reproduire le décor extérieur en studio parce qu’il tourne « a real Hollywood movie ». Franco se protège du rêve américain en le faisant passer pour une chimère d’immigrant. S’il y a un échange inégal à la racine du film, c’est dans cette manière dont l’insider se sert de l’outsider pour sortir d’une fabrique dans laquelle il ne l’aide pour autant pas à entrer.
Pour cette raison, The Disaster Artist a quelque chose de l’anti-Ed Wood. La panthéonisation paradoxale opérée par Burton reposait sur une célébration de la singularité dont Franco n’a à l’évidence rien à faire. Son problème n’est pas le mythe de la création, mais la mythologie manufacturée, et, avec lui, Wiseau ne s’approche jamais de la figure du génie romantique. Le réalisateur préfère lui-même convoquer Sunset Boulevard, avec lequel le rapport est moins à chercher dans le récit de l’échec que dans la description des fantasmes qui tapissent l’existence (sinon que Gloria Swanson y est une actrice déjà revenue, quand Wiseau reste un acteur jamais « arrivé »). C’est pourtant avec un autre film que The Disaster Artist semble entrer le plus directement en résonance : I’m Still Here, avec lequel Casey Affleck avait mêmement permis à Joaquin Phoenix de ruiner son éclat de jeune premier mais, là aussi, afin de lui faire gagner en profondeur. Les méta-films contemporains n’essaient plus de défendre une morale du divertissement (façon Sullivan’s Travels de Sturges) ni même de dénoncer le cynisme du happy end (façon The Player d’Altman) ; ils racontent seulement comment les grands gagnants du système tentent ardemment de lui échapper. C’est à se demander ce que ce commerce de la promesse a encore à vendre.
Scénario : Scott Neustadter et Michael H. Weber, d'après l’œuvre de Greg Sestero et Tom Bissell / Image : Brandon Trost / Montage : Stacey Schroeder / Musique : Dave Porter.
Sortie : 7 mars 2018.
Durée : 104min.