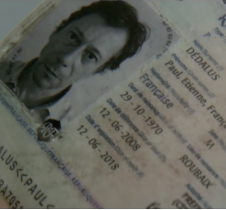Thierry de Peretti
Canal Historique
En quatre longs-métrages depuis Les Apaches (2013), Thierry de Peretti fait de l’histoire de son île, la Corse, un matériau dramatique à l’appui duquel il forme une méthode de travail. Casting sauvage de comédien·ne·s non-professionnel·le·s, tournage sur les lieux des événements racontés ou archives audiovisuelles constituent autant de ressorts utilisés par Thierry de Peretti pour associer les habitant·e·s à son histoire. Sorti le 4 septembre 2024, À son image adapte le roman éponyme de Jérôme Ferrari et suit le personnage d’Antonia, une jeune photographe qui, avec son groupe d’ami·e·s, traverse les années 1980-90, de l’éveil d’un nationalisme qui passe à la lutte armée jusqu’à la déchirure causée par la scission du Front de Libération National Corse (FLNC).

Débordements : Vous aviez coréalisé avec Julie Allione, votre directrice de casting, le film Lutte jeunesse sur le casting sauvage d’Une vie violente. Comment avez-vous procédé au casting d’À son image ?
Thierry de Peretti : Avec Julie, on travaille ensemble depuis Une vie violente donc quasiment sur tous les films. Lutte jeunesse est l’assemblage d’entretiens menés par elle lors du casting sauvage d’Une vie violente et à un moment j’ai pensé qu’il fallait en faire un film indépendant. Julie est cinéaste elle-même : elle a fait deux films dont le très beau Viril·e·s. Je travaille avec la même équipe depuis plusieurs films. Jeanne Aptekman, Marion Monnier, Rachel Raoult, Barbara Canale, Julia Canarelli, Toma Baqueni, José Deshaies, Claire Mathon, entre autres, ce sont avec elles et eux que je discute dès le tout début du projet. Le dispositif de casting qu’on va mettre en place, est différent pour chaque film et on en parle très tôt. Ce sont à la fois des vrais castings et un peu plus ou un peu moins que ça. Avec Julie on envisage l’étape comme si on devait d’abord faire un documentaire ou une enquête. Cela nous permet de rencontrer des personnes que l’on va intégrer au film, mais aussi de remettre à jour nos représentations sur les sujets dont le film s’empare. Même si le récit se passe dans les années 80-90 en Corse, époque que j’ai connue jeune homme, il s’agit avant tout de faire un film de 2024 et un certain état de la jeunesse aujourd’hui.
On a fait un casting sauvage, c’est-à-dire qu’on a mis des affiches un peu partout en Corse pour dire que je cherche des comédiens et comédiennes, professionnels ou non, pour mon prochain film. On reçoit un maximum de personnes que Julie voit sans moi dans un premier temps. Elle les voit en groupe en menant avec eux des sessions d’entretiens. Ces entretiens portent sur certains aspects couverts par le film, politiques mais pas seulement. Je regarde ce qu’elle a filmé et on réorganise les groupes pour revoir de nouveau tout le monde, en se rapprochant avec eux des vrais enjeux qu’on trouve dans le film. Ce sont de vraies sessions de travail. On s’approche de cette façon-là petit à petit de la distribution du film et les acteurs que l’on rencontre nous permettent de détailler les personnages. C’est un aller-retour permanent entre le scénario et le casting. L’idée est que toutes les personnes qui viennent au casting soient dans le film, même dans des rôles plus petits.
D. : Cette façon de concevoir le groupe, à la fois dans l’intrigue et avec les comédien·ne·s, vous vient-elle de votre expérience théâtrale ?
T.D.P. : Je ne crois pas. Plutôt l’inverse : l’envie de travailler, d’être en groupe m’a poussé à faire du théâtre, pas seulement en tant qu’acteur (mon premier métier), mais en tant que metteur en scène. C’est l’envie de travailler de manière collective et festive, qui a fait que la mise en scène de théâtre m’a plu, puis m’a conduite à vouloir faire du cinéma. On peut très bien faire du théâtre seulement à deux ou trois, mais ça ne m’a jamais vraiment intéressé. J’aime beaucoup les groupes, les bandes. C’est très cinégénique. Un groupe c’est, en instantané, une condensation, un bout de la société. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu’avec Julie on choisit des acteurs·trices dans l’idée que chacun·e serait absolument différent·e des autres pour porter en lui·elle tel ou tel aspect de la société qu’on dépeint, pas du tout. On ne pense pas à ça. Filmer un groupe m’amuse plus, c’est vrai, que des scènes à deux. J’ai l’impression que filmer un groupe revient à filmer de la danse.
D. : Votre manière de filmer les groupes met à égalité les seconds rôles avec les premiers rôles, les acteurs professionnels avec les non-professionnels, et, en même temps, choisit une certaine distance à la mise en scène qui détourne l’attention sur d’autres visages.
T.D.P : Peut-être qu’il faut envisager les films comme un tout, comme une grande toile, où certains personnages sont au fond, mais qu’on garde la possibilité de zoomer, de s’arrêter sur eux, même les plus lointains. Quelqu’un dans le fond est là, vivant, beau, et il a un rapport juste au reste du plan et donc au film. Dans À son image, on fait d’abord le portrait d’une jeune femme, Antonia, à la fois atypique, mais totalement connectée à la société de son époque. C’est un personnage tragique parce qu’elle meurt au début, mais pas un personnage si extraordinaire que ça. Elle est en permanence en relation avec les autres et à égalité. Il y a autant d’acteurs·trices professionnel·le·s que d’acteurs·trices pour qui c’est la première expérience de jeu. Je ne fais pas beaucoup de différences. Ce qui peut être vient de ma pratique désormais lointaine du théâtre, c’est l’utopie de la troupe où le personnage principal d’un projet, se retrouve avec un rôle secondaire dans celui qui suit, etc. J’aime aussi cette idée, plus romanesque que théâtrale, que la structure du récit se fait en parties qui se dédient à tel ou tel personnage. Il y avait dans À son image, dès l’écriture, l’espoir de dresser un portrait le plus vaste et à même de saisir quelque chose non seulement de la société insulaire des années 80-90, mais aussi de celle d’aujourd’hui. Les premières scènes du film témoignent de ce désir-là. On avait été très frappés avec Josée Deshaies, qui fait l’image du film, par D’Est de Chantal Akerman. C’est l’une des références pour notre film. Akerman y pose et répond à deux questions : qu’est-ce qu’un peuple et comment faire pour le filmer. Je m’inscris en faux avec l’idée de la distance.

D. : Pour préciser ce que j’entends par l’idée de distance. Je crois que vous êtes quelqu’un qui laisse des lacunes au sein des plans, des espaces vides. Le réel est quelque chose qui nous échappe et vous laissez des béances au sein de vos plans pour l’évoquer.
T.D.P. : La distance entre ce qui est filmé et l’endroit d’où on le filme, ce n’est pas quelque chose d’arbitraire et que je décide seul : j’en discute avec Josée Deshaies ou Claire Mathon. La distance juste est celle qui me permet de bien voir, de lire correctement, de comprendre ce qui est en train de se jouer. Cela vient peut-être du théâtre que je faisais, qui était un théâtre de texte où le décryptage était préalable à la compréhension de ce qui est censé se passer sur le plateau. Mais cette distance est avant tout déterminée par la liberté que je cherche à donner aux acteurs et, a fortiori, aux personnages. C’est très important pour moi que le spectateur soit libre de mon regard et des présupposés que je peux avoir sur la scène qui est filmée.
D. : Dans un des premiers plans du film, celui où Simon vomit, il s’opère une sorte de nuance au son lorsqu’il répète « C’est la meilleure soirée de ma vie ». La phrase est marmonnée la première fois qu’il la dit puis le son d’ambiance disparaît et elle est répétée plus distinctement. Le jeu de rapprochement ne passe pas à l’image mais par une subtilité sonore.
T.D.P. : Tout à fait. Il y a un travail sur le son qui contredit une apparence de naturalisme. Ce travail sur le son est, si ce n’est artificiel, construit par une accumulation de couches sonores. Encore une fois les questions scénographiques sont importantes car elles mettent en tension la séquence, que ça soit par la lumière ou les sons qui traversent et modifient les lieux et les atmosphères, mais aussi par le hors-champ, par le off et ce que le spectateur peut sentir ou deviner de ce qui vient de se passer, ou ce qui va se passer après.
Peut-être que ça vient de ce que j’aime en tant que spectateur. Je cite toujours les grands cinéastes taïwanais, Hou Hsiao-hsien et Edward Yang, qui filment assez peu l’événement-même. Pour la scène du pique-nique dans À son image, je pensais beaucoup au début de Norte de Lav Diaz, où un groupe d’amis vient boire un verre et passer un moment, rire et discuter, dans ce décor incroyable, sans se rendre vraiment compte de ce qu’il y a de terrible dans les paroles de l’un d’entre eux. Il n’y a aucun pathos. Le fait qu’il y ait quelque chose d’incomplet dans les plans me plaît beaucoup, que le plan puisse s’effondrer à un moment. Ça vient de la durée des plans : ce qui me fait rire ou ce qui crée le plus de tension c’est que le plan soit au bord de s’évaporer. J’avais vu une interview d’Hou Hsiao-Hsien, qui travaille beaucoup avec des acteurs·trices non-professionnel·le·s, qui disait qu’il ne pouvait pas trop se rapprocher d’eux avec la caméra parce que ça gênait les comédien·ne·s. Moi je suis acteur, je sais que ça gêne aussi les acteurs·trices professionnel·le·s. Une certaine distance, en plus de laisser la vie s’écouler dans le plan, retire également le nerf ou la psychologie, qui moi m’ennuie beaucoup.
D. : Pour revenir à la séquence dont je parlais, il s’agit aussi du moment où l’on comprend qu’il est le narrateur du film. Sa voix off s’oppose parfois à l’image et prend le relais sur les images, notamment lors de la mort de Pascal. À l’image, on suit Clara-Maria Laredo marchant dans les rues d’Ajaccio, pensant qu’on va assister au meurtre, et elle va ouvrir son atelier. Comment avez-vous mis en scène le texte de Jérôme Ferrari ?
T.D.P. : La voix off n’a pas toujours la même fonction : elle assume le rapport avec le roman et parfois se montre très littéraire. On peut se dire qu’on n’en a pas besoin par moments parce que ce qu’elle raconte n’est pas nouveau par rapport ce qui est à l’image mais elle a d’abord une fonction musicale. L’écriture de Jérôme Ferrari c’est une langue qui se déploie d’un roman à l’autre. La voix off doit être réexaminée sous cet angle-là, du timbre, du rythme, des allitérations et pas seulement sous l’angle du récit. Même si elle est aussi bien sur une autre façon de raconter ce qu’on est en train de voir, une autre façon de construire le récit, très subjective parce que c’est celle de Simon, quelqu’un qui raconte quelqu’un qui raconte. Lui-même fait partie du récit : c’est pas une voix off d’un lointain parent, il a été dans l’histoire, dans la vie d’Antonia.
D. : Cela se ressent dans la formulation des moments politiques où Simon donne d’emblée une lecture militante d’événements historiques.
T.D.P. : Sur les questions politiques, il a naturellement un point de vue sur tout ça, car il a été un acteur des événements. Certaines choses qu’il dit sont d’ailleurs tout à fait discutables. Cette voix off n’est pas celle du film mais d’abord celle d’un personnage en deuil, avec ses lacunes, ses souvenirs parcellaires et l’envie de dire l’histoire comme il l’entend ou telle qu’il s’en souvient. Cette voix a une force littéraire redoutable. Mais pendant l’écriture du film, elle n’a pas toujours été celle de Simon. Elle a appartenu à Antonia elle-même à un moment. La voix off dans Millenium Mambo [de Hou Hsiao-Hsien] nous avait, avec Jeanne Aptekman avec qui j’écris le film, beaucoup marquée : cette voix du personnage joué par Shu Qi qui se racontait à la troisième personne dix ans après qu’on la voie à l’image… Ça crée beaucoup d’interactions, de tensions, ça ouvre des pistes. Si on l’écoute bien, cela produit chez nous une étrangeté et un rapport au temps très complexe et qui modifie notre rapport à ce qu’on voit au fur à mesure que le film se déroule.
D. : Au son, vous utilisez aussi des musiques extra-diégétiques à quatre reprises qui indiquent les différentes étapes de la vie de photographe d’Antonia.
T.D.P. : La musique, en tout cas ces quatre morceaux, sont une manière de structurer le récit autrement que par ce qu’on voit à l’image ou par la voix off. Ces moments sont à la fois des béances, des pauses et un passage de relais. Ces quatre parties différentes et ces quatre textes différents – je pense surtout au Quannu moru interprété par Maria Violenza, une artiste punk sicilienne, qui reprend une chanson traditionnelle de la résistance communiste sicilienne Rosa Balistreri. J’aime que la musique ait sa propre indépendance, comme si quelqu’un jouait en temps réel sur l’image. J’ai vu le Napoléon d’Abel Gance cet été en plein air avec la partition de Simon Cloquet-Lafollye qui est d’une telle profusion… Par moments, la musique gêne ou propulse l’image.
D. : Pour revenir sur la photographie, vous maniez à certains moments des questions de théorie de la photographie – on pense à Devant la douleur des autres de Susan Sontag ou La Chambre claire de Roland Barthes – mais assez discrètement. Ces théories suivent un peu le cours de la vie d’Antonia et son rapport aux images.
T.D.P. : Ces questions passent avant tout par le personnage d’Antonia, oui. Ses interrogations portent avant tout sur les récits que l’on fait ou que l’on nous donne à entendre des évènements et de l’Histoire, sur leur réalité et la nécessité de trouver une image décente et précise et sur l’éthique qu’il fait pour ça. Le film, de son côté, met davantage en jeu tout ce qui touche aux questions de représentation liées à l’imaginaire de l’histoire contemporaine de la Corse. C’est par le choix de la troupe d’actrices et d’acteurs, par leur modernité, qu’il tente d’y répondre.
On s’est dit que le film pourrait être construit comme un album de famille qu’on consulte attentivement par moment et plus distraitement par d’autres. J’avais envie de jouer avec la photo comme un matériau très physique, concret. De travailler avec des natures d’images différentes, comme avec une matière vivante qui permet d’expérimenter tout en évitant que le rapport dialectique prenne trop de place. Tout film incorpore même malgré lui un rapport une réflexion sur l’image, qu’il le veuille ou non.
D. : À cet égard, le nationalisme, contrairement à Une vie violente, est vu depuis un personnage qui n’est pas militant ou engagé dans la lutte armée.
T.D.P. : Elle n’est pas une combattante, elle n’est pas une cadre du FLNC. Mais je ne suis pas sûr que le militantisme vous donne un regard plus précis sur les évènements. C’est même plutôt le contraire. Est-ce qu’on est dans son temps ou pas ? La place qu’on a eue par rapport aux événements, elle est celle qu’on aura eu, mais ça ne disqualifie pas la pertinence du regard qu’on a développé. Antonia est très proche du cœur du réacteur. Ce n’est pas parce qu’elle ne commet pas d’action qu’elle n’est pas au centre des choses. Son corps en porte d’ailleurs les stigmates. Quand elle sort de l’eau lorsque Pascal a été tué, je vois que son corps a changé, qu’il est lourd de ce tout que qui s’est passé et qui lui est arrivé. Mais même ses amis qui se sont investis dans la lutte armée, n’en sont que des acteurs secondaires, ils ne sont pas des cadres dirigeants et à ce titre n’ont qu’une vision parcellaire de ce qui se passe, se décide. La position d’Antonia est certainement proche de la mienne, jeune homme. C’est un temps où l’on ne pouvait pas faire autrement que d’être touché par les questions politiques. C’est pour cela que je me permets de raconter ce moment-là avec ce point de vue, parce que je m’en sens légitime, parce que j’ai traversé ces années-là, même si je n’en étais pas acteur.
D. : Ce rapport consubstantiel au nationalisme est-il la raison pour laquelle vous avez choisi Clara-Maria Laredo, militante dans le civil, pour incarner Antonia ?
T.D.P. : Elle est beaucoup plus militante que je ne le suis. Clara-Maria avait comme les autres acteurs.trices, un rapport très fort aux questions politiques, celles du film et de l’époque qu’il couvre. Mais ce qui est important c’est avant tout, qu’elle soit la comédienne qu’elle est. Ça m’intéresse de faire un portrait sur une jeunesse et des jeunes gens qui savent de quoi il est question, mais qui ne sont pas les contemporains de l’époque que le film évoque. Ils n’ont pas le même point de vue que moi sur ces années-là et les discussions qui peuvent sortir de ça, ont nourri l’écriture de certaines séquences. Antonia est engagée avec un projet qui est celui de la photographie, de raconter, de trouver l’image juste et de faire récit avec tout ça. Elle est méfiante vis-à-vis du militantisme et je partage cette méfiance. Ces années-là m’ont vacciné de toute forme de militantisme.
D. : Comme le dit Simon en voix off, et comme le lui rappellent ses deux amies, son rôle dans le début du film s’apparente à celui d’être « la femme de Pascal », dans un rapport assez genré à l’action politique. La photographie va la conduire à la rupture avec Pascal.
T.D.P. : L’expression Femme de vient du roman, mais aussi de l’époque où on disait autant « Tu es le mec à… » que « Tu es la femme de… ». Je ne dis pas que ça imprime la même chose que l’on soit un homme ou une femme bien sûr. À un moment donné, le fait qu’on sache que vous étiez au FLNC vous donnait certainement une forme d’aura. Ce que l’on comprend de manière comique avec le frère d’Antonia qui se fait engueuler par son père. Il y a un capital guerrier qui naît du fait d’appartenir à cette organisation militaire clandestine et que cela se sache.
D. : Comment concevez-vous l’écart entre les années 1980 et 1990 et la jeunesse contemporaine dont vous voulez faire le portrait ?
T.D.P. : Quand je dis que je fais un portrait de la jeunesse d’aujourd’hui, il passe par la tension entre ce qu’ils ont à jouer et eux-mêmes. Mais le film n’est jamais du côté de la reconstitution. Il y a des scènes qui n’auraient sans doute pas du tout leur place dans les années 90 ou pas de cette façon-là. Quand l’un des personnages dit lors d’un pique-nique : « Je quitte la lutte, parce qu’on se tue entre nous. » Ces mots ont leur place dans une AG et peut-être pas lors d’un pique-nique à la montagne ! Ce qui compte c’est que les personnages ne soient pas réduits à une idée ou à un propos. Je veux que les personnages soient complètement indépendants de ce que l’on veut leur faire porter. J’ai parlé avec Clara-Maria Laredo de cette réplique intraduisible que prononce Richard III : « I am myself alone. » Ça c’est Antonia ; d’une individualité féroce, ce n’est pas la femme de, c’est la femme de personne. Elle est toute seule elle-même.
En Corse le nationalisme, qui s’incarne dans quatre partis différents – deux autonomistes et deux indépendantistes – représente la première force politique de l’île et de très loin. Le projet politique plébiscité par les urnes est un projet d’autodétermination du peuple qui passe par une autonomie vis-à-vis de la tutelle de l’État, dite de plein droit et de plein exercice. En 2014, le FLNC annonce le dépôt des armes, mais tant que les solutions politiques n’ont pas été trouvées de part et d’autre, la possibilité d’un retour de la violence est toujours là, comme on a pu le voir au printemps 2022 au moment de l’assassinat en prison d’Yvan Colonna.
Certes la Corse n’est pas politiquement dans le même état que dans les années 80-90 que couvrent le film et où les nationalistes étaient minoritaires dans les urnes. Quand on est jeune à ce moment- dans ces années-là, mais sans doute encore davantage dans les années 1970, la Corse est laissée par l’État dans un tel état de paupérisation, sociale, structurelle, culturelle, avec un rejet des droits historiques et politiques du peuple, qu’il n’y a pas, pour toute une partie de la jeunesse, d’alternative, exceptée la lutte, et la lutte par les seuls moyens qu’on lui laisse, la violence.


D. : Dans À son image, vous utilisez particulièrement des régimes d’images différents : photographie, images d’archives, images arrêtées… Comment avez-vous réfléchi la mise en scène autour de ces différents types d’images ?
T.D.P. : Il y a toujours plusieurs raisons qui conduisent à ces choix formels. Disons que j’aime bien que le film raconte la recherche dans laquelle mes collaborateurs·trices et moi sommes quand on est en train de le construire. Je ne cherche pas à ce que l’effet soit parfait, utile, ni même juste, mais qu’il témoigne un peu de nos tentatives, réussies ou non, durant chaque étape de la fabrication. Il en va de la vitalité et de la physicalité de l’ensemble. Le choix de deux titres de punk dans le film, ça raconte sans doute un peu ça. J’aime que le film puisse être regardé comme une sorte de moodboard qui ne fait pas de différence entre les sources, que les archives utilisées et prélevées un peu partout deviennent complètement celles du film. Ça me plait d’imaginer que le film lui-même produise ses propres archives, un peu comme les photographies d’Antonia que l’on voit à la fin. J’espère que ça rend le film ludique. On a exhumé des images d’actualités qui sont très connues en Corse, comme celles juste après le double homicide de la prison d’Ajaccio, par exemple. Mais comme elles sont retravaillées dans le film et enchâssées au cœur de séquence de fiction, ça permet aux spectateurs de les regarder avec un œil nouveau. D’autres images comme celles de la revendication aux journée internationales de Corté de l’assassinat de Robert Sozzi sont plus rares.
Bien sûr, que lorsque le film est vu en Corse, ces images ne produisent le même effet que pour un public qui n’est que peu au courant de ces histoires, de leur charge politique ou qui n’en conserve qu’un vague souvenir. Dans le roman Jérôme Ferrari arrive à raconter les événements de Bastelica-Fesch en une demi-page alors qu’ils sont quand même assez complexes. En lisant, je me disais qu’il les racontait presque comme s’ils étaient imaginaires. J’avais trouvé fort qu’il réussisse à redonner la bonne dimension à l’événement qui, à l’époque où il s’était passé prenait tant de de place. À l’échelle de l’Histoire, c’est un évènement modeste. Je me suis posé cette question-là : comment raconter en donnant la juste proportion aux choses, sans en amoindrir celle qu’elles sont émotionnellement dans la mémoire de notre communauté. Et il faut aussi bien sûr qu’un spectateur extérieur à l’histoire contemporaine de la Corse puisse également y avoir accès de manière sensible.
D. : Vos films pourraient se rapprocher du genre du film historique, mais ils évitent soigneusement la tendance de la plupart des films historiques à se constituer comme des maîtres-œuvres, des formes achevées. Votre mise en scène de l’histoire cherche le processus.
T.D.P. : Les tournages c’est toujours de grands dérangements, je trouve. Certaines scènes sont tournées à l’endroit où les choses se sont historiquement passées. Non par fétichisme, tentative de décalque d’une scène primitive, ni même pour tenter une hypothétique séance d’exorcisme, mais pour faire se superposer des images dans le temps, dans l’esprit de celles et ceux qui ont à les interpréter en premier lieu. Le tournage permet de mettre en scène des situations qui deviennent dans leur longueur, performatives quand les acteurs·trices se jouent. Et ce n’est pas tant pour le spectateur du film, que pour celui qui passe à ce moment-là et assiste au tournage, au film en train de se faire. Cela a une influence très puissante sur les séquences, leur rythme. J’avais été marqué par une remarque d’Abbas Kiarostami sur ses films : il y disait que ses films n’étaient pas terminés. Qu’il laissait toujours la place au spectateur pour l’achever lui-même. J’aime beaucoup cette idée que les films restent suspendus, ouverts et toujours modifiables, même après qu’ils soient sortis en salles.
D. : Votre film tire son titre d’une citation de la Genèse : « Dieu a créé l’homme à son image. » Vous choisissez d’incarner un prêtre, parrain d’Antonia, qui lui a offert son premier appareil photo comme un fruit défendu qui va l’emmener ailleurs. Quel rapport entretient À son image avec la religion chrétienne ?
T.D.P. : J’ai une éducation catholique, on m’a enseigné le Nouveau Testament qui regorge d’images et de récits semblables, mais très différents dans leur détail. Ça donne le gout de la lecture, des questions d’interprétation. Je ne voulais pas que le fait de jouer ce personnage-là prenne trop de place et de signification ou que ce soit meta. Il y a quelque chose d’assez ironique, de cruel, dans la transmission de cet œil mécanique qu’est l’appareil photo.
D. : Prendre une image comme le personnage d’Antonia est une transgression vis-à-vis des interdits de l’Ancien Testament, dont le film tire son titre.
T.D.P. : Je le ressens vis-à-vis de la Corse. C’est vrai que, quand je montre le film en Corse, de nombreux spectateurs sont touchés mais aussi parfois un peu gênés parce que je montre quelque chose de nous de très personnel. Ce n’est pas que ça ne se fait pas, mais c’est comme si le film exposait quelque chose de très intime aux yeux du monde.
D. : En Yougoslavie, elle transgressera tous les préceptes qu’elle donne dans la première partie du film sur la photographie.
T.D.P. : Bien sûr, après il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que dit Antonia qui est sacrément de mauvaise foi par moments. Une des raisons pour lesquelles c’était important que ça soit Clara-Maria Laredo qui joue Antonia, c’est qu’elle n’est jamais dans le pathos, elle est à chaque fois dans le présent de la scène et dans une absence de sentimentalité que j’aime beaucoup. Ça ne veut pas dire qu’elle n’est pas touchée par les choses. Elle est dans l’écoute, dans le présent. Il y a aussi chez elle une certaine gravité, mais ça n’est jamais larmoyant. C’est rare.