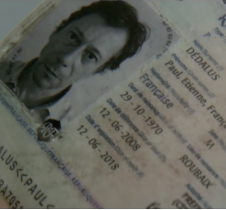Trois Amies, Emmanuel Mouret
Pardon et merci

Une amie proche me confiait, sans avoir vu le film et en dépit de son amour du cinéma parlé, être « revenue d’Emmanuel Mouret ». Car au fond, chez lui, le « monde » n’existe pas. Comme si les conversations ne s’écoulaient plus que dans un espace hors du réel – à moins que cela n’ait toujours été le cas. Au premier abord, Trois amies ne vient pas fausser cette (possible) impression. À l’instar de Les Choses qu’on dit, les Choses qu’on fait (2020), les virtualités amoureuses se déplient dans un cadre quasi-mythologique, prennent une dimension séculaire : théâtre antique, peintures rupestres, visites au musée, séances de classiques du cinéma. Bulle coupée du réel, simple entrechoquement de marivaudages hétéros et bourgeois ? Pas tout à fait. Le dernier Mouret est un film de fonctionnaires. Ses trois héroïnes enseignent en collège (celle d’arts plastiques n’a toutefois pas de poste – déjà en marge du récit « principal »), l’une d’elles est mariée à un collègue, puis se rapproche du remplaçant de ce dernier. Si le cinéaste se préoccupe peu de cet environnement social (Les Choses… était plus radical vis-à-vis de cette réticence, plaçant ses deux héros énonciateurs à la campagne, coupés de tout), il en tire un principe amoureux : l’amour telle une chape de normalité. Là où Les Choses… était un laboratoire de combinaisons sentimentales, où les personnages glissaient d’un partenaire à un autre, ce sont les récits des fonctionnaires de Trois Amies qui circulent, dans un principe de liquidité où les corps sont remplis puis délaissés par des schémas déjà éprouvés. La première apparition de Thomas (Damien Bonnard), professeur remplaçant Victor (Vincent Macaigne), dans un mouvement qui accompagne le Rhône à l’arrière-plan, n’est à ce titre pas trompeuse. Malgré la voix off du second, qui affirme, à propos du premier, « Ce n’est pas moi, ce n’est pas moi mais du tout », une continuité se dessine entre les personnages.
Si, comme Joan (India Hair), on serait bien en peine d’expliquer le théorème de Thalès qu’elle efface du tableau avant son cours d’anglais, Trois amies se lit tout de même à l’aube de la géométrie, et pas simplement parce que l’on y distingue ce qui s’apparente à un triangle amoureux – Éric (Grégoire Ludig) trompe Alice (Camille Cottin) avec la meilleure amie de celle-ci, Rebecca (Sara Forestier). Chaque relation entre deux points se conçoit inéluctablement dans la perspective d’un troisième, remaniant la droite en triangle – mais le chiffre trois satisfait rarement toutes les parties en amour (le triolisme de Chronique d’une liaison passagère, qui ne fonctionnait qu’un temps). Disons plutôt que, pour élaborer notre propre théorème, le triangle remet en question sa base, à moins que cela ne soit l’inverse. Principe qui se prolonge lorsqu’un des sommets s’efface et qu’un triangle se reforme, dans un effet de déjà-vu, sans toutefois que ces triangulations s’enferment dans les « confidences/cachotteries entre copines », écueil rapidement évité. On s’imagine avoir son existence en face de soi, et il n’en est rien : histoires qui se dédoublent, romances qui bégayent à l’insu des principaux concernés, comme le gag du faux reflet dans Sept Ans de malheur (1921) de Max Linder, aperçu lors d’une séance de cinéma. La géométrie qui s’écrit et se réécrit sous nos yeux dédouane le film de toute abstraction verbeuse ; par son dynamisme, son instabilité et, surtout, sa cruauté.
Cette mise en réseau des chantiers amoureux se traduit par un réinvestissement affectif et spatial : Thomas tente de prendre la suite de Victor, puis Martin (Mathieu Metral) s’immisce dans cette chaîne ; Rebecca s’empare du mariage d’Alice en couchant avec Éric, puis en rendant visite à l’amant de celle-ci. La profonde émotion qui sourd tout au long du film, non sans rappeler le magnifique équilibre entre trivialité orale et tragique des actes atteint avec Les Choses…, tient à cette difficulté à habiter sa propre histoire, mais également celle des autres. Le personnage extraordinaire de Rebecca, interprété par une Sara Forestier éclatante de vitalité, est le plus riche et bouleversant car il est une variable d’ajustement des différents triangles. Lorsqu’elle se rend chez ce mystérieux amant (Éric Caravaca) pour lui rendre les toiles offertes à Alice, se joue sous nos yeux une variation de ce qui s’était passé hors-champ avec cette dernière. Peintre dont elle est une admiratrice, Rebecca expérimente – sans volontarisme, se laissant davantage séduire qu’elle ne cherche à séduire – les potentialités amoureuses de son amie, presque par mégarde (le hasard est d’ailleurs à l’origine de la rencontre entre le peintre et Alice, cette dernière ayant rêvé de son numéro de téléphone – merveilleuse trouvaille surréaliste) ; avec une évidence qui semble la détacher d’une répétition semblable à un reflet délavé. L’histoire sera, en effet, tout à fait différente, dans une conclusion loin des attentes de Rebecca, puisqu’elle est éconduite dès le matin, chargée de livrer une lettre sans doute énamourée à Alice. Tous les fonctionnaires ne sont pas égaux, certains sont des privilégiés. La sortie de Rebecca de schémas dont elle n’est pas le premier trait, pour se consacrer à sa propre droite, n’en sera dès lors que plus éclatante.

La routine s’insinue dans le langage amoureux et le démystifie. Deux mots reviennent constamment, traversent toute tractation sentimentale, dans des proportions qui confinent à l’absurde : pardon (et sa variante, désolé) et merci. Mais Rebecca, après son week-end avec Éric, ne manque pas de souligner le manque de substance de ces mots, qui cache une impossibilité à se plonger dans le présent. Non, il n’a pas à la remercier pour ces quelques jours passés ensemble, juste à vivre ce qui se joue. Plus question de s’excuser ou de remercier, seulement de croire en l’échange qui a lieu, en le déconnectant de l’autre sommet du triangle auquel il renvoie. Comme Joan dans le dernier plan qui, même si elle ne manque pas de le remercier dans un premier temps, accepte la part de gâteau que lui tend un inconnu.
S’arracher au fonctionnariat amoureux, c’est s’accorder le droit d’aimer, mais, surtout, de ne plus aimer. Tout part d’un trouble, éprouvé par Joan, celui d’un désamour pour Victor, compagnon et père de sa fille. À cela une possible solution, énoncée et appliquée par Alice, vivre sans aimer, ou plutôt répondre à l’amour de l’autre dans des proportions similaires. Mais cette hypothèse vaniteuse, Joan ne peut s’y résoudre, et son drame de la non réciprocité se traduit, de fait, par un éloignement dans l’espace. Abordant le sujet de la séparation, les deux conjoints s’éloignent l’un de l’autre, Joan ouvrant toute une série de portes qui occultent Victor ; long cheminement conversationnel en un seul plan (comme de nombreuses scènes du film) se concluant par une arrivée dans le salon obscur, où Joan choisit de désormais coucher. Ne plus aimer se paye au prix fort. Lorsque Victor accepte le courroux fatal (traversant symboliquement une arche sombre), après avoir, lui aussi, tenté une rénovation de l’espace, faisant visiter à Joan une maison en travaux, il meurt, ivre, dans un accident de la route. Mais les conséquences de cette rupture échoient avant tout à Joan, frappée de culpabilité pour ne pas avoir su se montrer digne des marques d’affection excessives, comme si aimer pour deux suffisait. L’impossibilité à aimer n’est pas un symptôme en amont, elle surgit sous le poids des torts supposés. Joan s’en imagine incapable à partir du décès de Victor et de la trace laissée par son égoïsme.
Pour exorciser ce mal, Mouret passe par une figure surmélodramatique (et casse-gueule) qui lui permet d’assumer la part tragique de son entreprise : Macaigne en spectre translucide et narrateur omniscient, aussi ridicule (le kitsch de l’effet, des dialogues d’outre-tombe) qu’émouvant par sa volonté de se retirer définitivement de l’équation. Une fois la veuve laissée en paix par le fantôme – on peut questionner cette autorisation de Victor, même si Joan devient rapidement maîtresse de son propre destin –, s’accorder le droit d’aimer ne résout rien ; sortir de la culpabilité ne transforme pas la rencontre en nouveau départ. Si sa relation avec Thomas déchire autant (lui qui prend le poste de Victor, s’installe dans son immeuble, s’éprend de Joan), c’est parce que la mise en scène de Mouret travaille le gouffre impossible à résorber entre ce désir de s’abandonner et le refus de trahir ses sentiments, à l’image de ce plan où les deux amis sont séparés au cinéma par les sièges de leurs filles. Le manque supposé d’amour est perçu telle une faiblesse, un reproche fait à Joan pour ne pas partir à l’aventure avec Thomas, saisir cette évidence (la condition sine qua non de tout amour selon elle) appelée par les vœux de leurs filles au son des « Mariez-vous ! ». Mais une évidence où tout serait trop à sa place, trop normatif, trop « fonctionnaire ». Plusieurs fois, Joan a la possibilité d’y répondre, avec Victor comme avec Thomas. Mais lorsque ce dernier comprend que plus rien n’adviendra, lui le prétendant patient qui lui présente son ami Martin, et que l’ombre de sa mort plane dans une répétition de la disparition de Victor, tout retombe sur Joan, comme si les reproches glissaient d’une bouche à une autre. Alors, de nouveau, s’autoriser à ne pas aimer, pour ne pas se fourvoyer dans un geste de suffisance (Alice en couple avec Éric sans l’aimer, dit-elle). Il faut un point neuf à qui se relier ; Martin, donc, avec qui, pour filer la métaphore immobilière, elle visite un appartement au blanc immaculé, possible amorce d’une romance – quand bien même celle-ci reste lettre morte.
La relation entre Alice et Éric est sans doute davantage retorse, fixant plus nettement ce fonctionnariat de l’amour. Alice n’éprouve donc en apparence rien pour Éric, le contraire de lui, semble-t-il, alors qu’il file le bonheur avec Rebecca. Encore une fois le triangle, car c’est la présence de Rebecca sur le schéma qui donne son sens au couple – et par la même exclut celle-ci. Alors qu’elle doit rejoindre l’homme de son rêve, Alice demande à Rebecca de prétexter, vis-à-vis d’Éric, l’accompagner en week-end. Effet domino, Rebecca vend la mèche pour pouvoir passer ce dit week-end avec lui. Lors de l’échappée, Éric reste fixé à son téléphone, inquiet de ne pas avoir de nouvelles d’Alice ; et Alice, malgré son escapade adultérine « parfaite », n’aura au fond que ressenti son absence. La conjugalité est ici affaire d’orgueil et de possession, et tous ces mots vides de sens murmurés avant le coucher, le baiser mécanique sur la bouche les accompagnant, sont transcendés par la crainte inconsciente, mais latente, de la perte. Ce couple est le seul qui reste inchangé entre le début et la fin du film, le seul qui ne se confronte jamais verbalement à ses failles, ne modifie en rien son réseau de communication, et se retrouve pourtant dans une étreinte qui, d’ailleurs, échappe au plan (le couple chute au sol et disparaît derrière le matelas). Ils donnent seulement un autre sens aux banalités qui flottent autour d’eux. Mais le désinvestissement guette, en témoigne la dernière séquence où, alors que le nouveau compagnon de Rebecca est sur le point d’arriver, on sent chez Éric une impatience matinée de jalousie. Pour que le couple se (re)fasse, il faut un troisième sommet.
Trois amies, donc, trois sommets, trois femmes qui luttent dans des triangulations au voile morbide. Avec une élégance que ne renierait pas Buster Keaton, autre figure burlesque visible dans le film ; lui qui, dans Cadet d’eau douce (1928), affronte la tempête, voit s’abattre sur lui la façade d’une maison impossible à habiter. Si les personnages de Mouret – lui dont les premiers films faisaient la part belle au comique de geste – semblent être, en apparence, à mille lieux de l’air tragico-impassible des burlesques, ils en ont gardé la qualité première, perceptible à travers les hurlements de joie de Rebecca : l’insubmersibilité. Ne reste alors, comme à tous ces clowns tristes qui prennent le risque du péril physique, qu’à s’excuser, et à les remercier.

Scénario : Emmanuel Mouret et Carmen Leroi / Image : Laurent Desmet / Montage : Martial Salomon / Musique : Benjamin Esdraffo
Durée : 1h57.
Sortie française le 6 novembre 2024.