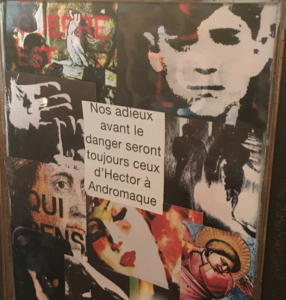Trop de tombeaux pour Dracula
Notes sur Christopher Lee
Ce paradoxe pour commencer : à l’annonce de la mort de Christopher Lee, les premières images qui reviennent en mémoire ne sont pas tant ses apparitions en Dracula ou en Scaramanga, que les tombeaux dont il se relève ou vers lesquels il retourne pour s’y enfoncer définitivement. Ces tombeaux sont certainement des façons de jouer sur le spectre de Dracula qui hante ses interprétations. Mais autre chose est peut-être aussi à l’œuvre, qui serait lié à l’invention de Lee – des manières de surgir et de disparaître motivées par un jeu grandiloquent.
Le tombeau du Corps et le fouet (Mario Bava, 1963) contient un cadavre déjà putréfié. Le spectateur s’attendait à un comte-vampire tout-puissant, maître de ses résurrections. Il est confronté à un catafalque et à sa boîte funèbre. Lee, pour une fois, n’en sort ni n’en rentre. Il donne corps à un fantasme de flagellation et de fureur. Le tombeau est la faible enveloppe d’un désir trop incandescent et trop coupable. Le corps de Lee offre cette ambiguïté entre la promesse de la résurrection et la projection de l’érotisme. Il est presque absent du film, n’existant qu’à travers les raccords sur les regards de Daliah Lavi. Tension exemplaire entre la maîtrise par le regard et cette forme excessive, impérieuse, presque insoutenable d’aristocratie grotesque et autoritaire. Le tombeau, c’est son point d’équilibre, la mesure du fantôme et du corps possédant.
Voilà où se trouve Lee, à cette intersection entre le vide et l’avide, entre ce qui disparaît et ce qui absorbe et dévore, entre les reliques de la culture classique et les recompositions souveraines de la culture populaire. De loin, le tombeau de Dracula, Prince of Darkness (Fisher, 1966) ressemble à un écrin démesuré. De plus près, il est un moule alchimique, un four artisanal d’où sortira une forme humaine. Fisher ne montre pas tant une naissance, ni même une résurrection, qu’une accélération démentielle du cours du temps, une décomposition inversée de l’espèce humaine. Que naît-il de ce récipient démoniaque ? Le spectateur ne voit pas Lee en tant que tel, mais une main. Lorsqu’il le verra enfin, celui-ci, étreignant une victime, sera déjà en train de se dissoudre dans sa cape noire. Il est très tentant de voir en Lee l’acteur qui a donné son corps à une forme d’anti-christ qui, lorsqu’il revient à cette non-vie du vampire, n’ordonne pas de ne pas le toucher mais incite, par hypnose, par fascination, à accepter la dévoration, la morsure, la soumission.
Le corps de Lee part et revient, ou erre, de la poussière à la poussière, des flammes à la boue. Il oscille toujours entre deux états, au risque de se perdre, de ne plus savoir dans quel excès il habite. Excès de chair ou excès d’invisible ? Excès de raideur ou excès de désarticulation ? Au début de Scars of Dracula (Roy Ward Baker, 1970), lorsque Dracula renaît dans une alliance de couleur grasse rouge sang et de sable cendreux, une chauve-souris mécanique, pauvre peluche artificielle, vient ponctuer la transformation, agent de la résurrection. L’apparition de Lee se loge ici, dans ce mélange indissociable de grotesque et de croyance enfantine, d’altération (au fil des incarnations et des maquillages) et d’inaltérable (une permanence inexpugnable de rôle en rôle – une indécision entre l’incarnation désinvolte d’un personnage et un commentaire narcissique omniprésent).
C’est cette souveraineté que nous avons cherché à interroger en demandant à plusieurs contributeurs de s’attacher à une apparition de Lee. Si nous approchons plusieurs de ses visages, c’est l’aller-retour fascinant entre la silhouette dessinée qui semble ne jamais s’effacer et un excès qui risque toujours de la mettre à mort que nous interrogeons. Lee, ou ce tombeau pop de la cérémonie et du carnaval.
Jean-Marie Samocki
***
***
Le vampire reste à venir – A propos de Cuadecuc, Vampir (Pere Portabella, 1970). Double filmique traquant jusqu’à l’obsession l’image manquante du film en train de se faire. Acteur dédoublé aux jointures. Négatif comme solarisé du Jess Franco, où la brume verte d’une froide journée mute en sombre fumée nocturne à la Murnau, où le foulard noir vient recouvrir le visage de Christopher Lee dans sa pré-apparition alors que de l’autre côté il arrive comme toujours déjà Dracu-là. Documentaire qui ne documente rien mais pousse d’autres portes derrière lesquelles surgissent autant de fantômes que de vampires en chair et en os. Inscription en ronde-bosse sur pellicule rétinienne. Les gestes préparatoires inquiètent le film du film. Toutes dernières minutes du documentaire de Pere Portabella : de la main droite Christopher Lee semble avoir extirpé quelque chose de son œil sombre encadré d’impressionnants sourcils circonflexes, casque d’impeccables cheveux noirs tirés en arrière, miroir agrippé par la serre des doigts de l’autre main. Des regards se lèvent qui semblent ne pas se croiser mais se répondent avec stupeur. Plan plus serré sur le visage de l’acteur encore vampire pas tout à fait humain, il enfonce un mini-pieu dans sa rétine comme pour répondre aux pieux plantés dans le cœur des vampires en cercueils de la scène qui précède. La petite ventouse extirpe la prothèse oculaire – retour vers le regard effrayé du faux spectateur. Lee se saisit alors de ses dents surnuméraires et les arrache d’un coup, décolle la moustache et autres adjonctions pilaires. Nous offre à voir ses yeux de verre tenus entre ses doigts comme des trophées, avec un sourire Majax enfantin du type « ce n’était que cela ». Noir.
Voix, première voix entendue de tout le film. Lecture par l’acteur du livre qui clairement ne répète pas puisqu’il demande en français de recommencer la prise. Par un jeu de miroirs la lecture se fait présence triptyque, trois images pour un vampire qui ne se reflèterait nulle part. Dracula lit Dracula. Nous lit la fin de Dracula qui referme le simulacre de making of. C’est ce regard-là que je retiens, en image rémanente pas tout à fait face caméra, de l’acteur en costume, au moment même où, en marge du tournage du film de Jess Franco, s’étant plié au jeu de la lecture de l’œuvre littéraire originelle pour Pere Portabella, il cesse de jouer, ou plutôt suspend son jeu comme un oiseau de proie son vol de repérage, en un plan qui semble appartenir simultanément à tous les registres cinématographiques possibles (le film, le documentaire, la vie). Extraite de son contexte, l’image dernière pourrait faire partie du film de Jess Franco autant que de celui de Portabella. Christopher Lee aura vécu onze vies de vampires, celle du Franco, Les Nuits de Dracula, étant jugée la plus fidèle à l’ouvrage de Bram Stoker. Pendant que Lee tourne deux films en un, Klaus Kinski tourne un autre film dans le film, vampirisé à son insu dans son refus d’apparaître dans des films mettant en scène des vampires. Cuadecuc, Vampir semble cristalliser aujourd’hui la présence écranique de Christopher Lee. Portabella a véritablement vampirisé Jess Franco pour dénoncer Francisco Franco mais dans l’opération il a fixé à jamais le regard de Lee dans son oblique caméra, celle d’un vampire méta-fort dont les pupilles lacrymales impriment nos rétines. Présence-absence plus jamais redoublée dans le réel. Tremblement de la pellicule. Mini solarisation en flash ultrabref. Passage au noir.
Émilie Notéris
***
Un corps désaccordé. A propos de The Curse of Frankenstein (Terence Fisher, 1957) et The Mummy (Terrence Fisher, 1959). À contre-courant peut-être des célébrations de la voix de basse de Christopher Lee, remarquable instrument mis au service d’une connaissance encyclopédique des langues (polyglotte, Lee en parlait neuf), j’aimerais encenser le travail corporel du comédien, digne de celui d’un danseur. La stature de l’individu, imposante, écrasante même, a en effet parfois eu tendance à masquer la subtilité de son jeu de corps. Or, personne n’était moins rigide que Christopher Lee, et ce sont probablement ses premiers rôles « muets » de la Hammer qui en témoignent le mieux. Son interprétation de la créature, tout d’abord, dans The Curse of Frankenstein (Terence Fisher, 1957). Contraint de se démarquer de la performance de Boris Karloff, éminemment hiératique dans le Frankenstein des studios Universal, Lee a ainsi décidé de jouer une créature quasi infantile, aux mouvements mal coordonnés du fait d’une proprioception déficiente. Une sorte d’accidenté de la route au visage hébété, patchwork répugnant de morceaux de chair cousus à la va-vite, peinant à donner cohérence à ses éléments épars tirant chacun de son côté, refusant de marcher d’un même pas. A l’écran, il résulte de ce choix un impressionnant travail de désaccordage en mouvement, une chorégraphie disloquée, désarticulée, une incapacité fondamentale par exemple à bien utiliser ses mains, étranges appendices dotés d’une vie propre au bout de bras qui n’en finissent plus. La démarche chancelante de cet assemblage contre-nature confère une dimension puissamment pathétique à cet individu divisible, à ce Léviathan en réduction composé d’abats de boucherie.
Créature de Frankenstein ou Momie tout droit surgie d’âges antédiluviens dans The Mummy (Terrence Fisher, 1959), Christopher Lee savait insuffler un supplément d’âme à ces monstruosités dépourvues de parole. Difficile de rester de marbre devant la souffrance millénaire de Kharis, cet amoureux transi condamné à être enseveli vivant du fait de son refus d’être séparé de sa bien-aimée par la mort. Le visage de la momie qu’il devient alors constitue en quelque sorte l’antithèse de celui de la créature de Frankenstein qu’il incarnait deux ans plus tôt : au caractère hétéroclite de celui-ci, il oppose désormais son unité fondamentale, son absence de détails. Son masque dépourvu d’expressions ne possède pas même de bouche. Seule une ligne signale la présence de cet orifice. Mais cette aphasie se révèle être largement compensée par l’inventivité des mouvements déployés par le monstre – déplacements dans l’espace (parfois vifs comme ceux d’un animal de proie) comme au sein de ses propres bandages (la haute expressivité de ses yeux). Toutes ces carapaces absurdes, grand-guignolesques devenaient une contrainte créatrice par laquelle il trouvait l’individualité profonde et bouleversante parfois des personnages qu’il incarnait. A partir du moment où Lee s’extrait tant bien que mal de la mare boueuse au tréfonds de laquelle a sombré son sarcophage, le spectateur se retrouve exposé à sa présence vacillante, à son regard intense prisonnier d’un tombeau de bandelettes déliquescentes, à ses bras ballants qui encadrent ce corps au torse bombé lancé vers l’avant, trébuchant d’un pas à l’autre, luttant en permanence pour conserver son équilibre dans ce dix-neuvième siècle auquel il n’appartiendra jamais.
Franck Boulègue
***
***
Le Double. A propos de I, Monster (Stephen Weeks, 1971). Lorsque John Landis, dans son livre Monsters in the Movies, interroge Christopher Lee au sujet de Je suis un monstre (I, Monster, Stephen Weeks, 1971), le comédien lui répond : « J’allais l’oublier, celui-là. Je crois que c’est l’une des meilleures choses que j’aie jamais faites ». Cette version de Jekyll et Hyde est en effet souvent oubliée des cinéphiles, et elle recèle l’une des meilleures prestations de Lee. En vérité, c’est en découvrant ce film en vidéocassette au milieu des années 1980 que l’interprète de Dracula m’est apparu pour la première fois comme un comédien nuancé, en plus de la star charismatique mais au jeu un peu monocorde que je voyais en lui(à ma décharge, je n’avais pas encore pu apprécier ses performances dans Les Vierges de Satan [The Devil Rides Out, Terence Fisher, 1968], Raspoutine, le moine fou [Rasputine, The Mad Monk, Don Sharp, 1966] ou The Wicker Man [Robin Hardy, 1973]).
En 1971, Lee avait incarné la plupart des grandes figures du répertoire fantastique, et il commençait de manifester une certaine froideur envers le genre qui l’avait rendu célèbre. Les personnages de Jekyll et Hyde manquaient à son palmarès. Rebaptisés Docteur Marlowe et Mister Blake par un caprice du producteur Milton Subotsky, ils offraient à Lee l’opportunité de jouer à égale mesure de ses deux visages : celui de l’acteur un tantinet rigide en quête d’une respectabilité artistique qu’il ne croyait pouvoir obtenir par le biais du fantastique (Dr. Marlowe), et celui – plus rarement dévoilé – du facétieux histrion, nullement dupe de la pose aristocratique attachée à son image publique, porté sur le cabotinage et l’autodérision.
Dans le film de Stephen Weeks, Marlowe/Jekyll est un bourgeois policé, avare de paroles et de gestes, et sanglé dans les convenances victoriennes. Son intérêt pour les théories de Freud en fait certes un original que son entourage considère avec suspicion, mais sa singularité ne verse jamais dans l’indiscipline, encore moins dans la subversion. Il correspond au Lee guindé que certains de ses partenaires dénoncèrent parfois, et dont nombre de fans (dont votre serviteur) devaient à regret s’avouer agacés. Blake, au contraire, apparaît comme un fameux drille (bien qu’inquiétant), dont la cruauté n’est peut-être qu’une extension de sa malice, et qui, tout bien considéré, tient plus du vilain garnement que du croquemitaine. Il est le Lee enjoué et farceur qui provoquait les fous rires de Peter Cushing sur les plateaux de tournage, le charmeur insolent qui éblouissait les starlettes des studios de Bray, le baryton classique optant pour la musique « metal », le comédien chevronné jonglant avec l’outrance et la dérision, conscient de ses tics et les utilisant avec autant de science que d’ironie.
Lee investit dans ces deux rôles, qu’il reconnaît d’évidence comme ses doubles, le meilleur de son talent. Il faut le voir, en Marlowe, parcourir sa demeure avec la solennité d’un croque-mort ou d’un juge résolu à prononcer la peine capitale, maître et censeur de ses émotions dont il réserve l’expression à une seule partie de son corps : ses mains souples et déliées, tantôt onduleuses, tantôt crispées, toujours « aux aguets » comme des bêtes sournoises.
En Blake, il se montre sardonique avec exubérance, fiévreux et emporté, plein d’un feu sombre et dévorant. Lorsque l’usage répété de la drogue l’affecte physiquement, il devient une épave, un noctambule déjeté, bouffi et hagard. Le maquillage minimaliste le transforme en un sosie lessivé de Humphrey Bogart, au point de le rendre risible. Ses ricanements et ses grimaces prennent une dimension pathétique, comme les mimiques au rabais d’un auguste de cinquième zone. C’est alors qu’il touche au sublime, en traduisant la déchéance du personnage par un jeu d’acteur délibérément outré. Il investit Marlowe d’une qualité grotesque qui le rend bouleversant, comme dans la scène du jardin public où il s’afflige de la fuite d’une fillette, repoussée par son aspect. Tendant les mains vers la caméra à travers les barreaux d’une tonnelle, il nous adresse un regard lourd de désarroi, comme le ferait un enfant qui tente d’apitoyer ses parents en forçant sa tristesse. Puis il baisse pesamment la tête, comme terrassé de désespoir. C’est parce qu’elle est effroyablement fausse que cette pantomime est d’une profonde justesse. Elle est le fait d’un très grand comédien, maître dans l’art du paradoxe – le contraire du Sir Christopher glacial et tranchant au sujet de qui le comédien Howard Vernon me confiait : « Nous nous disions bonjour… parfois bonsoir… Et encore… Il m’est arrivé de l’éviter… A part ça, je n’ai absolument rien à dire de monsieur… comment s’appelle-t-il, déjà ?… ah, oui ! Christopher Lee ».
Pascal Françaix