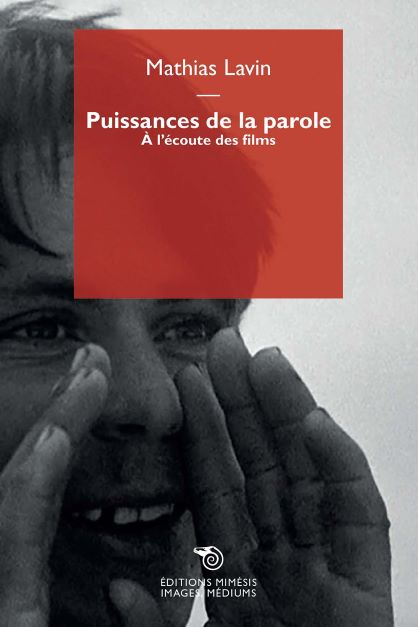Vocanalyses
Sur "L'attrait des ventriloques" d'Erik Bullot et "Puissances de la parole" de Matthias Lavin
Michel Chion avait jadis débuté son premier livre sur le septième art, La Voix au cinéma, par ce paradoxe : cet objet si flagrant paie son évidence sensible d’une étrange omission analytique. Centre gravitationnel de la perception auditive, la voix pâtissait, dans les écrits cinématographiques, du biais visio-centré sous-tendant ces derniers. Elle souffre par ailleurs d’être difficilement caractérisable. Son ubiquité mutante et sa matérialité impalpable découragent les catégories. D’où la lacune livresque en matière vocale, puisque les pages s’ouvrent mieux aux images. La voix au cinéma n’a suscité que peu de sommes (la plus récente en français remonte à l’ouvrage d’Alain Boillat en 2007, Du bonimenteur à la voix-over) et reste pour la prose critique un souci au mieux intermittent. La sortie concomitante de deux ouvrages qui en pistent les déplacements prend donc des allures de revigoration conceptuelle.
Le premier, L’attrait des ventriloques d’Érik Bullot, publié dans la collection bien connue de Yellow Now, traverse l’histoire d’une fêlure audiovisuelle, analysant « d’un côté, la représentation littérale de la ventriloquie à l’écran, associée aux motifs de la dissociation et du dédoublement, relevant de la comédie ou du fantastique ; de l’autre, son usage métaphorique de la part de cinéastes qui expriment une parole dissidente en détachant le corps de la voix, en faisant parler les objets et les choses, au croisement du cinéma et de l’art contemporain. » (p. 12), de façon à ce que ce spectre historique raconte des histoires de fantômes médiatiques – le cinéma aura ainsi accueilli ceux des arts forains ou de la téléphonie pour devenir à son tour un médium post-mortem, digéré et ventriloqué par les installations muséales[11][11] « …le champ de l’installation aura rencontré dans les effets de la voix acousmatique, à la fin du vingtième siècle, un thème de prédilection pour interroger la mémoire du cinéma. Ce n’est pas un hasard. Si le septième art a toujours été hanté par les motifs du double, du revenant et du cyborg, ces fantômes sont devenus aujourd’hui des allégories de sa propre métamorphose. L’art contemporain aura interrogé à nouveaux frais la survivance du médium, son devenir post-mortem, par le jeu de la voix dissociée. » (p. 61). Car la ventriloquie occupe le même lieu que le cinéma : sur la ligne de crête entre le forain et le médiatique, il est l’endroit d’élection de ce passage de témoin entre les arts du corps et les arts machiniques : « en dissociant la prouesse vocale de l’exécution des gestes, le ventriloque agit comme une machine, devenu lui-même l’équivalent du dispositif filmique qui sépare pantomime et bande sonore. » (p. 34) Du fait d’une telle situation stratégique, le thème ventriloque, postule Bullot, viendrait ainsi fournir des outils théoriques utiles à caractériser « la crise de représentation qui redistribue les cartes entre les arts du spectacle et les médias techniques. » (p. 19)
Publié dans la collection « Images, Médiums » de Mimésis, Puissances de la parole de Mathias Lavin entend aussi creuser certains de ses sillons analytiques dans le champ de l’archéologie des médias sonores, jadis entrouvert par Friedrich Kittler et aujourd’hui généreusement labouré par Jonathan Sterne. De même que Bullot rappelle en ouverture de son propos sur le transfert de la voix que celui-ci est solidaire de techniques (téléphonie, radiophonie) et de pratiques (psychanalyse, spiritisme) reposant sur des dissociations analogues, Lavin, s’il adopte d’abord Chion pour tuteur, articule les cas analysés à une anthropologie du geste (le premier chapitre est consacré aux langages des sourds-muets) et à une écologie médiale (en particulier son troisième chapitre, sur « l’effet-radio » dans un film méconnu de Capra, Miracle Woman, 1931). Plus largement, l’ambition de l’auteur est de se mettre « à l’écoute des films », comme y invite son sous-titre, pour soumettre à toute une gamme de problématiques cette parole qu’il distingue de la voix tout en concédant que cette démarcation conceptuelle s’estompe sur le terrain de l’analyse de film. À chaque chapitre son axe, de la figurabilité de la parole dans le muet (à travers Epstein notamment) à l’érotique de la voix ou à la typologie des paroles politiques. L’ensemble est subsumé par une ascendance dite « esthétique », qui écarte la revue trop minutieuse des faits historiques pour se concentrer sur, si l’on veut, la fabula figurans. Les mêmes privilèges de la fiction imageante sont sensibles dans la dissémination de la ventriloquie racontée par Bullot. En cela très français, les deux auteurs goûtent les mises en récit du dispositif cinématographique – Bullot plus franchement, qui souligne en fin de livre l’allégorèse en constituant l’horizon – sans trop en appeler aux déterminismes techniques (par exemple en articulant l’histoire de la voix à celle des microphones, ou, comme le fait Sterne, à l’histoire de l’ingénierie sociale de l’écoute).
Les deux auteurs ne partagent autrement qu’un tropisme vocal, différant en méthode comme en volume. Le livre de Bullot obéit à la forme brève et véloce de la collection dans laquelle il est publié. Issu du remaniement d’un manuscrit soumis à l’occasion d’une Habilitation à Diriger des Recherches, celui de Lavin s’étaye sur de plus amples développements. Surtout, l’un narre le grand récit d’une division transférentielle quand l’autre, malgré la chronologie qui le charpente, se conçoit plutôt comme tableau théorématique. C’est assez pour que l’on examine séparément leurs cheminements.
De la division à la dissidence
Acharné à métaphoriser le ventriloque pour en faire un paradigme social, technique et critique, disant la vérité du dispositif-cinéma comme de la prose essayistique, Bullot ne revient que brièvement sur ses stades antérieurs, notant surtout que la naissance de sa version moderne – l’homme et le pantin, seuls – en 1896 l’apparie généalogiquement au cinéma. Les divers modèles déployés par l’auteur au long de ses chapitres – la schize analytique (« Dissociation »), les lois duplices de la performance théâtrale et du trouble dans le genre (« Dédoublement ») et la polyphonie contrapuntique d’archives remises en jeu par les voix queer ou subalternes (« Dissidence ») – font de ces figures engastrimythes autant de cas de clivage, en qui se confondent projection vocale et intériorisation psychique. Ainsi, la ventriloquie des enfants de bois devient une variation artistique autour du thème du placard (par exemple Erich von Stroheim dans The Great Gabbo (1929) de James Cruze) ou du miroir homoérotique (dans Dead of Night (1945), film collectif d’Alberto Cavalcanti, Charles Crichton, Basil Dearden et Robert Hammer). Plus loin, Hans-Jürgen Syberberg (avec Hitler, un film d’Allemagne, 1977) et Trinh T. Minh-ha (avec Surname Viet Given Name Nam, 1989) étendent la ventriloquie à l’évocation des troubles de l’image archivistique, faisant de cette voix-témoignage une dissidence intestine à l’image même, disant le trauma qu’elle refoule. À la fin, le ventriloque annexe les clowneries plus ou moins comi-tragiques de Jerry Lewis, Federico Fellini ou Carmelo Bene pour exorciser cette voix mouvante.
Mais cet opuscule avançant tambour battant veut surtout faire sourdre de cette cartographie historique le fil d’une mutation du dispositif cinématographique. Bullot trouve chez Balázs la première formalisation de l’effet désorganisant de cette disjonction : « Il s’écoule toujours un certain temps avant que notre oreille s’oriente sur notre œil », laissant place, dans l’intervalle, à « une désorganisation déroutante et gênante de l’ensemble de l’image optico-acoustique[22][22] Bela Balázs, L’Esprit du cinéma, Paris, Payot, 1977 [1930], p. 279.. » Si la césure marquée par le passage du muet au parlant occupe déjà une grande place dans les explications des mutations du cinéma classique vers le cinéma moderne, Bullot en poursuit l’intuition dans une direction nouvelle, comme une explication souterraine du développement de la forme installation et du déplacement de la salle au musée. Chez Syberberg par exemple, dont le film « anticipe la forme de l’installation. » (p. 60), laquelle aura beaucoup remanié les mânes du cinéma : « Disjoint de son socle technologique traditionnel, démembré, réassemblé dans l’espace du musée ou sur les écrans domestiques de nos écrans domestiques, le cinéma est sorti de lui-même et parle à travers un nouveau corps. » (p. 52). Le livre aboutit à la même idée que le précédent sur Roussel : la ventriloquie est affaire de réanimation, dans les musées comme lors de conférences – activité régulière de Bullot, qui a fait de l’élocution contrariée (récemment encore, le braille) le sujet de prédilection de ses prises de parole publiques. Il est à ce titre surprenant que la question du doublage, longtemps évoquée en filigrane, ne soit finalement pas abordée (par exemple dans le cinéma d’animation, où elle est primordiale). C’est peut-être que le livre ne voulait pas dévier plus longtemps de son axe retors.
Celui-ci le mène, dans ses dernières pages, à des considérations sur la critique comme ventriloquie, à travers un dialogue entre « l’auteur » et « le lecteur » dont il est certain que l’un – mais lequel ? – est le pantin vocal de l’autre. L’artiste-critique émet depuis autrui un discours logé dans sa propre bouche : « Au même titre que l’artiste utilise un matériau tiré de la vie, le critique utilise le matériau de l’art. J’appellerai volontiers la critique une création dans la création. » (p. 81) C’est en quelque sorte le pendant littéraire du film que le cinéaste-internaute-archiviste Frank Beauvais a consacré au rêve d’une vie décalquée dans les films, Ne croyez surtout pas que je hurle (2019). La condition de ce parasitisme de la critique artiste semble être le stade morbide du cinéma, dépouille dépassée qu’il s’agit de ressusciter comme œuvre embarquée dans une autre. « Comme s’il devenait difficile de dissocier la ventriloquie et la forme de l’essai » (p. 75), le cinéma lui-même devient de plus en plus indissociable (ou indiscernable) du discours qui le produit, de la voix qui le performe. Peu importe désormais que le cinéma soit filmé, pourvu que de l’œil à l’oreille subsiste cette « désorganisation déroutante et gênante de l’ensemble de l’image optico-acoustique » dont parlait Balázs. Le cinéma, c’est là l’ultime tour de force, existe dans la prose. C’est peut-être qu’in fine, Bullot choisit de lire autrement l’idée d’un « cinéma ventriloque » : le cinéma dans le ventre d’un autre discours.
La phonogénie
Parallèlement à cette mythologie du dispositif, Mathias Lavin entreprend plutôt une méthodologie à vocation anthropologique. Le livre, dit-il en se référant lui aussi à Balázs, aurait pu s’intituler L’homme audible, cherchant dans les avatars de cette parole si spécifiante un même type de savoir sur l’espèce que celui découvert par son devancier dans les images mobiles. Cette humaine ambition explique aussi l’architecture de l’ouvrage, où le déroulé analytique des films suit moins la chronologie du septième art qu’une sorte d’histoire phylogénétique du langage. Le premier chapitre porte sur les « paroles gestuelles », liant à l’étude de films figurant des sourds-muets (Miracle Worker d’Arthur Penn, 1962) ou des êtres hors-langage (L’Enfant sauvage de Truffaut, 1970) un travail sur l’institutionnalisation conflictuelle de ces méthodes éducatives. Le second chapitre puise avant chez tout chez Epstein ces « voix venues du silence », qui, appareillées à un cinéma muet, n’en figuraient pas moins une « voix hallucinée ». Sous le titre de « paroles médiatisées », le troisième médite, via Capra, sur ce que le spectacle de la voix doit à ses amplifications techniques, tandis que le quatrième, basé sur une cinématographie bien plus contemporaine, axe son propos sur la « parole d’écriture », lorsque dans les films ascétiques d’Akerman, de Costa ou de Sokourov s’invitent les splendeurs d’un verbe littéraire. Ces quatre premiers pans du livre sont autant de pas de l’humain vers ce raffinement dans l’emploi de la langue que consacre la littérarité. On voit que Puissances de la parole articule deux projets. Le premier cherche à équiper de futures recherches désireuses de cerner cet objet pris en « tension entre localisation et diffusion » (p. 109). Le second l’inscrit dans les débats d’une tradition philosophique inaugurée par Aristote lorsqu’il fit de la parole une propriété humaine. Une telle raison explique que les deux derniers chapitres se tournent vers ces deux piliers existentiels que sont l’érotique et la politique. Un fameux dialogue de Johnny Guitar (Nicholas Ray, 1954) et l’Operating System de Her (Spike Jonze, 2013) servent de support à l’analytique du désir vocal, tandis que La Blessure (2005) du tandem Klotz/Perceval fait résonner les doléances des « inouïs » (le même chapitre propose une intéressante catégorisation des paroles politiques au cinéma, entre mots d’ordre, mots en désordre, témoignages et parole « autre », redéfinie à partir de la « parole essentielle » de Maurice Blanchot). La politique – l’utopie de l’isotopie vocale, disait Arendt lisant les Grecs – ne pouvait que clore un ouvrage aux origines si aristotéliciennes.
C’est toutefois par son usage singulier de Derrida – avant tout de sa dissertation husserlienne La Voix et le Phénomène – que Lavin renouvelle le plus les problèmes que Chion avait formulé dans un vocabulaire avant tout psychanalytique. Cette référence à l’auteur de De la grammatologie explique d’ailleurs l’intérêt porté aux rapports de hantise entre parole et écriture, comme, peut-être, le rôle cardinal que tient dans le développement un duo de cinéastes ayant collaboré avec Jean-Luc Nancy.
D’où aussi la tension fertile du livre entre deux concepts, entre un « phonocentrisme » déconstruit dans le sillage derridien, défaisant les mythes d’une présence de la voix au profit de la dissémination de ses traces, et l’emprunt à Epstein d’un terme parent de sa fameuse « photogénie », une « phonogénie » célébrant l’aura sonore des êtres. L’éclat inquiet propre à ces « puissances de la parole » vient aussi de l’évidence évanescente de son objet, et de son écartèlement entre une fonction de propriation (la voix individue) et une autre de dilution (la voix déplace, aliène). Elles expliquent également qu’un livre célébrant ces puissances s’ouvre sur la surdité et se ferme sur le drame d’êtres que personne n’entend, jusqu’à une dernière page sur Fini Straubinger dans le documentaire de Werner Herzog autour de sourds et aveugles, Au pays du silence et de l’obscurité (1971). Les puissances de la parole ont pour revers l’angoisse de son extinction ou de son dévissage. Si, comme le voulait Bazin, l’image est momie, la voix est caveau. Elle fait résonner des vies dont l’écho se répercute ou s’assourdit. Et l’intérêt du livre de Lavin est d’apprendre à y prêter les yeux aussi bien que l’oreille, en se situant à l’intersection du geste et du langage.
Yellow Now, collection "Motifs"
Publication : 22 février 2022.
96 pages.
Puissances de la parole de Mathias Lavin
Mimésis, collection "Images, Médium"
Publication : 20 novembre 2021.
276 pages.
Images : Erich von Stroheim dans The Great Gabbo (1929) de James Cruze