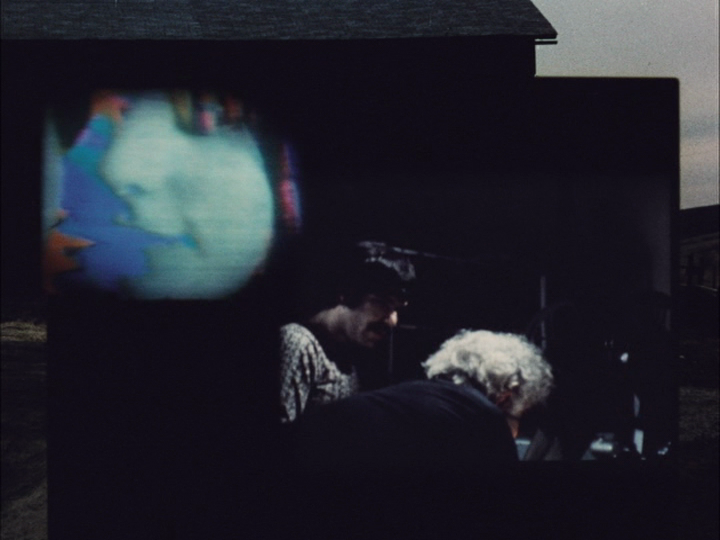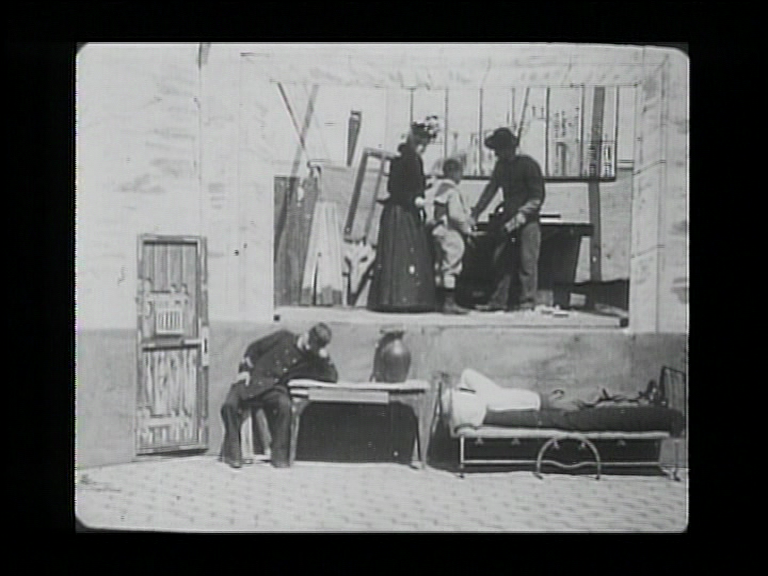We Can’t Go Home Again, Nicholas Ray
Note sur un dispositif multi-cadres
We Can’t Go Home Again (1973-1976) se singularise par son dispositif multi-cadres, fractionnant l’écran d’une somme d’images, accolées ou superposées, selon une dramaturgie soigneusement élaborée – et constamment reprise au cours des trois ans de réalisation – par Nicholas Ray. À l’exception de deux scènes où cette construction est abandonnée au profit d’une suite d’images plein écran, juxtaposées selon une continuité temporelle et narrative (la fable du Sphinx et la pendaison de Ray), la configuration écranique se présente de façon semblable tout au long du film : un liseré d’image forme un premier encadrement – telle une marie-louise – bordant un rectangle noir central sur lequel sont projetées des images de support, de taille et de forme variables (8 mm, Super 8, 16 mm, 35 mm, vidéo). Ces images incorporées surgissent rarement en bloc, comme autant de placards contigus à déchiffrer. Elles se succèdent plutôt, se juxtaposent, se chevauchent, rayonnent parfois les unes sur les autres, etc. Les connexions (plastiques et sémantiques) établies par le cinéaste sont donc déterminées par un rythme manifestement calculé – à l’origine, par ailleurs, des difficultés rencontrées lors des quelques projections publiques, véritables performances réalisées au moyen de plusieurs projecteurs, disposés côte à côte, et ponctuellement mis en marche selon les instructions de la partition générale[11][11] Pour plus de précision, voir le chapitre « We Can’t Go Home Again » de l’ouvrage-somme de Bernard Eisenschitz, Roman américain. Les vies de Nicholas Ray, Paris, Christian Bourgois Éditeur, 1990, p. 485-506. Le documentaire de Susan Ray Don’t Expect Too Much (2011) propose, quant à lui, une reconstitution du dispositif de projections mis en place par Ray.. Il arrive également qu’une image occupe, seule, pendant plusieurs minutes, une parcelle du rectangle central. La masse noire alentour est alors rendue à sa condition de support, empli de toutes les virtualités, en attente. Enfin, le liseré change régulièrement sans produire aucun choc, dans la mesure où la marge ne focalise guère l’attention : une ville sépia se voit notamment remplacée par une maison de campagne, au crépuscule.
Cette note est l’occasion d’identifier quelques-unes des modalités d’articulation de ces images entre elles.
1. Dès les premières minutes, les images réunies au sein du rectangle central composent un fonds désignant vraisemblablement un contexte général. La co-présence des événements enregistrés (procès des Chicago Eight, manifestations étudiantes, conventions politiques, répressions policières, etc.) figure effectivement une somme de déterminations mises à plat d’où viendra, par la suite, se détacher la trajectoire des trois principaux étudiants de Ray (Tom Farrell, Leslie Levinson, Richard Bock). Cet emploi des images multiples correspond mutatis mutandis à un usage codifié de la surimpression dans le cinéma hollywoodien dit « classique », signifiant la « démultiplication instantanée […] d’un fait ou d’une action »[22][22] Marc Vernet, « Surimpressions », Figures de l’absence. De l’invisible au cinéma, Paris, Cahiers du cinéma, « Essais », 1988, p. 62.. Si cette « démultiplication » se traduit chez Ray par une atomisation interne, les deux figures ont en commun de brosser par touches – superposées chez l’une, contiguës chez l’autre – un état de faits via des images significatives, éventuellement chargées d’affects. Ces images inaugurales qui, à première vue, composent chez Ray une mosaïque spatiale et temporelle, s’appréhenderaient alors comme un faisceau de relations complexe, pour qui cherche à démonter les procédés d’écriture expérimentés.
2. Cette première composition d’images, précédant l’arrivée du titre, noue un rapport de correspondance formelle avec les événements enregistrés. Ray y compile, en effet, des fragments de foules, réunies à l’occasion de rencontres plus ou moins houleuses. Or, il est manifeste que de tels événements se vivent, sur un plan perceptif, comme une expérience de l’hétérogène, du multiple, du furtif, parfois du choc, etc. En somme, la chose vécue donnerait sa forme à l’événement historique, recomposé en images. Dans le sillage de la modernité baudelairienne, Ray proposerait un équivalent formel de l’effervescence attachée aux événements convoqués.
3. En écho au blues chanté à trois reprises par Suzy Williams, intitulé Bless the family, les dernières paroles – post mortem – de Ray invitent chaque spectateur à cultiver la solidarité : « Take care of each other. It is your only chance for survival. All else is vanity. ». L’enjeu serait donc bien de recomposer une communauté à partir d’unités disparates, une famille de substitution, pour pallier le postulat du titre, traversant d’ailleurs, telle une plaie indéfiniment ouverte, la filmographie entière de Ray : « We can’t go home again ». La forme du film privilégie, en ce sens, un rapprochement d’images, solidaires les unes des autres, plutôt qu’une succession temporelle d’images singulières.
4. We Can’t Go Home Again recèle différentes figures de réflexivité, signalées avec d’autant plus d’acuité que le rectangle central apparaît déjà comme une mise en abyme de l’écran de cinéma – et parfois, selon certains détails du liseré, comme la mise en abyme d’un écran de télévision. Le film montre notamment Ray en train de regarder des images sur l’écran d’une visionneuse hors-champ, en salle de montage. Le raccord de regard s’effectue dans le coin supérieur gauche du rectangle central, derrière l’image du regardeur. Une autre scène figure un couple masqué s’étreignant devant un écran de projection. Une autre encore, Leslie nue, ondulant au rythme d’une musique psychédélique, le corps recouvert par des images projetées. Enfin, Tom, habillé en agent de police, dans l’encadrement d’une fenêtre, puis Tom face à son reflet en miroir. Les images projetées se creusent donc d’autres images, intradiégétiques, jusqu’au vertige.
5. Témoignant d’une approche radicale de la forme, le film de Ray semble, par moment, renouer avec certains usages du « cinéma des premiers temps »[33][33] Pour précision : dans le film de Zecca dont la dernière image illustrant ce texte est extraite, le condamné se remémore, pour la dernière fois, un épisode de son enfance., écartés par le cinéma institutionnalisé. Ainsi, lorsque Tom, de retour d’une convention républicaine, contemple son reflet puis rase sa barbe avec émotion, de petites images apparaissent à côté de son visage comme autant de phylactères. Les premières images sont en porte-à-faux avec les convictions politiques du jeune homme : piles de journaux titrant « Nixon wins », foules en liesse, arrestation musclée de deux manifestants. Puis, d’autres apparitions leur succèdent : le courant d’une rivière, un jeune garçon sur la plage, un cygne, Tom dans un paysage de campagne, etc. Ces petites images désignent à l’évidence des figurations mentales. D’abord la convention remémorée comme un traumatisme[44][44] Le narrateur précise que, sur le chemin, Tom s’est fait agresser par des rednecks. puis l’enfance, idéalisée. Le multi-cadres reconduit, dans le cas présent, une certaine façon de penser l’espace comme une surface à agencer selon des modalités proprement discursives.
Ces cinq points ne sauraient épuiser une oeuvre pour le moins foisonnante. Ils invitent simplement à en saisir avec précision les dynamiques formelles, et proposent par là même une alternative aux commentaires biographiques qui l’accompagnent généralement.