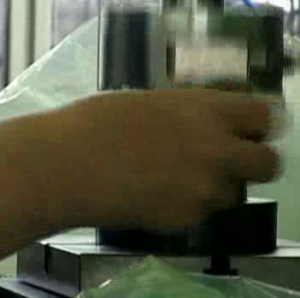Maxime Martinot
Départs de fiction
Le FID Marseille présenta cette année, dans la compétition française, Trois contes de Borges, le premier long-métrage de Maxime Martinot. Ce titre, modeste, pouvait laisser présager d’une adaptation scolaire, alignant en une sage récitation illustrée quelques moments choisis parmi l’œuvre foisonnante de l’écrivain argentin. L’ambition est pourtant autre. Ce sont les questions que tout acte de création littéraire posent au langage qui composent la matière vivante dans laquelle sont sertis les contes (El otro, El disco, El libro de arena). Un Borges, âgé et aveugle, s’entretient avec une jeune femme et mêle la pensée au quotidien et au paysage. Les histoires surgissent, ou prolongent cette parole : le vieux Borges rencontre, au bord d’un fleuve, celui qu’il fut ; un mendiant donne l’abri à un roi en exil dont le pouvoir tient dans une pièce à une seule face ; un colporteur se propose de vendre un livre infini. La fiction déborde sur le lieu de l’écriture, devenu lui-même imaginaire, tel un point où se rencontrent le présent et le passé, la voix des morts et la machine à écrire des vivants.
Le film est d’une intelligence rare, d’une culture prodigue. Précis dans son découpage, assuré dans ses mouvements de caméra et sa direction d’acteurs, élégant dans sa lumière, il impressionne d’abord par sa maîtrise. Mais cette maîtrise ne serait qu’un conformisme, si elle n’offrait aussi à ce film la tournure d’un récit d’aventure – aventure dans la profusion des livres, la luxuriance des langues, les remous des voix. Maxime Martinot a tourné ces Trois contes pour 27 000 euros. Somme dérisoire, dont les trois quarts ont été dévolu aux frais nécessaires à un tournage en pellicule 16 mm. Plus qu’une coquetterie, c’est un choix : d’une matière d’image d’abord, d’une exigence de précision et de concentration dans le tournage ensuite. Martinot s’est même lancé dans ce projet sans avoir les droits d’adaptation des nouvelles. Tout cela serait anecdotique si ce n’était ce genre de courage et de détermination qui manquent si souvent au cinéma français, qu’il soit jeune ou non[11][11] Cette introduction reprend, en une version légèrement remaniée pour l’occasion, ce que j’ai écrit sur le film dans le cadre d’un compte-rendu (Ailleurs et ici) du festival publié sur Chronic’art..
Débordements : Comment produisez-vous vos films ? Qu’est-ce que le collectif Comet, dont le nom apparaît toujours dans vos génériques ?
Maxime Martinot : Nous sommes pour la plupart encore étudiants, certains aux écoles de la Femis et de Louis Lumière, d’autres en universités, principalement Paris 8. Pour ma part, j’ai eu la chance de rencontrer une bonne partie de l’équipe en école prépa à Nantes (Cinésup), amis avec qui je travaille maintenant depuis plus de 4 ans. Trois contes de Borges est notre première « grosse » production, dans le sens où les autres films auparavant étaient des auto-productions, s’apparentant le plus souvent à des exercices ou des essais, dont le but était de s’approprier des outils et un langage commun à nous. Là, et grâce au collectif Comet, qui est aussi une association étudiante issue de la prépa nantaise, nous avons pu rassembler de l’argent (des universités parisiennes, du mécénat privé et du « crowdfunding ») et faire le film dans des conditions professionnelles, bien que l’équipe restait bénévole et en nombre réduit. Comme il paraît impossible de produire un long-métrage bénévole d’un seul coup, de rassembler l’équipe et les acteurs sur plus de 40 jours d’affilée, nous avons tourné à différentes périodes sur une année. Ce qui allait dans le sens du projet, puisque nous avons suivi l’ordre des trois contes, qui sont travaillés séparément à l’écriture.
D : Comment s’est fait le choix des trois contes ?
MM : Il faut revenir sur l’origine du projet : j’avais en main l’un des plus beaux textes de Borges, El hacedor (L’auteur en français). Lisant l’ouvrage en bilingue, le texte espagnol à gauche et la traduction française à droite, je faisais des comparaisons entre les deux, et comme beaucoup de lecteurs bilingues, je me suis posé la question éthique de la traduction, relevant ici et là des incohérences voire des trahisons totales du traducteur (c’était Roger Caillois, quand même pas n’importe qui). Je comprenais très bien que pour traduire un texte vers un autre texte, il faille faire des concessions. Mais je me disais qu’au cinéma il était possible, par la simultanéité voix / sous-titre, de rester vraiment proche du texte original en le traduisant plus littéralement. Le spectateur peut entendre et comprendre en même temps.
C’est par cette nécessité d’entendre les textes de Borges dans leur langue originale qu’est né le film.
Ensuite, le recueil El libro de arena me paraissait aussi le plus construit, le plus limpide dans la narration, s’apparentant tantôt au récit policier, tantôt au conte, etc… Alors que Fictions ou L’Aleph, très attirants, me paraissaient inabordables en vue d’une adaptation cinématographique : leur complexité serait sans doute tombée à plat dans un film, laissant trop de place à l’imagination du cinéaste, ce qui revient à l’idée, néfaste selon moi, d’interprétation des textes, dans un sens psychanalytique.
Le film a été d’abord écrit dans son ensemble avec les trois nouvelles choisies. El otro ouvre le recueil, et El disco et El libro de arena, qui se jouxtent, le terminent. Ces trois textes, de facture tout à fait différente, se rejoignent dans une conception presque lovecraftienne de l’éternité : indicible, invisible et pourtant bien prégnante dans certains objets de la réalité, du quotidien. Que ce soit par le biais du dialogue philosophique (El otro), le conte (El disco), ou le récit fantastique policier à la Poe (El libro de arena), c’est dans une trame très simple et presque banale que Borges situe ces objets aberrants. Il semblait dès le départ que ces incarnations de l’infini (le disque à une face, le livre sans début ni fin) seraient bien plus puissantes, rendues au cinéma, que la bibliothèque de Babel, le jardin aux sentiers qui bifurquent, etc… Car elles sont tellement simples, tellement nues, qu’elles peuvent prendre écho dans tout un réseau de choses concrètes que peut enregistrer la caméra : la nature, l’eau, les arbres, le vent, les corps qui parlent, un banc…
En prenant des récits plus « mythiques » de Borges, l’histoire serait un ensemble qui arriverait au fragment, ce qui me semble injuste. Ici, c’est le contraire.
D : Il y a me semble-t-il deux tendances dans votre cinéma, contradictoires si l’on veut mais qui font sa dynamique. Elles apparaissent déjà dans les Trois contes, mais éclatent avec davantage d’évidence dans L’esprit ailleurs, un moyen-métrage réalisé par la suite. C’est à la fois ce souci éthique de l’intégrité du texte et de la parole (la tendance straubienne, disons), et ce goût pour le collage, l’hétérogène, le fragment, la réflexivité (la tendance godardienne). Cela vous paraît-il juste, et si oui, est-ce quelque chose que vous tentez de concilier, d’accentuer, ou de dépasser ?
MM : Je suis d’accord dans un certain sens : l’héritage de Straub/Huillet d’un côté et de Godard de l’autre est essentiel, d’un point de vue cinéphile d’abord parce que ce sont ces films-là qui savent nous faire dire que l’amour sensible du cinéma et une réflexion sur notre monde peuvent être tout à fait solidaires ; d’un point de vue politique surtout parce que ce sont des résistants, des artisans complets du cinéma, bien que de manière très différentes, mais qui font front à toutes formes d’autorité commerciale et de dictature esthétique, au niveau français ou mondial…
Mais quant à « mes » films, je n’essaie ni de copier, ni de rendre hommage à Godard et Straub/Huillet, ou d’autres encore. S’ils sont malgré moi évoqués, c’est que ce sont des maîtres, et j’apprends d’une certaine façon avec « leurs » armes, armes que je manipule sûrement encore comme un bleu. Armes qui ne sont en fait ni miennes ni leurs mais qui tournent par-ci par-là depuis la nuit des temps, probablement.
C’est que je regrette très amèrement une chose : on n’apprend jamais le travail du cinéma par un binôme maître/apprenti sur le terrain (le duo réalisateur/assistant ne comble pas du tout ce manque, l’assistant réalisateur est un poste qui ne sert à rien et qui déplace juste d’autres problèmes).
Trois contes de Borges et L’Esprit ailleurs semblent contradictoires, pourtant les motivations sont les mêmes. On peut trouver dans le premier de l’hétérogène et une certaine réflexivité, et dans le second une attention à la parole, bien que sous un mode différent, aussi prégnante. Il est vrai que Trois contes semble très maîtrisé, là où L’Esprit ailleurs semble être improvisé, intuitif (ce qu’il est). Dans les deux cas, je trouve cela trop excessif. Je travaille à aller vers plus de justesse, moins d’éclats. Si je dis ça ce n’est pas que j’ai honte de ces deux films, au contraire. Mais il me semble que je pars sur des bases un peu « grossières », un peu naïves, pour élaguer ensuite, préciser toujours plus. C’est ma façon à moi d’apprendre le travail. Et apprendre le travail est déjà en quelque sorte le travail, le résultat des films.
D : Lorsqu’il écrit sur des films, Borges insiste toujours sur le bonheur qu’il y a à ne pas connaître le texte-source, car cela évite d’avoir à faire la comparaison entre l’œuvre cinématographique et littéraire. L’adaptation semble pour lui à la fois une dégradation et un trop-plein. Il parle ainsi d’ “abominables profanations” ou de “fidélité méritoire” pour qualifier ce type de transsubstantiation, jugeant ces deux aspects aussi peu intéressants l’un que l’autre. Avez-vous eu cette crainte de la comparaison ? Comment concevez-vous le travail du cinéma par rapport au texte ? Pour qualifier le travail fait avec et / ou à partir des textes de Borgès, vous parlez de “mise à l’oral”. Qu’entendez-vous par là ?
MM : Le point de départ du film ayant été la découverte de la langue, celle de Borges, il était évident qu’il fallait la rendre le mieux possible, la plus audible, la plus musicale surtout. Borges est devenu aveugle progressivement, et El libro de arena est sans doute un des premiers textes (il avait déjà plus de 70 ans…) qu’il a entièrement écrit « à l’oral », ne voyant plus. La simplicité du texte, apparente au conte, vient sans doute de là.
Quand il dit qu’il n’y a pas à connaître le texte source, Borges parle sans doute d’adaptations « classiques », où le travail, douloureux et approximatif, est bien d’adapter l’écrit à l’image, ce qui est absurde si l’on y réfléchit bien. Ce qui revient encore à l’idée d’interpréter, que fustigent d’ailleurs Straub et Huillet : le texte interprété est forcément souillé, dépossédé de sa propre existence. D’où la nécessité de travailler le texte dès le départ comme un corps en soi, comme un paysage rencontré ou un corps que l’on filme.
J’ai bien sûr la peur de la comparaison ; j’ai fait, pour des raisons tout à fait dérisoires (ou politiques), quelques coupes dans les textes, mais je ne pense pas que le film soit une adaptation. « Mise à l’oral », c’est cela : plutôt que mise en scène, c’est une mise en son du texte, une mise en vue, comme dit Deligny, d’images de corps disant un texte. Il faut que ce soit aussi simple que ça.
D : Le Disque est raconté deux fois : une fois en image, dans une séquence muette qui use d’intertitres, et plus tard, en son, par Borges lui-même, qui, debout au milieu d’une forêt, dit le conte. Pourquoi ce choix de faire aussi entendre le texte ? Est-ce une manière de redonner au cinéma une forme d’antériorité ou de primauté sur le texte littéraire, qui devient en quelque sorte l’adaptation de son adaptation ?
MM : Il fallait aussi montrer, insister, sur le fait qu’une image n’est pas un mot, que le cinéma ce n’est pas la littérature. Mais que le cinéma peut faire sonner la littérature, rendre le texte à sa source orale. Le cinéma remplace les troubadours, les poètes ambulants de l’époque. Et le texte n’appartient pas qu’à la forme écrite.
Donc, montrer une première fois le texte, faire la concession de l’adaptation, pour ensuite le redonner à entendre, c’est une manière de mettre en mouvement le texte, et secouer les clichés du texte écrit qui sévissent aujourd’hui gravement.
C’est un peu poussif, un peu trop pédagogique (comme la scène dans la bibliothèque), mais j’ai décidé de le faire jusqu’au bout…
D : L’importance du texte et des langues, c’est aussi l’importance des voix. Est-ce un élément qui a pu déterminer le choix des acteurs ?
MM : Ce qui comptait justement, c’était que le texte sonne. Le travail avec les acteurs était donc un travail oral, surtout oral. Un peu chorégraphique, mais nullement d’interprétation.
Je ne peux pas dire que j’ai « choisi » les acteurs. Je déteste l’idée de casting. Disons plutôt que j’ai travaillé à les rencontrer, à les voir et les entendre, faire en sorte que l’on s’accorde sur les choses à faire. Pour Hector Spivak, qui joue Borges, son allure et sa voix étaient déterminantes, bien sûr. Mais je n’ai pas fait de casting (ou vraiment très très peu), je fais confiance aux rencontres, à l’intuition, et surtout au fait qu’au cinéma l’on filme des corps qui échappent à l’imagination. Il n’y a pas une volonté de poser une image issue d’une tête bien pensante sur le texte d’un autre. Il s’agit de voir, d’imager, pas d’imaginer. J’ai entendu un jour Amalric dire qu’il n’existe pas de mauvais acteurs, seulement de mauvais cinéastes qui ne savent pas voir. C’est exactement ça…
D : Borges, ou l’acteur qui l’interprète, apparaît à la fois en tant qu’auteur, dans des séquences qui encadrent, ou parfois scindent, les contes, et en tant que personnage des contes eux-mêmes. Comment ont été construits ces passages entre les différents niveaux de fiction ?
MM : D’abord, Borges disait lui-même qu’il se voyait comme le personnage de toutes ces nouvelles (encore une fois, comme Poe, comme Lovecraft…). D’autre part, le spectateur s’y retrouve, glisse mieux ainsi d’une partie à une autre. Si l’on avait mis un autre acteur, cela aurait été plus confus que ça ne l’est déjà, et le texte n’aurait pas été dit par Borges…
Il y a beaucoup d’autres textes de Borges, mais aussi d’autres auteurs dans différentes langues. Plutôt que de faire un biopic, j’ai aimé l’idée d’évoquer des choses liées à la vie littéraire de Borges, sans forcément les contextualiser. Alors, ces textes « annexes » viennent introduire le Borges traducteur (il a traduit en espagnol Michaux, Joyce), le directeur de bibliothèque très érudit, citant sans arrêt des auteurs et extraits, connaissant très bien l’anglais, le français, et d’autres langues encore. Il s’agissait, comme il le dit lui-même, de « faire allusion », simplement allusion.
Chacune des trois parties a donc été écrite selon un axe particulier, se concentrant sur un aspect de la création littéraire et du langage. La première partie tourne autour de la lecture, la référence et la citation ; la seconde la traduction, l’adaptation ; la troisième prend Borges comme figure de poète, auteur perdu dans la mémoire de l’histoire littéraire.
D : Vous finissez actuellement un mémoire. Comment envisagez-vous le rapport de la “théorie” à la “pratique”, et réciproquement ?
MM : Je termine un mémoire autour des écrits et films de Fernand Deligny (son texte méconnu mais incontournable Acheminement vers l’image) et le couple de cinéastes portugais António Reis et Margarida Cordeiro, en particulier le film Trás-os-montes, un film dont la puissance inépuisable est un mystère absolu, et en même temps très simple ; sans ce film il n’y aurait sans doute pas d’autres films portugais aujourd’hui essentiels, comme ceux de Pedro Costa. Encore des maîtres, résistants purs et durs.
Si je prends le temps d’écrire et de travailler dans le champ théorique pour ensuite revenir à la pratique, c’est que cela me semble nécessaire, même évident. Je pense que le temps de l’écriture d’un film est comme une enquête unique battant à la fois sur le front du terrain physique, de la rencontre réelle, et dans le domaine de la réflexion, de l’écriture. On fait croire à l’école qu’intelligence et pratique sont dissociés, qu’on ne peut pas être à la fois poète et boulanger, des absurdités comme ça. Et l’absurde continue même dans les écoles de cinéma, où l’on n’apprend jamais à un apprenti technicien à travailler et penser en même temps, penser le réseau intellectuel dans lequel il exerce et où il se retrouve prisonnier.
Bref, je ne dis pas qu’il faut tout mêler, au contraire. Il s’agit de remettre à cheval les articulations nécessaires entre les choses, articulations qui sont largement rouillées par les systèmes de pensée uniforme et la politique de l’avilissement intellectuel qu’on nous sert tous les jours. Et cela sévit d’abord à l’école, ensuite à la télévision, qui parachève le rôle de dé-responsabilisation de l’école, où l’on apprend « par coeur » ce que l’on ne comprendra jamais à la télévision.
J’ai l’air de m’éloigner, mais je pense que tout cela est le seul et même problème.
D : Comment est née l’idée de cette série documentaire sur votre famille, ou en famille, intitulée Les vivants, dont le premier (et à ce jour unique) épisode, s’achève par un très beau geste : la caméra, passée dans les mains de votre “beau-grand-père”, se retourne enfin vers vous ?
MM : Il s’agissait de prendre la cellule familiale comme quelque chose de totalement étranger, dans le sens puissant du mot : un endroit inconnu mais proche, toujours à découvrir. Et encore une fois, c’est l’occasion de travailler, à chaque fois que j’y reviens, de manière très artisanale, avec juste une caméra et ce qu’il se passe autour. Je vois surtout cela comme un exercice de regard, comment le faire déplacer, le faire glisser, revenir… Exercer en quelque sorte le ciné-oeil de Vertov.
D : Dans les Trois contes, le découpage est particulièrement précis. Comment s’est fait le travail préparatoire, avant le tournage ?
MM : N’aimant pas écrire à partir de lieux imaginés, j’ai finalisé le scénario lors des repérages sur les lieux. Il me paraît à la fois plus simple et d’un point de vue éthique plus juste d’écrire à partir d’un lieu, d’un paysage ou d’un corps que l’on a sous les yeux, que l’on peut toucher, gravir, sillonner. Cela permet aussi de penser au découpage, au montage « préhistorique » du film dès le stade de l’écriture, chose que l’on défend de faire aujourd’hui aux scénaristes, allez savoir pourquoi ; pour moi, c’est une seule et même chose.
Durant le tournage, nous avons essayé de faire en sorte d’avoir assez de temps pour répéter longuement avec les acteurs et pour la mise en place technique. Le temps, et l’envie de l’équipe bien entendu, ont permis de faire que le film se fasse dans de bonnes conditions. Ce qui n’est pas si difficile que ça à exiger. On fait croire que tout doit se faire dans la précipitation, que l’argent de la production oblige à faire des journées de 12 heures, que l’on doit faire plus de 10 plans par jour, etc… mais ce sont de véritables mensonges. Vitesse n’est pas précipitation, rendement financier n’est pas économie. Ce sont des leurres.
On me rétorquera que j’ai fait ce film avec une équipe bénévole et dans des conditions « exceptionnelles », et que seules ces conditions permettent cela. Eh bien, je n’en crois rien.
D : Quel est votre rapport à la pellicule et au numérique ? Vous avez pris la décision, significative économiquement et esthétiquement, de tourner en pellicule les Trois contes, mais vous mariez les matières dans L’esprit ailleurs.
MM : Je fais partie d’une génération qui a connu très intimement le passage de la pellicule au numérique : les premiers films que je voyais avec une réelle envie de cinéma étaient parmi les derniers à être projetés en pellicule. Les personnes plus jeunes que je rencontre aujourd’hui n’ont pas connu cette époque-là (si ce n’est les dessins animés et films de divertissement vus dans l’enfance). Idem en termes professionnels : tourner en pellicule, pour les premiers films, est devenu très rare. Pire encore pour le 16mm. Les différences esthétiques et politiques de l’utilisation de la pellicule ou du numérique sont donc forcément très présentes dans nos réflexions, même si certaines semblent déjà un peu remâchées.
Je crois que la pellicule est une matière vivante, comme du vrai bois : on a l’impression d’en sentir la présence, l’essence brute rien qu’en la regardant. Le numérique, c’est un peu de l’aggloméré : de la poussière de bois agglutinée à de la colle rigide. Il y a dans la pellicule un rapport concret et immédiat avec l’étrangeté d’une situation, et paradoxalement, sa distance ; même en filmant de près on peut être à des années lumières de l’acteur ; en numérique, pour arriver à ça, il faut s’appeler Godard… Et puis il y a aussi une volonté de brouiller la temporalité, le contexte historique.
De plus, il y a la rigueur indéniable qu’impose un tournage en pellicule, surtout sur un petit budget : pour Trois contes de Borges, nous savions qu’avec une moyenne de 3 prises par plan environ, nous étions tenus d’avoir répété le plus parfaitement possible le texte, le plan. Cela entraîne une concentration et un silence qui au final peut être bénéfique pour tout le monde.
Enfin, il est de plus en plus difficile de tourner en 16mm (ici en Super16), c’était en même temps une dernière occasion pour nous d’apprendre à manier la pellicule, connaître ce qu’elle permet et ne permet pas, et peut-être tourner, malheureusement, l’un des derniers long-métrages dans ce format-là.
Images 1 : L'Esprit ailleurs / 2 et 3 : Trois contes de Borges