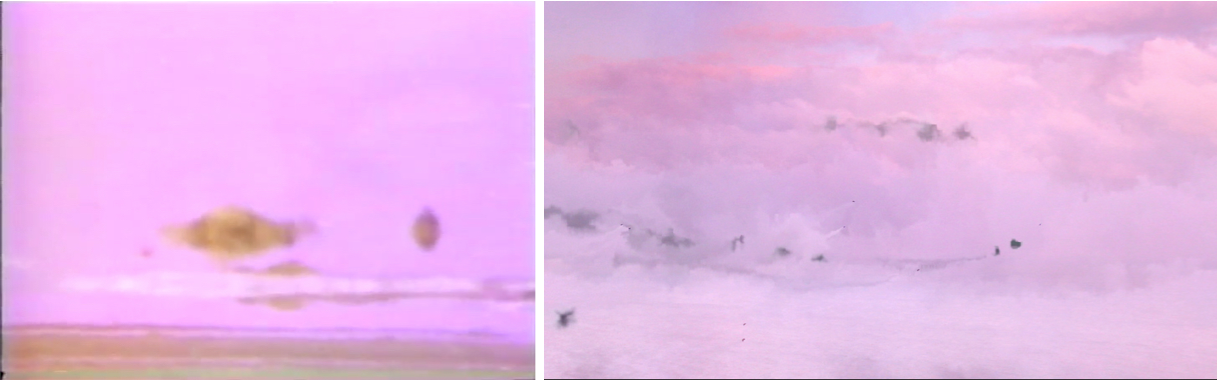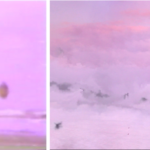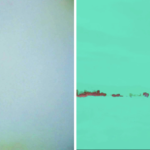Jacques Perconte
Traversées
Le 6 février dernier s’achevait « Soleils. Retrouver le monde, raconter les images numériques », cycle de six séances composé, à l’invitation de Nicole Brenez, par Jacques Perconte et Bidhan Jacobs pour la Cinémathèque française. Loin de chercher à clore une trajectoire avec le surplomb du regard rétrospectif, le cinéaste et le théoricien entrelaçaient amoureusement les recherches du premier avec celles de Mike Figgis, Leighton Pierce, Robert Cahen ou Michael Snow. Chaque programme inventait dans le temps de la projection, par le dialogue des formes, des matières, des flux et des idées, une œuvre nouvelle. La programmation retrouvait ainsi une dimension créatrice – dimension que l’institution, préférant les commémorations solennelles, n’aura d’ailleurs guère encouragée.
La projection comme performance, c’est ce qui était en jeu aussi bien avec Time Code et sa bande-son mixée en direct par Mike Figgis, qu’avec Soleils et la musique live de Jean-Benoît Dunkel. Empruntant son titre à Michael Snow, « La région centrale », l’ultime séance présentait quelques-uns des plus beaux films de paysage de Perconte en montage alterné avec des fragments du long-métrage de Snow. Au déploiement aussi méthodique que ludique, chez Snow, de procédures cinétiques d’exploration d’un pan de nature (caméra à l’envers / tourbillonnante /…) répondait, chez Perconte, ces zooms ou ces travellings qui, comme en une traversée de la traversée, ne donnent à l’oeil l’impression de pénétrer le paysage qu’en le faisant s’échouer à la surface éruptive de l’image numérique. Si différentes, ces deux esthétiques se rejoignaient en un même désir de défaire l’emprise humaniste-perspectiviste du regard de la caméra sur la nature. La beauté du programme, véritable défi technique, tenait aussi évidemment à l’alternance du 16 mm et du numérique. Chaque raccord était un vertige et une joie, un authentique transport – lumière et affect mêlés -, qui culmina dans la longue étreinte de deux plans superposés. Avec une rare intensité, nous aurons eu ce soir-là le sentiment que la projection même pouvait être un véritable évènement de cinéma.
Le lendemain matin, Jacques Perconte et moi étions assis à son bureau, face à ses écrans d’ordinateur et ses innombrables disques durs externes. S’engageant sur le cycle, la conversation se faisait bientôt traversée de l’œuvre, à mesure que documents et films étaient convoqués d’un clic. Signe de sa générosité, le cinéaste, pour qui la création et le partage participent d’un même geste, met en effet sur son site la très grande majorité de ses pièces.[11][11] Cet entretien fait suite à la publication de trois notes consacrées au travail de Jacques Perconte : Jacques aux mains d’argent, de Nicole Brenez, Sois le changement que tu veux voir dans le monde, de Bidhan Jacobs, et Jacques Perconte / Robert Cahen : l’« inspect » du monde sensible, de Fleur Chevalier.
Débordements : Quelle a été votre formation artistique et scientifique ?
Jacques Perconte : J’ai commencé à dessiner très petit. C’est la mécanique de compensation que j’ai développée pour exprimer mes émotions. Ma mère m’a toujours encouragé dans les arts plastiques. Elle m’a inscrit aux cours du soir au lycée. J’étais plutôt bon en maths, mais quand même littéraire. Je réalisais des courts-métrages de fiction avec des copains. J’écrivais beaucoup également. Quand j’ai présenté le concours des beaux-arts à Bordeaux, après avoir réussi la pratique, j’ai rencontré la brutalité de postures que je ne comprenais pas. Finalement refusé, je suis entré en fac d’arts plastiques. Là, on nous scandait (nous étions plus de 200 en première année) que nous ne serions jamais des artistes et que nous n’avions rien de mieux à faire que de nous battre pour obtenir un poste de prof quelque part… La première année était démoralisante. Beaucoup de cours très ternes. Devant l’a priori impossibilité de trouver des voies dans le dessin ou la peinture, j’ai décidé de chercher un autre chemin vers l’art. J’ai alors commencé la vidéo et l’infographie. On parlait d’art en vidéo, de technique et de métier en infographie… une terre vierge. Il semblait que peu de choses relevaient du geste artistique et j’ai foncé. J’ai commencé à chercher entre la vidéo et l’informatique ce qui pouvait se passer.
Je n’ai pas à proprement parler de formation scientifique. J’ai passé quelques années au sein d’un laboratoire du CNRS, d’abord en stage alors que j’étais étudiant en art, puis en tant qu’objecteur de conscience… Quatre années qui ont été, je crois, les plus formatrices que j’ai connues. C’est ma fraîche connaissance de l’internet qui m’a conduit là. C’est en archéologie que j’ai véritablement fait mes armes en informatique. Et Robert Vergnieux qui dirige maintenant l’archéopole a su nous donner beaucoup.
D. : La recherche scientifique continue-t-elle de vous intéresser ?
J. P. : Bien sûr, mais je ne sais pas bien l’expliquer ni l’exprimer. On en saura plus quand j’aurai terminé le projet que je commence sur les liens entre l’art et la nature. Une des cordes que je fais vibrer est celle de la pensée lyrique de Roger Caillois.
Ce que je peux cependant avancer sur le sujet, c’est l’apport des échanges qui se tissent aujourd’hui avec plusieurs chercheurs en sciences humaines. Je citerais plus particulièrement Bidhan Jacobs. Il développe une lecture de mon travail mettant en lumière certaines formes qui enrichissent et libèrent la pensée que je peux avoir de ma pratique. L’exemple le plus parlant est la place qu’il a donnée à un petit essai que j’avais fait : Le soleil de Patiras (2007). J’avais simplement mis de côté une séquence d’un tournage autour de l’île de Patiras, car j’y adorais quelque chose. Et Bidhan s’est concentré dessus, il y a vu tout de suite “comment [j’y élevais] la détection du signal de l’outil industriel (une mini-DV Sony DCR-PC 120 E) au niveau de la perception humaine et [faisais] remonter à la surface de l’image des structures profondes du réel”. Par là, il m’a libéré de la nécessité de pousser plus loin – quand je n’en ai pas envie, que cela n’est pas nécessaire – le travail plastique sur l’image. J’ai alors considéré cet essai comme un film. J’ai donné la place à quelques séquences de ce type dans ma filmographie. C’est ce qui m’a permis de faire Chuva (2012), qui s’ouvre sur une longue séquence de pluie en plan fixe, où l’on atteint les limites perceptives de la caméra pour glisser dans l’abstraction et les jeux de compression. C’est ce qui m’a réellement mis sur la voie de ce glissement documentaire qui s’opère dans mes recherches.
D. : En quoi ont consisté vos premiers essais cinématographiques ?
J. P. : J’ai commencé par la fiction, au moment du lycée. Il a d’ailleurs fallu que j’aille assez loin pour me rendre compte qu’en fait, j’étais en train d’expérimenter. J’ai tourné plusieurs courts-métrages, comme Azar (1995) par exemple, souvent plus proches des arts plastiques que du cinéma industriel. J’ai aussi fait un moyen, Sables (1997), lui-même relativement abstrait. Mon rapport à la fiction n’est pas très classique. Je ne cherche pas à raconter une histoire selon un genre, même s’il peut y avoir des personnages qui s’y rapportent. Puis j’ai entamé un projet de long-métrage, Chloé (1999), soutenu par Jan Kounen, de qui j’étais proche à la fin des années 1990. C’était très scénarisé, avec une équipe assez importante et parfois beaucoup de figurants. Le film s’est tourné en numérique. Je voulais vraiment questionner la fiction depuis l’outil vidéo. Mon parcours dans les arts plastiques m’avait fait comprendre l’importance des outils et du rapport entre la technique utilisée et le récit. J’ai même écrit une fiction, Chi Ocsha (2000), qui n’est pas devenu un film, mais s’est transformée en littérature électronique et en performances, évoquant les passages entre l’argentique et le numérique.
Chloé travaillait dans la cellule du couple un certain rapport au fantasme et au meurtre. Il y avait trois couples différents, chacun étant joué par les mêmes acteurs. L’idée était de travailler sur des images composites, avec des inserts produisant des interactions et des points de tension à l’intérieur du cadre. Le film a été tourné, mais Jan Kounen s’est éloigné du projet quand il a compris ce que je voulais vraiment faire. La post-production n’a pas pu être achevée – ni avec lui, ni avec les deux autres boîtes que j’avais trouvées. Le tournage a eu lieu fin 1998, début 1999, et c’était alors très compliqué techniquement, et donc financièrement, de fabriquer de telles images. Aujourd’hui, tu peux faire ça tout seul. Chloé est donc resté à l’état de rushes et de maquette pour la post-production.
C’est notamment cette expérience qui m’a permis de comprendre que mes motivations étaient très loin des standards du cinéma, même si mon travail actuel vient aussi de mon amour pour le cinéma le plus « classique ». Il y a eu un croisement tardif entre ma cinéphilie et les arts plastiques en mouvement, mais la base est bien ma passion pour les films de David Lynch, John Ford ou Sergio Leone. J’ai aussi été nourri aux films d’horreur, même si mon rapport à la représentation de la violence a par la suite beaucoup évolué. Je ne regarde plus rien de sanglant aujourd’hui.
D. : En voyant Après le feu (2010) sur grand écran, et plus encore d’Àrvore Da Vida (2013), dont la musique m’a semblé proche de celle de György Ligeti, j’ai pour la première fois pensé à Stanley Kubrick en regardant vos films, en particulier évidemment à la « traversée » de l’espace dans 2001.
J.P. : J’ai découvert 2001 assez tard, alors que j’étais déjà en fac d’arts plastiques. Je l’ai évité longtemps, il m’intimidait un peu. Ce qui est amusant, c’est que même si j’ai trouvé extraordinaire les effets visuels, je n’ai pas cherché à savoir qui en était à l’origine. Aujourd’hui, je ne peux plus assister à une projection de 2001 sans penser aux films de John Whitney. Mais Kubrick n’est pas le cinéaste le plus important pour moi dans le rapport à l’image. Lynch a été plus marquant. Je l’ai découvert avec la série Twin Peaks. Il y avait quelque chose d’étrange dans son rapport au temps, une forme de suspension. Un autre évènement pour moi a été Crash, de David Cronenberg. C’est d’ailleurs la première fois que j’étais dans une salle qui se vidait à une telle vitesse. Sombre, aussi, de Philippe Grandrieux, a été capital. J’ai vraiment compris qu’il pouvait se passer quelque chose au cinéma, dans la salle, qui relevait de l’art, que le cinéma était un médium très puissant.
Puis il y a eu Bill Viola. Un de ses films, Le Passage, était passé à la « Lucarne », le programme d’Arte dédié au cinéma expérimental et aux vidéos d’artiste. Il faut d’ailleurs souligner le rôle de la télévision, qui ouvrait véritablement des horizons. Je ne sais pas si c’est toujours le cas. J’ai ensuite découvert Chott El-djerid, sans doute mon film préféré. En voyant ces vibrations de lumière, quelque chose alors est devenu évident pour moi. Pour la première fois, j’ai réellement vu l’expression technique d’une image. C’est parce que la lumière était filmée d’une certaine manière, avec certaines optiques, qu’il y avait cette explosion de l’image – pour le dire autrement, l’expression d’une plasticité. L’autre immense découverte a été Stan Brakhage, qui est arrivée encore plus tard, au moment où je suis arrivé à Paris. J’avais déjà fait quelques films.
Mon passage vers le cinéma expérimental est aussi venu d’une déception de plus en plus forte par rapport aux films que je pouvais voir au cinéma. J’ai appris à faire des films en analysant à l’extrême ceux des autres. Par exemple, durant ma dernière année de lycée, j’ai ré-écrit Intérieurs, de Woody Allen. Je décomposais le film plan par plan pour essayer d’en comprendre la mise en scène. Pour chaque plan, j’avais plusieurs pages de notes, où je consignais chaque détail – depuis les dialogues jusqu’aux mouvements de caméra. J’ai fait cela pour cinq ou six films. Le cinéma était vraiment une passion dévorante. Puis, à partir d’un moment, j’ai commencé à avoir moins de plaisir. Cette phase de cinéphilie adolescente était en train de s’achever. Progressivement, je me suis rendu compte que ce désintérêt venait des images, de l’impossibilité du cinéma à assumer sa condition technique. J’ai aussi commencé à deviner la suite des films que j’étais en train de voir. Comme si, trop littéraux dans le langage, les réalisateurs dessinaient le devenir scénaristique à chaque plan.
En commençant à faire de la fiction, j’ai compris que j’avais besoin d’un rapport très direct à ce que je faisais. En fait, il fallait que les choses continuent sans cesse à évoluer. Pour Chloé, j’avais un scénario très établi. Mais, à partir du moment où l’on a entamé le tournage, j’ai ré-écrit le film, de façon quotidienne. L’histoire se modifiait au fur et à mesure. Sauf que le cinéma amateur se fonde malgré tout sur le modèle « industriel », avec une équipe nombreuse. C’est une machine très difficile à manœuvrer, impliquant des rapports de « management » lourds et pénibles. Pour les subventions aussi, il y a d’énormes contraintes. Mon projet Chi Ocsha, présenté sur un format à l’italienne, était rédigé du point de vue du personnage. Il n’a eu aucun soutien, car ce n’était pas conforme à la procédure. C’est après ces deux expériences inabouties que j’ai décidé de passer à autre chose, d’emprunter un chemin plus solitaire. Cela a été une déchirure, car avec Fabriche Marache et Jérôme Meynardie, nous avions créé autour du projet Chloé l’association Paradoxal, qui organisait un festival et produisait des films. J’ai quitté l’association à cette période-là. Aujourd’hui, Fabrice produit et réalise des documentaires, notamment Iranien. Il s’occupe de l’Atelier documentaire, une société coopérative de production. Jérôme est resté fidèle à la fiction et au cinéma indépendant.
D : Quelle a été votre première réponse à cette rupture avec la fiction ?
J.P. : Un film nommé Promenade, qui a été tourné en 1999, dans la foulée. Il s’agissait de trois promenades, avec trois actrices : Laeticia, celle de Chloé, Karen, que j’imaginais dans le rôle d’Artémisia pour Chi Ocsha, et Anne-Sophie, une amie qui allait poser pour moi par la suite, car je faisais beaucoup de photographies à l’époque. Les arts plastiques occupaient toujours pour moi une dimension parallèle au cinéma. Il n’y avait pas encore de convergence. Le film a été diffusé dans deux ou trois festivals consacrés à la télévision car mon producteur était lié à ce milieu-là. Dans ce cadre, à Sarlat ou ailleurs, il passait pour un O.V.N.I. absolu. C’était très drôle.
Promenade se compose de trois promenades plastiques. La première emploie comme technique l’animation de photographies surimpressionnées sur de la peinture grâce au numérique. La deuxième est faite à partir de vidéos refilmées sur écran, avec un jeu très fort sur la texture, les moires, pour obtenir une dissolution de la forme. La dernière travaille sur le flou. Elle a été tournée en mini-DV hors-focus. Puis j’ai là aussi re-filmé le résultat, cette fois en projetant l’image.
D : Vous travailliez beaucoup à l’époque sur le re-filmage, et l’accumulation des couches de matière.
J.P. : Oui, énormément. Il y a eu deux temps dans ma démarche plastique : filmer l’écran, puis voir ce qu’il y a dans l’image. Cela a été mon cheminement, la constante étant donc un rapport très plastique à l’image. J’ai travaillé avec des scanners, par exemple. Je répandais des liquides, puis je plaquais mes mains, mes bras, ma tête, je donnais des coups dans la machine. On voyait apparaître les traces de passage du scan [voir gun in the hand, scanner in the head (1996)]. Il m’arrivait aussi de repasser les images imprimées dans le scanner. Encore une fois, c’était une façon d’accumuler de la matière, de créer des perturbations. Ces recherches remontent peut-être à un travail à la fac autour d’un sujet intitulé « le corps du trait, le trait du corps ». Pierre Garcia[22][22] Auteur du Métier du peintre, publié aux éditions Dessain et Tolra. conduisait cet atelier. Il m’a permis d’avancer sur des routes dégagées de toute idée de discipline (dessin / peinture). J’avais produit une trentaine de dessins de femmes, d’après modèles. Cela a été une expérience de travail intense qui m’a fait comprendre l’importance du trait. Je savais “bien” dessiner, mais ce que je produisais était plat et chiant car je n’engageais pas mon geste.
Quand j’ai commencé à travailler avec des machines, j’ai cherché des moyens d’imprimer une trace physique sur l’oeuvre. Je tordais les câbles, je les coupais, je cognais dans les machines afin de retrouver une possibilité de travailler la matière par les gestes.
À partir de mes recherches autour du « corps numérique », comme ncorps (1998), j’ai commencé à développer des outils pour produire des images qui contiennent l’expression de leur support, c’est-à-dire des images où se manifeste à même la surface le transport via les dispositifs technologiques des informations enregistrées. Les “corps numériques” sont un ensemble de pièces, un projet de recherche. Au départ, il se fonde sur les concepts d’image-temps et d’image-mouvement de Deleuze en les transposant dans le numérique. Très vite, la question a été celle de l’historicité de l’image, du stigmate-média. Comment l’image peut-elle raconter son voyage à travers les moyens technologiques ? Je voulais comprendre ce parcours de la lumière : depuis sa réflexion sur le corps, sa capture par une caméra ou un appareil photo numérique, sa diffusion sur un écran de télévision, son organisation informationnelle dans une animation, sa mise en ligne sur internet, son téléchargement dans un navigateur, sa capture à nouveau par une caméra, sa diffusion sur un écran de télévision…J’analysais tous les stigmates laissés par ces histoires dans le corps de l’image. Je menais ces recherches de manière très scientifique, sans doute parce que j’étais influencé par le fait d’avoir été très jeune dans une équipe de recherche. L’idée ensuite m’est venue de croiser cela avec la fiction, notamment à travers les personnages que j’avais inventés pour Chloé. Petit à petit, il y a donc eu cette convergence entre le fait de tourner, mettre en scène, et travailler sur la plastique. On voit ce glissement-là dans une pièce de danse datée de 2001, Phex. Je filmais encore beaucoup les écrans, puis à un moment, j’ai fait le point non plus sur l’image, mais sur l’écran de la télé cathodique lui-même. Je me suis intéressé à ce qui se passait entre la surface de verre et l’image, aux moires, c’est-à-dire à la structure de l’image. J’ai aussi découvert quelque chose que je n’avais jamais vu auparavant, et qui m’attirait. Mon ordinateur n’étant pas assez puissant pour traiter toutes les informations, il me fallait compresser les fichiers vidéos. Les « défauts » ainsi générés me semblaient d’une grande beauté. Toute la dernière partie de Phex s’est ainsi constituée de composites de compressions vidéos. Pour la fin, j’ai compressé, compressé, re-compressé dix fois des images ralenties et sur-impressionnées, jusqu’à ce qu’elles laissent apparaître une très haute saturation dans les blancs et les couleurs, des structures internes extrêmement sensibles. En découvrant cette plasticité spécifique du numérique, j’ai pensé qu’il fallait poursuivre dans cette voie. Phex a ainsi été une manière d’entrer dans l’image.
Wisz (2002) a été une autre manière d’approcher cette question. Je faisais à l’époque un peu de VJing. Je devais jouer à Bordeaux avec Kid 606, un DJ américain assez hardcore, j’ai préparé un live autour du rouge et du blanc, constitué uniquement de compressions vidéo. À partir du modèle 3D d’une forme tordue dans tous les sens, j’ai procédé à une multitude de compressions, jusqu’à ce que la forme disparaisse, que l’on ne puisse absolument plus la distinguer.
D : Faut-il passer par des logiciels spécifiques pour travailler sur la compression ?
J. P. : La compression est une chose vraiment basique en informatique. A l’époque, les ordinateurs n’étaient pas assez puissants pour lire les images brutes. Ils ramaient, tout simplement. Pour réduire les ressources demandées afin de lire l’image, il fallait réduire la taille du fichier, le compresser. Dans tous les logiciels de compression vidéo, il y a des fonctions d’export de la vidéo dans d’autres formats, que ce soit donc pour la lecture ou l’envoi sur Internet. Ce faisant, un changement très fort de l’organisation interne du fichier s’opère. Apparaissent en fait les traces des mathématiques appliquées pour économiser de la place et de la ressource. Je découvre ainsi les variations de couleurs, la force des aberrations chromatiques. À partir de là, je vais fabriquer un vocabulaire, en commençant par regarder ce que produit tel ou tel changement de paramètres, comment il est possible d’altérer le fichier de façon informatique. J’ouvrais par exemple le fichier vidéo avec un éditeur de texte, pour voir comment c’était fait.
D. : Vous modifiez alors le code lui-même.
J. P. : Oui, un peu, mais cela ne me plaisait pas beaucoup. Je n’ai jamais cherché à maîtriser le processus en le programmant. J’ai toujours été plus attiré par le bricolage. Ce qui m’intéresse, c’est de détourner, de découvrir. Alors j’ai choisi d’écraser, de casser un peu brutalement les vidéos… Le problème, quand on casse une vidéo, est de réussir ensuite à la lire. Par la suite, j’ai compris que ces compressions temporelles étaient une histoire de blocs. Lors de la compression, le fichier est découpé par le logiciel en blocs, et ces blocs ont des structures construites autour d’une image-clé. Il y a une sorte de ponctuation : image-clé, pas d’image-clé, image-clé, etc. Les images-clé sont des balises qui redéfinissent la manière dont fonctionne un bloc d’images, jusqu’à la prochaine balise. Quand tu retires une de ces images-clé, tu restes sur l’ « explication » qui précède. Il y a alors une sorte de greffe entre une « explication », et le bloc d’images suivant, qui produit la métamorphose de ce dernier. Les images se mélangent, quelque chose tient dans le temps – ce n’est plus simplement aléatoire. Cela se passe vers fin 2001-début 2002.
D. : Continuez-vous à travailler sur un matériau purement abstrait, après Wisz ?
J. P. : J’ai travaillé sur des pièces en 3D, par rapport à des questions d’architecture par exemple, mais j’ai rompu assez vite avec cela, car importe aussi pour moi le modèle. J’ai fait beaucoup de photographies où le corps était essentiel, ainsi que la mise en relation des textures de la peau et de l’écran, de l’image après compression. Dans XSZ (2002), je compresse des images du film placées sur un fond noir, puis je fais un composite avec les images normales, qui apparaissent alors très découpées par cette augmentation du contraste. Avec SNSZ (2002), un film pornographique tendant vers l’abstraction, le corps devient l’élément moteur des mouvements internes de l’image. J’ai filmé des corps, mais on ne voit plus que les artefacts qu’ils produisent suite aux manipulations numériques. Ce film-là est mon dernier travail sur le corps. J’ai eu l’impression d’être arrivé où je le souhaitais. J’avais découvert la puissance d’une technique nouvelle, il fallait que je la mette mieux en oeuvre. Et le corps n’était pas le motif qui pouvait me conduire plus loin.
D. : A partir de là, vous commencez votre recherche sur le paysage.
J.P. : Oui. J’ai eu le sentiment d’avoir trouvé une technique personnelle, qui pouvait véritablement devenir mon moyen d’expression propre. J’ai alors voulu me ré-inscrire dans une histoire générale de l’art, en reprenant un motif, celui du paysage, qui a eu de Turner à Monet une très grande importance dans la révolution plastique qu’a connue la peinture au XIXème siècle. Uaoen (2003), mon premier film sur le sujet, vise la disparition de la dimension symbolique dans l’image, c’est-à-dire en l’occurrence de la perspective. Peu à peu, il s’agit d’entrer dans la réalité physique de l’image à travers un jeu sur les mouvements horizontaux et verticaux. L’image numérique est un plan (plat) de points physiques. On appelle les points des pixels. Ils ne bougent pas mais sont informés et s’éclairent selon le message qu’ils recoivent. Le rythme des variations d’éclairage (luminosité-couleur) sur l’ensemble de la matrice donne dans le temps une impression de mouvement. Dans les faits, ces mouvements perçus sont soit verticaux, soit horizontaux. Travailler sur la compression vidéo rend visibles ces mouvements : découpée en blocs qui se déplacent sur la grille, l’image dévoile dans sa fluidité naturelle, son architecture mathématique (les blocs carrés qui se déplacent à plat sur la grille soit à l’horizontale, soit à la verticale). L’image n’est alors plus une chose à lire depuis un point de vue fixe, dans une perspective symbolique. Les espaces de lecture au contraire se démultiplient, de l’échelle culturelle à l’échelle matérielle.
J’ai un rapport physique avec la nature, et politique avec le paysage. Sur le tournage, je fais mon cadre, mais après je ne regarde plus dans l’objectif. Je suis à côté de la caméra. Je découvre donc ce que j’ai filmé en arrivant chez moi. Tout se joue au cadrage. J’enregistre des portions de temps assez importantes, puis je choisis les moments où quelque chose advient : le vent qui souffle et fait vibrer la caméra, un oiseau qui passe, ou la pluie qui se met à tomber. L’expression plastique est véritablement liée au matériau, à ce qui se produit et que je ne maîtrise pas, mais que je recherche au moment du tournage. Le cadre, la lumière, la composition sont essentiels. Quand je travaille ensuite sur l’ordinateur, j’ai le souvenir de l’image telle qu’elle était, mais il s’agit pour moi de révéler autre chose du plan, sans référence à l’image originale. Je travaille sur les mouvements internes au plan – le passage des oiseaux, la fumée, la poussière, les vibrations de la lumière, etc.
J’utilise toujours de très grosses optiques. Dans mon dernier film par exemple, celui sur l’Ecosse, l’image tremble énormément. On sent le vent. Et les falaises sont aplanies, et tramées. C’est cela qui fait le lien avec le tissu qui apparaît ensuite par compression. Je n’essaie jamais de faire croire au spectateur qu’il est face au paysage. Le simulacre est présenté comme tel. Et, pourtant, la nature est intensément présente car elle est alors complètement détachée de son image. Ce que l’on voit est le résultat de l’opération technique même, qui permet de conserver une empreinte de la nature, et non le simulacre d’un double analogique, “transparent”, de la nature. Parce que la nature n’est pas dans l’image. En fait, je raconte une histoire plastique, celle du rapport que j’ai avec l’image en mouvement d’un paysage. Je mets en scène mon rapport à la dégradation de l’image sur l’écran, à la particularité de la colorimétrie, etc.
D. : La manipulation informatique se fait-elle sur des zones précises ?
J.P. : Non, sur l’image entière. Elle dépend donc de la composition. Pour prendre un exemple : Impressions (2012) reposait précisément sur le fait de filmer en plans fixes. Cela a été une source d’étonnement pour mes producteurs, car toute ma technique est construite sur le mouvement. Mais que la caméra bouge ou non, le monde, lui, ne cesse de changer, même de manière infime. En filmant assez longtemps, et en utilisant le télé-objectif, on peut capter les vibrations produites par les masses d’air et la lumière. La route ou le chemin de fer sont donc eux aussi en mouvement. C’est ce que mon travail vise à révéler.
Le potentiel plastique vient toujours de ce qui est filmé. La technique permet d’amener ce potentiel à la visibilité. Je n’aime pas tellement composer moi-même les mouvements à l’intérieur des images. Le plaisir vient du fait qu’un petit bug fait apparaître quelque chose – un peu de rouge ou de bleu, qui commence à se balader dans le plan grâce à la vibration de l’image. Il se passe alors une chose magique. Mon travail est de stabiliser ce bug, de l’enregistrer, ou de saisir une vibration particulière qui pourra suite à telle ou telle compression révéler quelque chose. La nature n’est plus là. Elle persiste, on la raconte, mais elle n’est plus là.
D. : Comment travaillez-vous le son ?
J.P. : Le son dépend de l’évolution de mon matériel. Pour l’image aussi, d’ailleurs. J’ai beaucoup de caméras différentes, depuis la caméra pro Sony au petit appareil de poche, ou au téléphone. Mon prochain film sera tourné dans un train avec un téléphone. Le son de Uishet (2007) est capté par un micro Sony à 90 euros et enregistré sur un mini-disc. Aujourd’hui, j’ai un Nagra et des micros plus performants. En ce qui concerne le son direct, je respecte sa composition. De même, je ne mettrais jamais un son de Normandie sur une image d’Ecosse. J’ai un respect très fort de l’ontologie du lieu. Je raconte la relation que j’ai avec les matériaux enregistrés, mais je raconte aussi un endroit. J’essaie d’être honnête de ce point de vue-là. Il y a un rapport à l’expérience vécue.
J’aime mettre de la musique sur mes films. Il m’arrive d’en composer, d’ailleurs. Le film sur l’Ecosse travaillera un alliage de musique concrète et de drone. Par contre il n’y en a jamais sur mes installations. J’aime mettre de la musique parce que c’est de cette manière aussi que je fais du cinéma. C’est un moyen pour moi d’envelopper le spectateur. La musique l’enlace. Quand je commence un film, j’ai souvent, je ne sais pas d’où, le nom d’un musicien qui me vient. Comme si, profondément, chaque film était aussi déjà potentiellement une musique. La plupart du temps c’est ce musicien qui réalise la musique. Une musique que je ne veux pas mimant l’image, que j’aime libre, qui prend ses aises. Une musique qui permet de quitter le rythme du film de temps en temps et d’y revenir à d’autres moments. Je change souvent de style même si j’ai quelques pérférences. J’adore travailler avec Samuel André, Jean-Benoît Dunckel ou Simonluca Laitempergher.
D. : Quels sont vos projets ?
J.P. : Je viens tout juste de finir mon film écossais, Ettrick, qui sera d’ailleurs présenté en compétition lors du Festival Côté Court en ce mois de juin. Il est le fruit d’une aventure au long cours[33][33] Des documents de tournage sont disponibles dans un riche album photographique.. Celle-ci a commencé lorsque Pip Chodorov a présenté Uishet à l’Alchemy Film Festival de Hawick, il y a quatre ans. Richard Ashrowan, son directeur, a alors découvert mon travail. L’année suivante, il m’invitait pour montrer Impressions. J’étais très heureux de pouvoir aller dans ce pays que je ne connaissais pas. Et le festival est extraordinaire, de par sa programmation, les cinéastes invités – dont certains sont devenus des amis, comme Robert Cahen, Chris Meigh-Andrews, Enrique Ramirez, Michel et Patrick Bokanovski, Joost Rekveld ou John Woodmann -, et ses projections dans la nature.
La lumière de ce mois d’octobre me donnait aussi envie d’en voir davantage. Malgré le temps, les hautes herbes des vallées étaient de nuances de jaunes et de verts très étonnantes. J’ai commencé à me balader, j’ai aussi filmé quelques matchs de rugby. Tout cela me donnait vraiment envie de revenir. Quelques mois plus tard, j’ai commencé à tourner sans trop savoir ce que je voulais. Peu à peu, j’ai découvert la profondeur d’une nature modelée par l’activité de l’homme, et compris que la laine qui sert l’industrie textile n’était pas celle des moutons que l’on voit partout. Autre surprise : la forêt d’Ettrick, qui me dit-on est plus grande que la ville de Londres, est détruite et replantée parcelle après parcelle car elle fait l’objet d’une intense exploitation. La traverser (elle ne se visite pas, elle est privée), c’est se glisser entre des immenses arbres serrés comme des sardines, entre lesquels le soleil peine à se frayer un chemin, alors que dans les parcelles exploitées, au contraire, il ne reste que quelques troncs au milieu des souches arrachées, pour que les oiseaux ne désertent pas. Le voyage suivant est très pluvieux, venteux, brumeux et froid, mais m’offre d’incroyables scènes. Le troisième se déroule à nouveau durant le festival. Je passe alors beaucoup de temps sur les routes à quadriller les “Borders”, une région entre l’Angleterre et l’Ecosse où il n’y avait pas de lois. C’est pendant ce voyage qu’il m’apparaît essentiel d’inclure la question du textile dans le projet. Parce qu’en regardant par la vitre de la voiture le paysage qui défile et les couleurs qui se mélangent, je me rappelle les textures des laines et des cachemires entremêlant roses et verts, bruns et rouges.
Puisque j’étais au coeur de la région du tweed. j’ai eu l’idée d’injecter quelque chose de la culture écossaise dans le paysage, de me servir des tartans comme d’un outil qui libérerait sa plasticité dans celle des images des forêts. De là j’ai voulu filmer les textiles en train d’être fabriqués. Paysage, textiles, machines et exploitation forestière se trouvaient ainsi liés. D’une certaine manière, quelque chose de documentaire se met en place dans mon travail, sans que pour autant je cherche à expliquer ou à raconter l’histoire d’un espace social. Je colle les choses de manière à ce qu’il se passe quelque chose entre elles. C’est un aspect apparu doucement dans mon travail, notamment avec M (Madeira). Ce sera d’ailleurs aussi le point de départ de mon prochain projet. C’est un projet double. Un film sur l’Islande et ses volcans avec la musique de Starwalker (Jean-Benoît Dunckel et Barði Jóhannsson), et un essai documentaire transmedia sur l’exploration de cette question du paysage dans la relation art-homme-nature. Mais je n’en dis pas plus pour le moment.
Et, puisqu’on ne travaille jamais tout à fait seul, je profite de cette tribune pour remercier ma compagne, Isabelle Silvagnoli qui m’accompagne et me soutient dans mes projets, mes producteurs passés, Triptyque films, Guillaume Massart et Thomas Jenkoe en particulier, présents : Rodolphe Olcèse avec Too Many Cowboys dont le soutien et l’amitié sont précieux et futurs, Darjeeling avec qui une belle aventure commence. Et aussi, sincèrement, Bidhan Jacobs et Nicole Brenez.
Pour suivre le travail de Jacques Perconte : http://timeline.technart.fr/ , http://www.jacquesperconte.com et http://www.galeriecharlot.com/fr/5/Jacques-Perconte
Sauf précisions contraires, les images proviennent des films de Jacques Perconte : Sassetot-Le-Mauconduit (2012) / Shining (Stanley Kubrick, 1980) et Uishet (Sans titre n° 5) (2007) / Chott El-djerid (Bill Viola, 1980) et Impressions (2012) / Sarasvaati (2001) et Annette (2009) / Promenades (1999) et Le Soleil de Patiras (2007) / Impressions.