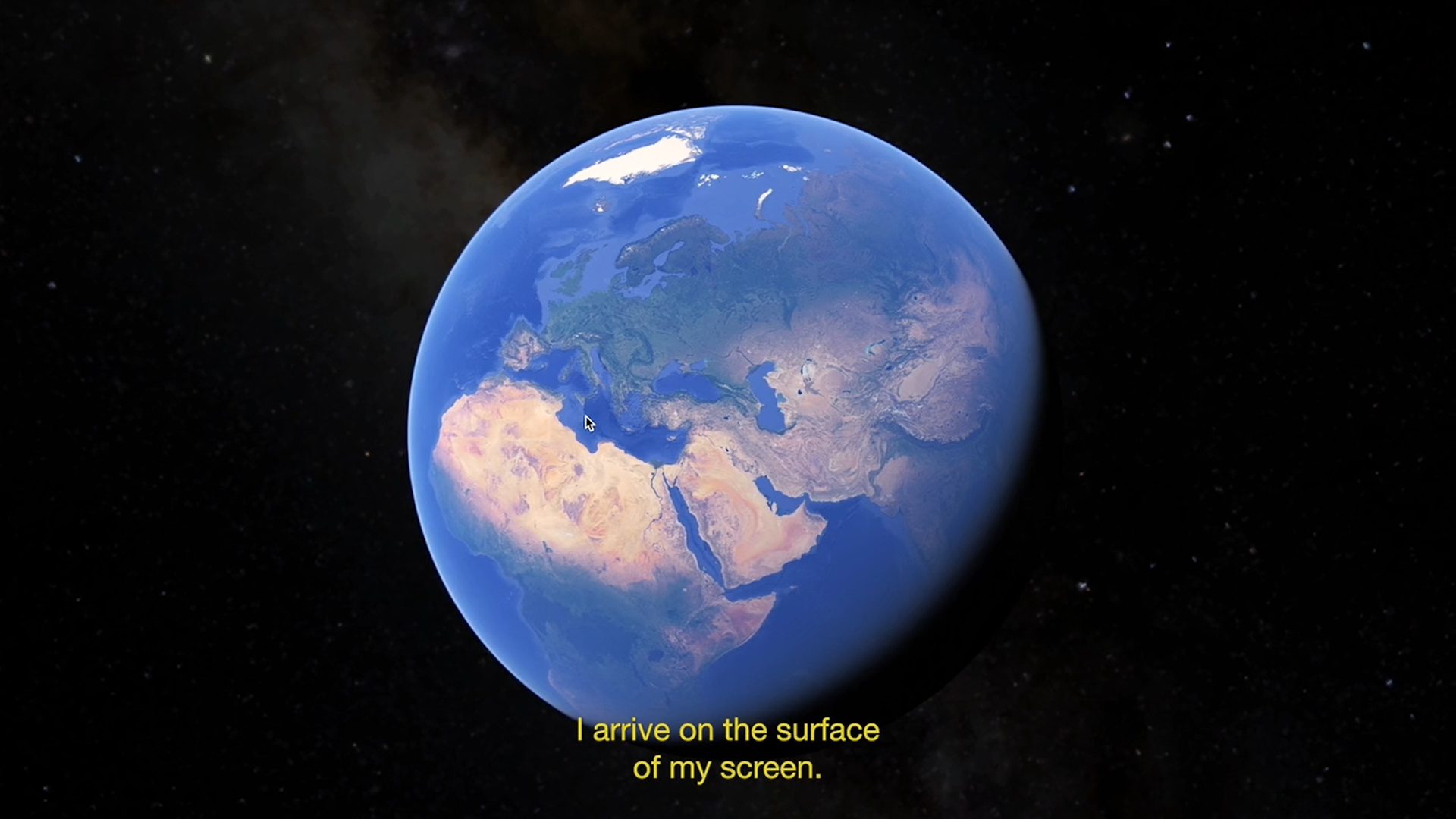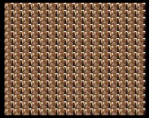Stefan Kruse (V. F.)
Description d’un combat. À propos d'A Reconnaissance
Avant-propos. Guerre globale et « média-guérilla »
Du 7 au 11 mai 2025, le festival Istanbul Experimental diffusait les dernières nouvelles d’une « média-guérilla » au long cours. Permettons que j’emprunte ce terme grandiloquent au groupe autrichien Total Refusal, qui s’est fait connaître avec ses films de machinima pseudo-marxistes (How to Disappear, 2020, Hardly Working, 2022). Deux de ses sympathiques représentants (Susanna Flock et Michael Stumpf) ont profité de la rétrospective qui leur était consacrée à Istanbul pour proposer une conférence aux accents prospectifs : quel futur pour la « média-guérilla » ?
How to Disappear, entièrement tourné dans les décors du jeu Battlefield V, posait les bases d’une pratique contre-hégémonique du jeu vidéo. Il révélait par un humour situationniste les fondements idéologiques de son gameplay. Ses cadrages réalistes (supposés prolongeables indéfiniment) se cognaient sur les limites du champ de bataille, une simulation d’horizon à jamais inatteignable : « Le paysage paraît infini, mais en réalité c’est un arrière-plan plat et vide, une toile de fond pour le tournage. » Aucune issue pour les déserteurs. Desertion cannot be played.
Que les jeux vidéo, parmi d’autres formes culturelles, aient contribué à préparer nos esprits au militarisme ambiant, personne n’en doute. Mais au contraire de l’attitude paternaliste habituelle, qui porte la critique sur l’ultra-violence et l’addiction, le collectif Total Refusal suggère une autre voie, plus empathique puisqu’elle suppose de se plonger soi-même dans les jeux, à commencer par les sorties les plus populaires, et de faire l’expérience de leur gameplay. La média-guérilla gagne du terrain sur les jeux de guerre chaque fois qu’elle parvient à dénaturaliser, un tant soit peu, les options idéologiques, individualistes, antiféministes et antidémocratiques sur lesquelles ils sont fondés. Leur recherche en cours sur Tom Clancy’s: The Division 2 prend la forme d’une balade le long de Pennsylvania avenue, du Capitole à la Maison-Blanche, pour examiner les points de tensions entre le capitalisme et la démocratie américaine. Ce jeu de tir aurait, selon le collectif, anticipé les attaques sur le Capitole de janvier 2021.
Ici, quelques éléments de contexte méritent d’être rappelés. À l’heure où j’écoutais Total Refusal dans le quartier central de Beyoğlu, les vagues de protestation suscitées par l’arrestation du maire d’Istanbul, Ekrem İmamoğlu, s’épuisaient à force d’être violemment et continuellement réprimées. Les organisateurs du festival m’ont confié que ces événements avaient monopolisé l’énergie des étudiants, qui constituent habituellement une grande part du public et de l’équipe bénévole. Le festival se trouvait relativement dépeuplé.
Au-dehors, les drapeaux turcs, parfois flanqués du portrait de Mustafa Kemal (Atatürk, père fondateur de la République de Turquie) flottaient depuis des semaines en chaque endroit de la ville, accrochés aux balcons. Plutôt qu’une démonstration de chauvinisme, il s’agissait du moyen imparable qu’avaient trouvé les Stambouliotes de contester l’arrestation du maire, sans s’exposer à une répression directe (car quel dirigeant interdirait le drapeau de sa propre nation ?).
L’expérience d’un festival est toujours faite de rapprochements, non seulement entre films, mais aussi entre la salle et son dehors. Lors de l’ouverture, un film de Davide Minotti et Valeria Miracapillo, At All Hours and None (2023), faisait le portrait d’Aslı Erdoğan, une autrice, physicienne, activiste, ancienne prisonnière politique en Turquie, qui vit aujourd’hui en exil à Berlin. Dans l’ensemble des images de la vie d’Erdoğan, hybridées par une surprenante profusion de procédés (du collage surréaliste artisanal au glitch numérique), les images des émeutes du parc Gezi, en 2013, au cours desquelles l’autrice fut arrêtée, ravivaient dans les esprits les émeutes récentes.
Le sens commun suppose une différence de nature entre les guerres du type Battlefield V, exercées sur des populations à l’extérieur, et la répression étatique que montre At All Hours and None, exercée contre la population de l’intérieur. Cette différence devient de moins en moins évidente aujourd’hui, alors que les violences extérieures et intérieures se confondent spectaculairement en une « guerre globale contre les peuples[11][11] Mathieu Rigouste, La guerre globale contre les peuples. Mécanique impériale de l’ordre sécuritaire, La Fabrique, 2025 ». Cela vaut pour la Turquie aussi bien que pour la France depuis laquelle j’écris. Mais cela est sans doute plus vrai encore d’espaces dont on ne saurait dire s’ils sont intérieurs ou extérieurs, enclaves locales de cette militarisation globale.
C’est depuis un tel espace que le dernier film de Stefan Kruse, A Reconnaissance, interroge à sa manière les images de cette guerre globale. Kruse y prolonge son travail sur les machines de vision militaires employées dans la surveillance civile (A Lack of Clarity, 2020), et sur les images de migrants traversant la Méditerranée (The Migrating Image, 2018). En cartographiant l’environnement de l’aéroport international de Malte, Kruse tourne autour d’un centre absent : l’œil du drone Heron 1, qui surveille les flux migratoires dans la Méditerranée. Fait d’images trouvées sur GoogleMaps ou tournées sur place, le film produit une expérience de confusion étrange et fascinante entre le regard physique et la déréalisation associée au regard numérique. J’ai souhaité l’interroger sur cette étrangeté.
Débordements : J’aimerais commencer par votre titre. Dans le vocabulaire militaire, la « reconnaissance » désigne le fait de recueillir des informations sur les forces ou les positions ennemies en envoyant de petits groupes de soldats ou en utilisant des aéronefs. C’est un moyen de rappeler l’origine militaire des activités d’IAI (Israel Aerospace Industries), une entreprise israélienne spécialisée dans l’aérospatiale et l’aviation qui fournit à Frontex ses technologies de surveillance. L’industrie de la surveillance faisait l’objet de certains de vos essais précédents, notamment A Lack of Clarity (2021, prix du meilleur documentaire au Istanbul Experimental, sur l’utilisation de caméras thermiques dans la surveillance nocturne). En outre, la « reconnaissance » implique une représentation spatiale : elle consiste à dessiner des cartes et à décrire des positions. Cela peut faire référence à la reconnaissance aérienne d’IAI, mais aussi à votre propre exploration du complexe militaro-industriel de Malte à travers les images satellites de Google. Quels sont les liens entre les représentations aériennes de l’espace et le complexe militaro-industriel que vous étudiez ?
Stefan Kruse : Au point de départ de ce film, il y a la lecture d’un article généraliste de Reuters, indiquant que Frontex venait d’acquérir le drone Heron 1, qui allait donc survoler la mer Méditerranée depuis l’aéroport de Malte. À ce moment-là, je réfléchissais déjà à un film centré sur le complexe frontalier européen. L’article a suscité de nombreuses questions dans mon esprit et c’est à partir de là que ma recherche sur ce phénomène invisible a commencé. L’idée m’est venue de remettre en question les structures opaques au croisement des organismes bureaucratiques transnationaux non élus et le complexe militaro-industriel.
Les articles de Reuters semblent être la principale source d’information et, pour des raisons évidentes, ils ne contiennent pas d’informations nuancées ou de questions éthiques. Ces articles représentent le statu quo et fonctionnent comme un simple contenant pour diffuser une information destinée à être copiée-collée. Ils représentent un support prétendument neutre et généralement invisible, ce qui est aussi le cas du drone. Les médias mainstream seront inévitablement des alliés du drone et de Frontex, puisqu’ils ne posent aucune véritable question. Il est donc devenu important pour moi de faire la part entre l’information mainstream et l’information réelle et pertinente. Ce fut également l’une des motivations de mon voyage à Malte. Il s’agissait simplement de trouver plus de ressources d’informations fiables.
Depuis 2017, les autorités européennes – et en particulier Frontex – s’appuient sur un réseau d’aéronefs opérés par des sous-traitants privés pour surveiller la mer Méditerranée. Alors que Frontex affirme que cette surveillance permet de sauver des vies en mer, plusieurs enquêtes ont montré qu’elle était utilisée pour fournir aux garde-côtes libyens les informations nécessaires pour intercepter les migrants. Le Heron 1 est une pièce maîtresse de l’arsenal de Frontex puisqu’il peut voler plus longtemps et plus près des côtes libyennes. L’IAI, que vous mentionniez, n’est que le fabricant des drones, tandis que la surveillance de la mer Méditerranée est orchestrée par Frontex et déléguée à de nombreuses entités différentes (Airbus, qui assure la maintenance, les forces armées maltaises, etc.). Ce complexe difficile à décortiquer fait partie de la structure bureaucratique qui entoure le drone. LIMINAL & Border Forensics ont réalisé une vidéo intitulée Asymmetric Visions qui approfondit cette dimension du Heron 1.
Étant donné que les informations sur le Heron 1 et sur les opérations de Frontex en général sont communiquées en creux et de manière limitée, j’étais constamment confronté à la question suivante : « Que suis-je en train de regarder ? » ou : « Que suis-je en train de lire ? » L’administration de Frontex n’avait aucune intention de me parler, et je me suis retrouvé avec un concept et un personnage principal que je ne pourrais jamais saisir entièrement.
Cela m’a naturellement amené à explorer différents moyens d’approcher et d’enregistrer le drone. J’ai passé la plupart de mon temps à réaliser ce film derrière mon propre écran, à faire des recherches et à enregistrer. Le point de départ de l’enregistrement du drone a été la découverte d’un site web non commercial de suivi des vols qui affichait occasionnellement le Heron 1. À partir de là, j’ai commencé à enregistrer autant de vols que possible afin de me faire une idée de comment, où et quand il volait. Il en est sorti toute une bibliothèque d’enregistrements d’écran (informations vectorielles de suivi de vol), dont une grande partie a fini dans le film.
Des rapports ont fait état de drones du même type que le Heron 1 patrouillant, surveillant ou terrorisant les citoyens de Gaza et de Libye. Il n’est pas anodin que Frontex et, par conséquent, l’Europe se dotent d’un tel drone. Il me semble qu’ils étendent ainsi la violence exercée sur les populations gazaouies ou libyennes à l’ensemble de la Méditerranée. En camouflant cette violence sous un masque humanitaire, ils étendent l’espace aérien opérationnel de l’Europe. Il s’agit quasiment d’un cheval de Troie bureaucratique. Comme vous le mentionnez, le mot « reconnaissance » fait souvent référence à la collecte de données en territoire ennemi et il semble que les politiciens, les militaires et les fabricants de technologies de surveillance décident toujours de ce qui est qualifié de « territoire ennemi ». C’est ce que je voulais remettre en question avec le titre.
La « reconnaissance » peut également faire référence à l’approche narrative et subjective d’un pays et de son paysage que j’assume en réalisant ce film. De plus en plus, je vois le film comme une « reconnaissance » de l’époque dans laquelle nous vivons, et le drone Heron 1, son fabricant, son histoire et son opération en mer Méditerranée comme un symptôme de la violence et de la guerre qui traversent tous les éléments de la société occidentale en 2025. Un condensé de guerres sans fin et de sociétés de plus en plus surveillées, rationalisées par des idées creuses de liberté et de rationalité, d’un État en basse tension conduit par la logique du capitalisme mondial et qui supprime lentement les éléments humains de son équation. Le montage du film devait assumer une forme abrupte.
Je crois que nous sommes le plus souvent invités à penser aux événements de l’actualité comme séparés dans le temps et non reliés entre eux. Dans ce film, je voulais au contraire créer un réseau entre tous les différents éléments que j’ai rencontrés et insister sur le fait qu’ils se reflètent d’une manière ou d’une autre les uns les autres. J’ai abordé Malte et le drone de Frontex comme un microcosme représentant une violence systémique presque invisible, camouflée en progrès ou en utilisation légitime de la technologie. Le paysage entourant le drone, qu’il s’agisse des casernes militaires britanniques abandonnées que Frontex occupe désormais, du tourisme de masse ou des carrières de calcaire désertes qui attendent d’être remplies de déchets de démolition provenant d’une économie soi-disant florissante, tout cela renvoie à la même mentalité dans une certaine mesure. Je crois que c’est une logique similaire à celle de Harun Farocki, dont l’œuvre est centrée sur le lien inévitable entre la construction et la destruction.
Après avoir mené des recherches sur ce sujet pendant de nombreuses années et parlé de mon projet à de nombreuses personnes, j’ai l’impression que la plupart des gens n’ont aucune idée, ou très peu, des activités de Frontex et de la militarisation accélérée des frontières européennes depuis la soi-disant crise migratoire. Ce qui, à bien des égards, est tout à fait compréhensible. Je me suis également rendu compte que cela créait des interprétations intéressantes du film. Au point que certains spectateurs pensent qu’il s’agit d’un film de science-fiction construit à partir d’éléments fictifs et inventés.
Je crois que c’est aussi ce qui semble créer une réaction négative ou instinctive dans une partie du public. Il y a une frustration qui est liée au manque de connaissance. Toutes les informations contenues dans ce film sont déjà librement accessibles à tous, mais, en même temps, le film donne peut-être l’impression de révéler quelque chose de confidentiel. À l’instar de ce que je cherche moi-même à faire, le public veut des réponses. Il veut que cela vaille la peine de consacrer du temps à ce film.
L’essentiel de ma pratique cinématographique réside dans la création de contre-images et de contre-récits, autant d’alternatives au flux d’information conventionnel et répétitif et à certaines tendances du cinéma contemporain. Surtout, il est devenu important pour moi que le film contienne les sentiments ou les sensations que j’ai éprouvés lors de sa création. D’une certaine manière, j’ai essayé de rester fidèle au processus de création en soulignant le sentiment d’égarement que l’on éprouve en essayant d’atteindre une agence invisible. Un film qui se dérobe constamment ou qui prend une nouvelle forme. Une tentative arythmique de donner un sens à quelque chose qui n’en a pas.
Je crois en un cinéma politique qui parvient à l’introspection, qui réfléchit à son propre regard et à ses moyens d’existence dans le monde moderne et, par conséquent, à ses propres lacunes et défauts. Je cherchais une forme cinématographique qui ne succombe pas à la tentation de se renfermer sur elle-même et de se réduire à un récit de propagande, même si elle traite d’un sujet hautement politique. En ce sens, je considère également la forme d’un film comme un moyen de résister à une certaine logique de marché à laquelle un film est inévitablement confronté. Comme Pietro Bianchi le laisse entendre dans son récent essai publié sur e-flux « Cannes 2025 Dispatch, Pt. 1 : The Word, the Image, and the Phantasm », il existe également une certaine obsession grandissante dans le monde des festivals de cinéma et du streaming, centrée sur la question : « De quoi parle le film ? »
Ceci étant dit, je suis prudent lorsqu’il s’agit de parler de l’art et du cinéma comme d’un moteur de changement réel. Il me semble que ce discours est exploité par les institutions artistiques, les financeurs et les artistes, qu’il crée par conséquent des discours étranges et des bulles de bien-être. Cela nous fait du bien à l’estomac quand nous le disons, mais il est peut-être temps de nous libérer de cette illusion. Pour citer un récent post Instagram de@Freeze_magazine, le monde de l’art part du principe que l’art est intrinsèquement influent sur le plan politique. Que cela ait été vrai un jour ou l’autre, il est clair que cette époque est révolue. Le problème n’est pas le désir de pertinence, mais le refus d’affronter les limites de ces tactiques. Elles ne fonctionnent plus aujourd’hui – si tant est qu’elles aient jamais fonctionné. Nous sommes dans un paysage façonné par la manipulation émotionnelle et la propagande douce. Ce dont nous avons besoin, ce n’est pas d’un moralisme plus fort, mais d’une réflexion plus fine, de stratégies pragmatiques et d’un espace où l’on peut exprimer des désaccords sans se déchirer.
D. : Votre film s’ouvre sur un échec : un message de FRONTEX refusant de vous donner accès à la « tente blanche », l’endroit où est stationné le Heron I, drone de l’IAI.
S. K. : Oui, c’est un échec dans le sens du « glitch » qui ouvre une porte sur le film.
D. : Dès le début, on vous défend de voir directement dans « l’œil du drone » et on vous rejette à la périphérie des activités de l’IAI. Vous soulignez cette position périphérique en utilisant des médiations : la surface de votre écran pour les images Google, et la maille de l’aéroport pour les images que vous avez prises sur place. L’espace n’est perçu qu’à travers des obstacles visuels ou des modèles numériques. Quel était l’intérêt de créer un tel mystère autour d’un espace réel qui resterait inaccessible ? Et pourquoi est-il pertinent d’enquêter sur l’environnement de l’aéroport plutôt que d’entrer dans ses espaces interdits ?
S. K. : L’hypothèse est que le drone est un symptôme d’un problème plus important. Le problème fondamental de notre époque, dont nous ne pouvons jamais parler parce qu’un voile apparaît systématiquement et nous distrait.
C’est une position un peu méta, mais en regardant le film maintenant, j’ai le sentiment que le sujet (moi en train d’essayer de faire le film) essayait inconsciemment de briser les écrans qu’il rencontrait. Les écrans et les barrières auxquels il est constamment confronté. La surface plane qui le désillusionne et l’immobilise, malgré sa promesse d’une vision divine du monde.
À notre époque, chaque organisme ou agence a besoin de cet écran pour se promouvoir ou se défendre. Cela vaut aussi bien pour Frontex que pour l’organisation locale des observateurs d’avion Military Aviation Reachout, que j’ai rencontrée. L’écran maintient les apparences et permet que tout reste à sa place. Il utilise une terminologie creuse et un langage visuel qui occulte ce qui se passe véritablement derrière lui. Cela me rappelle beaucoup le langage que nous sommes forcés d’adopter pour être éligibles aux bourses et aux résidences. Sans doute la dernière scène du film est-elle l’aboutissement de cette tentative ratée de traverser ou d’éliminer ces écrans, qui culmine dans une mort digitale et conceptuelle. La mort d’une approche qui, selon moi, aboutit nécessairement à l’échec ou l’épuisement.
En un sens, le film est aussi une tentative de décomposer la structure bureaucratique complexe autour du Heron 1. De l’étaler aux yeux du monde dans l’espoir de la dissoudre. Arriver physiquement à Malte était le seul moyen de sortir de l’écran. Une issue à ma propre bulle conceptuelle et à l’idée de ce que ce film devrait être et une tentative de m’ancrer et de relier tous les fragments d’information sur le drone : Frontex, IAI, l’équipe allemande d’Airbus, etc. Je crois que je voulais une expérience en première personne. Voir l’ensemble de l’appareil de mes propres yeux.
À mon avis, c’est ce genre de structure bureaucratique qui maintient le statu quo en prétendant à une position de supériorité rationnelle. Plus on pourra collecter de données, mieux ce sera. Plus il y aura de caméras de surveillance, plus nous nous sentirons en sécurité. C’est ce genre de rhétorique qui nous éloigne de plus en plus, polarise de plus en plus la situation et crée un manque d’empathie grandissant pour les réfugiés noyés dans la mer Méditerranée ou les personnes bombardées et éradiquées en Palestine. Cette violence est bien camouflée et la voix autoritaire d’une pensée rationnelle nous induit à penser que c’est cela la bonne procédure. C’est par essence une rhétorique motivée par le marché.
D. : Dans A Lack of Clarity, vous avez utilisé des images de caméra thermique dans le but d’enquêter sur les technologies de surveillance nocturne. Ici, il semble que vous ayez utilisé la même technologie pour les plans tournés à Malte. L’image thermique, en noir et blanc, associée à un sound design très complexe, provoque un sentiment de défamiliarisation. Même à la fin du film, alors que l’arrivée du Heron 1 est filmée, pour la première fois, sans le grillage de l’aéroport en amorce, la nature de l’image jette un doute sur l’objet visuel lui-même. Comme le dit le commentaire : « Qu’est-ce que je regarde ? » Qu’est-ce qui vous intéresse dans l’imagerie thermique ? Qu’est-ce que cela a affaire avec l’idée de « désincarnation » (disembodiement) associée au regard numérique ?
S. K. : J’étais guidé par l’idée que la distinction entre l’enregistrement d’un écran numérique et les images filmées sur place pouvait être brouillée. Un monde dans lequel on devrait interroger chaque image que l’on croise. Quelque chose qui, en général, pourrait être appliqué plus souvent. Un regard dans lequel le numérique et le « physique » (disons cela, faute d’un autre terme) se fondent lentement l’un dans l’autre. Une frontière qui, peut-être, a déjà disparu dans ma propre vie. Entre les deux opposés que sont l’obscurité totale et l’illusion, ces images thermales peuvent tromper et clarifier.
D. : Votre utilisation de Google Earth et Street View est très intéressante. Il ne s’agit pas simplement d’un substitut à votre exploration de l’environnement de l’aéroport de Malte : vous en faites une sorte de machine à voyager dans le temps. Toutes les images de Street View sont associées à un « watermark » (une empreinte superposée à l’image supposée assurer son authentification et empêcher son détournement de la propriété intellectuelle). Ces « watermarks » mentionnent la date de leur enregistrement. Chaque espace devient alors une superposition de différentes versions, enregistrées à différents moments, et entre lesquelles vous naviguez.
Google Maps est devenu un moyen pour moi de visiter, puis de revisiter, un lieu dans lequel j’avais passé de nombreuses heures. Google Maps est en définitive un collage imparfait et hypnotique, et peut-être la meilleure expérience de seconde main (via l’écran) qui existe. Durant cette période, j’ai passé la plupart de mes heures de veille dans cette matrice de montage, guettant les glitchs et les vides. Certains d’entre eux étaient des watermarks avec des indications temporelles, et je me suis rendu compte que ces indications changeaient de manière aléatoire en fonction de mon emplacement. Ils passaient même de 2019 à 2016 lorsque je me déplaçais d’une cinquantaine de mètres, comme vous le voyez dans le film.
Google Maps charrie la même promesse que la technologie des drones : une vue quasi divine 24/7 de la Terre depuis une perspective verticale. Un sentiment de pouvoir et l’acquisition de la connaissance, en seulement un clic. J’ai voulu explorer ces parallèles entre l’infrastructure de l’Internet, le drone et mon propre comportement en ligne pendant la fabrication du film. Adopter une position similaire à celle du pilote de drone (en restant loin de ma cible) m’a amené à me poser une question (que j’ai gardée dans la voix off) : « Est-ce que je peux encore saisir le présent ? »
D. : Vous avez enregistré vos conversations avec les locaux au son seulement. Pourquoi ne pas les avoir filmés ? Comment avez-vous pensé le son du film ?
S. K. : Comme le film prend place dans un non-lieu en dehors de l’aéroport international de Malte, je voulais aussi approcher l’espace sous différents angles. Ces genres d’espaces fonctionnent aussi comme des brèches dans la violence qui caractérise le XXIe siècle, dont je parlais plus tôt. Ils sont le résultat du capitalisme numérique mondial. Ils ne sont pas faits pour des êtres humains. Passer du temps dans un tel espace devient aussi une façon de se l’approprier. Occuper et écouter comme un moyen de contrer sa vocation de stockage et de transit.
Pour le design sonore général du film, nous avons créé une bibliothèque de sons à onde courte. Cela a été rendu possible par un site web qui permet d’écouter et de contrôler un récepteur d’ondes courtes situé au club de radio amateur ETGD à l’Université de Twente. Contrairement à d’autres récepteurs, celui-ci peut être commandé par plusieurs utilisateurs en même temps, ce qui signifie également que mon sound designer Asbjorn Derdau et moi avons intégré une autre communauté similaire à celle des observateurs d’avion. Ces enregistrements ont servi de toile de fond pour tout le design sonore du film.
En plus de l’idée d’observer l’environnement immédiat qui entoure Heron 1, j’ai aussi trouvé pertinent d’enregistrer les gens que nous rencontrions, qui quotidiennement errent autour de l’aéroport près du drone. Nous partagions cet espace avec les observateurs d’avion et nous avions en commun le fait de pointer nos caméras vers l’aéroport et ses engins. Nous avons rapidement lié amitié avec ce groupe, qui s’est avéré être une source précieuse d’informations. Ils m’ont encouragé malgré le fait qu’ils ne s’intéressaient pas directement au drone. Au deuxième jour du tournage, quelqu’un nous a donné (à moi et à mon collaborateur Asbjorn Derdau) les horaires de vol pour les trois jours suivants. Cela m’a amené à m’intéresser au savoir-faire de la communauté locale, comme un moyen de contrer la forme de plus en plus surveillée et opaque de l’État moderne. Le hasard des interactions humaines comme brèche pour contourner le complexe de la surveillance. Peut-être même une mentalité insulaire décontractée comme bouclier ou comme camouflage par rapport au système.
Je ne souhaitais pas les montrer à l’écran parce qu’il était important pour moi que l’œil du film soit rattaché (autant que possible) à celui du drone. En « mode suivi » (« tracking mode »), comme on dit pour les caméras militaires. Montrer les visages et les corps de ces gens serait une trop grande distraction par rapport à la forme que le film a prise. Donc garder cette distraction sonore était un moyen de les inclure dans le film tout en gardant à l’image le travail manuel de maintenance du drone effectué par l’équipe d’Airbus.
En ce sens, j’étais aussi intéressé par l’idée d’inclure la matérialité et la force de travail que cette opération requiert. Souvent, quand on lit des choses sur les nouvelles technologies de surveillance des frontières (et qu’on est exposé à leur matériel promotionnel), on a l’impression que cela existe et fonctionne de façon entièrement automatisée. De la même façon que nous sommes poussés à penser à Internet comme quelque chose qui existe dans les nuages et pas aux serveurs physiques qui requièrent de l’électricité, du travail physique, etc. C’est pour cette raison que j’ai inclus les communications radio entre le pilote du Heron 1 et le contrôle de la circulation aérienne. Les enregistrements donnent un petit aperçu d’une erreur technique qui oblige à faire atterrir le drone pour une inspection approfondie. Cela est devenu intéressant en ce qui concerne les soi-disant heures de vol réussies, qui semblent être l’une des principales raisons de l’opération de surveillance de masse.
Il est important de noter que les plane spotters (observateurs d’avions) ont aussi été les seuls êtres humains avec qui j’ai réussi à entrer en contact et à interagir. Ils représentent un élément humain, une interaction humaine détachée du monde numérique, d’Internet et des réseaux sociaux, qui – dans leur état actuel – finiront inévitablement par nous éloigner de moments inattendus comme celui-ci et perpétuer l’apathie générale. En même temps, les plane spotters incarnent aussi des regards indifférents au drone et à la politique qui l’entoure. Le drone ne les intéresse pas, ni eux ni leur communauté. Ils représentent donc aussi le détournement du regard, celui du passant ordinaire. Dès qu’un autre avion commercial de type Airbus décollera, leurs yeux se détourneront inévitablement, et le monde continuera son cours habituel.
En ce sens, ils représentent aussi une part de moi-même. Même si je m’efforce de regarder le drone et la tente blanche dans laquelle il se trouve, il a été constamment difficile de m’y accrocher et de construire une narration autour de lui. Le film opère dans cette zone grise, ce non-lieu, qui ne remonte jamais vraiment à la surface. Frontex, en tant qu’entité entre armée et police. Le complexe militaro-industriel et la production d’images commerciales qui lui est liée. Malte, une île située entre les continents européen et africain. Le Heron 1 comme symbole d’une dissolution de la frontière entre la paix et la guerre.
Je suis fasciné par ces fissures, ces marges du monde moderne. Ce sont des points de départ difficiles pour un projet de film, car il y a un risque élevé que cette position se dissolve une fois le film passé dans la machine à pitcher. Dans une société de plus en plus obsédée par l’étiquetage, ces zones ou ces sujets sont peut-être les derniers refuges face aux algorithmes d’IA omniprésents. C’est une hypothèse naïve, mais je pense qu’il y a quelque chose à apprendre dans ces espaces intermédiaires. La bureaucratie qui leur est liée est trop complexe et « ennuyeuse » pour que nous nous y accrochions. Elle est non sensationnelle et, par conséquent, aussi invincible qu’évidente. Ainsi, dans une tentative de créer des films intéressants en utilisant ces éléments comme des personnages, j’encouragerais toujours une attitude qui résiste à la question inévitable, dictée par le marché : « De quoi parle ce film ? »