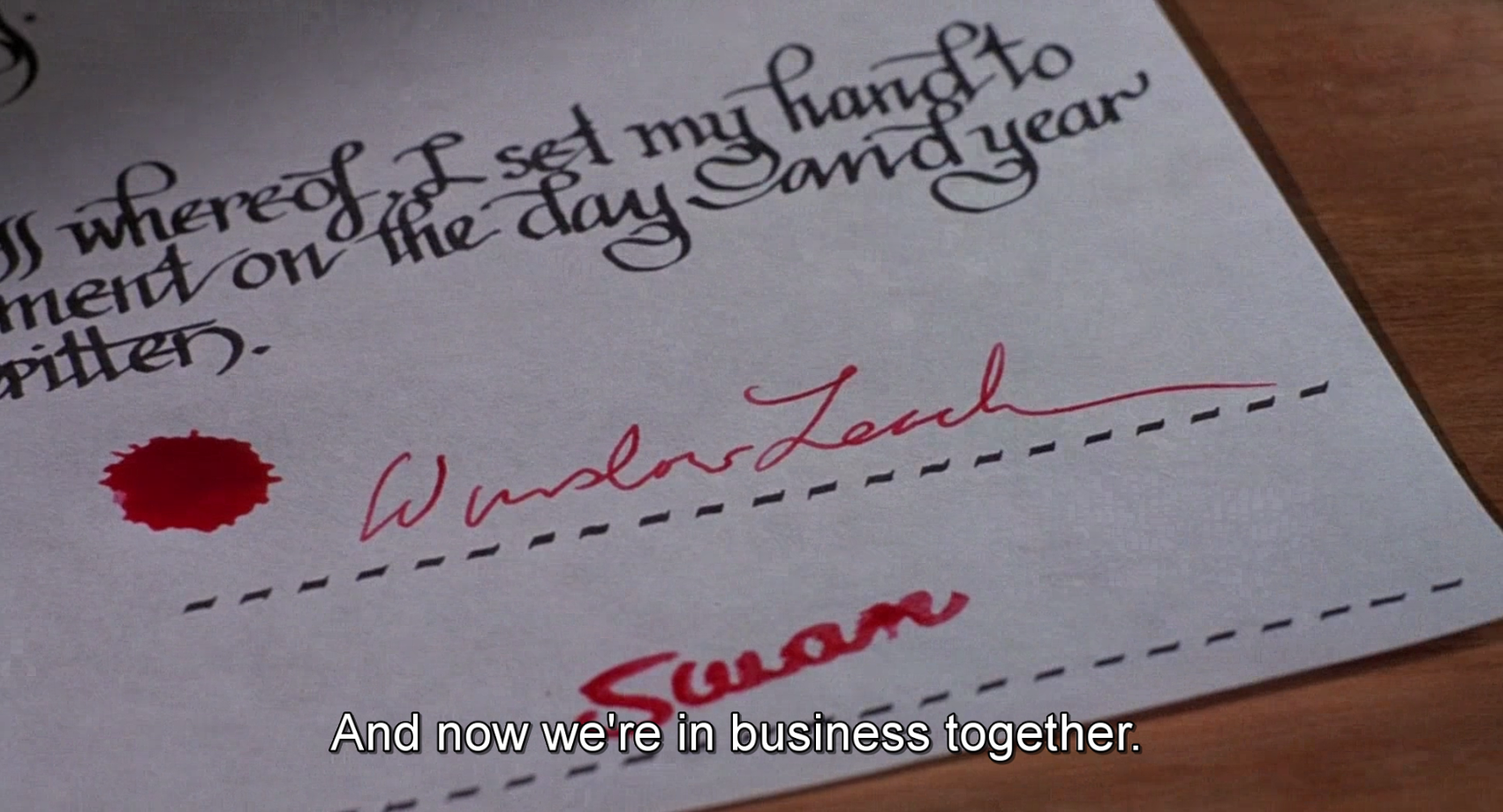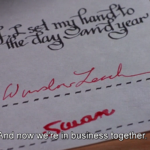Histoires du Diable
Lettre de Vilem Flusser à Felix P. Ingold (et réponse de Jean Epstein)
En 1965 à Sao Paulo, Vilem Flusser publie A história do diabo en portugais. En 1983, il adresse à son ami Felix Philipp Ingold une lettre résumant l’ouvrage en allemand, dix ans avant la traduction posthume qu’en proposera la revue European Photography, alors basée à Göttingen : Die Geschichte des Teufels.
Le quatre mars prochain paraîtra aux éditions Exils Histoire du diable en français.
À la lecture du courrier allemand[11][11] Daniel Irrgang, « Die Briefe zwischen Vilém Flusser und Felix Philipp Ingold, 1981–1990 », Flusser Studies 20, décembre 2015., il est frappant de constater les échos qui existent entre le diable historiographique de Flusser et le diable cinématographique d’Epstein, surtout si l’on considère le succès que rencontrent les deux penseurs au sein de la théorie des média et des études visuelles françaises contemporaines [22][22] On songera évidemment au numéro de la revue Multitudes (2019/1, n°74) consacré pour partie à l’étude et à la traduction de travaux de Flusser, mais aussi au récent Puissances du végétal. La vitalité révélée par la technique, dirigé par Teresa Castro, Perig Pitrou et Marie Rebecchi aux Presses du Réel (2020) placé sous le patronage de Jean Epstein, au deuxième tome de Penser l’image intitulé Anthropologies du visuel aux Presses du réel également (2015) dans lequel Emmanuel Alloa donne une traduction de « L’image-calcul » de Flusser, à l’ouvrage collectif Indefinite Visions (Martie Beugnet (dir.), Edinburgh University Press, 2017) dont l’introduction consacrée au motif de la vague et du flux cite tour à tour les deux penseurs, à la journée d’étude Techno-images. Configurations visuelles et média tenue en 2019 à l’Université Paris 1, à l’exposition Time Machine. Cinematic temporalities dont le commissariat était assuré par Antonio Somaini et Marie Rebecchi en 2020 ou encore au texte publié par Jérémie Brugidou dans Trafic à l’occasion de sa soutenance de thèse (« Vers une écologie de l’apparition », Trafic n°115, septembre 2020), où se croisent la photogénie epsteinienne et le Vampyroteuthis Infernalis de Flusser (pour la traduction française, V. Flusser et L. Bec, Vampyroteuthis Infernalis, Ch. Lucchese (trad.), Bruxelles, éditions Zone Sensible, 2015).. Nous avons donc souhaité mettre en relation les deux auteurs, le temps d’un échange épistolaire imaginaire.
Vilem Flusser à Félix Philipp Ingold, 8 février 1983
Je définis Dieu comme la tendance générale à l’entropie, à l’aléatoire, au chaos (uniformisation, mort thermique, inertie) et « Diable » comme ce que l’on oppose à « Dieu » du fait de sa tendance antagoniste à l’entropie négative, au déterminisme, à l’ordre (à l’information, à l’histoire). Par conséquent, « Dieu » est anhistorique et l’on ne saurait faire son histoire. (Impossibilité de la théologie). Une histoire du « Diable » est quant à elle possible et apparaîtrait comme un épicycle superposé à « Dieu ».
Dans la mesure où l’Église catholique a longuement et minutieusement pensé la question du « Diable », je propose d’employer ses propres catégories en vue d’écrire une histoire diabolique. Mais dans la mesure où l’Église ne considère que les aspects négatifs du « Diable » (ne prenant en compte que la conséquence néfaste de l’entropie négative dans le deuxième principe de la thermodynamique et sa nécessaire réversibilité), balayant tous ses aspects positifs, les catégories ecclésiastiques doivent être neutralisées avant que nous ne puissions les utiliser. Par exemple : plutôt que d’employer le mot « péché », nous disons « volonté libre ». Ainsi, « peccare posse = une volonté libre en puissance », « non peccare non posse = relativité » et « peccare non posse = révision de la volonté libre ».
Comme principe directeur de l’histoire diabolique, je prends les sept « péchés mortels », car le péché et la mort (liberté et destruction au sein du chaos) ont historiquement reçu le nom de « Diable » pour les caractériser. Et je classe ces sept péchés suivant un ordre ontologique. Il s’avère que j’ai besoin, dans un premier temps, d’un péché que l’Église ne cite pas, à savoir celui grâce auquel l’univers physique a pris forme. Voici la structure du livre :
1) Le péché originel : le Diable en joueur aux pouvoirs trop complexes : physique nucléaire, astronomie, macro-physique, chimie, origine du monde.
2) La luxure : le Diable en amant : le développement des organismes avec le but anti-divin de conserver et de développer davantage l’individu et l’art.
3) La colère : le Diable en combattant : la dialectique entre, d’une part, l’esprit négatif de la nature et ses lois, et, d’autre part, le hasard.
4) L’envie et l’avarice : le Diable en « bâtisseur de villes » (civitas humana). Dialectique entre « envie » (à gauche) et « avarice » (à droite) et leurs différentes synthèses historiques. Histoire économique, sociale et politique.
5) L’orgueil : le Diable en créateur : naissance d’univers abstraits, de l’art, de la science, de la religion, des idéologies. L’histoire des « modèles ».
6) La paresse et les tristesses du cœur : le Diable en autocritique : la philosophie, qui conduit en définitive à l’analyse des systèmes symboliques et surtout à l’analyse du langage. Et finalement, ce « péché » ramène à « Dieu », décompose la matière et l’énergie en champs, l’esprit en bits et le système en chaos. Le « péché » se décompose en « Dieu », le probable engloutit l’improbable, fin de l’histoire.
En guise de post-scriptum je pose la question : la culture occidentale n’est-elle pas la seule culture historique, la seule culture démoniaque, et l’Extrême-Orient n’anticipe-t-il pas justement la rechute actuelle en « Dieu » ?
Le Cinéma du Diable, Jean Epstein, 1947
Dans cette mentalité médiévale, dont tout n’est pas oublié, le Diable apparaît comme le grand inventeur, le maître de la découverte, le prince de la science, l’outilleur de la civilisation, l’animateur de ce qu’on appelle progrès. Aussi, puisque l’opinion la plus répandue tient le développement de la culture pour un avantage insigne, le Diable devrait être surtout considéré comme un bienfaiteur de l’humanité. Mais la foi n’a pas encore pardonné le divorce qui l’a séparée de la science et celle-ci reste suspecte au jugement des croyants, souvent maudite, œuvre impie de l’esprit rebelle. […]
Plus précisément, le Diable se trouve accusé d’avoir continuellement renouvelé l’instrumentation humaine. De fait, les outils ont exercé une influence décisive sur cette évolution de la pensée, au cours de laquelle la cosmogonie s’est dressée contre la théologie. La règle est générale : chaque fois que l’homme crée, à son idée, un instrument, celui-ci, à son tour et à sa manière, refaçonne la mentalité de son créateur[33][33] Jean Epstein, « Accusation », Le Cinéma du Diable, in L’Intelligence d’une machine, Le Cinéma du Diable, et autres écrits [1947], Écrits complets vol. V 1945-1951, Nicole Brenez, Joël Daire, Cyril Neyrat (dir.), Paris, Independencia éditions, 2014, p. 100..
En somme, les symboles Dieu et Diable représentent, chacun, un vaste groupe de valeurs multiples. Cette double complexité ne nous paraît plus exactement divisible selon les deux vieilles catégories du bien et du mal, aujourd’hui partout emmêlées. Tantôt bon, tantôt mauvais, Dieu est la force de ce qui a été, le poids de l’acquis, la volonté conservatrice d’un passé qui entend perdurer, immuable dans le présent et dans l’avenir. Dieu est la tradition, la coutume, la loi, qui se prétendent inamovibles parce qu’appuyées sur des postulats ancestraux, sur des mythes archimillénaires, si profondément enracinés dans la pensée qu’ils y font figure d’évidences, de données immédiates de la conscience. Dieu est la raison, appelée enfin, quoique à contre-cœur, au secours de la foi affaiblie, afin de maintenir la règle qui endigue le cours aventureux du développement humain. Tantôt mauvais, tantôt bon, le Diable personnifie l’énergie du devenir, l’essentielle mobilité de la vie, la variance d’un univers en continuelle transformation, l’attrait d’un avenir différent et destructeur du passé comme du présent. Cette incessante démarche vers la nouveauté semble purement anarchique, car elle ne s’inféode à aucun ordre, les employant tous selon ses besoins et en créant d’inédits, les rejetant tous quand ils deviennent inutiles ou gênants, même celui de la raison. Qu’importe la voie ou l’instrument, ce qui compte, c’est de vivre davantage, d’éprouver et de connaître plus, de découvrir à chaque fois du visible dans le non-vu, de l’audible dans le non-entendu, du compréhensible dans l’incompris, de l’aimable dans le non-aimé. Par deux fois, dans le texte inspiré, Dieu proclame qu’il se nomme « Je suis », qu’il est « Celui qui est ». Il affirme ainsi qu’il signifie la permanence, sans laquelle rien ne saurait être. Mais la permanence seule ne nous serait d’aucune réalité. Un univers absolument constant serait un monde non pas même mort, mais nul et non avenu. L’existence, c’est-à-dire l’action, naît dans le conflit de la permanence et du devenir. Dès que Dieu prétendit cesser de créer, d’agir, son œuvre eût été vouée au non-être, si elle n’avait continué à recevoir la vie, c’est-à-dire le mouvement, d’une autre source, du devenir. Dans cette puissance ennemie du repos, négatrice de l’achèvement, reconnaissons l’autre principe, diabolique, de tout phénomène [44][44] Jean Epstein, « Permanence et devenir », Le Cinéma du Diable, op. cit., p. 108-109. Consultable en ligne..