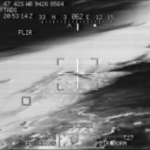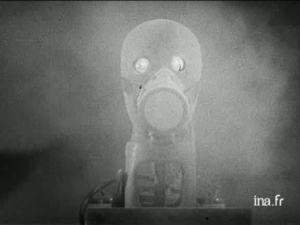Il n’y aura plus de nuit, Eléonore Weber
Essayer de voir
Ce n’est pas le jour, mais ce n’est pas non plus la nuit. C’est une zone intermédiaire pâle et grisâtre, un peu floue, une sorte de crépuscule artificiel, une obscurité diurne. En surplomb, le regard explore cette zone aliène, lunaire, en suivant les mouvements de silhouettes aux contours vagues, lumineuses contre le fond blême. En bas, des éclats scintillent, indistincts, comme des étincelles. Et, en off, une voix féminine : « On ne distinguera que des silhouettes, mais on ne verra pas le visage des gens. Il n’y aura plus de réciprocité, plus de face à face ». Un nuage de lueurs flotte dans une course presque chorégraphiée – sans doute un groupe d’animaux, peut-être un sanglier avec ses marcassins. On se laisserait emporter dans une rêverie esthétique abstraite, mais les chiffres qui entourent le cadre et, surtout, la cible en son centre, nous empêchent d’oublier l’origine militaire de ces images. On pourrait alors se croire dans un jeu vidéo, first-person shooter : au premier abord, rien ne nous permettrait de distinguer ces images de celles d’une création vidéoludique, plus vraisemblables que réelles. Ces squences semi-nocturnes, d’ailleurs, circulent sur YouTube à côté des enregistrements de parties devenus aujourd’hui une sorte de genre audio-visuel à part entière. Miracle égalisateur de la plateforme où tout peut être regardé, tout fait clip et trouve donc son public. Les gamers diffusent ainsi leurs exploits comme les soldats du film, qui partagent les captations en vue subjective de leurs missions censées plutôt demeurer confidentielles. C’est sur YouTube que l’artiste Éléonore Weber découvre et récupère les images de nombreuses opérations militaires aériennes : celles que la France comme les États-Unis mènent la nuit au Proche Orient, à la faveur de caméras thermiques et infrarouges qui dissolvent – mieux, diluent – le noir en quête de « terroristes ». Elles constituent la matière visuelle d’Il n’y aura plus de nuit que la cinéaste aurait présenté en mars au Cinéma du Réel, annulé à cause du confinement. Il a été accessible, en revanche, pendant une semaine sur la plateforme SVOD Tënk, alors que le désengagement rapide acté par l’administration Trump de ces mêmes territoires instables (voir le pacte avec les Talibans signé fin février) s’accompagne du rapatriement de troupes occidentales pour cause d’urgence virale.
Ces images n’appartiennent pas au cinéma, puisqu’elles sont produites par la machine de guerre. Ou bien, si elles appartiennent au cinéma, c’est qu’on postule avec Virilio qu’entre celui-ci et l’univers militaire il y a une familiarité ancrée dans une longue tradition logistique où convergent développement technique, intérêts stratégiques et investissements financiers[11][11] Paul Virilio, Guerre et Cinéma I. Logistique de la perception, Paris, Cahiers du Cinéma, 1991.. Les objets visuels repris par la cinéaste jouxtent le domaine des images qu’Harun Farocki appelle « opérationnelles » : à savoir des visualisations machiniques dont le but serait plus immédiatement opératoire qu’informationnel ou esthétique. Issues par exemple de dispositifs de vidéo-surveillance ou de missiles téléguidés, ces images s’inscrivent dans un périmètre instrumental et visent essentiellement à faire et aussi à faire faire, pas nécessairement à voir, ni à être vues. Au travail de Farocki nous renvoie leur traitement par Éléonore Weber qui métabolise cinématographiquement de tels matériaux à travers une procédure d’exposition et d’observation critiques. Par ces gestes, Il n’y aura plus de nuit s’installe dans le champ d’un cinéma de montage qu’on pourrait définir comme « analytique », selon une célèbre formule du duo de cinéastes italo-arméniens Yervant Giannikian et Angela Ricci Lucchi[22][22] Yervant Giannikian et Angela Ricci Lucchi, Notre caméra analytique, Paris, Post-Éditions, 2015.. Un « cinéma analytique » tâche de montrer à l’intérieur d’un dispositif attentionnel cinématographique – et donc de soumettre à l’analyse esthétique et spéculative des regards – des images destinées à d’autres usages : des journaux de voyage amateurs aux captations de l’aviation militaire. Évidemment, le premier spectateur attentif de ces éléments visuels est le cinéaste qui les extrait de leur flux ou de leur latence, par un déplacement vers un espace où ils peuvent faire l’objet d’une expérience analytique et d’un agencement créatif. Dans le montage d’Éléonore Weber, les captations d’opérations « chirurgicales » sont ainsi exposées et, en même temps, mises à distance, notamment par la couche sonore en off qui complique les niveaux d’observation. Au premier degré du regard appareillé d’un soldat – enregistré en direct pendant une mission militaire – se superpose le point de vue de la réalisatrice qui accompagne le film par ses commentaires, doublé lui-même par les réactions d’un pilote de l’armée confronté à ces scènes par la cinéaste et dont elle se fait porte-parole. La dernière couche de ce système de regards enchâssés est, bien entendu, celle du spectateur qui explore les strates de l’image, en naviguant à travers ces différents degrés et les possibles identifications.
Si le paradigme originaire de l’appareil cinématographique – du moins, selon une tradition théorique très importante – consisterait en la puissance réceptive du monde extérieur tel qu’il est véhiculé par la lumière, ce principe est totalement subverti par les caméras opérationnelles dont les hélicoptères d’assaut sont dotés. Leurs capacités de rendre visible (malgré l’absence d’éclairage) dessinent un outil à images projectif et génératif en temps réel à l’encontre du modèle traditionnel, réceptif et en décalage. Ces instruments incarnent, en ce sens, l’impasse atteinte par la tradition de l’objectivité mécanique-chimique des appareils argentiques lorsque le relais est pris par la technique digitale de captation, fondée sur des programmes numériques qui ordonnent d’une manière productive le visible selon une grille prédisposée par le sujet[33][33] Voir à ce sujet : Jean Louis Comolli et Vincent Sorrel, Cinéma, mode d’emploi, Paris, Verdier, 2015.. Dans ces images, l’idée d’un « inconscient optique » dévoilé involontairement et a posteriori par la caméra – décrit et revendiqué maintes fois dès les premières décennies du cinéma : de Benjamin à Epstein – est ainsi renversée[44][44] La notion benjaminienne d’inconscient optique est évoquée dans la présentation du film par le programmateur du Cinéma du Réel Jérôme Momcilovic.. D’une part, l’outil de captation est conçu pour montrer en direct et à dessein des éléments invisibles à l’œil nu : c’est moins un enregistreur ouvert qu’un détecteur de présences ciblées. De l’autre, il n’y a plus, ici, de distinction ou d’écart entre regard humain et opération machinique, puisque le dispositif de visualisation innerve directement son utilisateur dans une sorte d’étroit couplage cyborg.
La dimension la plus inquiétante dévoilée par le film d’Eléonore Weber pourrait justement être celle-ci, qu’il n’y a plus de solution de continuité entre l’être humain qui observe (pense, décide…) à travers la machine et cette dernière – et, par conséquent, qu’il n’y a pas de décalage entre l’image et l’observateur. Le soldat tend à coïncider avec ce qu’il voit – et cela signifie aussi : ce qu’il ne voit pas – et ce qu’il voit correspond in fine à ce que le fonctionnement de la machine lui permet de voir. Dans de telles circonstances militaires, le lien ordinaire entre voir, décider et agir s’accélère dans un court-circuitage programmé. En effet, l’impression est que le soldat de l’hélicoptère dont nous empruntons le point de vue est dispensé de penser et de décider dans ces gestes automatisés. Il fonctionne plutôt, il devient le « fonctionnaire » – pour le dire avec le vocabulaire de Vilém Flusser – du programme de visualisation auquel il est branché[55][55] Nous renvoyons pour les questions de programmation et de fonctionnement aux réflexions de Vilém Flusser : en particulier au dossier « Vivre parmi les programmes », Multitudes, n° 74, 2019.. Rien que pendant les quelques heures de mission aérienne, sa sensibilité est remplacée par celle de la machine. Il exécute sa tâche de surveillance et de domination du territoire dans une zone grise où la présence subjective fait corps avec la machine programmée. Une certaine disposition stratégique de ses capacités à voir et sentir ne peut que prédisposer aussi son raisonnement, si on adopte une équation purement spinozienne où ce qui affecte notre corps affecte aussi notre pensée.
Les interrogations qui émergent font écho à celles suscitées par l’essor des drones dans les activités militaires, dont rend bien compte un film comme 5000 feet is the best d’Omer Fest[66][66] Pour une riche discussion des théories critiques autour des drones armés et de leur détournement par les pratiques artistiques, voir : Yves Citton, « Logique et esthétique du drone armé », 1er janvier 2020, AOC.. Choisirait-il, notre soldat, de tuer les êtres lumineux qui fourmillent anonymes dans son viseur aérien s’il était face à eux, dans une relation symétrique et frontale ? Quels doutes, décisions ou actions découleraient de la possibilité de percevoir ces sujets face à face, en partageant le même milieu sensible et dans un contexte d’interaction ? La puissance technique de visualisation nocturne semble de ce point de vue se retourner en impuissance : d’un côté, les capacités visuelles du soldat sont étendues mais, de l’autre, elles sont réduites. Cette réalité augmentée par la technique qui pénètre l’invisibilité des ténèbres correspond à une réalité diminuée en fonction d’une production restreinte et synthétique d’informations utiles. Aucun sujet humain n’accède à cette vue distante et sélective, que des saillances lumineuses contre un fond morne. Ce n’est qu’un exemple particulièrement emblématique de la logique que Gilbert Simondon décelait à la base de la technique (non sans en relever les aspects discutables) : à savoir, l’extraction de figures pertinentes et maitrisables, isolées d’un fond continu et vivant rendu ainsi passif et inerte[77][77] Gilbert Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, Paris, Aubier, 1958.. L’image de synthèse qui guide le soldat opère une réduction stratégique du perceptible et de l’intelligible afin d’induire des réactions plus automatiques et efficientes que ce que les hésitations et les nuances d’une analyse sensible directe auraient permis. S’il faut éliminer la nuit, c’est qu’elle cache, elle rend incertain et indécis. « Il n’y aura plus de distance, plus d’abris ni de recoins : nulle part où se cacher » affirme la voix-off. L’obscurité nocturne serait un espace au conditionnel où le fait de moins voir laisse fourmiller les possibilités fugitives : la pénombre abrite des incertitudes clandestines, irréductibles à l’emprise de la surveillance et de la domination. À ce propos, la critique du contrôle scopique du jour qui scande le début du film Black Code / Code Noir (2015) de Louis Henderson – dans un renouvellement post-colonial de la critique des aspects les plus violents de la « Raison » des Lumières – parait résonner dans le travail d’Éléonore Weber : « Plus belle que le jour, / paisible en tout cas, / la nuit constellée, savante et douce, / est le meilleur modèle de connaissance / et un bien meilleur modèle de connaissance / que le jour solaire, cruel, unique, / blessant au regard, / idéologique et opiniâtre. »[88][88] Voir au sujet de ce film le texte de Vincent Coupard, « L’émeute dans le système », La Revue Documentaires, n° 30, 2019..
L’enjeu principal du travail d’Eléonore Weber se situe, finalement, dans la tentative de libérer ces captations visuelles de leur efficacité opérationnelle, de leur fonctionnement fatal. Il s’agit, en ce sens, de produire des écarts cinématographiques à la place de l’immédiateté instrumentale redoutable qui caractérise le contexte de provenance. En réalité, à l’origine, il n’y a pas d’« image » à strictement parler dans ces séquences. C’est d’abord une vision en temps réel à travers laquelle le soldat voit et agit instantanément. Le temps du cinéma, en revanche, est un temps décalé, de distanciation, où les enregistrements en direct deviennent des images ouvertes à une expérience impossible dans la compression opérationnelle du cyborg militaire. La voix off qui mélange réflexions de la cinéaste et commentaires d’un soldat impliqué dans ce genre d’actions constitue un contre-point aux séquences visuelles, et creuse l’écart où se glisse l’analyse du spectateur. Celui-ci, donc, ne peut pas s’identifier aisément au point de vue du soldat, avec l’insouciance captivante d’un jeu vidéo : ce point de vue est rendu tangible, questionnable et pensable par le recul du dispositif filmique. Parfois, ces enregistrements contiennent, eux-mêmes, des moments imprévus de résistance au dispositif de visualisation et de domination guerrier, mis à l’arrêt par des interruptions ludiques. Par exemple, lors d’une séquence où la caméra-regard du soldat semble avoir oublié son objectif de surveillance et suit, distraite et songeuse, les jeux d’un groupe d’enfants. Ou encore : dans une autre séquence, l’image se rapproche d’un jardin où un groupe de personnes est attablé pour un repas. En renversant la perspective surplombante et neutre du soldat-machine, les observés adressent leur regard ainsi que des gestes vers l’observateur distant en refusant de rester des cibles inertes ou des simples données visuelles. Avec humour, quelqu’un lève une bouteille pleine en proposant à l’hélicoptère de s’unir au festin – l’enchantement froid produit par cet œil isolé, solitaire et opérationnel semble brisé, deux sujets se font face rien que pour un instant. On (et le soldat) se voit voir, car un regard est renvoyé au nôtre.
Texte dit par Nathalie Richard / Montage : Charlotte Tourrès, Fred Piet et Eléonore Weber / Montage son : Carole Verner / Mixage : Ivan Gariel / Production : Gaëlle Jones
Durée : 75 mn