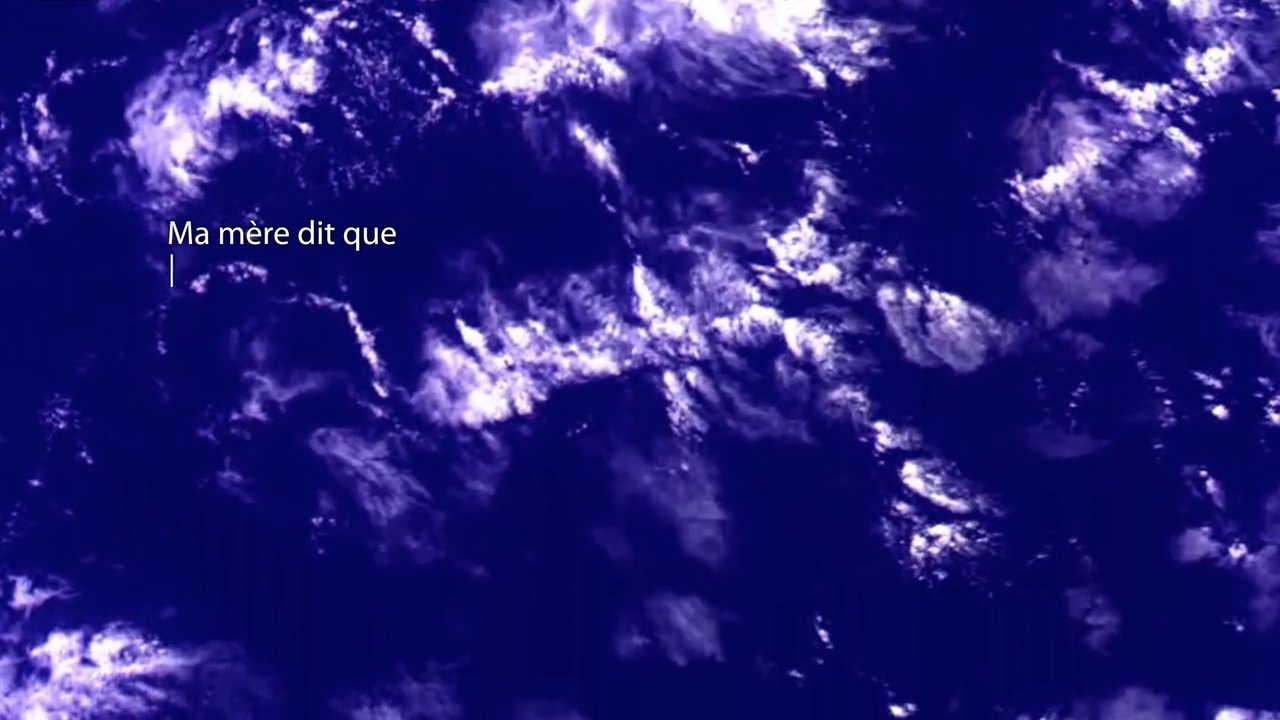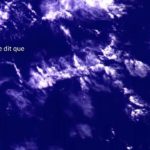Isabelle Ingold et Vivianne Perelmuter
Retenir l'image, voir le monde - À propos d'« Ailleurs, partout »
La vie des films a, par les temps qui courent, tendance à s’étirer : il aura fallu plus de trois ans pour qu’Ailleurs, Partout, découvert à Lussas en 2018, se fraye un chemin jusqu’aux salles. Trois ans aussi pour qu’une promesse d’entretien se réalise. Par chance, le film d’Isabelle Ingold et Vivianne Perelmuter est de ceux que l’on retient. Sa singularité peut s’exprimer factuellement, en disant qu’il se construit autour de la mise en rapport de l’histoire de Shahin, un réfugié iranien rencontré en Grèce, et des images de live webcam glanées sur Internet. Mais sa force vient du traitement sans surplomb qu’il réserve à ce matériau visuel a priori ingrat et discrédité, et d’une façon de faire se lever ensemble la réflexion et l’émotion. Il est plusieurs fois question de retenue dans l’échange qui suit : de ce que les cinéastes retiennent des heures d’images visionnées sur leur écran, de la retenue nécessaire à l’émergence d’une pensée, mais aussi de ce qui, dans ces images mêmes, les a retenues.
Si, faisant se mélanger des éléments hétéroclites, Ailleurs, partout est nécessairement un film très composé, la composition touche aussi au musical, en prenant en compte l’action propre des images sur la sensibilité. Isabelle Ingold et Vivianne Perelmuter reviennent ici sur son élaboration, la récolte des images, la construction du montage, le travail sonore, leur désir de maintenir une tension et une ambivalence au long du récit. Film de montage ou de composition, on pourrait aussi bien dire d’Ailleurs, partout qu’il est un film d’« entre-retenue » : un film où les cinéastes et les images, où ces images et les sons s’entre-tiennent, trouvant à s’influencer et à s’enrichir mutuellement à travers la distance qui les sépare. Si la méthode laisse place à du tâtonnement, sans doute est-ce qu’il faut accepter de se laisser toucher et déplacer soi-même pour parvenir à décaler le regard sur une actualité déjà saturée et à redonner à voir le monde par des images censées le surveiller ou en assurer le devenir-touristique.
Se tenant éloignées du systématisme, Isabelle Ingold et Vivianne Perelmuter témoignent par contre d’une attention au détail, revenant sur une image, un son. Sens du détail qui se manifeste aussi dans la seconde partie de l’entretien lors de laquelle elles nous ont emmené « devant la table de montage » afin de revoir et commenter différents moments issus de live webcams identiques, confrontant les images sélectionnées à celles laissées de côté, pour mieux saisir ce qui, ici ou là, les avait retenues. Nous les remercions chaleureusement de nous avoir confié certaines images tirées de leur rushes.
Débordements : Ailleurs, Partout se construit autour de l’histoire de Shahin, un réfugié iranien que vous avez rencontré en Grèce. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette rencontre, et la manière dont elle a déclenché un désir de film ? Comment les images de live webcam sont venues ? Est-ce que vous avez eu d’abord envie de faire un film sur Shahin et la jonction s’est faite après, ou est-ce que c’est à partir du moment où il y a eu les vidéos que l’envie de film est née ?
Isabelle Ingold : On est allées en Grèce pour la toute première fois en avril 2016, pour un tout autre projet de documentaire avec un historien français. Le film ne s’est finalement pas fait. Nous étions arrivées avant lui et nous avions loué une voiture à aéroport pour repérer un peu. On a décidé d’arriver sur Athènes en empruntant non pas l’autoroute, chère et très vide, mais la route qui longe la côte. À un moment donné, on a eu cette vision au loin d’un bâtiment immense avec plein de gens sur le balcon et des couvertures suspendues sur la rambarde. Un peu plus loin, on a aperçu des panneaux qui disaient « Domestic flight, International flight » et des tentes sur une sorte de terre-plein qui donnait directement sur la route, sans barrière. C’était le camp d’Hellinikon, l’ancien aéroport avait été transformé en camp avec une partie officielle à l’intérieur des bâtiments et une partie extérieure plus « informelle », avec des tentes, des gens qui attendaient une place à l’intérieur. Donc il y avait des enfants qui jouaient, des femmes voilées qui allaient chercher de l’eau, des hommes qui discutaient.
C’était le soir et d’un coup il y a eu un mouvement de foule, de gens qui rentraient à l’intérieur, parce qu’il y avait un couvre-feu à 22 heures. Celles et ceux qui n’avaient pas franchi les portes à cet horaire passeraient la nuit dehors. Parmi la foule, il y avait ce tout jeune homme, Shahin. On s’est regardés, comme il nous a souri on lui a souri, et on s’est mis a parler. On est restés ensemble pendant une heure ce jour-là, et puis on l’a revu tous les jours lors de ce premier séjour. On est retournées en Grèce deux fois, pour lui rendre visite. Il nous semblait difficile de rendre compte de cette rencontre et de la confrontation avec le camp à travers un film. Pour la première fois, on a fait une installation que l’on a présentée au château de Lunéville, dans ses anciens cachots, et dans une université à Los Angeles. La pièce centrale était constituée d’un triptyque avec Shahin et sa mère, qui se parlaient par téléphone, et entre les deux, le camp où il vivait.
On a gardé des liens avec lui et puis en 2017, il nous a écrit qu’il était parvenu en Angleterre. On est allées le voir, mais le jeune homme que nous y avons retrouvé n’était plus la même personne. On avait le sentiment que son énergie, sa confiance en l’avenir, sa curiosité des autres, de comment les gens vivent, de ce qu’on faisait comme métier, s’étaient éteintes. Il était complètement renfermé, vivait dans sa chambre, à regarder Internet la nuit et à dormir une partie de la journée. C’est là, vraiment, qu’on a eu envie de faire un film pour comprendre ce qu’il s’était passé.
Vivianne Perelmuter : Et d’emblée, le projet fut associé aux images de live webcams, en majorité des caméras de surveillance, parce que c’est ce que Shahin regardait. Puis très vite, on s’est dit, que dans le film, il n’y aurait que des images provenant de cette « fenêtre-là », sa seule fenêtre sur le monde. De sorte qu’on opère une inversion de perspective : on ne donne pas à voir sa vie, ni son visage, on regarde le monde depuis son vécu de migrant.
D : Vous fréquentiez déjà ces images ou c’est cette idée qui vous a amenées à les regarder ?
V.P : Comme tout le monde, on en avait déjà vues quelques-unes, mais ponctuellement, sans explorer. C’est grâce à lui que l’on s’est immergées dans cet univers, en se demandant d’abord ce qu’il voyait, ce que l’on pouvait voir du monde à travers ces caméras. Et en essayant, vraiment, de ne pas y projeter de suite nos idées préconçues, d’être assez ouvertes et accepter d’être surprises. C’était à une expérience de perception qu’il nous invitait. Et aussi bien à une réflexion sur le monde. On a d’abord tâtonné comme lorsqu’on débarque dans un pays étranger, on a progressivement découvert les spécificités des caméras, les pays où il y en a moins, ceux qui en sont quadrillés. Grâce à Shahin mais différemment de lui puisque l’image qu’il nous avait montrée dans un premier temps était une caméra de surveillance dans une station-service : il y avait ce couple qui de manière tout à fait anodine faisait le plein de la voiture et tout à coup « boum », une explosion. Il nous montrait ça et on se demandait pourquoi il regardait ce genre d’images alors qu’il n’allait pas bien… Peut-être pour faire diversion. Et puis, inévitablement, il y a une fascination de la catastrophe, et même de la violence alors qu’elle vous révolte ou vous concerne intimement. Nous voulions simplement être ailleurs. Quand vous faîtes un film avec ce type d’images, vous devez réfléchir non seulement au dispositif qui est derrière, et qui transforme chaque personne soit en potentiel suspect soit en consommateur, mais encore à sa réception. Quel spectateur, quelle spectatrice devenons-nous ? Comment ces caméras disséminées aux quatre coins du monde changent-elles notre rapport à l’espace géographique, politique ? Aussi ouvertes que nous voulions l’être, ou plutôt, justement afin de l’être, nous devions nous fixer un protocole, exclure tout le sensationnel, tout ce que traquent ces caméras. C’est à cette condition que nous pouvions en faire un autre usage, les détourner et pas seulement les critiquer.
D : Dans le protocole de recherche des images, est-ce qu’il y a eu des évolutions ? Est-ce qu’il y avait dès le début des choses que vous recherchiez en priorité, ou une immersion totale ? Il y a dans le film des images assez variées, que ce soit dans les zones géographiques ou les textures d’images.
V.P : La première étape a été comme un repérage. De quoi il en retourne ? Qu’est-ce que c’est, exactement ? La deuxième s’est faite en même temps qu’on écrivait et qu’on montait le film : on partait des matériaux narratifs qu’on avait, par exemple les conversations téléphoniques entre Shahin et sa mère, ou les textos et chats qu’on a échangés avec lui, et on se demandait ce qui pourrait résonner. Toujours en nous tenant au plus près du sensible, de tous les signes qui font qu’une image devient un plan. Et jamais on ne cherchait à strictement illustrer le trajet réel de Shahin, mais plutôt d’en accompagner le mouvement intérieur, ses intermittences, d’en réverbérer les affects, le vécu, faire ressentir l’attente par exemple. C’est l’attente de ce jeune homme mais, par le dialogue avec les images, elle capte, révèle à son tour quelque chose du monde. Au fur et à mesure, quoiqu’en sourdine, on cherchait à relier, par le montage, ce qui est séparé par le cadre de ces caméras, et par les frontières.
On a monté, en suivant un double mouvement : à certains moments, décontextualiser, qu’on ne puisse pas savoir où l’on est, et à d’autres moments, au contraire, resituer, que quelque chose dans le mobilier urbain, dans le fait que les gens conduisent à droite ou à gauche, les traits ou les rituels des gens, la structure ou la taille des maisons, puisse indiquer que l’on se trouve aux États-Unis ou en Angleterre, ou en Russie. Que par l’attention aux détails, tout à coup toutes ces petites différences nous reviennent. Et la volonté qu’il y ait une grande diversité nous guidait toujours : de même que les matériaux narratifs sonores étaient très différents dans leur contenu, leur style, la langue employée, les images devaient l’être également, aussi bien du côté de leur source géographique que de leur texture. Il y a avait un désir de faire l’inventaire de ce monde et, plus consciemment, de composer une image du jeune homme et du monde qui ne soit pas uniforme et figée, un récit qui ne soit pas homogène et linéaire. On relie mais on ne lisse pas, on ne comble pas les écarts.
D : Quand Shahin parle avec sa mère de la jeunesse en Iran coupée du monde, vous utilisez un plan de satellite, qui, en nous faisant passer à un autre type d’image, participe de l’hétérogénéité du film. Comment prenez-vous la décision d’inclure ce plan ?
V.P : On s’est posées pas mal de questions sur le genre d’images qu’on pourrait inclure. Cela commence par celles qu’on écarte. On n’irait pas dans les lieux privés, dans les appartements. C’était une limite pour nous. Concernant l’image du satellite, on a fait confiance à ce que l’on éprouvait en regardant : il y avait de l’inquiétude, mais aussi de l’émerveillement, un mystère, de l’apesanteur. Toute l’ambivalence de la globalisation… C’est une live webcam avec personne derrière, donc le même dispositif que pour les autres images. Et elle porte à sa limite extrême la viabilisation, la surexposition du monde, des pays lointains. C’est la planète elle-même qu’on peut observer en temps réel.
I. I : Pour revenir au processus, on récolte mais après, au montage, on fait des séquences qui mélangent des continents différents, des pays différents mais en créant des espaces communs ou un fil de parenté, des sortes de modules auxquels on donne des noms : « les petits gestes », par exemple, avec les gens un peu suspendus, désœuvrés pendant leur travail ; « les piscines » à la fin… On crée un espace qui n’existe pas. Au moment du le récit de l’arrivée de Shahin en Angleterre, lorsqu’il attend son deuxième entretien de demande d’asile, on passe du Mexique à la République tchèque. On a choisi des lieux géographiquement éloignés mais qui se rapprochaient par l’atmosphère qui s’en dégageait, par la texture, le grain de l’image, le fait qu’elle est en noir et blanc parce que c’est la nuit (il y a des caméras qui sont en couleur le jour et passent en noir et blanc la nuit). On les a donc entremêlés pour créer une séquence qui pour nous s’appelle « Le camp ».
V.P : La première fois que je suis tombée sur ces images au Mexique, j’ai ressenti une émotion intense. Je n’ai pas de suite compris ce qui me bouleversait. C’était une usine, une zone industrielle, mais il y avait quelque chose dans sa construction, dans ce noir et blanc, qui m’a fait penser, je l’ai réalisé après, à un baraquement de camp de concentration.
I.I : Il y a aussi des pylônes, comme des tours, qui font penser à des miradors.
V.P : J’ai dit à Isabelle que ça trouverait une place dans le film, sans savoir où. Et lorsqu’au montage, on a abordé l’arrivée de Shahin en Angleterre et son sentiment d’enfermement, cette image est revenue tout d’un coup. Et parce qu’elle est revenue, ça a changé la manière même dont on raconte. Sur ce passage, nous avions au départ deux éléments : la voix de la narratrice et le questionnaire de demande d’asile. Mais comme l’image nous bouleverse, on pense à la mère de Shahin, on pense au fait qu’elle ne sait pas exactement, ne peut imaginer ce que vit son fils. Et donc, on décide d’intégrer sa voix, si aimante, si inquiète, en relation, en contraste avec cette image de camp.
D : Une structure se met en place à partir de la matière à votre disposition : c’est-à-dire la matière sonore que sont vos discussions avec Shahin, ses conversations téléphoniques avec sa mère. La lecture de son compte-rendu d’entretien de demande d’asile est venue à quel moment ?
I.I : A la fin de notre premier séjour en Angleterre, en même temps que l’idée du film. Shahin parlait souvent de cet entretien. C’est un moment très douloureux pour lui, il avait l’impression d’avoir mal répondu.
V.P : On lui a demandé s’il avait toujours le document où sont consignées, mot pour mot, les questions posées et ses réponses. Il nous l’a apporté et nous l’avons lu ensemble, nous l’avons décortiqué. Et on lui a proposé de lire le document pour le film et d’ainsi changer sa perspective, rependre la main. On a fait un premier enregistrement cette fois-là. Shahin soufflait, s’arrêtait constamment. C’était rude pour lui mais en même temps sa parole se déliait. Il nous confiait des choses qu’il ne nous avait jamais dites, et ne dira jamais à ses parents. C’était dur et en même temps comme une libération.
I.I : Après avoir terminé une première version du montage, nous avons réalisé un deuxième enregistrement. Nous étions plus précises, nous avions sélectionné certains passages du questionnaire. Shahin a été extrêmement généreux et enthousiaste. Il a passé trois ou quatre heures à enregistrer avec nous, il était très concentré et voulait faire au mieux, et c’était complètement différent. Cela devenait aussi une mise à distance pour lui de lire ce texte.
Au montage, on a vraiment utilisé le questionnaire comme fil pour la structure du film, pour donner aux spectateurs des repères chronologiques et géographiques. Mais après, il fallait bousculer ce mode de récit, le faire bifurquer, le troubler, ramener l’épaisseur du vécu, d’autres récits. Et la place de ceux-ci se jouait essentiellement en fonction du voyage intérieur de Shahin, ce qu’il voit et pense, ce qu’il fait ou ne peut faire, ce qu’il éprouve, le détachement, l’attachement, l’angoisse. Ces éléments-là n’avaient pas une stricte place attribuée, nous devions construire ou re-construire l’évolution, les intermittences du vécu du jeune homme. Faire ressentir, l’enthousiasme au début lorsqu’il arrive en Angleterre, puis la déception, et, tout le long, comment ses désirs et ses projets changent.
Chaque élément narratif nous posait des questions différentes par rapport au montage. On construisait des séquences mais il y a des séquences qu’on a déplacées, promenées. On n’a pas commencé par poser la voix de manière fixe, pas du tout. Il s’agissait plutôt dans une premier temps de construire une séquence entre un son et des images, et puis dans un second temps de construire la globalité du film. Même si, en fait, le mouvement du film est toujours là qui aimante, sous cape, le montage. Il m’est déjà arrivé de travailler avec des réalisateurs qui posent la voix d’abord. C’est pas du tout comme ça que nous travaillons.
V.P : C’est un va-et-vient constant : même lorsqu’on a l’idée d’une séquence, la manière de la forger tient à la façon dont une image évoque une parole, et vice versa. Par exemple, on voulait créer une séquence qu’on appelait « les émerveillements ». Elle devait rendre compte de ce sentiment d’émerveillement qu’avait éprouvé Shahin en arrivant en Europe. On a commencé à chercher des images, et puis décembre est arrivé, et, avec les fêtes de fin d’année, les éclairages urbains à ce moment-là. Les capteurs des caméras étant de piètre qualité ou simplement usés, les lumières avaient des effets étonnants. Il y avait cette ville en Ukraine où la neige réverbérait davantage les lumières, qui à leur tour modifiaient les couleurs, les faisant déborder du contour des choses et des êtres. Nous avions en tête l’extrait de la conversation avec la mère que nous voulions placer sur cette séquence mais la manière concrète, précise, de choisir tel mot, tel silence, de les tisser avec l’image, cela vient avec le détail de l’image et les inflexions des voix.
D : Il y a toujours un écart qui permet cet espèce de mouvement permanent. Comme vous le disiez les images ne sont pas convoquées comme des illustrations, ce qui permet une ouverture. Mais on suit quand même un chemin, sans être laissés à la dérive.
I.I : Oui, il y a un écart et des moments où ça se rapproche, comme par exemple lors de la séquence « En Angleterre » où Shahin raconte qu’il est déçu, en colère. On a clairement cherché dans les images quelque chose qui pouvait faire penser à l’Angleterre. C’étaient des petites maisons, des rues assez étroites. Donc il y a des moments où c’est plus proche, il y a même des moments où on synchronise l’image et le son, mais c’était important que cela soit rare et donc d’autant plus fort.
V.P : Quand bien même on n’avait pas écrit la structure du film au préalable, il y avait l’idée d’un lent mouvement d’approche, pas d’observation mais d’accompagnement. Et quand tu accompagnes, tu te retrouves un peu comme un aveugle au bras de quelqu’un qui te fait traverser : tu dois sentir autrement, tous tes sens sont en éveil. Le vécu de Shahin, c’est ce qui guide mais avec ses sinuosités, ses angles morts, ses revirements, ses pensées contradictoires, en restituant l’imminence, le brouillard de l’instant. Et en embarquant le public dans cette expérience-la. D’autant plus que nous abordions cette fois un motif qui brûle l’actualité. Il fallait se défaire de ce qui, dans le flux d’images, tend à anesthésier le regard et l’émotion ou au contraire surchauffer les esprits. Cela passait notamment par cette manière d’accompagner : ne pas dire ou se dire « il est désorienté, il est en train d’attendre », mais faire que quelque chose dans le montage désoriente, dilate le temps par moments, le contracte à d’autres. Et pouvoir ainsi s’approcher de ce jeune homme, qui vit une chose que pour la plupart nous n’avons pas vécue, mais qui peut, ici ou là, avoir des échos avec notre expérience intime du monde. Le mouvement dans le film part d’une sorte de désorientation et d’abstraction vers quelque chose où, peu à peu, ça s’incarne.
D : Il y a un déport vis-à-vis de Shahin à travers les images de vidéosurveillance. Ce parti-pris d’ouvrir une expérience personnelle à autre chose passe notamment par l’usage d’images qui ne montrent pas l’espace actuel où se trouve le personnage, des images qui, si elles enregistrent des choses réelles, ont aussi une variété de texture, des couleurs très surprenantes. Il s’en dégage une espèce de relation avec le réel qui est un petit peu déphasée.
V.P : Déphaser pour mieux phaser. Ces caméras-là, lorsqu’on en retient ce qu’elles ne recherchent pas, ne visent pas – puisque leur fonction consiste à traquer la catastrophe, le vol, la violence, l’accident de voiture –, une présence, des grains de réel nous reviennent, à travers la configuration de l’espace, la radiance de certaines couleurs, les gestes des gens, les petits gestes… Même la pluie redevient un événement, une force miraculeuse. C’est de l’instantané en flux continu, ces caméras. Mais si tu prêtes attention aux petits gestes, à tous les détails, tu le ralentis, sans qu’on ait jamais ralenti des images, et elles se chargent de temps. Tout d’un coup, des récits viennent, et un geste, même infime, à l’instant T, peut alors raconter tout ce que la personne a pu vivre avant et vivra après. Donc, quelque chose nous semble ramener un sentiment de présence.
D : Concernant la sélection des images et la structure, on sent justement clairement que la présence humaine arrive à un point donné du film, quand Shahin est enfermé et qu’on voit des employés de commerces ou restaurants. On peut penser qu’un critère de sélection tient justement à une présence, une posture, un geste, tandis que dans toute la partie qui précède les critères seraient plus optiques et visuels, liés aux images elles-mêmes. Un des plans frappants, assez beau, est celui où le point est fait sur la pluie au premier plan et pas sur la ville en arrière-plan… On se dit que c’est une super idée de cinéma, sauf que ça vient juste d’une caméra automatique. Vous retenez aussi ce qui est un peu inhabituel, par rapport à un régime d’image courant, de petits décrochages.
I.I : Exactement. C’est comme cela notamment que l’on a regardé et choisi les images. Ce qui permet de renouveler le regard. Dans cette séquence, la pluie est un des personnages mais elle agit également comme passeuse : elle permet de relier des images extrêmement différentes parce qu’il y a la force organique de ce lien. Mais ici, il s’agit de faire sentir la différence, l’éloignement des lieux, et de s’étonner qu’il pleuve partout en même temps. C’est d’ailleurs ce que dit Shahin à ce moment-là. Au début du film, avec ce qu’on appelle des routes ou des no man’s land, il s’agit d’espaces dont on ne voit rien et qui ne sont éclairés que par un faisceau de lumière (la voiture qui passe dans le paysage, etc.). Et c’est ce qui devient le critère, entre guillemets. Mais lorsqu’on est dans la collecte, on ne peut pas taper ce genre de mot clé ! Il faut regarder et enregistrer plein d’images, puis on range, et puis quand on les a vues, on s’en souvient, ça se dépose en vous, et au moment de construire, une association d’idées survient et hop ! on va rechercher l’une d’elles parce que quelque chose nous y avait retenu sans qu’on sache à chaque fois quelle place elle pourrait trouver.
V.P : Le « point de vue » au cinéma ne coïncide pas forcément avec une place de caméra, et quelqu’un derrière. Là, on n’a pas choisi la place, et il n’y a personne derrière. Mais c’est aussi la manière dont on construit un regard, une approche. Le montage est un point de vue, à travers ce que l’on retient de ce que l’on voit, là où on décide de commencer un plan et où on le termine. J’ai l’impression qu’on a retenu ce qu’on considère généralement comme les déchets ! Mais le critère évolue en fonction de la tonalité qu’on veut donner. Si c’est la désorientation au début et bien ce sera davantage des routes dans la nuit, si c’est la solitude ou l’attente, cela peut être de s’approcher de corps désœuvrés, de ce qu’ils vivent dans leur coin. La question pour nous était comment épurer, trouver un équilibre entre quelque chose de très concret, singulier, et de plus ouvert. Cette jeune femme dans la boulangerie, elle existe en tant que personne, mais elle me laisse assez d’air pour que je me glisse dans l’image en tant que spectatrice, que ça m’interroge sur ce que vivent les humains. Après il y a des signes, des choses qui font qu’une personne ou une image va nous retenir : ça peut être un flou, un corps suspendu entre deux actions, une surexposition qui fait qu’un corps se détache au milieu d’un magasin…
I.I : On était touchées, parfois émerveillées, parfois bouleversées par l’attitude des gens. Quelqu’un qui penche tout d’un coup, puis reste tellement immobile. L’homme qui est endormi sur le comptoir où il n’y a plus personne – je ne sais même pas où sont les employés de ce bar. Ce sont des moments où tout à coup on capte quelque chose de la vie de quelqu’un. Les gestes racontent les conditions de travail, la solitude aujourd’hui, la fatigue… Les gens nous ont semblé extrêmement fatigués. Je me suis souvenue qu’un ami nous avait dit : ils ne nous auront pas tant en nous violentant, qu’en nous épuisant. Mais y avait aussi, entremêlée à la fatigue, une grâce, une vitalité, quelque chose qui résiste.
D : On reste toujours dans une tension, justement. Le film fait communiquer les expériences et les lieux en nous faisant passer d’un espace à l’autre, on remarque des gestes, mais en même temps le cadre reste fixe et renvoie à un enfermement. Le dispositif même, par l’utilisation des caméras, ne permet pas qu’une appréhension sensible et euphorique du geste. Dans les images que vous avez retenues, les employés n’ont pas l’air très actifs : comme vous avez sélectionné des temps morts, calmes, on dirait qu’ils sont juste payés à être là, à occuper un espace.
I.I : Ces gens travaillent quand même (rires), mais ils/elles ont des moments de pause ou d’attente. Certains métiers comportent pas mal de moments d’attente. Les gardiens par exemple. On en avait enregistré beaucoup, il en reste deux dans le montage. On les voyait dans des guérites ou devant des portes extérieures, des portes intérieures, des tourniquets. Au Brésil, c’était dans le hall d’une tour, probablement de bureaux, le gardien était là assis, parfois debout. À des moments de la journée, personne ne passait, ou alors c’était le soir et les gens étaient partis.
V.P : Je crois que c’est Watteau qui avait composé une série de dessins sur la guerre, mais en montrant toujours les soldats en train de dormir, de se reposer. Comment figurer la guerre ? Qu’est-ce qui peut en rendre un sentiment vif, un sentiment de présence ? Pareil pour le travail. Parfois, on y parvient en montrant justement le contre-champ : quand les gens ne travaillent pas, dans quel état sont-ils/elles ? Comment sont leurs mains, comment sont leurs corps ? Et c’est ça qui nous intéressait. L’action dit quelque chose, mais la suspension dit l’effet du travail, ce qu’il y a avant le travail ou après, et à côté de l’image vue, une autre se lève dans votre tête.
D : Il y a aussi des plans où on quitte un rapport de surveillance pour passer dans un rapport au paysage, comme celui qui montre le soleil à l’horizon, avec une caméra qui se trouve au sommet d’une montagne.
V.P : Il y a essentiellement deux types d’images : des caméras de surveillance, et des caméras touristiques. C’est le cas pour cette image, mais là aussi, la question est de savoir comment les arracher à leur fonction. La carte postale n’est pas forcément la manière la plus intime de découvrir un pays, d’habiter l’espace. On prend donc des moments où le capteur transforme, déforme les lieux, les choses, donne une beauté non immédiatement digérable.
I.I : Normalement cette caméra filme une ville, mais on ne la voit plus dans ce plan parce que le soleil éblouit et que des nuages la cachent. Le tout premier plan du film, avec le phare, est aussi une caméra touristique, mais qui ne montre pas ce qu’elle est censée montrer (la météo, un chemin où on peut se promener), elle devient moins figurative et à la fois acquiert une autre matérialité.
D : Il y a aussi un plan que vous avez tourné vous-mêmes vers la fin, depuis un ferry qui rentre à quai : quelle était la nécessité d’inclure ce plan, de déroger au principe de faire un film uniquement composé d’images de live webcams ?
V.P : C’est un plan que l’on a filmé lorsqu’on est allées voir Shahin en Angleterre pour la première fois. Il était chargé de cette histoire qui fait aussi l’histoire du film. Et puis, c’était comme l’aboutissement de notre démarche : si tout le travail avec les images de live webcams, y compris les caméras de surveillance, consistait à en faire un autre usage, à les détourner de leur fonction initiale, à les investir d’un point de vue, alors on pouvait, in fine, y inclure une image que nous aurions filmées nous-mêmes. Et la plupart du temps, les spectateurs ne font pas la différence.
I.I : Nous étions attachées à ce plan comme au réel de ce voyage. On a filmé Shahin à différents moments, et il restera cette image-là, qui n’est pas Shahin mais une trace de notre relation. L’image a été placée très tôt dans le montage, et elle nous a guidées comme un horizon.
V.P : En fait, on a commencé par mettre en place la toute première première séquence, du rêve, et cette dernière séquence, et on a construit le chemin entre les deux après. Cette image nous semblait juste car dans son mouvement vers la rive, elle ouvre mais elle porte une indécision, un tiraillement.
D : La fin, entre le rêve de Shahin de manger une glace à la pistache, une image de plage visuellement bruitée, le travail que vous faîtes au niveau du son, les différentes musiques et chansons qui se mêlent, condense une tension, produit un sentiment ambivalent.
V.P : Oui, l’ambivalence était essentielle pour nous. On a monté le son comme un DJ mélange différents morceaux. Il y a Gracias à la vida de Mercedes Sosa, qui est à la fois lumineuse et mélancolique, Lights, une chanson pop de Archive, avec guitare électrique, batterie, Alfred Deller qui chante Oh Solitude… Et puis, mais indistincts, des sons de police radio… mais ce n’est pas souligné, c’est entremêlé.
D : Lors de ma première vision du film, j’ai été marqué par le moment où, alors que s’affiche à l’écran un message de Shahin disant qu’il désire voir le monde entier, l’on passe à un écran noir, tandis que le volume sonore augmente subitement. La fin, avec l’importance de la musique, prend aussi le spectateur au niveau des sensations. Est-ce que vous pouvez dire un mot de cette dimension perceptive, la volonté de trouver une émotion à travers le son ? Peut-être aussi un mot du choix de faire apparaître des lettres à l’écran, ce qui participe aussi à une forme de richesse perceptive.
V.P : On voulait diversifier les registres de parole, et ainsi non seulement rendre les différentes facettes de Shahin, mais également varier l’attention du public, solliciter leurs yeux de différentes manières – voir une image et lire une image. Cela crée du mouvement à l’intérieur, votre place change. Et puis, cette diversité correspond à notre vécu aujourd’hui : on chatte, on texte. Avec Shahin, on se parle très rarement au téléphone. Avec la mère, cela n’aurait pas pu être du texte, car les choses passent davantage dans les non-dits, l’intonation, les rires, les pleurs. Avec nous, il pouvait parler plus frontalement, alors qu’il voulait épargner ses parents. Mais il y avait toujours l’idée qu’il fallait, plutôt que d’observer, être avec. Le rythme d’apparition des lettres à l’écran est donc le rythme de l’écriture.
L’écran noir est venu un peu comme ça. À un moment, on est dans l’écriture et plus aucune image ne semble adéquate ou, plutôt, le noir devient une caisse de résonance où chacun et chacune peut projeter ses désirs – c’est de ce désir que Shahin parle à ce moment-là. Interrompre le fil des images avec un écran noir, c’est de la sensation et c’est une surprise. Et cela permet, on l’espère, de mieux regarder après. On convoque les gens au niveau de l’intelligence, mais tout autant au niveau du corps. Il n’y a pas de pensée sans émotion. Mais il faut qu’elle soit retenue : qu’elle ait du temps, de la place pour cheminer un peu, se déposer. Sinon ça devient la surchauffe, le court-circuit, la simplification.
I.I : Le recours à l’écriture à même l’image était aussi une manière de jouer des rythmes différents. D’avoir des moments où on change de vitesse, pour reprendre de l’élan. Et, par rapport à la parole orale, on a l’impression d’être autrement dans la tête des gens, avec d’autres hésitations ou gênes qu’on a aussi fait figurer à l’écrit. Par exemple, au moment où il est question du passeport vrai ou faux.
D : Concernant la trame sonore, il y a les voix, mais aussi des sons électroniques, des moments où tout à coup un volume augmente, des ruptures, des extraits de radio… Comment vous avez procédé pour ce travail de composition sonore ? Est-ce qu’il se fait dans un dernier temps ?
V.P : Non, il se fait vraiment en même temps. Parfois, on place un son avant l’image, pas forcement une voix, un son qui donne une tonalité ou une scansion à la séquence. Puis, on met une voix. Ou alors on commence par l’image mais de suite après, en travaillant sur le son, cela change la manière dont on va la monter, parce que le son fait aussi voir autrement l’image, guide, colore votre regard. La plupart des images sont muettes à l’origine. Et là aussi, on s’est dits qu’on ne voulait pas illustrer mais d’une part essayer de faire résonner une sensation, une pensée, une humeur dans laquelle se trouvait Shahin, et, d’autre part, trouver la consistance, le paysage sonore de ces images. Mais, ces images pour nous, sont aussi le monde, notre vécu du monde, qui saccade, qui pixellise, se court-circuite, se floute… On a donc travaillé avec des sons électroniques, qui peuvent par moments friser le bruit, et, à d’autres, la musique ou, du moins, devenir sensuels, délectables. Nous les avons entremêlés à des éléments acoustiques, la pluie, ou un son de moteur de bus, tout ce qui documente le monde, toute cette matière. Le dialogue entre les deux n’est jamais fixe. Parfois, ils s’entrechoquent, s’empêchent mutuellement, d’autres fois ils se mettent en valeur. Si on a eu beaucoup de sons électroniques, quand tout d’un coup la pluie éclate, ce son de la pluie retrouve toute sa force, sa matérialité, sa portée.
I.I : Ta manière de travailler le son, et même dans les films où il y a du son direct, consiste parfois à le recomposer totalement avec d’autres sons afin de sélectionner ce que tu gardes, choisir dans le fouillis un ou quelques sons qui rendront mieux la singularité d’un lieu ou l’enjeu d’une scène. Ici je pense par exemple à cette petite dame en cuisine qui touille son café, avec un son qui permet de pointer une zone de l’image, qui n’est pas un son de petite cuillère mais qui y fait penser car il semble synchrone.
V.P : Ne pas illustrer avec le son, c’est souvent chercher avec l’image un autre rapport que le synchronisme, c’est comme induire un estrangement, un déboîtement pour regarder à nouveau. On cherche quelque chose qui peut jouer comme un écho ou, au contraire, comme un contrepoint. Pour cette petite dame, on a mis une trame électronique, très répétitive, qui tapisse, et qui est plutôt dans les médiums. Et on s’est dit qu’il fallait quand même, là, pour ce petit geste et cette toute petite cuillère – elle touille, elle touille, elle n’en finit pas de touiller – essayer de guider le regard et la sensation. Donc, on a synchronisé les mouvements de la cuillère contre la tasse avec un son cristallin qui se détache très bien des médiums du fond, ce qui permet de le mettre très bas. Avec ce son ténu pour accompagner un geste lui-même ténu, on fait ressentir d’autant plus le contraste, le décalage entre la femme, seule, et la grande cuisine.
Partie II : Devant la table de montage
1 – LE BERGER
C’est Isabelle qui a d’abord vu ce lieu le soir, avec cette famille. Elle l’a de suite enregistré. J’ai vu que c’était à vingt heures, parce qu’Isabelle mentionne toujours l’horaire de l’enregistrement dans le titre du fichier. L’heure locale du lieu. C’était vingt heures donc, et comme la famille était bien habillée, Isabelle s’est dit que la mère et ses enfants allaient certainement à une fête. Nous sommes revenues dans ce lieu de jour en espérant les revoir, et puis nous étions intriguées par le lieu lui-même. On ne voyait pas grande chose. Et puis un matin, j’y retourne et j’aperçois un berger mais déjà il disparaît hors cadre. Je suis arrivée trop tard. Alors, je reviens à nouveau, un peu plus tôt, et je commence à enregistrer et j’attends. Et voilà qu’il repasse avec son troupeau de chèvres. C’est ce plan qui est dans le montage.
2 – UNE FEMME QUI PLEURE
Je suis tombée par hasard sur cette cuisine. Il y avait deux femmes qui cuisinaient et rangeaient en même temps. Quelque chose dans le cadre m’a retenue : quelque chose de décadré qui mettait en valeur le corps de deux femmes, enfin c’était elles qui changeaient le cadre en avançant ou s’éloignant. Et puis, il y avait la couleur saturée de leurs gants plastiques et de l’autre coté des légumes verts. C’était à la fois électronique et organique. Alors, je suis restée là, je n’enregistrais pas tout le temps. J’attendais, j’ai commencé à huit heures du matin, puis à midi et demi, il y eut ce moment où cette femme se retrouve seule, elle s’immobilise soudain, alors j’enregistre. Elle reste 10 minutes comme ça, et après elle s’approche et pleure.
C’est comme en tournage de documentaire, tu sens les choses parfois. Dans cette cuisine, avec cette femme, quelque chose te retient, pas encore certaine mais comme une intuition. Alors, tu attends. Lorsque j’ai vu cette immobilité, et ce cadre qui fait qu’elle est pleinement là alors même que son visage n’est pas vu, avec cette main posée sur la table, comme accrochée à une bouée de sauvetage… tu restes, le miracle se produit.
3 – LE CAMP
Et ça, c’est « le camp », ce sont les premières images que j’avais vues. D’abord, je ne savais pas que c’était une grande usine. C’est au Mexique, ça je le sais, mais tu pourrais te croire aux États-Unis… Et de suite, avec ce mirador… quelque chose m’a étreint. J’ai regardé d’abord, puis j’ai enregistré, mais pendant très très longtemps.
Ici, le même lieu, également de nuit mais l’effet n’est plus du tout le même. Ils avaient dû changer la caméra. L’image est de meilleure qualité et en couleurs et je ne retrouvais pas mon sentiment initial… Et pourtant, c’est la même chose. Mais pas. C’est sans doute le noir et blanc, le grain, qui me rappelaient des images d’archives de camps de concentration. Finalement, on a choisi le premier enregistrement.
4 – EMERVEILLEMENTS
Là on est en Russie, c’est décembre. Quand on a vu ça, la neige se teintant de toutes les lumières et couleurs de la ville, les petites silhouettes noires des êtres humains, on s’est dits que la séquence des “émerveillements” devait ressembler à ça. Du froid et du chaud. Et puis Noël, c’est pour Shahin quelque chose de nouveau qui va avec sa découverte de l’Europe. Et voilà la même ville de jour. Cela devient trop figuratif. La nuit et les aberrations du capteur de la caméra épuraient le côté folklorique.
5 – LE JEUNE HOMME A LA MONTRE
J’arrive dans un endroit et crois comprendre que c’est un restaurant ou une boîte de nuit chic. Il est écrit « private », on est au Japon, et j’attends. Et puis ce jeune homme entre dans le cadre, et de suite il retient mon attention, il a quelque chose qui me touche. Notamment son port. L’image est très saccadée, c’est une suite d’images fixes, en fait. Donc, il y a des trous d’espace-temps que je ne peux saisir. Mais je sens d’autant mieux les changements de posture du jeune serveur. Il reste longtemps là, il est élégant avec sa cravate, et il va regarder sa montre… puis, il a ce petit geste qui me bouleverse, qui me dit quelque chose sur lui, de son travail. Je ne l’oublierai pas. Mais il a fallu attendre, je suis restée quasiment une heure.
6 – LE SOMMEIL DES EMPLOYÉS
Là on est en Asie, et on comprend qu’il s’agit d’un restaurant, et un autre jour je vois ça. Vivianne me dit « il faudra y revenir ». Et elle y revient plusieurs fois pas toujours à la même heure.
Et un jour, je suis surprise, stupéfiée…
Je me rends compte que j’avais des préjugés, je ne me doutais pas qu’en Asie, les gens pouvaient se toucher comme ça, avec une telle intimité, une telle promiscuité comme au Brésil où je suis née. Cela dit quelque chose de leur relation, et de leur travail, et ça me déboîte de ce préjugé selon lequel les Asiatiques seraient moins physiques que les Latins… Avec Isabelle, nous étions émerveillées, et à la fois bouleversées par leur extrême fatigue.
Retranscrit avec l'aide de Lilou Audry, Chloé Vurpillot et Maÿlis Seassau.