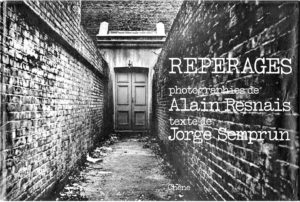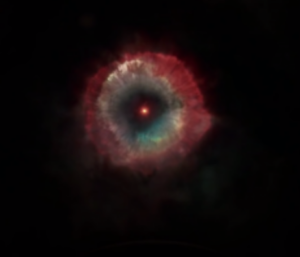Night moves, Kelly Reichardt
Le bleu du ciel
Quelques visages se succèdent, à peine arrachés à la pénombre par le voile intermittent dont les recouvre une lumière colorée. Réunis dans une grange, une poignée de spectateurs lèvent les yeux comme des enfants vers un film qui leur fait la leçon. Le commentaire en voix-off, annonçant un inévitable désastre si rien n’est fait, exhorte chacun à l’action. Les images de forêts en flammes, de mers polluées, de champs noyés de pesticide se succèdent, soutenues par une musique grandiloquente. Le ciné-tract, semblable en son esthétique à bien des montages à visée politique, publicitaire ou commémorative visibles en ligne, se voudrait l’agent d’une mobilisation, d’une mise en mouvement selon les deux sens que l’on peut prêter à cette expression : amener à agir, ensemble. Or, l’esquisse de discussion qui suit la projection ne renvoie pas seulement le film à la naïveté de son projet (conversion plus ou moins directe d’un message en actions), mais en pointe surtout l’aspect contre-productif. Face à un désastre global et quasi-inéluctable, toute tentative pour l’enrayer semble vaine. Montée sur scène, la réalisatrice défend alors, presque à l’encontre de la manière dont est construit son film, un modèle d’action locale. Discours qui semble résonner en Josh (Jesse Eisenberg), resté debout au fond de la salle, dans une posture qui manifeste une évidente défiance envers celle du spectateur. La séquence s’achève, ou est achevée, par une coupe brutale, au milieu d’une phrase. Surtout, la scène qui lui succède s’y oppose terme à terme : passage de la nuit au jour, d’un espace confiné à un extérieur urbain, d’une quête de sens politique à l’absurdité de la communication – un homme-sandwich, déguisé en vache, s’agite sur un trottoir à proximité d’un centre commercial. Le monde, dans toute sa ludique obscénité, semble alors réduire à bien peu de choses les velléités des citoyens réunis dans la grange. La coupe est pourtant aussi un raccord. Josh et Dena (Dakota Fanning), qui observent l’homme-vache depuis leur pick-up, sont en chemin pour acheter le bateau qui donne son nom au film, et servira à leur opération : faire sauter un barrage hydro-électrique.
La question qui travaille sourdement Night moves semble d’abord celle-là : en quoi messages et actions peuvent-ils s’engendrer mutuellement ? Si le film écologiste n’a d’autre but que de susciter une « prise de conscience » et un passage à l’action, de l’autre côté, l’explosion du barrage est supposée valoir comme message. Josh ne dit rien d’autre, lorsqu’il affirme qu’il est temps que les gens se réveillent. Mais, pas plus que les spectateurs ne se muent par l’injonction éthique que leur lancent le film et sa réalisatrice en activistes, l’action ne se convertira en message. À cela, plusieurs raisons. La mort accidentelle d’un campeur recouvre toute interprétation de ce geste comme politique – dans les critiques mêmes, l’emploi majoritaire du terme « éco-terroriste » plutôt qu’activiste le dit bien. À peine la discussion est-elle engagée, à la table du déjeuner de la communauté agricole dans laquelle habite Josh, qu’un fils et son père s’opposent ainsi sur l’intérêt d’une telle action (dont ils ignorent les responsables). Si le fils approuve, malgré tout, au nom de la vertu supérieure de la cause, le père condamne. Pour lui, il n’y a là que théâtre. Davantage que l’accident, c’est donc peut-être la lisibilité ou non du message qui est questionnée, la capacité de l’action à signifier. Le film lui-même ne dit rien du but de l’opération, et il faut s’en étonner. Pourquoi un barrage ? Pourquoi celui-ci plutôt qu’un autre ? Toutes questions en général débattues en groupe en début de film, et qui établissent pour le spectateur un enjeu dramatique. Pas plus que l’objectif n’est ici considéré dans sa dimension stratégique, le message que cette action est supposée véhiculer ne sera explicité. De là qu’il est possible d’envisager Night moves comme un pur exercice de style, une relecture du film de casse ou « d’opération » (faire sauter un pont, …). La question alors évidemment se pose de l’intérêt de donner un arrière-plan militant à ce qui pourrait se réduire à une stricte mécanique narrative, aussi virtuose que vaine.
Le pessimisme du film semble procéder du fait que le message ne passe pas, que personne ne se réveille. Plus radicalement encore émerge l’idée qu’il n’y a au fond même pas de message. Si elle est « théâtrale », l’explosion du barrage ne le serait guère qu’en tant qu’elle offre une scène ; mais celle-ci est vide, sans aucun acteur pour porter une parole. Bien que le scénario s’inspire de faits récents, il faut peut-être voir là un symptôme de son ancrage dans l’imaginaire des années 1970. Cette forme d’activisme renvoie en effet au groupe radical The Weather Underground qui, de la fin des années 1960 jusqu’au milieu des années 1970, pratiquait l’action directe tout en ayant pour ligne de conduite de ne pas s’attaquer à la vie des personnes. Causant accidentellement la mort d’un homme lors d’une explosion à New York en mars 1970, le groupe plongera dans une clandestinité totale en même temps que se trouvera largement discrédité ce mode d’action. La résurgence de cet imaginaire révolutionnaire-là à l’heure des mouvements « Occupy », qui semble davantage constituer la scène contestataire américaine actuelle (du moins récente), surprend au point que l’on peut avancer l’hypothèse que s’il n’y a pas de message, c’est que le film lui-même, davantage que ses personnages, n’a pas de prise sur le présent. Rêverie angoissée à partir de ce qui pourrait revenir comme modalité du politique, mais n’est pas là, et fonctionne donc comme forme vide, sans contenu. Mais peut-être est-il également possible de concevoir la politique du film moins en termes de pourquoi / pour quoi que d’enchaînements et d’associations – affaire de rythmes, de corps, de corps pris et produisant ensemble des temps d’action hétérogènes.
Night moves envisage l’action d’une manière qui ne nie pas les rapports de causalité, mais les rend opaques. Ce n’est pas un monde fracturé où rien ne se raccorde à rien. Au contraire, tout semble s’enchaîner presque parfaitement, et il y a moins des accrocs qu’une simple dilatation du temps lors des scènes où, comme lorsque Dena doit acheter une grosse quantité d’engrais, le projet est suspendu au bon-vouloir d’un élément extérieur. Le sommet de cet art de la suspension, ou de la vibration tenue, surviendra quand les trois jeunes gens, après avoir déclenché la bombe, devront arrêter leur barque au milieu du lac le temps qu’un automobiliste, stationné sur la route en surplomb, change son pneu crevé. Mais là encore, tout finit par reprendre son cours – nul barrage pour s’opposer au flux de l’action. L’opacité vient en fait d’une clandestinité de la clandestinité. Rien n’oblige, parce que l’opération est clandestine, à n’en rien dévoiler aux spectateurs. Les films jouent d’ailleurs le plus souvent sur l’effet de confidence pour intégrer plus fortement celui-ci. Night moves verse pour sa part l’énergie d’une scène dans la suivante, les raccorde à la fois fermement et de manière souterraine, sans qu’il soit jamais tout à fait possible de savoir précisément ce qui passe, se poursuit, est poursuivi par les personnages.
La séquence de projection dans la grange pourrait ainsi bel et bien apparaître comme ce qui déclenche la mise en application du plan si, dans la scène d’ouverture qui la précède, Josh et Dena ne visitaient le barrage à faire sauter. De la même façon, lorsqu’ils arriveront avec le bateau chez le troisième comparse, on comprendra que l’opération est prévue depuis suffisamment longtemps pour que ce dernier ait pu amasser une quantité importante de l’engrais qui servira d’explosif. Ni amont, ni aval : enchaînements souterrains, flux sans tumulte mais puissant malgré tout. Le film s’avance sur une ligne de tension, progresse en la constituant au fur et à mesure. Urgence sans urgence, qui place les activistes au point du paradoxe. La nécessité vitale d’agir, et d’agir tout de suite, rencontre aussi le temps des prévisions. L’impact de l’action se perd moins dans le gigantisme de la tâche que dans le temps qui la définit et lui donne sens. Sur le bateau qui les mène au barrage, Dena raconte qu’elle n’a jamais pêché, et ne le fera plus maintenant que la recherche scientifique annonce que les océans seront presque vides de poissons d’ici à 2050. Le manque de lisibilité de l’action, que le film traduit par une opacité de l’opacité et une évidente attention à l’atmosphère nocturne, peut alors s’envisager au regard de ce temps à la fois long et court. En un clin d’oeil, au regard des enjeux, l’inertie nous aura fait glisser jusqu’au point de non-retour. Les plans depuis la berge du bateau glissant paisiblement sur le lac, comme si l’eau était à la fois remontée et descendue comme le temps lui-même, pourraient le figurer : les enfants jouant à la guerre parmi des souches d’arbres morts sont autant des animaux préhistoriques que les derniers survivants de l’humanité. On ne se hâtera jamais qu’avec lenteur, la lenteur même sera état d’urgence, confronté à une perspective à la fois trop vaste et trop écrasée.
À l’activisme clandestin répond un autre type d’action politique, qui en diffère tant sur le plan de la fonction, du mode que de l’inscription dans le temps. Le travail de la communauté agricole dans laquelle vit Josh ne cherche pas une justification en dehors de lui-même. Il est une manière concrète d’établir de nouveaux rapports dans la production tout en basant celle-ci sur des principes écologistes. Tel est le discours du père à son fils : pour voir le monde changer, des gens faire quelque chose, il suffit de regarder par la fenêtre de leur maison. La culture donne un temps à l’action, une cohérence et une consistance. Celle-ci porte ses fruits (et légumes), littéralement, indubitablement. Josh l’entend, sans rien dire. Une rupture s’opère alors au niveau de la mise en scène, de plus en plus focalisée sur sa perception. Mais c’est à l’aune d’un mouvement de caméra immédiatement antérieur que l’on peut mesurer pleinement la fêlure. Partant de la fenêtre de la yourte de Josh, la caméra parcourt l’espace en un lent panoramique jusqu’au lit sur lequel il est allongé. Emane de son visage, pour la première fois, de manière presque imperceptible, quelque chose comme de la satisfaction. Sortir de soi-même, ne plus se pencher vers la terre mais se projeter. Dans l’ouverture circulaire de la yourte, le bleu du ciel. Leur action a réussi, il en attend l’écho, il l’entend sans doute déjà. Ce même plan reviendra peu après, et Josh alors se détournera de cette vision. Faut-il penser Night moves comme la condamnation de l’idéalisme au profit du pragmatisme ? De la grande action au profit de la petite ? Le film en réalité ne tranche ni n’oppose complètement. Après tout, des champs vus par la fenêtre au disque de ciel, il y a moins une rupture qu’un cheminement. Une autre manière de répondre à la même urgence en retissant, de manière secrète et ponctuelle, le réseau des relations. Le film touche en même temps là à sa limite. Il n’invente pas une proposition d’action. Que faire et comment ? L’interrogation demeure. Le dernier plan, sur le miroir servant à surveiller le magasin dans lequel Josh, incapable de remplir la fiche de candidature, vient de postuler, achève de tout clore. Mais par sa forme circulaire, ce miroir rappelle aussi l’ouverture de la yourte, ce fugitif instant où Josh a semblé heureux d’appartenir au monde. Repli, et rappel. Josh a peut-être tout perdu, de son vrai nom à son nom d’emprunt pour l’action, de sa communauté à la fille qu’il aimait. Les travellings, jadis sur des plans de légumes, parcourent désormais des vitrines remplies d’objets pour la randonnée. Le désespoir serait absolu, s’il n’était libre au spectateur de se souvenir que des relations se sont nouées pour agir, qu’un ciel a existé et qu’il existe toujours. Il vaut peut-être encore, malgré tout, d’y risquer son regard, et d’y engager sa vie.
Scénario : Jonathan Raymond et Kelly Reichardt / Photographie : Christopher Blauvelt / Montage : Kelly Reichardt
Durée : 112 mn
Sortie : 23 avril 2014