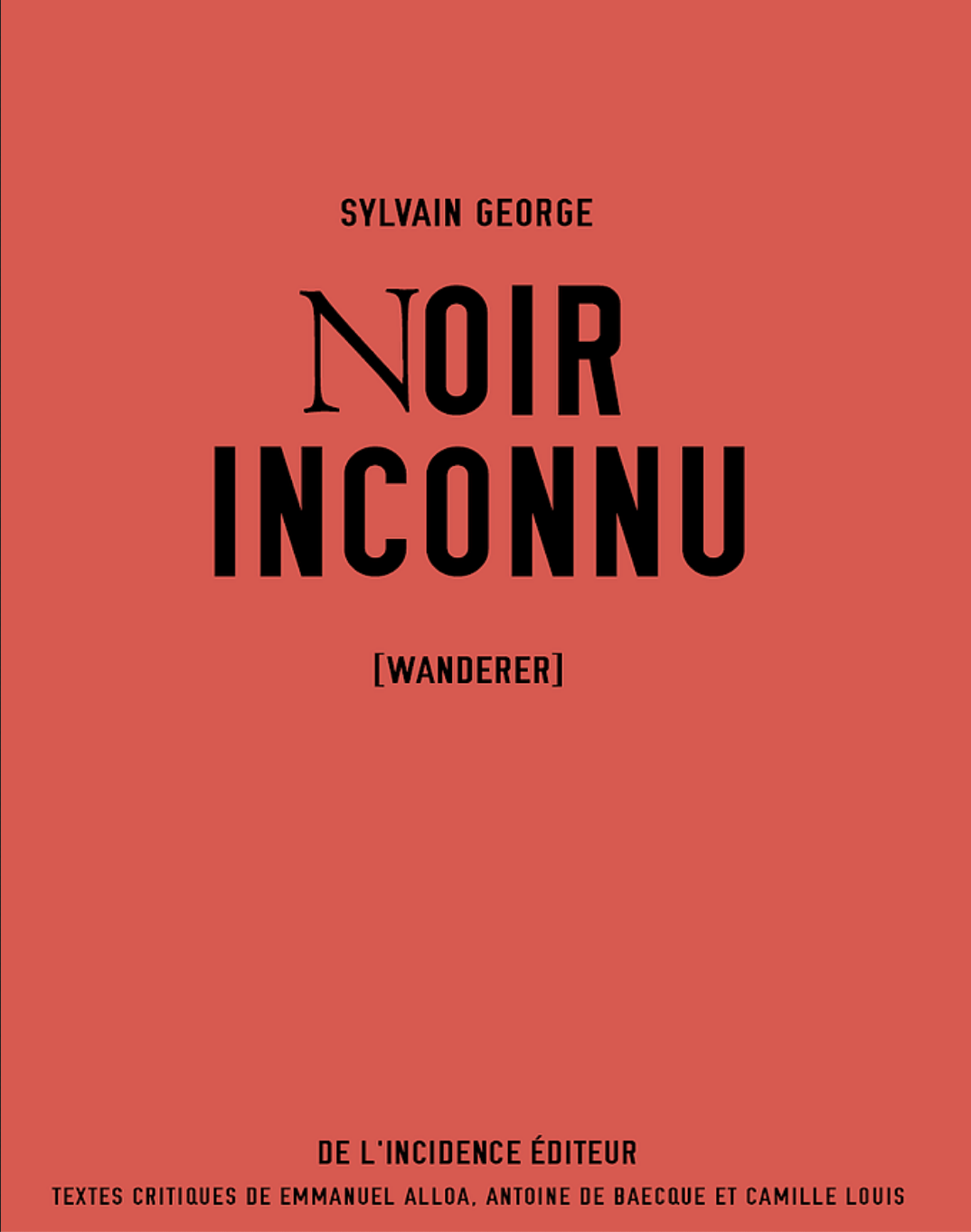Sylvain George (2020)
Une forme qui vient encore
Vieux compagnon de la revue (voir ses entretiens ici ou là, ainsi que son hommage à Angela Ricci Lucchi et le film offert à Débordements pour ses cinq ans), Sylvain George a récemment publié chez De l’Incidence un recueil de poésie. Bien que peu avertis en matière de critique littéraire, il nous a semblé profitable d’interroger cette conversion du cinéaste en poète, pour, à travers elle, écouter les échos que se rendent les films et les pages. L’entretien est suivi d’un poème extrait du livre.
Débordements : Vos films étaient déjà traversés par nombre de références poétiques, de Rimbaud à Lautréamont en passant par Cravan ou Michaux. Comment êtes-vous passé de ce regard cinématographique tourné vers la poésie à une poésie qui, à bien des égards, semble souvent travaillée par l’image filmique ? Et quelles formes de liens voyez-vous entre ces deux formes d’expression ?
Sylvain George : Il y a tout d’abord un intérêt marqué depuis de très longues années pour les domaines de la littérature et de la poésie, de la philosophie et du cinéma … Chacun s’attelle en effet, jour après jour, au « métier de vivre », pour reprendre le titre du journal de Pavese, et essaie de découvrir comment construire et définir une relation, un rapport avec « soi », avec l’autre, avec le monde, avec le passé comme avec le présent. La construction de ce rapport, de cette relation au monde relève sans doute d’une nécessité intérieure, et c’est en ce sens qu’elle est synonyme de liberté. C’est Spinoza a formulé cela en des termes extrêmement clairs et puissants : « On dit qu’une chose est libre quand elle existe par la seule nécessité de sa nature et quand c’est par soi seule qu’elle est déterminée à agir ; mais on dit nécessaire ou plutôt contrainte la chose qui est déterminée par une autre à exister et à agir selon une loi particulière et déterminée. » La nécessité s’oppose donc à la contrainte qui est toujours extérieure et synonyme d’oppression et de domination. C’est donc par nécessité que l’on peut se réfugier dans les champs du cinéma, de la philosophie, de la littérature, etc., afin de tracer ses lignes de fuite, c’est-à-dire de parvenir à prendre en charge ces questionnements trop vie écartés, déconsidérés, et qui pourtant reste cruciaux car se déployant et se répercutant quotidiennement dans tous les compartiments de l’existence : comment vivre ? Comment faire pour vivre dans le « camp de l’ennemi » (Mekas) ? Dans un monde capitaliste, cause de « désolation » pour le plus grand nombre (Arendt/Pasolini) ?
La littérature, la philosophie ou le cinéma peuvent faire parti (ils ne sont bien sûr pas les seuls), de ces « moyens purs » (W. Benjamin), non orientés vers une fin prédéterminée, qui permettent de lire, déchiffrer, appréhender de façon critique les multiples plans de réalités, superpositions et niveaux de discours, qui nous traversent, nous fondent et fondent le « monde », entravent tout un chacun. Les réalités sont construites en effet, on a trop souvent tendance à l’oublier ; les politiques publiques contribuent à les façonner et à leur donner formes. Ces dernières elles-mêmes reposent sur des présupposés philosophiques : par exemple les dispositifs de discriminations positives à l’œuvre aujourd’hui (et que l’on trouve notamment dans les banlieues autrefois classées ZEP, aujourd’hui classées APV, RAR, CLAIR, ÉCLAIR, etc.), transposition de l’affirmative action aux Etats-Unis, reposent sur un concept qui a fait fortune, celui d’équité, théorisé et substitué au concept d’égalité par le philosophe John Rawls dans son livre Théorie de la justice… Ce qu’on a appelé des « conceptions du monde » (Weltanschauung), ou leurs résidus, traces, survivances, les irriguent tout autant et nous traversent. Parvenir à les décrypter permettent de se positionner par rapport aux évènements et aux choses, à « soi », invite à la création de postures singulières, à l’invention de nouvelles formes de de vie, de nouvelles dissidences subjectives, comme à la définition de nouveaux « styles » (Macé).
Un livre comme un film peuvent être en effet de ces gestes, multiples et radicaux qui, de par leur surgissement intempestif, leur patiente/impatiente construction, leur existence pleine ou contrariée, permettent de se réveiller du rêve d’une époque comme du rêve de l’autre, et de renvoyer à leur profonde inanité les pseudos états de normalité, certaines fictions politiques prises dans les rets persistants du mythe (entendu comme étant ce qui ne change pas dans le cours de l’histoire : le pouvoir de certains groupes sociaux sur d’autres), qu’un ordre dominant, établit voudrait faire passer pour naturels : « Il n’y a pas de normes. Tous les hommes sont des exceptions à une règle qui n’existe pas » écrivait Fernando Pessoa quelque part[11][11] Fernando Pessoa, En bref, Paris, Ed. Christian Bourgois, 2004..
Le travail cinématographique, comme celui de l’écriture dite « poétique » – notion qu’il faudrait essayer, loin de tout essentialisme, de préciser tant elle est protéiforme – peuvent être des moyens qui par une attention soutenue accordée aux phénomènes, êtres et choses, opèrent des césures spatiales et temporelles dans le cours du temps et des choses, instaurent au sein de l’ordre normal du temps des temps autres, créent de « véritables état d’’exception « (Benjamin, Pessoa), des « sauts hors du rang des assassins » (Kafka), des « lieux de nulle part », de « personne » (Celan), des « états d’urgence » (Pasolini) ; mettent en œuvre des « figurations de pensées » ou « images de pensée » ; donnent à voir, lire et entendre les êtres et les choses dans leur teneur la plus profonde; favorisent la création de nouvelles relations, de nouveaux contacts, de nouveaux touchers poétiques et politiques avec le monde tel que dès lors, il ne va plus. Ils ouvrent, comme moyens purs, à la sphère du poétique, de l’éthique et du politique.
Je pars en effet du postulat que le « poétique » est latent en toutes choses, quelles qu’elles soient, quelles que soient les espèces (animales, végétales, minérales), et jusqu’aux plus prosaïques ou généralement disqualifiées, appartenant à la réalité du plus bas, les réalités les plus rugueuses, crues, cruelles, et qu’une extrême attention accordée à celles-ci permet de l’appréhender, de le déployer, d’en être saisi… Les modalités de l’attention trouvent à se déployer dans le travail effectué sur le langage, les tentatives de sortir du langage instrumental, arbitraire, variable selon les intérêts de chacun, au profit d’un langage envisagé non comme un système de signe, mais comme une puissance d’adresse, un langage à partir duquel il est possible de gagner des perspectives critiques sur le présent et d‘envisager une impulsion utopique : le langage du nom qui consiste à nommer les choses en fonction de ce qu’elles sont vraiment. Ce travail de nomination correspondant au fait d’accorder la parole aux choses apparemment « muettes », de laisser parler les choses au-delà du nom qu’elles portent, implique donc dans le même temps la construction d’un dialogue, d’une conversation. L’acte de nommer les choses du monde et l’acte de converser avec celles-ci, loin d’être opposés comme il est généralement admis, sont noués l’un à l’autre, s’inscrivent dans une même relation critique et dialectique par et dans laquelle chacun des termes étant affecté et altéré l’un par l’autre, se trouvent reconfigurés ; par et dans laquelle sont mis en jeu les catégories de l’identité et de l’altérité, les agencements et déterminismes de toute sorte, des processus de desubjectivation et de resubjectivation, de déterritorialisation et reterritorialisation… : s’élabore ainsi, entre expérience et expérimentation, détermination et indétermination, et loin de toutes formes « d’entre-soi », une forme de communauté d’ « amis étrangers » (W. Benjamin), « sans appartenance » ou « émancipée » selon Rancière – « une communauté d’êtres qui partagent un même monde sensible pour autant qu’ils restent distants les uns des autres, qu’ils créent des figures pour communiquer à travers la distance et en maintenant cette distance. Une communauté émancipée, disait Jacotot, est une communauté de narrateurs et de traducteurs[22][22] Jacques Rancière, « Le moment de la danse » in Les temps modernes, Paris. La Fabrique Editions, 2000, p. 114. » – et dont les prémisses principales seraient à la fois une politique sans archè, la fin de toute téléologie et l’appropriation de l’impropriété. Une relation, un mouvement, un rapport à la langue profondément insurgeant, qui forment donc dans le même temps, donnent lieu, instituent comme autant, et pour mieux les subvertir encore et toujours, des figures métamorphiques, un poème ou un film, résolument à l’écart des réalités admises, la domination de l’homme sur la nature, de l’homme sur l’homme, qui apparaissent dès lors pour ce qu’elles sont véritablement : de pures irréalités.
Cette recherche de communauté ouverte entre les mondes se redouble et s’articule et s’exerce dans l’établissement des liens transversaux, dans les opérations de déplacements, migration, circulation, transformation, collage et appropriation auxquelles procèdent entre elles certaines pratiques artistiques normalement séparées. Rancière y voyait le « propre » de la modernité de l’art, et mon travail, comme j’ai commencé à l’esquisser, n’y échappe sans doute pas. Mes « objeux filmiques », balances dialectiques cinématographiques, participent en effet de ce mouvement en faisant le jeu de l’hybridation, en s’intéressant aux mots, aux images, aux mouvements, aux temps, aux espaces et aux combinaisons diverses et mouvantes de divers éléments (textes poétiques et philosophiques, mises en scènes, performances, ciné-concert, installations…). Les points de rencontre, de contact, particulièrement entre « poésie » et « cinéma », se font dans l’attention accordé aux sujets comme aux opérations de « montage. » Documenter le réel, c’est donc peut-être en effet à la fois interroger les rapports entre les énoncés et venir les déplacer, les agencer, afin de mettre en lumière des liens qui sont inapparents, de faire surgir d’autres niveaux de réalité. Dès lors, appréhender différents régimes de sensibles, saisir et traduire plastiquement la teneur de vérité d’un être ou d’une chose, capter les signaux secrets qu’émettent les oubliés de l’histoire, la nature « muette » – les thématiques de l’immigration et des mouvements sociaux etc., tout comme la prise en charge de vies sous-exposées, bafouées, disqualifiées, niées par l’idéologie dominante et la violence d’Etat, et la violence policière, est le projet au long cours qui m’occupe depuis mes débuts) – nécessite et implique donc un certain usage, cruel, dansant, critique, de la caméra, du médium choisi et des ressources qu’il peut offrir[33][33] Choix de l’outil et options que celui-ci peut offrir : caméra argentique, numérique, téléphone portable, etc. : une grande attention accordée aux parfums, sons, couleurs, textures, matières, objets, lieux, gestes, corps, récits, et développement, déploiement dans les temps et les espaces… ; tout comme des opérations de montage qui créent des liaisons ou des déliaisons, rapports ou non rapports, par des enjambement, associations sensorielles, correspondances entre des motifs, juxtapositions dialectique de fragments/télescopages « bonds du tigre » temporels … ; et ce, jusqu’à une forme filmique advienne, trouve à se définir en toute liberté et avec la plus grande des exigences, faisant foin de toute idée de neutralité axiologique, en fonction de la relation et du dialogue noués entre les sujets filmés/filmant et les conditions de production des images – loin de toutes doxa en vigueur qui reconduit les partitions admises et les assignations à résidences (certains sujets parmi lesquels les « migrants », les « pauvres », se devraient d’être filmés et exposés, sans « fioritures », « effets », « pauvrement » etc.), il n’y a au contraire aucun recul ou timidité à avoir devant la forme nécessaire à inventer, et celle-ci ne tardera à surgir et s’imposer, après que l’on s’est parfois fort heureusement ou fort désespérément perdu dans le travail et les vertiges de l’immanence : « les inventions d’inconnu réclament des formes nouvelles.[44][44] Arthur Rimbaud, Lettre du Voyant, Paris, Ed. Gallimard, coll. Poésie, 1973, p. 199. »
Précisons que parmi les points de contact, l’intégration dans mes premiers films, ainsi que vous le rappelez, de panneaux avec des citations de poètes tels que Baudelaire, Lautréamont, Rimbaud, Celan etc., ne participe pas d’une littéralisation des actions et évènements en train de se passer sur l’écran, ou d’une injonction faite aux spectateurs à épouser une certaine lecture de ceux-ci, mais bien d’une invitation à y découvrir de nouveaux degrés de signification. Le décalage en effet entre l’élément écrit, le texte montré, et les éléments visuels, produit une césure, un arrêt, un écart, une béance dans le flux des évènements et de la « narration », qui autorise l’articulation entre des problématiques participant de l’extrême contemporain avec d’autres du passé plus lointain, en apparence étrangères ou prescrites, et permet par là-même de créer de façon poétique et politique de nouveaux effets de sens ; dans le même temps, dans un effet de boucle, la lecture cursive du spectateur est interrompu et il est alors appelé à faire retour sur sa propre lecture des évènements, comme des images-évènements jusqu’alors projetées. Ainsi, dans L’Impossible – pages arrachées par exemple, film de 2009 qui traite de la criminalisation des personnes migrantes (accusées de causer des troubles économiques et politique en Europe en général, à Calais en particulier, de mettre en danger le roman national etc.) comme de celle des mouvements sociaux des mouvements sociaux engagés contre la loi LRU, il m’avait semblé pertinent d’opérer une sorte de renversement dialectique, d’une part en me ressaisissant de façon non didactique du motif du mal tel que Benjamin avait commencé à le travailler à partir des œuvres de Lautréamont, Rimbaud et Dostoïevski, comme signe de transgression envers l’ordre moral bourgeois, la subjectivité bourgeoise, le logocentrisme ; et d’autres part en déployant de nouveau, dans une perspective quelque peu césairienne, matérialiste et historique, et par la citation de quelques mots, les dimensions politiques, esthétique et heuristique de la poésie de Lautréamont et Rimbaud, deux hommes qui ont connu et vécu, de près ou de loin les évènements de la Commune et son échec. Rimbaud ne se sera peut-être jamais plus défini que dans les deux poèmes « Génie » et « Démocratie. » Dans ce dernier poème, il condamne les vieilles démocraties colonialistes et appelle à une vraie démocratie, à des temps nouveaux ; « Génie » est une critique du “Génie du Christianisme” de Chateaubriand qui faisait l’éloge des valeurs morales et civilisatrices du Christianisme. Rimbaud-révolté définit « le Génie » comme éternité et amour, mesure parfaite et réinventée – dans le même temps bien sûr, il utilisera ici comme ailleurs tous les lieux communs de la littérature romantique, le lyrisme, le rêve, la nature…, pour mieux se moquer des codes du romantisme, ne plus s’agenouiller, se « relever » : « en avant, route ! » Cette dimension parodique et destructrice, cet humour ravageur, on les retrouve aussi chez Lautréamont qui se moque lui aussi du romantisme, comme du petit-moi-qui-crie du romantisme noir des années 1820, et porte peut-être ce que pourrait être le romantisme français, avec Baudelaire et Nerval, à son plus haut degré d’efficience. La poésie furieuse et cruelle de Lautréamont est en effet un mélange de sérieux, de tragique et de grotesque, dans laquelle il n’y a pas un passage qui ne soit suivi immédiatement de sa critique. Le pittoresque et l’extravagance poussés au plus loin produisent des effets d’ironie. Certains chants sont des plagiats de Shakespeare (le fossoyeur), Musset, Goethe ou recopient des manuels scientifiques. De même, ses « beaux comme » où l’image est aussi éloignée que possible de l’objet comparé, l’énumération de plusieurs comparaisons suggérant l’arbitraire de toute image. Lautréamont cherche à montrer le ridicule des conventions sociales qu’impliquent les formes littéraires. Il n’attaque aucune école en particulier, mais toutes les écoles. Il n’attaque pas simplement l’homme bourgeois, mais tous les hommes, l’Homme qui « juché sur un trône formé d’excréments humains et d’or », n’hésite pas à manger « le pain des autres », avant de s’effondrer ivre mort « comme une punaise qui a mâché pendant la nuit trois tonneaux de sang » Il détruit tout ! Et pourtant fait preuve d’une terrible générosité pour tous, et attention aux « petits », en inventant des devenirs-animaux, quitte ensuite à se moquer de nouveau de son geste. Car s’il détruit tout, il ne s’épargne pas ! On entend ainsi dans le même temps, dans sa prose-récit et son vouloir dire, une violente mise à nu, un rire désespéré, qui témoigne de sa révolte inassouvie ; un rire à l’os comme autant de sarcasmes qu’il s’adresserait à lui-même, comme signe de la révolte du révolté contre lui-même, contre donc toutes formes de clôture (Il y aurait sans aucun doute une forme-qui-vient-encore à faire émerger, filmique ou textuelle, et qui pourrait se baser sur un montage dialectique et poétique Lautréamont/Shakespeare).
Une de ces formes-qui vient-encore, a trouvé à se cristalliser dans Noir Inconnu – Wanderer. Si le travail cinématographique s’est toujours accompagné, depuis les tout débuts, d’une pratique de l’écriture qui a pu donner lieu à des formes diverses, en lien toujours avec les films réalisés[55][55] Des notes de tournages qui ont pu former un journal de bord à l’instar de ceux que peuvent en produire les anthropologues au cours de leur investigation sur le terrain, et dont certains fragments ont pu être publiés dans des revues comme Trafic, ou Débordements… ; ou bien encore de sortes d’échappées à teneur poétique, constituées d’impressions, souvenirs et images de tournage, publiées là-aussi dans diverses revues dont celles déjà citées, ou ayant été édités… Ces différents types d’écrits ont aussi pu donner lieu à des performances scéniques et musicales dans des lieux divers tels le Festival d’Avignon, le Lieu Unique, l’Espace 1789, le Tns, le Centre Pompidou, la MC93 à Bobigny…, celle-ci restait néanmoins extrêmement secondaire voire velléitaire par rapport à mon activité cinématographique. La création naissant sans doute d’un profond sentiment d’enfermement, ladite pratique est devenue primordiale pendant un temps personnel et professionnel compliqué, et où il m’était nécessaire de trouver un moyen pour mettre à distance et subvertir certaines réalités totalement verrouillées, d’inventer des issues existentielles, de prendre le large. Il prolonge et pousse plus avant les travaux d’écriture déjà entrepris à partir des expériences de tournage (lieux, personnes, choses, situations et évènement rencontrés…), est traversé par celles-ci, et reprend donc aussi en charge des points de contact et terrains partagés (ellipses, surimpressions, ralentis, accélérations, images enchainées, fondus, jump-cuts, téléscopages/montages de fragments, saccades rythmiques..), entre poésie et cinéma, étant entendu ainsi que j’ai essayé de l’indiquer, que c’est en terme de circulation, de traduction, de migration que les rapports entre les champs de la poésie et du cinéma pourraient être qualifiés…
D. : Le recueil est pris entre nomination et profération, entre le vœu de dire le nom des morts et celui de faire retentir les cris d’outre-tombe ou d’entre les frontières. Je ne sais pas si vous seriez d’accord avec l’idée qu’il s’agit d’une « poétique de la vocifération » ; je me demande en tout cas quels principes innervent cette langue féroce.
S. G. : Dans la continuité de ce que j’ai essayé de développer plus avant, je dirai que le livre essaie d’œuvrer et de construire des partages de lumière, des mises en exposition égalitaires à la lumière, afin de vivre, au présent, dans un autre monde. Il s’essaie à créer, au sein de l’ordre normal du temps, des conduites disruptives, des manières d’être différentes d’habiter le monde sensible. Cela passe donc par un travail de l’immanence, la construction de regards différents sur ce qui fait « problème », ou sur ce qu’un ordre dominant considère comme étant un problème, ainsi qu’une attention accordée au plus ténu/la découverte de la puissance commune d’humanité et des « choses », qui est présente partout.
Pour ce faire, se déploie une écriture qui peut paraitre cruelle et implacable en ce qu’elle ne veut rien laisser dans l’ombre, et qui n’est pas sans renvoyer, entre autre, à la sublime frontalité de Swift – on se souvient de son texte Modeste proposition pour empêcher les enfants des pauvres en Irlande d’être à la charge de leurs parents ou de leur pays et pour les rendre utiles au public, écrit au XVIIIe et dans lequel il recommande aux Irlandais de dévorer leurs gamins pour oublier la famine – à l’humour de Lautréamont comme précisé plus haut ; comme à une certaine approche de la poésie objectiviste en ce que le sujet est « congédié » au profit du parti pris des êtres et des choses, et d’une interrogation sur les formations symboliques du réel, la découverte de liaison inaperçues ou cachée volontairement dans le réel – ce qui n’exclut pas pour autant, passe tout autant, par un certain usage, crypté, de la métaphore, celle-ci n’étant pas envisagée comme une intensification imagée d’une relation existante avec le réel, mais comme une relation en construction avec celui-ci ainsi, un pont ou mouvement de bascule des plateaux, ou niveaux de réalités[66][66] La puissance et nécessité de la langue cryptée et de la « métaphore », me sont apparues d’une part après la lecture des ouvrages de Léo Strauss, dont notamment La persécution et l’art d’écrire ; et d’autre part alors que j’étais confronté à un litige extrêmement sérieux dans le domaine professionnel. Un litige qui m’a conduit, lors-même que les torts avaient été imputés à la partie adverse, de devoir accepter un accord que je ne souhaitais pas. Je ne parvenais pas, tant la situation était injuste, à parapher le document contractuel jusqu’à ce que soudain, en quelques secondes, j’écrive quatre vers qui, via un certain usage de la métaphore, codée, cryptée, quatre vers qui, via un usage exprimait mes sentiments devant l’injustice de la situation, insultait de la pire manière les personnes concernées ; mais surtout désignait d’autre niveaux de réalités et plan d’immanence. Si dans une certaine réalité, dominante, ces personnes pouvaient avoir l’impression d’avoir remporté la partie, sur un autre plan d’immanence, selon un jeu de bascule des plateaux qu’active et désigne les vers, ceux-ci avaient déjà perdu depuis bien longtemps la partie. Les quatre vers inscrits sur le document, j’ai pu alors apposer ma signature…. Une écriture poétique qui, comme le petit hérisson de Schlegel dans le fragment 206 de L’Athenaeum – «Pareil à une petite œuvre d’art, un fragment doit être totalement détaché du monde environnant, et clos sur lui-même comme un hérisson. » – vient piquer, prendre à revers, à rebrousse-poil, renverser dialectiquement et poétiquement (par déplacement), non seulement les partitions majoritaires, mais aussi certaines conduites ou productions énoncées par les personnes soi-disant les mieux attentionnées, attachées à travailler, pour le dire vite, sur les conditions de la « vie commune » (Jacques Rancière a bien montré en effet comment il peut y avoir des formes différentes de construction et de symbolisation du commun qui sont toutes également réelles et également traversées par le conflit de l’égalité et de l’inégalité, et il serait dès lors vain d’être choqué ou révolté qu’on puisse par exemple à la fois travailler sur les plantes, les fleurs, les arbres, l’Anthropocène, l’émergence de mondes possibles, et se réjouir dans le même temps de la victoire d’Emmanuel Macron ; ou bien encore, de développer une « écopoétique » tout en faisant parti des signataires d’une pétition pour appeler à l’élection de François Hollande… : c’est-à-dire concrètement, reconduire les impasses et prises d’otage, mystifications de la démocratie représentative, apporter son blanc-seing à des politiques inégalitaires et discriminatoires, validation de l’enfermement des enfants, la militarisation des frontières, etc. Je n’en suis pas moins extrêmement vigilant quant à l’existence et la profération dans l’espace public de nouveaux mots d’ordre contemporain, nouvelles églises et littérature de communion qui les accompagne (« Anthropocène », « Vie commune » « Champs des possible » « Partage » etc., tant ceci peuvent être saisi par des « insiders » afin de cultiver « l’entre-soi » et favoriser simplement des stratégies personnelles) ; ou certaines afféteries, perpétuation du genre hauturier, conformismes du non-conformismes, stratégies de distinction en vigueur dans le champ, la poésie, dans lequel mon livre et son écriture migrante et roturière pourrait vaille que vaille s’inscrire (déclarer que la poésie est morte ; appeler à des poéticides ; promouvoir de la post-poésie en voulant répéter sempiternellement le vieux geste rimbaldien qui appelait à se débarrasser de la vieillerie poétique ; appeler à subvertir les us et vigueur du « marché de la poésie » en y important une esthétique post-punk et usage du sample, etc.)… ; ou bien encore les « lenteurs du siècle », ce qui « traîne encore », « revient » sans cesse, se promène dans l’air du temps ou les courants d’air : les scories, bourrons, reliquats du sacré et persistances du mythe.
Le livre est donc constitué de « fragments-hérisson », de « morceaux d’espace flottant »[77][77] L’intérêt pour la notion de fragment provient sans aucun doute de l’appétence pour une certaine littérature romantique (romantisme allemand, avec les frères Schlegel, Novalis et Hölderlin ; romantisme français avec certains auteurs déjà cités comme Baudelaire, Nerval (« Les nuits d’Octobre » principalement), Lautréamont, Rimbaud…), une littérature contemporaine (Artaud, Dos Passos, Beckett, Perec, Blanchot, Barthes…) ; ainsi que de la fréquentation de l’œuvre de certains philosophes : de Héraclite à Foucault en passant par Nietzsche et Benjamin (Ainsi, la dénomination des fragments du livre « Morceau d’Espace Flottant (MEF), renvoie directement à une expression, « morceau flottant d’espace », que Michel Foucault utilise dans son texte « Des espaces autres », dans lequel il développe son concept d’hétérotopie ; et qu’il utilisait aussi en 1978 pour qualifier les embarcations des « boat people », et plus précisément le « Haï-Hong » (« L’ïle de lumière »), ce bateau errant de port en port, avec à son bord plus de 2500 personnes dont des enfants, et qui finira par être accueilli par les pays européens. L’hétérotopie, selon Foucault, se dirait d’un espace caractérisé par le plus grand nombre de connexions possibles avec les autres espaces. Néanmoins, outre ce grand nombre de connexions, les hétérotopies ont aussi la propriété de les mettre en forme selon un style contraire à leur spatialité habituelle, “tel qu’ils suspendent, neutralisent ou inversent l’ensemble des rapports qui se trouvent, par eux, désignés, reflétés ou réfléchis”. Il en existe donc deux types : l’utopie et les espaces du dehors. Ces hétérotopies sont constituées comme des lieux aux rythmes insolites et si puissants qu’ils façonnent de nouveaux imaginaires, de nouvelles relations entre les espaces, à l’échelle la plus vaste possible puisqu’ils sont aussi des connecteurs. Selon Foucault, l’hétérotopie est donc fortement déviante en tant qu’elle repousse les limites de l’espace. Reste qu’une critique peut sans doute être formulé en ce que Foucault exclut toute dimension temporelle au profit de la seule dimension de l’espace. En inversant, faisant permuter les termes « espace » et « flottant », notre intention est d’apporter une inflexion à cette « expression » et au concept d’hétérotopie en y rajoutant la dimension temporelle. Il faut donc lire « morceau d’espace et de temps flottant » comme étant non seulement des « espaces autres » mais aussi des « temps autres. »). L’utilisation du fragment-hérisson est donc envisagée d’un point de vue critique contre à une certaine conception de celui-ci qui voit en lui une partie d’une unité originelle perdue, et de laquelle naîtrait une tension entre l’un et le multiple : la construction d’un art de la fragmentation à la recherche d’une unité, tout en refusant la tentation totalitaire et tout en éliminant la rhétorique née de l’illusion selon laquelle le langage coïncide avec la pensée. Ici, le fragment est un moyen de bloquer la linéarité du « récit » et de favoriser la multiplication des pistes de lectures au détriment de l’homogénéité du propos. Le fragment-monade fonctionne comme la substitution de tout élément originel au profit d’une structure combinatoire et rhizomatique. A l’instar des Fragments du discours amoureux, Noir Inconnu-Wanderer pratique la fragmentation systématique afin de ruiner tout système et toute possibilité de situer le sujet parlant : collage et montage construisent un texte sans origine ni fin, un texte tourbillonnaire dans lequel le sujet s’origine indéfiniment. Le fragment-monade, reste sans doute, encore et toujours, ainsi que le pressentait Novalis, un art nouveau en constante redéfinition., comme autant d’illuminations profanes, de chimères linguistiques (ainsi l’écriture emprunte, pour mieux s’en jouer, les détourner, à différents registres tels le réalisme critique ; l’autobiographie ; la confession ; l’élégiaque ; le registre technique de la marine ; scientifique dans l’évocation et description de phénomènes naturels… ; insère en son sein des expressions en langues étrangères, locutions de langues mortes, discours d’hommes politiques, slogans ou grafs…), pour déclassifier et défaire la naturalité supposée de l’ordre des choses, au profit de figures nouvelles et polémiques, et dessiner les linéaments d’une communauté sans consistance ni appartenance, en tension, toujours à venir.
D. : On sent aussi l’influence du jazz. Bien des textes ressemblent par endroits à des partitions, avec plusieurs indications (« scat », « supplique ») qui pourraient relever d’une sorte de solfège sauvage. Qu’est-ce qui a ordonné ces scansions aux rythmes souvent vifs, à bâtons rompus ? Et pour vous qui avez tant médité le montage, quels rapports entre le rythme des images et celui de votre phrasé ?
S. G. : J’ai en effet employé le mot « Scat » non en référence à une certaine drogue, mais au jazz/free-jazz et ces sublimes moments d’improvisation et de dialogue entre la voix et les instruments. Que Louis Amstrong, dont il est dit qu’il serait le premier à l’avoir « inventé », ait improvisé/joué avec des sons, des onomatopées, des « borborygmes » à la place des mots et paroles de la chanson qu’il interprétait et qu’il avait oublié et ce, dans un contexte de ségrégation raciale et de « déshumanisation » des individus noirs, des « sauvages », renvoyés qu’ils étaient du côté d’un pseudo état de nature, est selon moi absolument saisissant d’un point de vue poétique, esthétique et politique. C’est l’exemple même, emblématique, de la puissance « carnavalesque », des renversement dialectiques et poétiques de certaines pratiques politiques et artistiques, puisque prenant les choses aux mots, s’en prenant aux mots, un nouveau langage est créé qui vient subvertir les réalités, inadmissibles, et pourtant admises. Un mot, une pratique, qui ensuite connurent une fortune certaine dans la musique (rock, métal (plus précisément les moments d’improvisation dans les concerts), ont contribué notamment à l’émergence de nouveaux courants musicaux : influence dans la création de la musique « Dj, toaster » en Jamaïque, auquel il faudrait rajouter l’élocution endiablée de certains animateurs radio américains, le « Jive talk » ou « Harlem jive » à savoir l’argot du jazz dans lequel la déformation phonétique tient une place prépondérante.
Pour ce faire, il en va sans doute, ainsi que vous l’indiquez, de la question majeure du rythme. Et concernant celui-ci, Émile Benveniste et Henri Meschonnic, dont les travaux s’appuient en partie sur ceux du premier[88][88] Émile Benveniste, « La notion de « rythme » dans son expression linguistique », Problèmes de linguistique générale, Paris, Ed. Gallimard, coll. « Tel », [1951] 1966, p. 327-335. Henri Meschonnic, Critique du rythme, Anthropologie historique du langage, Lagrasse, Éditions Verdier, « Verdier poche », [1982] 2009., ont bien montré dans leurs recherches comment le rythme n’est pas synonyme de mètre et de mesure, comment cela était traditionnellement admis, mais devient l’agencement spécifiant de tout discours, un facteur d’historicisation mis en œuvre par l’homme : « Dans la théorie du rythme que Benveniste a rendue possible, le discours n’est pas l’emploi des signes, mais l’activité des sujets dans et contre une histoire, une culture, une langue[99][99] Henri Meschonnic, op. cit., p. 71.. » Contre la langue de signes de la sémiotique, en faisant du rythme le « signifiant majeur » de tout discours, Benveniste bouleverse le statut du sens, et par là toute la théorie du langage. En substituant au schéma dualiste du signe le modèle d’organisation imprédictible d’un discours qui spécifie chaque fois le sujet comme historique, une force nouvelle est conférée au langage et à la littérature comme domaines de l’invention et de la liberté du sujet.
Dans Noir inconnu, le rythme appréhendé comme individuation d’une forme-sujet dans l’espace et le temps, se donne à lire, comme cela a été esquissé plus haut, à travers de multiples changements de registres de nature différente parce qu’il me semble intéressant de jouer sur les frontières entre les genres et le styles, de travailler sur une poésie qui emprunte des éléments qui lui seraient étrangers ; changement de styles, comme de tonalités qui peuvent venir ou non se télescoper dans une parole ; parole qui peut être découpée dans le texte en fragments, en des phrases, en des vers, qu’il s’agit d’organiser ; créer des rapports ou non rapports, des continuités ou discontinuités, en jouant des ressemblances et des dissemblances, convergences ou divergences, concordances ou discordances des temps, en nouant et dénouant, liant ou déliant les mots entre eux, des mots dans une phrase ou des phrases, des phrases dans/avec les fragments, de la disposition des éléments dans l’espace de la page… L’enjeu étant, qu’il s’agisse d’un livre ou d’un film, de parvenir à capter, traduire, et exprimer plastiquement les sentiments, ouvertures au passé et au présent que la confrontation avec les mots et les images peuvent produire… En dehors de quelques hypothèses esthétiques et politiques de départ, je ne savais absolument pas ce que j’allais faire lorsque j’ai commencé le livre, les directions vers lesquelles le travail de l’écriture, de l’immanence allait me mener, quelle forme le livre allait prendre, quelle forme allait se développer, les agencements qui seraient les siens… et pour cause, puisque le sens, on l’a vu, n’est pas préalable au discours mais en constitue l’avenir, l’inconnu.
Ce que la forme du poème, du film, met peut-être en jeu, dans ses conditions d’apparition et son surgissement, dans son existence forcément dissensuelle, c’est l’opposition entre la « police », c’est-à-dire l’organisation, l’établissement des corps, la distribution des places, et de l’autre la « politique », c’est-à-dire l’interruption du dispositif de la police. Cette irruption de la forme est tout autant une irruption démocratique qui provoque une césure temporelle, un « espace-entre-les-hommes-et-les-choses », pluriel, complexe, riche d’une immensité de gestes, d’accents, de manières d’être, de conflictualité, d’actions démocratiques… Un poème, un film, donc, comme une de ces formes qui adviennent, ces formes-figures insurgeantes qui, à l’instar de la « démocratie insurgeante » [1010][1010] Miguel Abensour, La démocratie contre l’Etat, Paris, Ed. Félin, 2004., anarchique, rebattent les cartes, détrônent l’Etat pour rendre à la société civile le rôle de communauté politique dont elle a été dépossédée, subvertissent les catégories, partitions et limites admises, posent les exigences d’une égalité réelle et radicale entre les êtres et les choses, tout en les mettant en contact avec l’inconnu. Une forme-qui-vient-encore…
Extrait du poème « Morceau d’espace flottant 46 »
Elle grogne, la voix de John, la voix plurielle en ses ressacs :
« Celui qui n’a plus de patrie. Et l’idée de la patrie s’en va.
Les vivants s’en vont, les morts reviennent.
Sur la tombe, les fleurs mortelles. Dieu ne frémit plus. Il n’a plus d’ombres, de brumes ensanglantées, ou d’ubacs, et d’adrets jamais plus. Ni ses avatars mêmes. L’idée même de salut ne paraît pas compromise, elle n’est plus, absolument. Tout se joue à chaque fois, à chaque instant.
Ainsi s’écrit, dans le refus résolu de l’Ordre poétique, cercles et panthéons, l’impossibilité d’incorporer la douleur et la faille. Ainsi se consignent, dans le poème-abattoir et ses reflets changeants, ses mots sabirs, son verbe tison, ses phrases biffées-balafrées, le lexique de l’amour et de la captivité, les brusques mouvements d’accélération, visions et percées, réminiscences les plus lointaines, insoupçonnées, les cheminements de la remémoration. A s’en briser les tempes. Déplorations, invocations, évocations, résurrections des vivants et des morts, requiem… Ainsi se lit le poème haschichin, le poème infâme, le poème souillé, le poème épars, brisé, mal équarri, physique et abrupt de la discontinuité, en migration perpétuelle, en avance toujours, arraché irréfragablement à la déposition du jour, aux ultimes scories de la mort de Dieu. Ainsi le geste-qui-élague, sans aveux, toujours réinventé, de l’ennemi déclaré : un écart béant, une manière de se tenir à distance ; d’aller, au-delà des vagues, réalités humaines dans leur ensemble, telle la flamme sur le bois mouillé ; tel le paysage mouvant qu’inventent, sur les prairies et rivières, les déplacements de l’ombre et de la clarté ; tel celui qui saigne sur le papier avec ses ongles, ses griffes, ses sabots, ses pieds. Ainsi la puissance intempestive du cœur transgressif, du poème-crime, du geste-tikkun et des répétitions incantatoires : de nouvelles cristallisations de matières dynamiques et silencieuses, des figures dans le temps.
Quelque chose, quelqu’un, quelque part…
Du fond de ma déréliction, souffle la force lapidaire du vent, les serments du condamné, la haine du pouvoir et de l’autorité, le refus des révoltes aristocratiques. La joie s’avive en ferment. Tout est si soudainement plus vif et pratique : le retour au réel plus ardent, le parfum de l’aubépine plus amer, les sucs du venin plus mortels, la mer du temps enfin aperçue distinctement. J’agite les eaux dormantes, sans impression pourtant de la grâce sur mon cœur boursoufflé de polypes. L’aspersion sur mon corps n’est pas intérieure. Je reste définitivement impur. Je mange encore les blessés et les morts.
Ouvrez les ports !
Seul le chant du barbare peut me sauver de la peur. Une eulogie furieuse, sanglante. Avec lui, son être de chair, d’or et de sang, meurt le désir et l’attrait des mythes, les mystères mantiques, la nostalgie envers le passé. Avec lui, son corps sombre, détruit, vaincu, et qui ne peut être simplement reconstruit, meurt cette idée de la barbarie comme simple figure, antithétique, de la civilisation moderne – Hache ! Mâche ! – face cachée, dévoilée, ignorée-pourtant-toujours-et-encore la doublure du monde. Un revers terrifiant que rappelle la rhapsodie. Une apocalypse X, qui méduse et sidère les vies-oublieuses de leurs moindres gestes – vies-absentes à elles-mêmes et leurs restes tentaculaires, remous, secousses ; vies-éloignées qui vont jusqu’à regarder et vivre, jusqu’à se regarder vivre le spectacle de leur propre destruction, de leur propre anéantissement, comme une ultime jouissance. En pure gelée. L’enfer en images : les vies-scélérates. Avec le corps-cire en torche, dernière lueur, clarté obscure de l’utopie, meurent les idées de l’homme-réceptacle, de la rédemption comme acte divin, de la communauté humaine authentique dans l’avènement de l’Antéchrist invincible.
Un homme est mort. Le scélérat !
Il hâle seul le monde d’ici-bas, il est l’accord mineur, le cancrelat ! Le noyau noir infracassable. Le précipité. Hors de.
Unskilled.

Éditeur : De l'Incidence.
258 pages.
Sortie : 11 septembre 2019.
Entretien réalisé par mail en janvier 2019.