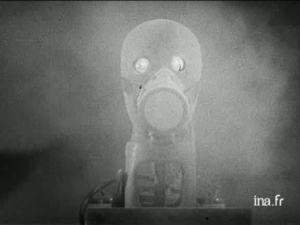Cherchez le veau
A propos de Petit Paysan, Va, Toto et Sans Adieu
Sans adieu est le portrait choral d’une poignée de personnes âgées au fin fond du parc du Forez, en Auvergne ; il est touchant comme il se doit. Ces personnes sont seules, aimables, honnêtes, pas brutales pour deux sous ; elles aiment leurs bêtes – elles sont éleveuses, et se font naturellement les boussoles infaillibles du monde consumériste où les jeunes générations s’égarent.
On ne saurait lui enlever cela : la proximité du réalisateur Christophe Agou avec Claudette, l’empathie dont il fait preuve à son égard, jusqu’à sa façon de mettre en sourdine les effets de cinéma afin d’éviter de passer pour le petit new-yorkais parachuté chez les agriculteurs, tout cela contribue à la justesse du portrait de ces solitudes multiples, de ces gens que le temps, la vieillesse, les banques et les normes contribuent à isoler dans leur campagne.
Pourtant, il y a un mais. Sans adieu sortira au cinéma moins de deux mois après Petit Paysan, d’Hubert Charuel, dont il partage la thématique – la mort à petit feu de la paysannerie étranglée par les normes – et la même séquence centrale – le crève-cœur d’un cheptel malade précocement exterminé. Sans adieu sortira également dans la foulée de Va, Toto, de Pierre Creton, où une nouvelle personne âgée s’entiche, à l’instar de ces agriculteurs attachés à leur animaux condamnés, d’un marcassin que les chasseurs, appuyés par les règles, finiront par lui arracher.
Vouloir tourner avec des animaux sans avoir recours au dressage ou aux images de synthèse place immanquablement les cinéastes dans une position équivoque vis-à-vis de la réalité : Petit paysan a beau être une fiction, les vaches filmées ne jouent pas, elles ; quant à Va, Toto, il met en scène un animal sauvage ayant été éduqué, plaçant d’emblée les images documentaires à portée d’une histoire d’amitié inter-espèce comme la fiction les fantasme. Cette porosité des genres trouve un certain écho chez les artistes, en particulier dans la porosité de la frontière entre les espèces.
L’usage du split-screen chez Creton ne dit pas autre chose, mettant dos à dos le marcassin domestiqué et le chien, transformant par là même la limite entre les plans en axe de symétrie. Et s’il en allait de même des clôtures ? Et si le sort du bétail et celui des éleveurs se ressemblaient plus qu’on l’imagine ? Si le comportement des humains valait celui des chiens ? Les réalisateurs s’interrogent puisque, comme chacun sait, l’heure est à la remise en question de la condition animale.
Le premier plan de Sans adieu est ainsi celui d’une clôture affaissée, inutile, enveloppée dans le brouillard. Vaches et poules boivent à l’eau des mêmes flaques, tandis que la caméra virevolte autour de Claudette, la fermière, comme un troisième animal aux côtés du jard blanc et du chien. Creton et Charuel s’amusent aussi de ces échanges, filmant respectivement un marcassin et un veau à l’intérieur des maisons ; dans Petit paysan, l’éleveur lui-même semble tomber malade en même temps que ses bêtes, et partage presque des symptômes identiques, localisés autour des omoplates.
Ce qu’on appelle le “spécisme”, et qui consiste à tracer des frontières bien droites et perpendiculaires entre les différents états du règne animal, n’a plus rien d’une donnée de base, au contraire. Quelque chose a changé, dont même le cinéma français le plus éloigné des villes, des internets, et de leurs débats philosophiques, a pris acte. Dans ces films à tendance antispéciste, la viande, symbole de la relation traditionnelle de l’humain à ses bêtes, a d’ailleurs quasiment disparu.
Dans les trois films, le seul plan carné, très court, est celui d’une énorme pièce de boeuf déposée à frire dans une vieille casserole, par l’un des agriculteurs de Sans adieu. Pierre Creton cadre lui aussi une casserole en plongée, mais c’est en voix off qu’il indique qu’une saucisse y mijote : le réalisateur tient, lorsqu’on le lui demande, à préciser que seules les lentilles apparaissent à l’écran, et qu’il n’y avait pas de saucisse lors du tournage – ce qu’on peut comprendre, le personnage de son film étant quand même un petit cochon.
Dans Petit Paysan, on ne voit que des légumes, du pain, du champagne, même pas de laitages – tout au plus entr’aperçoit-on un yaourt vide lors d’une scène de dîner, comme en un geste de pudeur vis-à-vis de la finalité réelle du cheptel. Il est alors intéressant de constater que Sans Adieu, qui ne recule pas devant la représentation de la pièce de bœuf, montre également à un moment donné le yaourt en train d’être consommé – geste d’une banalité confondante dans l’écrasante majorité de la production cinématographique mondiale, mais ici lourd de sens.
A l’instar de son personnage principal cependant, qui cherche à dissimuler la maladie de ses vaches, Petit Paysan, très pudique, cherche lui aussi à cacher les choses plus qu’à les révéler ; et il y a sans doute quelque chose du gag (quoiqu’involontaire) lors de la scène de dîner galant, où l’éleveur semble se dépêcher de finir son repas avant le plan large fatidique révélant le contenu des assiettes – un poisson dans celle de la jeune femme, plus rien dans celle de l’éleveur.
Il ne sera donc plus question que de laitages ; finie la viande, et la laiterie est naturellement un décor commun aux trois films (même si elle n’apparaît que furtivement chez Creton, lors d’un cauchemar). Rappelons que La Famille Bélier, qui rassembla sept millions de spectateurs en 2014, se déroulait dans une famille de fromagers, et que l’héroïne y prenait en amitié l’un de ces veaux inévitables dans la production de lait de vache.
La justification de ce tropisme laitier est au fond assez simple. Pour faire de la viande, il faut nécessairement tuer ; pour faire du lait, non : on réservera naturellement la tendresse pastorale aux éleveurs qui, a priori, n’ont rien des bourreaux. Le seul rapport à l’animal d’élevage est celui de la traite, et leur mise à mort est systématiquement vue comme une tragédie.
* * *
Toutefois, il y a toujours un mais. Le commerce du lait, lui aussi, apparaît litigieux. Dans Sans Adieu, la traite des vaches est filmée avec, en off, la voix d’un reportage sur des parents souhaitant mettre aux enchères le prénom de leur progéniture. “On croisera peut-être un jour des gens qui pourraient s’appeler Pampers, ou Coca-Cola“, entend-on peu avant le seul et unique plan du film sur un camion citerne venu chercher la production, un énorme logo CANDIA inscrit dessus.
“Quant à l’équilibre psychologique de l’enfant…“, entend-on enfin, juste avant le fondu au noir : l’équivalence est nette, ces vaches soumises à la traite mécanique sont semblables à des enfants vendus par les éleveurs aux multinationales, et il convient ici de déplorer cette mécanisation du vivant, y compris au sein des plus petites exploitations, tout en regrettant le temps où le lait était vendu sans le truchement de camions citerne et de marques.
“C’est un morceau de nous-même qu’on emporte“, s’écrie Jean-Clément, l’éleveur de Sans Adieu, alimentant la thèse de la clôture comme axe de symétrie plutôt que frontière. Et le même Jean-Clément d’inscrire sur son étable, le soir où la bétaillère vient chercher son cheptel contaminé : “Aujourd’hui des gens dits intelligents de la société moderne viennent prendre des vaches, des animaux innocents, dans les étables, pour les assassiner“. La caméra s’attarde sur l’écriteau pour permettre au spectateur de tout lire. L’idée de “meurtre alimentaire”, chère aux militants de la cause animale, n’est pas loin. Évidemment, ce serait aller un peu vite en besogne.
Petit paysan raconte quant à lui l’histoire d’un éleveur dont les vaches tombent malades l’une après l’autre. Plutôt que de les signaler aux services vétérinaires, il préfère les abattre lui-même : la morale est ainsi celle de Steinbeck dans Des souris et des hommes, à la fin duquel le héros choisit d’abattre lui-même son compagnon d’intelligence moindre, pour ne pas reproduire l’erreur d’un autre personnage, qui était de ne pas s’être chargé d’abattre son chien lui-même. Il est communément admis que cette décision est émouvante et que celui qui abat lui-même ses bêtes est moralement supérieur à celui qui confie la sale besogne à d’autres.
Les agissements contraires aux normes européennes du petit paysan éponyme sont cependant rapidement épinglés par la gendarmerie. Mais plutôt que d’avouer avoir tué puis brûlé ses bêtes – ce qui serait criminel – celui-ci confesse à propos de sa dernière victime : “Je l’ai mangée.” Cruelle ironie épinglée, quant à elle, par Hubert Charuel : il n’y a de meurtre alimentaire à proprement parler que si l’animal meurt pour rien. S’il est tué et mangé, tout rentre dans l’ordre – en l’occurrence, satisfaits par ce mensonge, les gendarmes laissent le paysan repartir, moyennant quelques steaks gratuits.
C’est ici que le bât blesse, et que les films échappent à leurs auteurs. La production de lait, tout comme la production de viande, a besoin que des “animaux innocents“, pour citer Jean-Clément, passent à l’abattoir : si une mère n’enfante pas, elle ne produit pas de lait ; et si son bébé reste en vie, c’est lui qui en profite. Les bébés doivent être injectés dans le circuit de la viande, de manière à ce que le lait soit redistribué aux humains – voire, comme c’est le cas dans Va, Toto, aux marcassins. Cette contingence, au sujet de laquelle le système communique peu, implique une violence extrême allant de la séparation des mères et de leurs petits à la mise à mort de ces derniers. Or ces veaux constituent le point aveugle de ces films du tropisme laitier.
Sachant cela, en effet, comment comprendre l’écriteau de Jean-Clément ? Et comment comprendre la scène finale de Petit Paysan, dans laquelle Pierre offre une mort douce, médicamenteuse, au veau qu’il a recueilli chez lui ? De deux choses l’une : soit le massacre est perçu comme un problème, et l’euthanasie de l’une des victimes programmées est une manière de révéler, en creux, le sort de celles qui n’auront pas bénéficié d’une telle euthanasie, soit le massacre n’est pas adressé dans le film, auquel cas l’euthanasie finale ne révèle rien, sinon la bonté d’âme du bourreau malgré lui.
La scène qui suit celle de la bétaillère dans le film de Christophe Agou est en ce sens très révélatrice. Au camion emportant les animaux vers la mort succède une séquence où Claudette déplore que son chien lui ait tué ses poules. Prédation humaine d’un côté, canine de l’autre ; toutes deux paraissent injustes, mais la première profite de l’aura naturelle de la seconde. On n’y peut rien, c’est comme ça. Les chiens tuent des poules, et les humains, des vaches.
C’est qu’il faut écouter Jean-Clément jusqu’au bout, lorsqu’on lui enlève ses bêtes : “Ayez le courage de nous rémunérer !“, conclut-il. Il serait terriblement réducteur de prétendre qu’il n’y a, entre les hommes et les animaux de ces films qu’un rapport purement financier – tout Petit Paysan ne veut d’ailleurs démontrer que cela, comment Pierre souffre du massacre de son cheptel non pas pour des questions financières, mais bien symboliques, affectives (“ça n’a jamais été un problème d’indemnité“, clarifie Pierre). Cela étant dit, la tendresse de l’éleveur pour ses bêtes n’est pas la dimension la plus convaincante de Petit Paysan.
A l’exception des papouilles au veau rescapé, et de quelques caresses sur les cuisses de vaches dont la tête est hors-cadre, on ne voit pas l’acteur approcher de la tête d’un animal, par exemple, ou lui manifester une affection réelle, d’un individu à un autre, entre quatre yeux. En l’occurrence, quelques erreurs de script révèlent le peu d’attention porté aux animaux filmés : la première vache tuée est par exemple la 2304, mais c’est finalement la 5001 qui manque (un second visionnage s’imposerait, mais il est très probable que le réalisateur n’ait pas porté beaucoup plus d’attention à la continuité des étiquettes que les gendarmes se satisfaisant de steaks achetés au supermarché en imaginant manger l’animal de l’éleveur grâcié).
Petit Paysan et Sans Adieu passent ainsi pour exemplaires en matière de condition animale, mais cette exemplarité se constitue, dans les deux cas, sur l’escamotage du sort des veaux dans les exploitations laitières. Pierre est cet amoureux des bêtes qui envoie certes des dizaines de veaux à l’abattoir chaque année, mais n’en est pas moins proche des mères qu’il continue d’exploiter. S’il est capable de les tuer lui-même, à la hache ou au fusil, et les yeux dans les yeux, c’est par amour – d’un amour que ne partage pas le réalisateur qui, lui, détourne le regard, et épargne au spectateur le plan de l’animal brutalement mis à mort, fidèle à une société où les vidéos de L214, révélant justement le moment du trépas, passent pour plus obscènes que le trépas en lui-même.
La concomitance de ces trois films – et en particulier de Petit Paysan et Sans Adieu, où le rôle de l’élevage laitier est véritablement central – correspond peut-être à un désir, pas forcément conscient, de réagir à la vague de vidéos à scandale publiées par L214, justement, comme si le temps était venu de permettre au cinéma soutenu par les régions de se réapproprier l’élevage, de ne pas le laisser devenir ce monde entièrement dévolu aux images militantes. Une guerre du visible est en cours, opposant L214 (entre autres) à ces réalisateurs français tournés vers leurs racines campagnardes avec un idéal de relation homme/animal en tête.
Mais le spectre des images volées aux abattoirs plane sur ces fables bucoliques, et la scène d’accouchement mécanisé de Petit Paysan ressemble aujourd’hui terriblement à une scène de vulgaire décapsulage – puisqu’il faut enlever le veau pour pouvoir prendre le lait.
* * *
Toute femelle filmée en train d’être traite porte avec elle le fantôme du petit à qui son lait se destinait. En 2016, Gorge Cœur Ventre, de Maud Alpi[11][11] Voir notre entretien avec Maud Alpi, publié le 15 novembre 2016., avait bien tenté de fixer ces fantômes, de les accompagner dans la zone sale de l’usine ; mais se sera vu refuser les honneurs de la Semaine de la Critique – contrairement à Petit Paysan l’année d’après. Et en 2014 sortait discrètement Les Chèvres de ma mère, de Sophie Audier, qui mentionnait la nécessité d’envoyer les chevreaux au boucher, et le chagrin qu’en concevait sa mère. Coïncidence non-négligeable : c’est avec Gorge Cœur Ventre le seul film récent sur le sujet à avoir été réalisé par une femme.
Non seulement ces fantômes sont aujourd’hui ignorés, mais la caméra de Charuel et Agou filme délibérément ailleurs. Une telle diversion n’a malheureusement rien du geste artistique, tant elle est typique dans un pays dont la culture gastronomique repose à ce point sur l’utilisation de bovins en grands nombre. En 1996 déjà, Florence Burgat (qui a sorti L’Humanité Carnivore au Seuil cette année) remarquait dans Le Monde diplomatique, que “attachées aux seuls aspects sanitaires, les discussions autour de la “vache folle” occultent le sort et la condition des animaux d’abattoirs, désignés comme les coupables, en aucun cas les victimes.” Nous sommes en 2017 : les animaux ne sont peut-être plus les coupables, mais pour Petit Paysan et Sans Adieu, les victimes restent les paysans.
L’idée même d’euthanasie, antithèse de l’abattage, innerve d’ailleurs le film de Charuel, le personnage de Bouli Lanners déplorant en effet qu’au lieu de l’aider à se reconstruire financièrement, l’état lui rembourse des médicaments (“Comme ça tu meurs, mais tu ne t’en rends pas compte !“). En attendant, lors du long trajet de la Charente à la Belgique – pays de l’euthanasie ! – qu’effectuent les vaches de Pierre, celles-ci n’auront pas droit au moindre plan qui rappellerait au spectateur leur existence dans la remorque de la bétaillère. Les véritables expendables, ce sont elles.
Sans Adieu, en revanche, ne manque pas d’inserts réguliers sur les yeux des animaux, y compris dans la scène de la bétaillère ; mais n’en finit pas moins sur cette séquence où une grand-mère joue avec trois chatons. Les campagnes regorgent plutôt d’histoires de portées tuées à la naissance : comment ne pas reconnaître la même ironie terrible qui consiste à s’attacher à un veau exceptionnellement euthanasié, plutôt que de parler de ceux qui meurent ?
“Il y a un truc qui pue, on ne sait pas ce que c’est“, inculque Pierre à son père dans Petit Paysan, pour le préparer à mentir à la gendarmerie. Le projet du film est celui-ci. Se convaincre qu’on ne sait pas, s’habituer à ne pas voir ; escamoter ce qui dérange. On puce un nouveau-né, on lui perce une oreille ? Hop ! Le bébé est aussitôt baptisé “Biniou”, façon d’annuler la rudesse du puçage. Comme dans La Famille Bélier, où le veau baptisé “Obama” est voué à disparaître bel et bien sans adieux, “Biniou” n’est appelé par son prénom que lors de son baptême, preuve que celui-ci ne sert véritablement que de cache-misère à la scène du puçage.
Petit Paysan raconte comment un éleveur cherche à cacher le cadavre de ses animaux, quintessence du récit publicitaire de l’industrie de l’exploitation animale, où la question majeure consiste à cacher tout ce qui pourrait couper l’appétit des clients – c’est-à-dire les cadavres. Le bowling où se rend Pierre avec ses amis apparaît d’ailleurs comme le reflet de cette machinerie opaque dont on ignore comment elle fonctionne, mais dont on se satisfait qu’elle continue de toujours remplacer les quilles abattues par des nouvelles. Quant à la séquence où Pierre verse de l’alcool sur les plaies de ses omoplates, elle ressemble comme deux gouttes d’eau à une scène d’autoflagellation.
Mais en surface, l’illégalité selon Charuel ne tient pas au fait d’avoir tué deux vaches malades à la hache et au fusil plutôt que de les guérir. Officiellement, Pierre ne s’autoflagelle que d’avoir désobéi aux recommandations de la vétérinaire. La mort prématurée des bêtes, inhérente au fonctionnement d’un élevage, est niée ; la laiterie passe presque pour un sanctuaire. On considérerait volontiers qu’un tel choix scénaristique est sans importance s’il n’apparaissait pas intimement lié au choix idéologique qu’il défend : l’élevage comme unique garantie de la relation de l’humain aux animaux. Sans lui, c’est l’apartheid. Cette théorie douteuse, défendue sur les ondes par la tristement célèbre Jocelyne Porcher, chercheuse à l’INRA, est parfaitement mise en scène lors du plan final de Petit Paysan. Pierre passe devant une vache dans un pré. Il pourrait aller vers elle, sans l’exploiter, gratuitement – mais l’ignore et s’en va. C’était l’élevage ou rien. Privé d’exploitation, le petit paysan tourne le dos à l’animal, à la caméra, au monde, et disparaît au fond du plan.
De même la flûtine entendue au générique de Sans Adieu est-elle aussi l’écho de ce choix idéologique-là, évoquant une utopie champêtre et non-violente qui n’a jamais existé, n’existe pas et n’existera jamais, mais dont le film se permet néanmoins d’être nostalgique. En regrettant que les animaux, à l’instar de leurs éleveurs, soient mis à mort par un système moderne déshumanisé, les cinéastes formulent en effet l’idéal d’un monde où, la relation individuelle primerait, et où la mise à mort n’aurait plus rien de scandaleux. Imagine-t-on un commerce s’éteindre sans scandale ? Si parallèle il y a, il est en effet ailleurs : dans l’absurdité affichée de ces éleveurs qui aiment leurs bêtes et les tuent quand même, semblable à une France qui aime ses agriculteurs, mais ne fait rien pour les maintenir en vie.
Pas plus que l’état français, Charuel et Agou ne semblent prêts à renoncer une fois pour toutes à la mort des plus humbles. Leur cinéma reste un cinéma de Porcher, ou d’Élisabeth de Fontenay, citée plein cadre dans Va, Toto, dont l’un des personnages lit Le Silence des bêtes à voix haute : c’est-à-dire un cinéma qui, comme Élisabeth de Fontenay dans son entretien avec Karine Lou Matignon (“Les animaux considérés”, dans Les Animaux aussi ont des droits) considère à la fois qu’il existe “une hideuse contradiction entre les soins attentifs qui pourvoient quotidiennement aux besoins des bêtes et la finalité ultime de ces soins, à savoir l’abattage“, mais qu’il n’existe “pas de réponse” à la question de justifier le droit de vie et de mort que s’octroient les humains sur les bêtes. Un cinéma de l’impasse, en somme.
Qui sait si la réponse – laissée en suspens par Gorge Cœur Ventre avec les paroles de Show me the place, de Leonard Cohen – ne finira pas par venir ? De ce besoin de fables pour étouffer le malaise ressenti vis-à-vis des animaux à l’heure des caméras de surveillance, Pierre Creton est en tout cas celui qui se satisfait le moins des mythes consolateurs à base de petit paysans au grand coeur. Va, Toto est farouchement antichasse (quoique pas au point de choquer les chasseurs ayant participé au tournage), plutôt antiviande, pas antiélevage (Creton ne cuisine pas de saucisse, mais comment renoncer aux choux à la crème?). Sa manière de recourir au split-screen pour illustrer la variété de nos relations aux animaux en dit cependant plus que toutes les larmes de crocodile des éleveurs chez Agou et Charuel.
Que le cinéma soucieux d’animalité soit devenu végétarien est une avancée précieuse. En attendant de virer végane et de laisser tomber les salles de traite aussi, de citer Burgat plutôt que Fontenay et de ne plus ignorer les veaux dans les bétaillères, il reste voué à n’offrir que des films plongés dans l’ombre, baignant dans l’impensé, à n’offrir qu’un cinéma hanté – je veux parler bien sûr de ce veau euthanasié par Pierre, son maître aimant, sur un canapé de cuir qui n’embarrasse personne.
Va, Toto, un film de Pierre Creton, avec Ghislaine Paul-Cavallier, Vincent Barré, Pierre Lavenu (sortie le 4 octobre 2017 ; durée : 94 mn).
Sans Adieu, un film de Christophe Agou (sortie le 25 octobre 2017, durée : 99 mn).