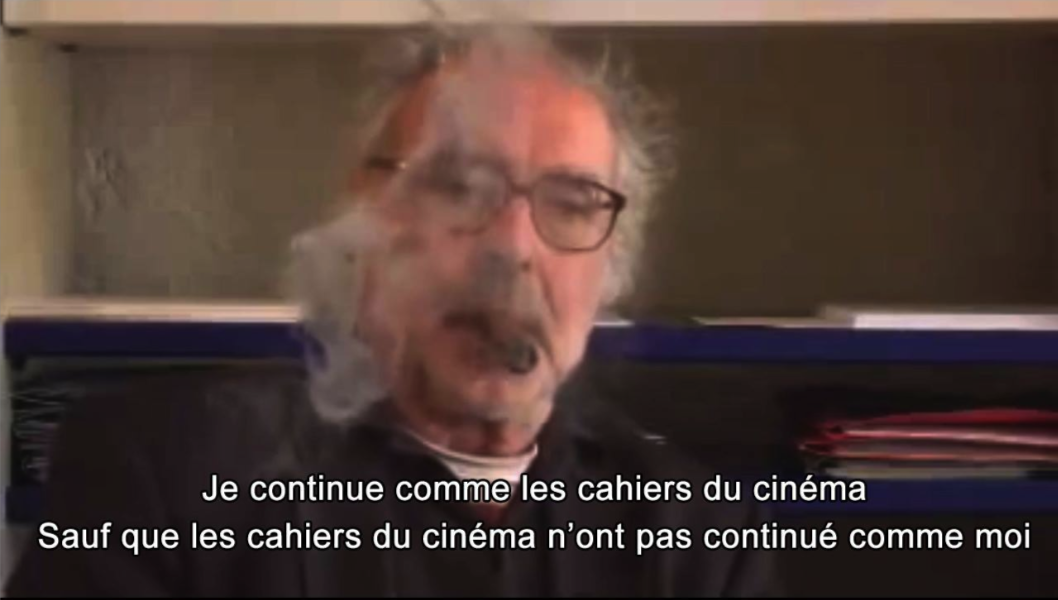Criticon 2
Addendum au bibendum
Ce texte fait suite à un autre qu’on pourra lire ici. Mais, comme le tout est sans queue ni tête, on pourra tout aussi bien faire l’économie du premier épisode et, même ici, sauter de bout en bout, balader son regard au hasard des envies, sans chercher le chemin d’une progression théorique qui, avouons-le, n’existe pas. L’ensemble n’est qu’un chapelet de truismes sur la critique. Choses que tout le monde a en tête, mais qu’il est bon parfois de mettre sur le bout de la langue. D’où cet étalage qui vaut plus pour les papilles que pour les neurones.
***
Depuis quand s’enquiquine-t-on à critiquer ? Bien des lustres. Platon déjà s’y amusait dans quelques uns de ses dialogues ; mais son Socrate de papier ne s’y attaquait guère à un faire ou une manière : il visait, au choix, le propos de tel auteur, Homère en tête, ou l’être même de la représentation. L’intersection des deux, le travail d’une œuvre, jamais. Méthode appelée à durer, soutenue par une théorie des arts en forme de grande architecture essentialiste : longtemps, il n’y eut d’autre critique à faire que la condamnation d’un écart par rapport aux règles de l’art. Corneille dans ses différents Discours ou Racine dans ses préfaces se contentaient encore de constater l’adéquation au code, ou de justifier de légères entorses (ainsi pour Bajazet). Critique-grille, qui coche cases et critères, délivre des certificats de conformité. Il n’y a, dans ce régime des arts, que des degrés de perfection, pas d’apologie de la singularité ; et, dès lors, rien qui ressemble à une histoire conçue comme empilement de mouvements, série de lézardes dans l’édifice de l’art.
Il revint à Diderot et quelques uns de ses pairs, illuminateurs précoces, de bousculer un peu le schéma. La critique, encore timide (la presse, son humus naturel, demeure alors rare), naît concomitamment à une nouvelle conscience de la mode, pauvre victime de l’ironie voltairienne et de la bile rousseauiste, et, surtout, à l’idée de Critique comme fête et combat de la raison, lutte du lampadaire spirituel contre les ténèbres et scléroses des vieilles dominations. La critique n’apparaît réellement que lorsque l’image du temps se réforme, quand il devient ontologiquement différence (pour les classiques, il était tout au mieux dégradation, ce qui justifiait que l’on conserve un même idéal réglé). Et la critique d’art, appuyée sur la conscience de l’humaine inconstance dont la mode lui offre le spectacle, appuie en même temps la Critique dans son opération de balayage historique, époussetant les poussières d’intolérance et autres dérogations aux principes de la raison naturelle. De là qu’on ne juge plus, alors, selon les canons et autres règles intronisées par le temps ; mais l’alliance de la critique esthétique et de la Critique morale et politique entraîne la première sur un terrain qui n’est qu’à moitié le sien : si on peut à l’occasion s’ébaudir devant tel épanouissement du trait, tel modelé ou incarnat, le jeu des formes n’est pas l’alpha et l’omega de ce propos ; le discours sur l’œuvre prétend avant tout exhiber le discours de l’œuvre, sa moralité – ainsi Diderot sur Greuze. Cela pour la rallier à la lutte en cours. En ce siècle de mutation douce bougeait en premier lieu le discours, ou du moins était-il ce qui dans le changement se laissait le mieux percevoir ; c’était à lui, et non aux formes, qu’étaient dévolus les grands pouvoirs de transformation sociale. La conscience de l’historicité des pensées semble avoir émergé avec celle de l’historicité des formes.
Et elle a duré alors que cette dernière se profilait tambours battants. D’où la longue bataille du XIXe siècle, scolairement étiquettée « de l’Art pour l’Art », en vérité querelle entre deux régimes critiques, celui hérité du siècle passé mais désormais au service d’une bourgeoisie ayant pompé aux classiques une idée décolorée de la « bienséance », celui d’une classe paradoxale, plus esthétique que sociale, qui, de Hugo à Baudelaire et jusqu’à leurs tardifs épigones, entend introduire dans le régime des arts la perturbation que 1789 a entraîné en politique. Aucun homme de plumes qui à l’époque ne joue sur les deux tableaux : rien de la séparation un peu trop schématique qu’on connaît aujourd’hui entre « créateurs » et critiques ; pas d’écrivain alors qui n’ait formé sa langue et son oreille dans l’écoute et le rendu de la prose d’un autre. C’était encore le cas pour Zola, pour Proust. Cela parce que la critique était le lieu où se formait la conscience historique, la saisie du présent ; l’homme qui prétend au nouveau doit d’abord inspecter l’état de l’art et l’aventure des formes. C’est là tout l’argument du Peintre de la vie moderne. Et, donc, cette nouvelle critique pour qui les guerres de l’art sont révolutions formelles entend s’affranchir de la vieille tutelle moralo-discursive : l’art pour l’art, c’est surtout l’art contre la moraline. Le monument de ce conflit : la préface dont se fend Théophile Gautier pour son Mademoiselle de Maupin, allègre massacre des critiques s’offusquant pour un rien, mettant tout à l’index, tonnant contre la dépravation des mœurs que catalysaient des livres comme les siens. Et Gautier d’y opposer l’indifférence de la forme et le scintillement du verbe, d’en appeler à un jugement rendant justice au ciselage du langage.
On sait qui a gagné cette guerre. La critique morale vivote encore çà et là, rarement prise au sérieux, même par nos institutions scolaires. Les honneurs vont, de Baudelaire à Blanchot, de Bazin à Burdeau, à la critique des métamorphoses formelles, à celle décryptant un certain état du langage ou des images. Principal signe de ce déplacement, l’emphase mise sur la « vision » au détriment du « discours » (jeu connu de bien des critiques, qui consiste à montrer que sous l’idéologie apparente d’une œuvre se cache une toute autre Weltanschauung). La vision : noyau secret, foyer d’où rayonne le tout de l’œuvre, lieu où se noue la cohérence d’un travail formel et d’une fable humaine ; espace, surtout, où se réverbère une individualité profonde et cachée qui n’est autre que le Moi créateur. Paradigme formulé par Proust dans Contre Sainte-Beuve, qui achève de rompre avec la vieille mode analytique. La nouvelle critique n’est pas séparable d’une certaine image de l’individualité. De là que l’image de l’art qui la sous-tend se fonde sur un certain mythe de l’œuvre – terme qui, chose notable, a d’abord été mis à l’honneur par les alchimistes, désignant la sublime transformation, le stade ultime de la création ex nihilo. Solidarité de l’individu clôturé et de l’œuvre totale, de l’individualité supérieure et de la vision dressée contre la doxa, de la vie devenue art et de la forme contrant le nivellement social : monument contre excrément, ainsi se comprennent les productions de l’art à l’époque romantique, qui est encore, à moitié, la nôtre.
À moitié seulement. Deux siècles de vie ont suffi à éroder en partie ce paradigme. Et ce n’est pas le moindre des paradoxes du cinéma que de s’être trouvé le cul entre deux régimes. D’un côté, il a été investi, très tôt, par tous les tenants de la nouvelle image de l’art, par des wagnériens comme Faure ou Canudo (le cinéma comme art du peuple, donnant au peuple moderne la mythologie qui lui correspond), par des esthètes qui voyaient en lui la grande synthèse après laquelle tout le XIXe siècle a couru. De l’autre, il représentait une sérieuse entame dans les fondements du nouveau régime qui déjà vieillissait. Celui-ci se résumait en une formule : l’art est l’ennemi de l’industrie (Godard est le dernier avatar de cette croyance). Le cinéma, art monnayé, oblige à un remaniement du complexe critique, qui n’a jamais complètement eu lieu. Les séries télévisées annoncent une dissolution plus prononcée encore du système de l’œuvre. Même l’image de l’individu qui a porté cette dernière s’est vue passablement retouchée ces dernières décennies : adieu âme forclose, être barricadé autour du soi – Deleuze, Foucault, Lacan et consorts ont fissuré cette carcasse morale, fait du sujet un ludion multiple, un homme peuplé par l’Autre, bref rien du Moi consacré se consacrant par une œuvre lui renvoyant la belle image de son intégrité morale et psychologique. L’œuvre s’est dissoute dans un textualisme post-moderne. Or la critique telle qu’on l’a longtemps exercée et que, faute de savoir où donner de la plume, on perpétue encore, est solidaire de ce navire qui sombre. Reste à savoir si elle coulera avec.
***
La formule de Buffon, « Le style, c’est l’homme », a fait date dans nos sensibilités. Cœur de l’œuvre, mais également son enveloppe et sa chair, le style fait mine, pour une critique digne de ce nom, de point névralgique de l’analyse : là, en amont de tout récit et le déterminant secrètement, antérieur aussi à toute idéologie qui n’est plus que l’expression discursive d’une vision s’incarnant en premier lieu dans une syntaxe, là, dans ce lieu sans lieu, qui se confond avec le corps de l’œuvre tout entier, là se trouverait la vraie palpitation que la critique entend attraper, le principe génératif, la voix ou le regard après lesquels courent nos gros sabots analytiques. Les textes fameux de Proust, Barthes ou Sontag sur la question, faisant du style une coloration personnelle, une mythologie intérieure, l’arrangement singulier du monde en lequel s’exprime une individualité, n’ont fait que préciser l’adage buffonien. Le style est la serrure du Moi dont la critique doit trouver la clé.
Hélas, ce style est à la fois la chose la plus appréciable et la moins qualifiable. Effet par excellence – le choc produit par une œuvre, le doux frisson et les serrements du cœur ressentis devant elle ne sont fonction que de lui –, il est aussi ce dont les causes sont les plus élusives, les plus rétives à tout discours. Scénario et propos laissent beaucoup plus facilement prise à la parole critique, parce qu’elle y trouve du déjà-langage, des éléments plus aisément convertibles en écriture. Malheureusement, aucune critique sérieuse ne peut s’en tenir à cela ; aussi dangereuse que soit l’utilisation d’une telle topologie de la profondeur, on peut poser sans grand risque que fable et formules forment la surface quand le style, ce secret à ciel ouvert, représente la seule véritable étoffe, le lieu idéal que se doit d’investir le verbe-bistouri. Récit et idéologie appartiennent à l’exprimé ; réductibles à des propositions, ils deviennent facilement l’objet d’un énoncé. Le style, lui, est l’expression même, et dès lors l’exprimer se révèle tâche des plus ardues (mais pas impossible).
Graal de la critique, substantialité insubstantielle, objet qui, pour le langage, est semblable aux mets que contemple Tantale et qui se retirent dès qu’il croit les saisir, le style nargue les plumitifs, les pousse aux plus grandes audaces verbales, force à toutes les torsions et autres alambiquages que la langue admet. Douleur sanctifiante : car c’est dans cette chasse au style que la critique s’approche au plus près de cet art vers lequel elle lorgne, c’est par cette adresse langagière qu’elle déploie – le style ne peut se dire que par figures et suggestions, par une langue nécessairement métaphorique, violentant l’usage régulier des mots – qu’elle égale le plus cet art dont, jouant à son tour de l’expression, elle n’est plus, d’un coup, le laquais, mais bel et bien le pair. Pour dire le style, il faut bien en avoir. Voie vers l’art.
Autre paradoxe princeps : le fait que l’œuvre critiquée soit, dans l’élan même de la langue qui s’en empare, jugée inépuisable. La plume qui la cerne sait qu’elle lui échappe ; et, comiquement, la critique ne se justifie que d’ainsi se limiter, coagulant du sens sur le fond de son hémorragie potentielle. L’œuvre est diamant, à la fois insécable et riche de mille facettes. Elle ne se contemple que comme ensemble, mais toujours à travers un prisme, une réfraction singulière du regard. Toute critique s’avouera partielle (et, à l’occasion, partiale), mais fera de cette troncature inévitable l’argument de sa vertu : sa force tient à cette violence réductrice, à ce puissant perspectivisme – c’est probablement depuis Nietzsche que l’idée de critique se voit inextricablement mêlée à cette idée de regard axial mué en volonté de puissance : il aura fallu un philologue démentiel pour que la critique passe enfin pour prétention d’un regard monadique à rabattre le monde dans son éclairage intérieur. Elle est vision de la vision, traversée singulière, redécoupage de l’œuvre pour la tailler aux dimensions du soi. L’œuvre n’est donc inépuisable que depuis qu’il y a commerce et conflit des individualités.
Il faudrait retracer cette histoire houleuse qui a mené à l’idée d’une appropriation « personnelle » du texte. Luther en serait l’essentiel jalon, lesdits hérésiarques les malheureux prodromes, Leibniz le grand conciliateur. Mais le véritable basculement est récent. Kant encore, quand bien même c’est dans sa Critique de la faculté de juger qu’on a puisé toutes les théories du génie dont s’est abreuvée la modernité, voulait voir dans le beau le ferment du commun, et promouvoir dans l’œuvre le véritable trait d’union des hommes, le nœud d’un échange qui ne soit pas sanglant. Mais, d’une idée du partage à une autre, du partagé au partageant, elle est devenu le signe de la division, l’éloquent emblème des regards babéliens. D’où que la critique soit toujours, indécrottablement, une polémique (notamment, mais pas seulement, entre revues – la floraison des sites de critique n’a d’ailleurs fait qu’encourager un mélange d’inceste textuel et de lutte fratricide). D’où la virulence légendaire de bien des critiques de cinéma, colère qui n’a rien d’une vertu indignée mais d’une crainte de voir son regard en péril, encourant un désaveu d’existence.
***
Pourquoi des critiques ? Énigme persistante – il y a bien de l’aberration à l’origine de l’écriture. L’argument économiste de la demande sociale, posant qu’il y a de la critique pour répondre au désir de certains qu’on flèche le sens et balise le regard, peine à vraiment convaincre. Les (de plus en plus rares) lecteurs de critique sont pour la plupart des regardeurs autonomes ; ils n’attendent pas des textes un éclairage ou une explication – à la limite, quelques faits de production, un zeste de bio, des graines de contexte, ce qui ne fera jamais à soi seul une critique. La critique n’est pas du côté du savoir à transmettre ou de la lumière à jeter. Elle n’a à voir qu’avec le plaisir, reste à savoir lequel.
Une piste : la critique a pris le relais des salons, s’est même un temps superposée à leur bel art de la conversation. Presque pas de critique au XVIIIe, où les regards échangent leurs vues dans les antichambres et les alcôves, les coulisses et le Trianon. Au XIXe s’amorce la relève. Les piques et louanges que la presse convoie s’originent dans les salons des comtesses et les loges des actrices où s’encanaillent les plumitifs ; la critique n’est que la parlote continuée par d’autres moyens. Balzac l’a splendidement montré dans Illusions perdues, où, incidemment, il démontre par le fait (narratif) que les plumes sont par nature mercenaires, jouets des alliances et vendettas.
La critique viendrait de là, du papotage et autres babils élevés (la loquèle bien connue de feu Daney en atteste). C’est dire que, de toutes les écritures, elle est celle qui s’enracine le plus dans l’oralité, dans la communication. D’où un mode de lecture singulier, à l’écart de ceux qu’on pratique pour les romans ou pavés théoriques. Ceux-là, on s’en imbibe ou on les recrache, on s’insère dans leur monologue. Un texte critique incite à une autre posture, toujours au bord du dialogique, du droit de réponse (tout intérieur). On expérimente l’aventure romanesque, on comprend la somme philosophique, on écoute la critique ; et, dans ce prêt d’oreille et de regard, on discrimine, on acquiesce et rejette : discussion virtuelle qui ne s’exerce pas face à d’autres textes.
Longtemps la littérature s’est considérée comme continuation écrite de la parole (l’entretien, à la Fontenelle ou Diderot, reste une formes majeures du XVIIIe) ; la critique, genre littéraire, hérite de ce trait plus que les autres. Aussi écrit soit-il, un texte critique gardera cette nature d’avis émis et jeté dans l’arène des salons (Internet a quelque chose d’un immense salon virtuel, les forums en témoignent).
***
Le geste critique s’installe dans un monde aux coordonnées balisées par deux pôles aussi dangereux qu’automatiques : l’explication et l’interprétation. Chacune a ses beautés, ses puissances, ses facilités aussi, ses excès surtout. Réduits à leur épure, qui est aussi leur extrême, ces deux archétypes analytiques condensent l’essentiel des travers possibles du regard écrivant. Impossible pourtant d’en faire l’économie ; mais est vertu, en la matière, un usage bridé de ces deux manières, un dosage homéopathique de leurs sucs.
Soeurs ennemies, elles aiment à ce l’on dresse le tableau de leurs oppositions. L’explication tire gloire de sa prétention à la modestie : elle décrit, déplie, démonte, dissèque, inspecte les rouages pour exposer le sens des références et les raisons des figures ; elle éclaire par l’entour, apporte partout sa passion de la transparence. Son idéal : le squelette, c’est-à-dire l’ensemble des parties comprises dans leur unité fonctionnelle. De là que l’explication, très catéchisante, reproche à l’interprétation le désinvolte de ses échappées sémantiques, son évaporation dans les nuages où s’exerce le jeu libre et délié des associations fumeuses. Face à une explication arrimée à l’œuvre, l’interprétation passe vite pour une experte en désamarrage, façon bateau ivre voguant au hasard des remous de la psyché. L’une opte pour le rase-mottes, l’autre pour le vol plané ; l’une enchaîne le sens, l’autre le pousse au vagabondage. Rien pour réconcilier ces deux postulations symétriques.
Sinon la pratique, qui les mêle allégrement. La critique est mélange ; en son phrasé se croisent plusieurs gestes, faisceaux de façons plus ou moins spontanées – princesses de ces réflexes, l’interprétation et l’explication. L’herméneutique et le contextualisme sont notre fatalité. Notre cortex, dressé à ces rigueurs, se rend naturellement à elles. La contemplation pure n’existe pas ; elle est toujours contemplation-peinture, badigeonnage de l’esprit répondant à l’empreinte sur la rétine. Qui, devant un film, ne laisse pas libre cours au trajet délié des associations, redoublant la projection technique d’une projection psychique ? Et qui, devant ce même film, ne décortique pas les signes socio-culturels, ne fait pas rentrer ce qu’il voit dans ce qu’il sait ? Toujours s’initie un double mouvement de décollage et de collage, d’envol du sens et de placage de références. Choses nécessaires.
Choses néfastes aussi, par les écarts du regard qu’elles induisent ; à trop haute dose, interprétation et explication égarent, désorbitent. Cela parce qu’elles fonctionnent sur des opérations de déplacement, solidement assises, l’une sur le Signifiant, l’autre sur le Référent, tous deux objets partiels, supports de fixation à partir desquels dériver. L’interprétation part à la recherche du latent caché derrière le Signifiant, l’explication liste l’implicite plié à l’intérieur du Référent. Or ces deux dessous sont plus extérieurs qu’intérieurs, du moins demeurent des extérieurs intériorisés, des fictions de sens n’appartenant jamais immédiatement à la matérialité de l’œuvre.
Déplacement, c’est-à-dire remplacement. Pour l’interprétation dans sa version hard, chaque élément du film doit valoir pour autre chose : telle image en cache une autre, etc. Méthode propre à la psychanalyse, qui a érigé l’interprétation en science reine : le rêve veut dire autre chose que ce qu’il montre, le discours dit l’inverse de ce qu’il déclare, etc. Le marxisme obéit à un schéma semblable : l’esthétique n’est qu’épiphénomène, produit fallacieux de rapports de production que l’interprète dialecticien doit mettre au jour. Et Nietzsche, confluent historique, résume la formule de ce camouflage : pas de forme ou d’idée qui ne soit émanation de forces souterraines ou fille d’une volonté de puissance qui, suivant les hasards de sa vitalité, entraîne telle ou telle « conception de la vie ». L’œuvre est à interpréter parce qu’elle ne sera jamais, en dernière instance, que l’insidieux revêtement d’une réalité qu’elle masque. Ces trois fondateurs de notre modernité théorique ont englué l’analyse dans une théorie du soupçon : pour interpréter, il faut toujours aller voir ailleurs, substituer à tel élément un autre, associer pour s’éloigner, bref ne jamais s’en tenir au produit esthétique lui-même. Certes, l’interprétation telle qu’on la pratique à l’égard des films s’aventure rarement aussi loin, et n’est qu’une version redux de ce tic théorique. Mais le principe en est identique : idéologiser, métaphysiciser, décrypter la Vision alliée au Signifiant.
L’explication fonctionne sur un même pas de côté vis-à-vis de l’œuvre, une même giration du regard vers son dehors. Sa prétention : lever le voile, apporter le savoir supposément manquant ; c’est postuler qu’entre le film et le spectateur doit s’intercaler l’essentiel maillon de la référence, culturelle ou technique. Postulat qui se prolonge ainsi : le film parle en un langage qui reste toujours à décoder ; il ne trouvera pleinement son effet que lorsque la critique, jouant le beau rôle de relais cognitif, aura armé le regard du public, livré un kit de compréhension. Noyer le film dans un bain culturel, tel est le geste de l’explication. Elle le domestique par le background. On sait les heurs et les malheurs de cette pratique : d’un côté, ce gain de savoir, s’il ne change rien à l’affect filmique, l’enrichit de nouvelles perceptions, et il est parfois précieux de savoir de quelle tradition figurative sort un film, ou à quelle réalité sociale il s’adosse ; mais l’explication, de ce point de vue, restera toujours du côté extérieur de la languette, ne regardera que la face du film tournée vers le dehors, parce qu’elle se voue à n’en comprendre la logique interne qu’en la rapportant à des contenus transcendants. Et, à force d’épuiser ainsi les ressorts de l’œuvre, elle les casse.
« Circulez, y’a rien à expliquer », disent tant de cinéastes. Injonction qui va avec celle, autrement nonchalante, du « Libre à vous d’interpréter tant que vous voudrez ». Double anathème fort compréhensible, qui entend séparer le domaine mécanique du règne de la sémantique. Ils aimeraient qu’on se préoccupe plus du « comment ça marche » que du « qu’est-ce ça signifie » ; ils sentent bien que les jeux de l’interprétation et de l’explication, toutes ces variations libres en forme de fugue disharmonique, permettent surtout de faire l’économie du film dans sa matérialité hétérogène, dans ses dissonances internes et ses fluctuations formelles ; que sous la prolifération du sens se cache la réduction du film à des contenus.
Là blesse le bât : interprétation et explication sont des agents d’abstraction ; elles homogénéisent, ne produisent pour toute image du film que des épais concepts : entités abstraites pour l’interprétation (idéologie politique, sens de la vie, à la limite « thème »), catégories génériques pour l’explication (type de drame, soubassements socio-historiques et autres éléments de contexte seront toujours des cadres, des cases). Étiquettes sémantiques qui voilent le produit sur lequel elles sont apposées. Le sens est la monnaie d’échange de l’œuvre, le vecteur de sa circulation, le moyen de son insertion dans le commerce des hommes. Il y a l’œuvre, matière brute, puissance d’affection valant avant tout par la sommes d’effets mêlés qu’elle provoque – affects en leur fonds indicibles, indémêlables ; et puis, produit d’une distillation de ceux-là, le sens, qui verbalise ce non-savoir, qui fait entrer dans la clarté de l’expression ces impressions multiples. Le sens n’a pas de rapport immédiat avec l’œuvre, seulement avec sa digestion. Il est son tampon social, la marque que l’homme applique au non-humain.
De là que la critique n’a pas forcément rapport à l’élaboration du sens ; la maintenir à ce jeu niveau interprétativo-explicatif, c’est en faire un simple jeu d’écriture qui décore les films par quelques variations verbales et autres jeux d’esprit, c’est réduire toute la portée potentielle de son exercice à du simple coloriage, à des amusements de surface. C’est rater l’œuvre dans son métamorphisme, rater aussi en elle tout ce qui résiste au langage. Difficile aussi d’y échapper : la critique, ouvrière du langage, ne peut pas se soustraire au royaume sémantique, quand c’est le privilège de l’image d’aborder des rivages où cette monnaie n’a pas cours.
Tel est le sens, asile des aveugles et des mâcheurs de mots, fétiche et gri-gri de la critique, leurre des scrivailleurs. L’œuvre est matière, lui éther. Il naît de l’heureux processus d’appropriation de l’œuvre : résonance psychique, écho d’un soi angoissé, biberon de l’âme. D’où le fait que le sens sera toujours existentiel et moral ou critique et politique, bref qu’il sera toujours réfléchi à l’aune d’une conscience individuelle, pensé sous la forme d’une intentionnalité. Le paradigme du sens est marié au mythe de l’expression : l’œuvre ou l’objectivation d’une subjectivité, produit d’un vouloir-dire dont le critique irait chercher la source, le petit soi caché derrière le voile filmique. De là que ce sens sera toujours platement indexé sur une psychologie, fut-elle un peu élargie (englobant la politique considérée, par exemple, comme « critique de la société », etc.), bref une vague morale agrémentée de visions fantasmatiques.
Le sens est le gain que le spectateur prétend tirer du film, le trésor qu’il lui arrache, bonne pour sa petite épargne intérieure. Chose comique, cette quête acharnée du sens croît à la même vitesse que prolifèrent les banals et vains discours sur « la perte de sens dans nos sociétés modernes ». À croire que les deux mouvements sont solidaires, que l’angoisse du vide et le bourrage sémantique se nourrissent l’un l’autre dans une égale inanité.
Tout cela pour jeter un soupçon de doute sur cette vieille idée voulant que la critique soit uniment tournée vers le sens-de-l’œuvre. Se cantonner à cela, c’est s’en tenir à un registre d’effets ; tâche propédeutique, nécessaire mais non suffisante.
Cette recherche assidue du sens témoigne néanmoins d’un autre paradoxe de la critique. Le sens n’est jamais dans l’œuvre ; il est toujours produit, en partie à partir d’elle, en partie à partir du tiers interprétant. Poser que la critique tourne autour du sens, c’est du même coup affirmer que ce qu’elle critique dans un film, c’est ce qu’elle y ajoute. Cela montre assez que toute analyse d’œuvre repose sur l’annihilation de son propre objet.
Il y a un mot à la mode qui dit tout l’anachronisme du critique : l’expertise. Notion reine, même si huée, elle définit un rapport au travail bâti sur un domaine de compétences et une somme de savoir-faire (d’où la diplômanie de notre époque, plus démentielle que jamais – or, on le sait, aucun titre ne fait le critique). Cette expertise qui singularise l’être laborieux de chacun, le critique, justement, ne la connaît pas. Il n’a pas de savoir propre, de capacités bien à lui. Il vient du temps où le bien-dire était le summum de toutes les qualités, où la parlure échelonnait les êtres et où rien sinon un certain art verbal ne permettait d’accéder aux postes et tribunes. Alors le critique était roi, parce que l’esprit généraliste et mobile représentait la vertu par excellence ; trop inexpert dans un monde soucieux de ciblage capacitaire, il est désormais paria.
Pas de savoir pour le certifier : il y a, certes, ladite « culture générale », qui enrichit l’œil et affûte la langue, mais il s’agit typiquement du savoir qui ne se transformera jamais en savoir-faire ; sa nécessité n’a en outre jamais été vraiment prouvée : comment expliquer sinon les débuts tonitruants de tel(le) ou tel(le) jeune critique, au talent déjà assuré malgré un âge trop réduit pour avoir accumulé un trésor culturel important (et inversement, combien de critiques en place depuis des lustres, au regard gros d’images mais dont le verbe fléchit et se ramollit). Ce savoir aux vertus incertaines dont on voudrait faire la « spécialité » du critique est de toute façon trop général pour être un savoir propre ; il a même besoin d’être partagé pour être valide : un critique ne parle en fin de compte qu’à des connaisseurs.
Quant aux capacités, là encore règne le flou : écrire, parler sont choses communes, et choses qui, d’une part, s’apprennent par des voies de traverse, hors des bancs de l’école, d’autre part, ne se peuvent juger sur aucun critère. La dispersion des offices où le critique exerce ses dons n’aide pas plus à définir une tâche spécifique : en plus d’écrire, le critique parle ; d’ailleurs, si son écriture constitue son capital symbolique, le moyen de sa reconnaissance, c’est surtout par sa parole qu’il capitalise argent comptant : il présente des films, anime des débats, déblatère à la radio, pond des fascicules et bonus dvds, parfois professe à la fac ou devant un parterre atterrant de petites classes, bref il vient partout apporter la caution de son inexpertise là où l’on demande un tampon ou une plus-value culturels. Paradoxe assez drôle voulant qu’il légitime du savoir partout alors que sa propre légitimation fait toujours défaut. Guignol culturel, tel est le critique : figure de cire dans le théâtre du savoir, rangé aux côtés de l’universitaire identiquement convoqué dès qu’il y a besoin d’ajouter à la diffusion des films un peu de vernis discursif. Plus que par un faire spécifique, qui n’est jamais que la maximisation d’une activité pratiquée par tous (tout le monde regarde, juge, parle), il est défini par une fonction sociale, par la place qui est lui impartie dans un certain système de circulation.
Ni savoir, ni capacité, ni actions spécifiques : pauvre critique à l’être flouté (et souvent floué), ne sachant vers où se tourner pour trouver une consistance ontologique que toute sa pratique récuse. Une seule définition positive, qui désignerait une manière d’être plutôt qu’un mode d’agir : le critique est l’allégorie d’un certain rapport à l’histoire que nos sociétés ont longtemps valorisé ; il est, par excellence, le possédé de la culture, l’homme qui a les œuvres pour démons, le destin de l’art pour Némésis, bref, il est l’être pétri par le savoir de l’autre. Le critique est historiquement apparu quand la culture est devenue pour les hommes une maladie, une tumeur avec laquelle se débattre en permanence ; plus précisément, quand la culture s’est résolument associée à l’idée d’histoire, quand savoir et devenir sont devenus consubstantiels. C’est une des raisons du relatif déclin de sa figure, qui longtemps a représenté le penseur par excellence : dans une époque qui ne se soucie plus d’histoire, qui n’est plus hantée par un destin que les aventures de l’art emblématiseraient, le critique, homme du diagnostic historique, perd de sa préséance. Cela fait quelques décennies que l’on a confisqué aux formes esthétiques le pouvoir magique que deux siècles de pensée romantique leur avaient conféré ; si l’art perd de sa puissance mystique, le critique perd son pouvoir vicarial.
***
Si la critique a si longtemps trôné sur l’autel de l’esprit, si par moments elle passait même pour activité plus haute que la création elle-même, c’est que son exercice prétendait naturellement outrepasser les frontières du jugement de goût dans lesquelles on la maintient aujourd’hui. La critique fut, lors des grands embrasements intellectuels du siècle, le moyen d’une chronique de la vie de l’esprit, la propédeutique à toute ontologie du présent. La critique alors ne tenait pas en place ; elle débordait son cadre a priori – l’analyse d’une œuvre – pour aller diagnostiquer quelque fait civilisationnel ou s’interroger sur le devenir de la pensée. Baudelaire déjà avait trouvé dans la critique d’art le prisme de la quintessence du contemporain. Les weimariens comme Kracauer ou Benjamin excellaient à ce jeu, relayés en Autriche par Karl Kraus (Kracauer a d’ailleurs formulé cette méthode en de nombreux textes : « L’ornement de la masse » déploie tout l’attirail d’une analyse symptômale, qui attrape l’insignifiant significatif d’une époque pour le constituer en monade éclairant de sa lueur singulière l’entièreté du présent). La revue si bien-nommée fondée par Bataille, Critique, a toujours combiné cette double formule : s’en tenir à des recensions, mais toujours trouver en elles le moyen d’un élargissement du regard. Et les Cahiers, dans leur période trop décriée, dite « lacano-maoïste », avaient érigé la critique de cinéma en critique du monde, lors d’une décennie où des noms comme Barthes, Blanchot ou Foucault avaient fait de la critique l’avant-garde de l’esprit, la déblayeuse des potentialités historiques dans lesquelles les artistes n’avaient plus qu’à s’engouffrer.
Ambition aujourd’hui avariée, du moins disparue de bon nombre des pratiques critiques. On ne sait trop si cet abandon est l’effet ou la cause de la perte de pouvoir symbolique que connaît aujourd’hui la critique. Il est évident que le rôle princier qu’elle avait auparavant était solidaire de cette fonction de diagnostic, et que, en s’en départissant, elle ne fait que creuser sa propre tombe.
***
La France est le théâtre d’un drame domestique : critique et université se chamaillent à n’en plus finir, et la querelle chaque jour s’envenime. Divorce d’autant plus désolant que leurs noces furent des plus douces : on se souvient de ces temps heureux où pour peupler les estrades l’on allait débaucher les prophètes de ciné-club et autres plumitifs à la langue si peu académique. Temps idylliques de l’après Mai, quand le cinéma, achevant la course de sa légitimation, voyait s’ouvrir à lui les portes de l’Ecole. Alors jouvencelle, sans codes ni clans, pleine d’allant et de crédits, la fac de cinéma recrutait à tour de bras dans son dehors, puisqu’elle n’avait pas encore eu le temps de secréter son propre corps de spécialistes. Aussi, la critique avait en ce temps la verve plus théoricienne, et dans les pages des grandes revues on ne dénigrait pas les sommets d’abstraction. Édénique époque d’un savoir non encore scindé.
Et puis vint la discorde et ses torrents d’encre rouge. L’université s’est mise à exiger des titres autres que le renom, et, les décernant elle-même, elle n’a plus accepté comme membres que ceux qu’elle intronisait : fatalité endogamique des institutions. En face, la critique a réduit le champ de son discours (pas nécessairement sa qualité), s’est peu à peu moins gorgée de grande théorie. Et, des deux côtés, les stylos se sont transformés en stylets dès qu’il fallait prendre la plume pour parler de l’autre : aujourd’hui encore, il n’est pas rare de voir tel critique esquinter l’Université, tel universitaire amocher la Critique : ne sont pas visés un individu ou un groupe, mais un dispositif de savoir et une modalité de transmission.
Nuançons : le fossé n’est pas sans ponts, certains portent la double casquette, les deux institutions font parfois montre d’hospitalité pour des émissaires de l’autre camp, et il arrive que chacune se penche sérieusement sur le cas de l’autre, pour le meilleur et pour le pire : numéro de revue sur l’état de l’université, colloque sur celui de la critique. Politesses des plus tièdes, de voisinage plus que d’amitié. Les repas chez l’autre servent surtout à garantir que les deux intérieurs diffèrent, à certifier que chaque c(h)amp est régi par des normes bien à soi, que les deux discours conservent sans danger leurs chasses gardées.
Chose qu’on n’irait pas contester : la distinction d’espèce a toujours été claire ; seulement, jamais un tel degré d’étanchéité n’avait été atteint. Qu’on se penche un peu sur les cursus : les grands « théoriciens » (mauvaise appellation, qu’il faudrait remplacer par « praticiens de la théorie ») aux livres desquels les plus jeunes générations d’étudiants se sont abreuvées de savoir ont fait leurs armes dans la critique (Raymond Bellour, Jacques Aumont, pour ne citer qu’eux) ; certains grands critiques ont d’abord tété les pis de l’université (dernier en date, Antoine de Baecque ; mais ce fut aussi le cas de Rohmer, et d’autres après lui). Cette route sans obstacle entre les deux pôles a été résolument barrée. Les vertus de l’échangisme (diversification, enrichissement, renouvellement) passent désormais pour des vices. Il n’y a plus qu’à attendre un drame à la Roméo et Juliette.
***
Les antithèses séparant ces sœurs ennemies ont déjà été listées (pour faire un peu d’auto-promotion, citons Quantique et clinique, l’excellent article de Pierre Eugène publié dans ces mêmes pages). Remettons tout de même un peu d’huile sur le feu, afin d’en vivifier l’éclat.
Trois traits marquants de l’écriture critique : son impressionnisme avéré (le style est volontiers celui de la notation, petite touche discursive) ; son discours voulu non totalisant (l’esprit de système lui répugne) ; sa superficialité sans complexe (le mot ici n’a rien de négatif : le superficiel est le mode d’analyse de la surface, du symptôme, et non de la structure ; mode virevoltant, à sauts et à gambades, s’embarrassant peu du souci de tout dire, tout parcourir). Traits qui ont souvent participé à la définition de la critique comme forme libre, souple et, parfois, expérimentale : la critique est la « petite forme » de l’essai, sa version miniature : une micrologie.
Traits qui l’opposent point par point au discours universitaire. Si la critique penche vers l’essai, celui-ci est encore hanté par l’idéal de la somme, du traité, mastodonte discursif (à l’occasion pachydermique). Pas d’impressionnisme ici, mais du systématique à gogo, avec une belle charpente conceptuelle, l’impeccable logique pour ciment, la démonstration synthétique pour canon. On voit sans peine se profiler le spectre de la totalité. La recherche, dans son fondement, rassemble. Quoi ? Des sources, mais aussi de la recherche. À rebours de l’allègre superficialité de la critique, le discours académique – en cela tout de même plus modeste et honnête – radiographie ses antécédents, fait le tour des discours d’avant, ratisse, note et cite.
Autre écart entre le critique et l’universitaire, le rapport à leurs objets. Le critique, par définition, brasse large, touche à tout. L’universitaire se vend en tirant argument de sa spécialité (est quand même attendu de lui, dans les comités, une certaine largeur de vue, une connaissance plus étendue que celle que sa thèse affiche). On sait les avantages de chacun des deux modes : aptitude à la comparaison pour le critique, vue panoramique sur le devenir du cinéma ; précision sans faille pour l’universitaire, bibliothèque vivante pour un savoir sans zone d’ombre. On sait aussi les inconvénients : tendance du critique à la dispersion, et donc aux jugements à l’emporte-pièce et autres fanfaronnades infécondes ; risque, pour le chercheur, de se voir atteint d’autisme intellectuel, de cloisonnement cérébral (combien de fois n’a-t-on pas conseillé aux apprentis académiciens d’aller se construire un igloo au pôle nord pour être sûrs que personne ne vienne marcher sur leurs plates-bandes – spécialités de cagibi).
Il en est pour user de la distinction nietzschéenne entre esprit de pesanteur (l’université) et esprit danseur (la critique). Et d’autres d’évoquer celle, météorologique, entre le brouillard et le temps clair. Mieux vaudrait se réclamer de Pascal et de sa partition plus équilibrée entre esprit de finesse et esprit de géométrie (cela pour identifier des pôles, plus que des types).
***
Au-delà de toutes leurs dissensions, malgré la vendetta infiniment reconduite, critique et universitaire sont solidaires dans leur déclin historique, dans leur inéluctable déclassement. Plus précisément, l’universitaire comme Professeur, le critique comme Plume, soit les deux comme signatures, comme cachet intellectuel. Le nouvel ordre du savoir est comptable ; l’information, les données en forment la manne. Le traitement auquel il invite est de compilation plutôt que de confection. Des intellectuels dont le savoir-faire consiste en une certaine virtuosité, en un habile jonglage avec les références, en puissance du Regard converti en splendeur du Verbe, ne peuvent que sombrer en ces eaux plates, familiers qu’ils sont des tempêtes de l’esprit. (Le signe le plus net de cette mutation dans l’économie de la pensée est la fin du modèle de la controverse, des grands débats houleux. Les vieux chevaux de bataille – tel programme esthétique, telle idée de l’art, telle défense et illustration – ont été envoyés chez l’équarrisseur.)
Ce qui disparaît ici, c’est aussi une certaine alliance du savoir et de l’autorité (Professeur et Plume sont autant d’avatars du Maître). On ne peut que s’en réjouir.
***
En novembre 1936, Goebbels fit interdire la critique d’art qui, à ses yeux si « spécialistes », revêtait des caractères par trop juifs. Le maestro ès propagande de masse, aux discours duquel ne manquaient pas un certain lyrisme de l’art, voyait dans la gente critique les mêmes traits anti-Volk que le nazisme prêtait aux Juifs : intellectualisme outré teinté d’une nuance d’individualisme (qui juge s’écarte du lot), mépris pour les affects sans mélange et autres élans fusionnels sous la bannière du Reich. Bref, un parasitisme malvenu : le critique, comme le Juif, désagrège le Tout national, entame la belle rondeur organique de la communauté. Avec lui se perdent et l’innocence et l’immédiat, c’est-à-dire la pureté d’un rapport ne s’encombrant pas de réflexion.
C’est un discours qu’on entend encore parfois de nos jours, débarrassé de ses oripeaux antisémites.
***
Autre récrimination moins hargneuse mais tout aussi catégorique, le fameux « Tout ça, c’est de la branlette. » La pique fait mouche ; sa seule erreur est de voir ici le motif d’un blâme quand cette alliance avec l’asticotage de nos doux organes devrait plutôt être porté au tableau des bons points de la critique. Car, après tout, la masturbation est une pratique à laquelle s’adonne la très grande majorité de l’espèce humaine (voire animale), et généralement non sans plaisir ; elle vaut toujours mieux que la castration qui, la psychanalyse nous l’a appris, se rattache elle à tout le registre des interdits (celui d’agiter sa langue comme celui de branler son mou).
Mais, l’onanisme réhabilité, l’injure n’est pas pour autant essuyée. Mieux vaut en saisir les ressorts. L’anathème contre le plaisir solitaire est somme toute récent ; l’un des premiers à en faire sa marotte, c’est Rousseau, qui dans l’Emile l’affublait du titre de « dangereux supplément ». Supplément dans deux sens : parce qu’il supplée au digne coït, mais surtout parce qu’il est le bonus par excellence, le non-nécessaire, et, partant, le gâchis stérile, un cancer dans l’ordre des plaisirs que la nature instruit. La branlette, c’est l’excès. C’est aussi l’imagination enflammée (Rousseau bannissait également le roman des outils pédagogiques, parce qu’il attise des sens que le précepteur ferait mieux de veiller à tenir en laisse), et surtout l’égoïsme, le soliloque de la chair. Démoniaque Onania, qui épuise les réserves des êtres en les laissant disperser leur foutre aux quatre vents.
S’explique ainsi ce qui est reproché à la critique par ce soupçon de souillure. Masturbatoire, elle l’est pour représenter tout à la fois un plaisir surajouté et une pensée débridée, parcourant sans frein les chemins du sens. Et, comme la pollution (mot favori de Sade, depuis hélas tombé en désuétude), elle ne produit rien, gâche à l’envie.
C’est bien vrai. Que ce soit là un mal est moins évident. Que ce soit la définition de toute pensée l’est déjà plus : réfléchir ne sert pas à grand-chose, sinon à se délecter d’idées et autres émulsions cérébrales qui sont autant de friandises de l’esprit. La chose débouche rarement sur une quelconque locomotion. L’esprit branle le monde, qui s’en moque bien : formule de toute philosophie.
Et puis sait-on jamais. Jupiter, en agitant son divin membre dans le ciel olympien, a bien dû inséminer par accident quelques nymphettes d’ici-bas. Idem pour le critique, qui parfois ensemence l’Histoire par un jet d’encre.
***
Les Romantiques allemands, ancêtres de notre cérébralité contemporaine, avaient posé en un seul mouvement deux axiomes : que toute opération poétique est en même temps monument critique, soit qu’en l’œuvre se marient expressivité et réflexivité, faisant de la critique la modalité fondamentale de tout regard ; que toute attitude d’esprit est par nature foncièrement ironique, soit dédoublée. La distanciation permanente de l’esprit par rapport à lui-même et la potentialité critique inscrite dans chaque œuvre vont de pair. Coïncidence historique qu’on oublie trop souvent.