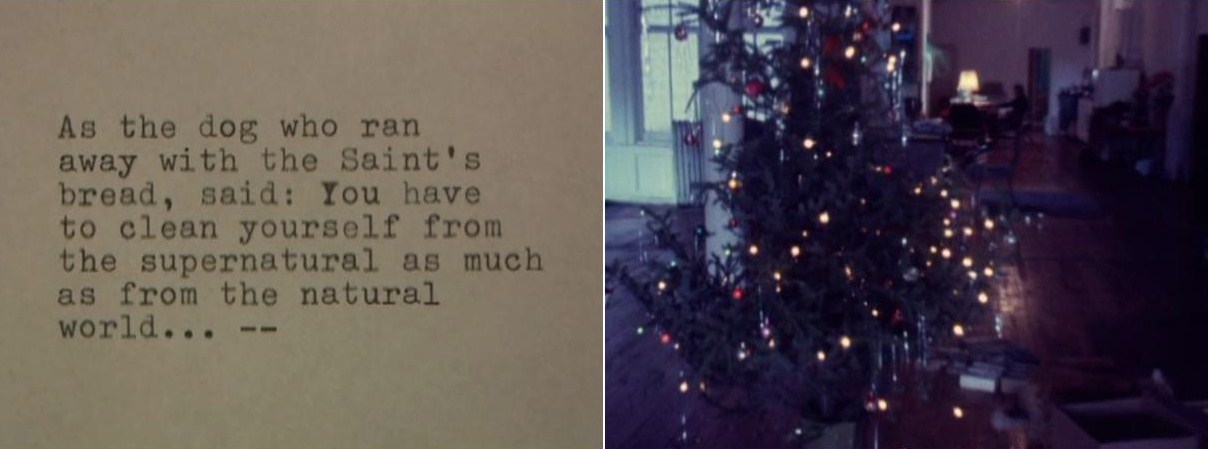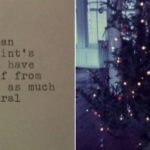Du soleil pour les yeux
Mosaïque critique d'une année de cinéma
***
Au jour le jour, sous la forme d’une brève note ou d’un montage visuel, seront convoqués quelques plans, motifs, sensations ou idées de cinéma qui nous ont retenus, et que nous voudrions retenir encore un peu. Ainsi s’esquissera, avec les pleins comme les creux, notre mosaïque critique de 2014.
***
Le soleil et l’amour. « Ne filme jamais directement le soleil ». Tel est l’avertissement donné, dans Computer chess, au novice en cinéma chargé de conserver les traces d’un improbable tournoi de programmation informatique. Se développant en un circuit intégré (intérieur / mental), le film trouvait sa fin, libération et agonie, dans une anti-lumière, qui, brûlant les capteurs alors que le caméraman tournait son objectif contre le soleil, se répandait en un épais sang noir jusqu’à nous dérober l’image – ou, mieux, offrir l’image d’une image qui disparaît. Faire face au soleil, c’est mettre en péril le cinéma ; c’est le faire advenir aussi, en confrontant le regard aux principes – physique, technique, imaginaire – qui le fondent. Présence absolue, qui nous rappelle que l’image n’est jamais qu’absence, trace de ce qui apparaît dans son éloignement même ; et que ce qui est absolument là, ne peut se deviner que dans l’aveuglement. Aveuglé, le jeune frère de Fred l’est, lorsque ce dernier, tel un ange, apparaît dans son dos auréolé d’une lumière d’or. Si Mange tes morts croit au miracle, il n’est jamais sulpicien. La lumière y est ce qui protège et ce qui blesse, un bouclier et une lance – ce par quoi la chair se manifeste dans toute sa glorieuse fragilité. Elle est déchirure. C’est depuis cette déchirure fondatrice qu’un commun se tisse, se retisse. Communauté des amoureux de Sunhi, la si bien-nommée, absente à soi et rayonnant pour tous, les réchauffant, suscitant en eux l’élan du langage – qui ne comble pas, mais marquant les écarts, ouvre au partage. Sunhi, figure d’une démocratie amoureuse, sans élection, se liant à tout un chacun dans l’intensité fugace de la rencontre. C’est encore cela que présente Vers Madrid – The burning bright, à l’échelle d’un pays. Ce soleil démocratique, enfin arraché aux dieux et aux rois, dont les « indignés » ont fait autre chose que leur marque ; le signe de la puissance d’être-là et de rayonner des corps-lucioles d’une communauté en construction permanente. Pour les gueux, pour les yeux – du soleil, toujours.
R.N.
***
Du rouge, s’il vous plaît. “Je ne sais pas au juste comment être Amy la morte” : la phrase se trouve au milieu du roman de Gillian Flynn (Les Apparences), au moment où Amy Dunne a épuisé tous ses rôles (celui de la fille cool, de l’épouse mal aimée, de la victime) et songe à disparaître pour de bon. Alors qu’elle roule vers un motel où elle pourra enfin prendre du repos – se reposer, en somme, de tous ses rôles –, Fincher la montre morte au fond d’un lac, coulant au ralenti. D’un gris verdâtre, cette image n’est pas dissonante par rapport aux teintes générales du film. La fiction du journal, la fausse disparition, le jeu de piste élaboré par Amy n’ont pas changé la couleur de ses jours : tout est toujours aussi froid et terne. Les eaux du lac ont la même couleur que sa chambre, sa cuisine, sa salle de bains. Commence alors le moment creux de Gone girl, un des plus intéressants du film, celui où Amy s’empiffre devant la télé, en attendant d’être quelqu’un d’autre. La couleur des cheveux a changé, le beau teint de porcelaine est devenu blafard, le visage de Rosamund Pike, ravissant dans le plan d’ouverture, paraît maintenant gras, presque bouffi. Amy est tombée au bas de l’échelle sociale, et explore d’autres nuances de gris : non plus le gris chic et aseptisé de sa jolie maison résidentielle, mais celui glauque d’un motel, où on la voit, pour la première fois, pleurer et sombrer.
Dès lors, le dernier mouvement du film n’a plus qu’à organiser le retour d’Amy dans la grisaille de son intérieur froid et pourtant étrangement confortable (comme souvent chez Fincher), un intérieur où tout paraît trop grand: la douche à l’italienne où a lieu l’explication avec Nick, la cuisine dans laquelle Amy a retrouvé sa place, comme un personnage de catalogue, le lendemain de son retour. Mais avant cela, la couleur aura brutalement jailli, lors du meurtre de Desi Collings, l’ancien prétendant d’Amy. Pour la première fois, une sensation de chaleur passe dans le film : sous le tranchant du rasoir d’Amy, le cou de Collings s’ouvre comme une fontaine, laissant gicler le sang, procurant enfin à Amy la jouissance qu’elle a cherchée auparavant par des moyens plus intellectuels, plus retors (le faux journal, le faux scénario policier). Le sang est tellement chaud et revigorant qu’Amy le garde sur sa peau jusqu’au moment où elle rentre chez elle, retrouvant alors ce gris dans lequel toute couleur doit disparaître. Le rouge écarlate du meurtre de Gone girl a la beauté de tout ce que le personnage d’Amy a cherché durant sa “disparition” : la sensation de la “première fois”. Du premier baiser donné par Nick – autre superbe scène, où les lèvres d’Amy se couvrent de sucre – au premier meurtre, Gone girl raconte, comme Under the Skin ou Nymphomaniac, la quête de sensations d’une femme qui ne ressent plus rien.
J-S M.
***
***
Une année de chiens. Les toutous, fidèles amis du cinéma. On aura vu cette année trois modes canins représentant autant de postures existentielles et de façons de communi(qu)er. Roxy Miéville dans Adieu au langage, chien solitaire et rilkéen, errant de par la clairière de l’être et les forêts du sens, attaché à son esseulement pour mieux laisser résonner en lui la déraison du monde et l’éclat de la terre. Les quatre molosses d’Et maintenant ?, habitants du jardin des plaisirs et de la paix construit par Joaquim Pinto, vivantes allégories des félicités douces et de l’amour sans orage, figures aussi de la communauté restreinte ne s’ouvrant au bonheur que par la clôture de son enceinte. Et puis la meute vengeresse de White God, infect pamphlet qui, s’il avait pour lui la belle intention de se faire métaphore d’une percée de la haine en Hongrie, parvenait à une morale inverse à celle des deux films qu’il adoptait pour ancêtres : quand The Birds proposait l’image d’une violence aveugle et immotivée, il raisonnait sur les justes vengeances du ressentiment ; et le White Dog de Fuller, radioscopie d’un racisme enraciné dans le pays au point qu’il en devient instinct, ne se retrouvait nullement dans ce film au titre si proche, au discours si lointain, qui persistait à voir dans la xénophobie non le fait d’un dressage collectif, mais une simple affaire individuelle. La horde de canidés hongrois, de ne se donner pour cibles que quelques ennemis des bêtes au lieu de se réunir en confrérie des opprimés luttant contre une organisation qui les bafoue, ne pouvait dès lors que devenir chasse sauvage et imbécile engagée dans un combat sans avenir ni vision.
Trois façons d’être-avec. Rester seul pour se lier avec le Tout. Se barricader dans une utopie verdoyante. Suivre un énième chef qui, comme toujours, ne promet que l’ivresse des carnages. Notre politique n’ira donc pas chercher dans les chenils ses modèles. La communauté est à pister ailleurs.
G.B.
***
Vers l’avenir. Dans Les Combattants comme dans Bande de filles, un jeune adulte quittait une existence collective trop lourde à porter (le quartier et ses coercitions pour Marieme / Vic ; l’héritage du père pour Arnaud) afin de s’affirmer comme individu. Pour l’un et l’autre, l’apprentissage de la vie d’adulte, la construction de son individualité, impliquait de s’exclure de son milieu pour se tourner, seul, vers l’inconnu. Par leurs plans conclusifs, ces deux films « sur la jeunesse », réalisés par de « jeunes auteurs », entraient en écho, proposant l’un des héros-type de l’année : le « combattant ».
À cette image, on pourrait opposer celle d’un film « de vieux », où une ouvrière et mère de famille effectuait précisément le trajet inverse. Seule, exclue de son travail par un vote suspect, Sandra partait à la rencontre de ses collègues, le temps d’un week-end, pour les convaincre de voter à nouveau – pour elle cette fois. La démarche du personnage était similaire à celle du « militant » : le porte-à-porte évidemment, la répétition d’un discours qui se rode peu à peu, malgré des fluctuations selon les interlocuteurs, les réponses qu’il faut essayer d’apporter aux questions de l’autre. Avec, en ligne de mire, l’organisation du travail et un processus démocratique tronqué qu’il faut réparer. Alors que pour les premiers, l’existence nécessitait une sortie – individualiste, « survivaliste » – du social, pour les Dardenne, la vie commence quand, par le contact, la parole, l’obstination, on (se) mobilise pour une cause juste. C’est cet apprentissage que fait Sandra. Alors que la fiction s’ouvre sur elle endormie, déprimée, apathique, elle trouve, progressivement, à tâtons, les mots et les gestes pour parler, argumenter, parfois convaincre l’autre. Peu importe alors qu’elle retrouve ou non son emploi, ce qui compte, c’est qu’elle soit parvenue, pendant deux jours et une nuit, à entrevoir la possibilité de s’opposer à sa condition, et par-là-même, car les deux vont ensemble, à exister et à faire exister autour d’elle une communauté qui a cru en son combat, et qui peut-être a été ravivée par lui. A la fin, quand à son tour elle part seule vers l’avenir, ce n’est pas uniquement en son nom, mais aussi au nom de ceux qui l’ont accompagnée, qu’elle prononce les derniers mots du film : « on s’est bien battu. »
F. LD.
***
***
Sirkmania, 1. Ce n’est pas une tendance, ni même une déclaration ou un rassemblement de forces. C’est peut-être seulement une perception. De nombreux films, cette année, m’ont fait penser à Douglas Sirk et aux années Cinquante. Je pourrais l’expliquer par un goût du classicisme et mon épuisement devant des revendications de modernité, pour le dire vite, totalement détachées du monde et de la nécessité de vouloir le mettre en images. Pas seulement, cependant. Cette pensée dirigée vers le cinéma de Sirk est ce qui reste quand j’ai tout oublié des films. Je suis certainement injuste, et les films dont je parle sont de qualité variable mais quelque chose se fixe ici, où la fiction se développe pour mourir souvent après, comme en manque d’oxygène.
Le plus évident est Une nouvelle amie, le meilleur film de François Ozon avec Gouttes d’eau sur pierres brûlantes, qui prenait son élan dans l’aspiration du cinéma de Fassbinder. Les références à Sirk sont fréquentes chez Ozon, mais rarement avec cette ampleur, cette profondeur et cette connaissance marquée par l‘amour. Le tournage au Canada semble être motivé par la recherche d’une maison sirkienne, vaste, avec pelouse verte rutilante, qu’on pourrait presque réduire à sa façade. Le moindre arrière-plan est pensé pour imprimer la pression du regard d’autrui. Ce qu’il y a de plus fort ici est qu’Ozon, grâce à Sirk, essaie d’associer la couleur qui éclate et le secret qui naît, qui sourd, qui emmène la conscience dans son trajet personnel. C’est ainsi que la question sexuelle ou amoureuse est moins importante que le rapport d’un être à son secret, à la façon dont il l’incarne (comme le personnage de Duris) ou dont il repousse sans cesse le moment où il doit faire corps avec lui (c’est ici le personnage de Demoustier). Il sait aussi amener un final bouleversant en gardant l’affect et le chromo social, en cherchant à travers la situation dramatique et excessive non pas l’explosion, mais l’aveu, la tendresse, le sens du toucher et de l’étreinte.
J-M S.
***
Sirkmania, 2. White Bird de Gregg Araki a aussi ce sens de la banlieue pavillonnaire, cette description des architectures et des espaces, ce rapport entre l’explicite du social et l’intériorité de l’individu. Ce ne sont pas ces scènes qui m’ont touché, même si les grandes haies, les piscines bleues sur fond vert sapin me plaisent. J’évoque surtout le personnage de la mère aveugle, profondément sirkien, ou profondément attachée à une conception de la fiction, pour laquelle l’individu, en quittant le centre social, se confronte à l’aveuglement – comme une marge, un danger mais aussi un seuil de transformation. Regard du voyant, de la mère, du vide, regard sans fonds, rivé à une solitude mythologique.
Mommy de Xavier Dolan n’a pas la conscience aiguë d’Araki : il n’a le sens ni de la perte, ni du risque. Il confond l’emphase et l’affirmation, mais il a ce sens du voisinage buté, peuplé d’hommes creux, presque des vigies de science-fiction n’existant qu’un court instant pour étonner de leur bêtise avant de disparaître magiquement. Bref c’est la folie pavillonnaire, et elle fonctionne, elle justifie même le goût de la réclusion et du rapprochement dans ces cocons criards. Cette intimité élargie et presque vulgaire au début permet aux familles, aux âges de se recroiser, de faire circuler leurs sentiments et d’acquérir un forme de grandeur in extremis, grâce à la laideur bienveillante du réel.
La fin de Love is strange montre a contrario la maturité d‘Ira Sachs que Dolan ne cherche pas à atteindre. L’adolescent reçoit un frêle héritage d’un grand-oncle mort et pleure dans l’escalier : il possède la pudeur muette et fragile d’un personnage de Gus van Sant. Mais il vient d’un cinéma classique, celui de Sirk ou de McCarey, où la question de la représentation est liée non à la naissance des larmes mais au choix d’un lieu et d’un temps pour pleurer. Ici, c’est entre l’entresol et un vasistas, contre le mur, à l’écart, comme pour les meilleures scènes de ce film. Cet écart est celui entre la fonction narrative et la nécessité d’une incarnation, entre une transmission ratée et une compréhension différée. Alors, il reste les larmes, non comme un aveu, ni même comme un discours, mais comme un héritage aussi décisif qu’une absence et aussi essentiel qu’un don.
J-M S.
***
***
Cinémarmaille. Moonfleet. Les yeux maritimes de John Mohune fixent le roublard Jeremy Fox avec la calme immensité de l’écarquillement. L’enfance est là, dans l’ouverture d’une iris – identique à celles qui, il y a bien longtemps, ouvraient les plans d’un cinéma nouveau-né –, dans l’éclosion d’un désir qui sait devoir s’armer de patience ; car l’enfant songe avant tout à son devenir d’adulte, et trépigne, sait combien le temps est long quand si peu d’années sont déjà passées. Ses yeux, en attendant, se soustraient à l’inscription d’autres désirs que celui de grandir. C’est cela, l’enfance : le non-écrit, même si déjà sillonné. Son nom est utopie, lieu impossible où se marieraient conscience et innocence, où la feuille vierge laisserait transparaître ce qui existe sans être pour autant – car être, c’est être fripé, froissé, plié.
Utopie qui fut l’autre nom du classicisme. La galerie de mioches ayant chahuté les écrans cette année nous avertissent en fanfare que ce temps est révolu. Rares y furent, Boyhood mis à part, les gamins qui ne soient pas marqués. Les gosses sont déjà gros d’un temps qui, en définitive, n’est que celui de la dégradation. Les trois sœurs du Yunnan montrait un trio de frangines d’ores et déjà accablées par le soc et la charrue, l’empuantissement de l’atmosphère et l’absence parentale. Même trauma pour le chétif bambin de L’institutrice, poète précoce habité trop tôt par les rafales du sens et les saignements du verbe, inspiré donc imprimé, et sans espoir de ratures. Le pauvre Quinquin n’est pas plus laissé indemne, son innocence supposée étant d’ailleurs rayée dès la première séquence lors de laquelle il propose à sa douce de lui enfoncer un rongeur dans l’anus. La palme de la perversion revient au Benjie de Maps to the Stars, enfant sans enfance, drogué jusqu’aux yeux et trop au courant du monde, damné pour n’avoir déjà plus rien à découvrir, et dès lors promis à un prompt décès. L’enfance n’a plus lieu, n’a plus de lieu. Elle est dévorée par des initiations rognant sur son vide salutaire. Seul Mange tes morts mettait en garde, tout en manifestant l’échec : son scénario secret, c’est la vaine préservation de l’innocence de Jason, qui finalement contemplera la mort. Et Mommy indiquait, bien malgré lui, l’envers de cette disparition : une adolescence s’originant plus tôt et ne s’éteignant jamais, bref, à la place d’un blanc un jour remplacé par le savoir et ses tranquilles noirceurs, l’empire d’une immaturité qu’on aura du mal à faire passer pour de l’insouciance. Et si, selon l’adage connu, l’enfant est le père de l’homme et, partant, l’avenir du monde, on ne pourra déduire de son éclipse que l’évanouissement des possibles sur lesquels s’étaient édifiés les rêves du passé. L’espoir de l’altérité meurt avec la latence dont les mômes étaient l’heureuse annonce.
G. B.
***
***
Le temps de deux séances. Par deux fois cette année, le temps aura été mis à l’épreuve. Dans Boyhood, le temps ne se déversait que du réservoir des possibles. Dans Edge of tomorrow, le blocage produisait un changement. Le film de Linklater doit au premier abord énormément à l’enregistrement et à la reproduction d’un temps qui passe. Chacune de ses ellipses mettait en jeu une avancée irréversible, sensible à même les corps des acteurs. Mais sa beauté naissait de la rencontre entre cette perspective documentaire, conséquence de l’étalement du tournage, et une écriture qui permettait de penser ce temps coulant dans une ouverture permanente. Ce processus conduisait alors à une double fin, advenant tout autant sur le support matériel de la toile que sur un écran mental où beaucoup ont pu voir un baiser (interactivité, n’est-ce pas ?).
Edge of tomorrow, grâce à la générosité du fantastique qui permettait à Cage (Tom Cruise) de revivre la même journée, rendait de son côté effective et visible la suggestion de Boyhood, la potentielle différence contenue dans un moment. Face à une menace extra-terrestre, il s’agissait dans ce cas d’accumuler de l’expérience jusqu’à l’accomplissement d’une bonne version – celle qui mènerait à la victoire. Si son principe le rapprochait du jeu vidéo, lui autorisant un traitement léger voire primesautier de la mort, le film s’en distinguait par une contestation de l’enjeu de départ, induite par l’évolution du personnage. L’attachement sentimental de Cage à Rita venait en effet parasiter la mission militaire. L’objectif, plus que gagner du terrain, progresser, pouvait être de gagner du temps à passer ensemble – le fantasme, quand la bataille fait rage, d’une soirée au coin du feu. Et si la victoire était au rendez-vous, on s’en réjouissait moins que de revoir un visage unique, celui de celle qui, ne se souvenant de rien, restait à conquérir (la suite immédiate doit avoir quelque chose d’Amour et amnésie).
Mais si ces films offrent l’image d’un temps sans platitude, susceptible de se creuser ou se multiplier, chacun le donne à percevoir à travers un récit mettant en place une évolution de ses personnages. Chacun invite à reconsidérer l’importance de la durée dans l’expérience cinématographique, au sein de laquelle l’articulation des images rend sensible les pliures et autres contorsions du temps. À songer, aussi, qu’il n’y a pas d’autre temps cinématographique que celui d’une séance.
R.L.
***
L’éternité des familles. Au contraire d’Interstellar, Boyhood, tourné pourtant sur 12 ans, n’aura offert aucune image, marquante ou spectaculaire, du temps, ni même de la famille, au sein duquel s’ancre son récit. Cette absence tient à la pudeur traversant le film, qui empêche tout autant la famille que le temps de vraiment « prendre ». C’est une pudeur particulière, de celle qui lie un frère et une sœur n’osant pas se dire au revoir, s’embrasser ou se prendre dans les bras. La pudeur également d’un fils qui, en partance pour la fac, se sent gêné à l’idée de fêter ce départ, de prendre part à l’émotion de ses parents, de se retourner pour voir le chemin parcouru – cette pudeur adolescente qui répugne à témoigner son affection par les gestes ou les mots, pour qui un câlin serait déjà incestueux. Le temps et la famille, profondément liés, sont affaires de coupes dans un mouvement, de cérémoniels, ici toujours désamorcés par la retenue des uns et des autres. Recouvert d’un voile de pudeur, le temps se donne alors difficilement à ressentir. Rien ici ne s’approche de la scène, très belle, de visio-conférence d’Interstellar, qui vise à une débauche lacrymale que ne recherche pas Boyhood. Le film de Linklater n’apparaît ainsi jamais comme spectaculaire : le sentiment familial travaille chaque scène souterrainement. Dans le classicisme américain, la famille s’aimait et ne perdait pas une occasion de se fêter. Meet me in Saint-Louis de Vincente Minnelli, par exemple, était un film quasi-théorique sur les efforts mobilisés par une famille pour que rien ne change. Même une série post-moderne comme les Simpson fonctionne sur un principe d’immobilité : tout peut arriver (même l’invraisemblable) pendant l’épisode, pourvu que tout reprenne sa place à la fin, condition de l’éternité familiale.
Dans Boyhood, il y a ces très belles scènes où Mason, accompagné de sa copine, rend visite à sa grande sœur étudiante. Ils se rendent à un concert, jouent au billard, atterrissent dans un bar et dissertent sur le chemin parcouru et l’âge adulte. Ils passent la nuit à se concentrer sur un sentiment qui ne cesse de leur glisser entre les doigts, se demandant l’un l’autre où peut bien se trouver cette étape qu’ils sont censés, aux dires de tous, avoir franchie. Tout à la fois excités et stupéfaits par cette nuit parfaite et ces heures de liberté qui s’étalent devant eux, ils tentent de vivre le moment présent – un peu complaisamment, un peu maladroitement, exactement comme le faisaient déjà Julie Delpy et Ethan Hawke dans la trilogie des Before. La grande délicatesse de Linklater consiste à confier son film au regard légèrement distrait et immature de Mason, à ne jamais parler par-dessus ce regard-là : la question n’est pas de savoir si Mason est bon photographe, mais de ressentir sa ferveur et sa confiance, de percevoir le sentiment qu’il éprouve d’être fait pour ça. Ce qui importe est cette sorte de cogito adolescent n’advenant que par intermittence, au milieu de plages entières de distraction vitale.
Linklater passe son temps à consciemment désamorcer l’idée qu’il puisse arriver quelque chose, une mort, un accident, qui ferait se précipiter la conscience du temps. C’est discrètement qu’il fait se répondre deux plans, et là encore, c’est une affaire de regard : Mason enfant allant chercher sa mère encore étudiante à la fac, puis quelques années plus tard, Mason adolescent pénétrant une salle où elle donne cours, l’observant furtivement mener sa vie. Les deux situations étant trop éloignées pour interpeller Mason, c’est à nous que Linklater offre d’apprécier ce temps-là, cette ligne du temps qui en cachait une autre : un motherhood dissimulé derrière un boyhood. En cela, l’étalement du tournage permet d’offrir l’expérience d’un temps qui passe sans crier gare, sans jamais se mettre en scène. Changer les acteurs au fil des années, se servir de maquillages ou d’effets numériques, reviendrait à prendre en charge et à conscientiser le passage du temps. Mais ce qui intéresse Boyhood est bien cette distraction sérieuse avec laquelle nous ignorons le temps, bien que lui-même pense toujours à nous. Le temps a sa propre justesse, accomplit un travail qu’aucune simulation de vieillesse ne pourrait égaler – il est plus imprévisible, plus dévastateur ou plus clément qu’on ne le pense: il possède son propre jeu d’acteur et Linklater lui laisse ici toute la place d’improviser.
M. J.
***
***
Cache-cache. Aspiré puis rejeté, perdu, désorienté, notre regard s’était abîmé en 2013 dans les profondeurs infinies d’un espace aux coordonnées labiles voire absentes (Gravity), ou échoué à la surface d’un écran qui grésillait de pixels (Pacific Rim). Léviathan construisait même sa dramaturgie de la perception sur cet épuisant ressac : de la toile tendue d’un ciel aux lourds nuages pommelés jusqu’à un océan sans fin constellé d’étoiles de mer, il n’y avait qu’un mouvement, celui qui liait indissolublement chalutier et caméras. L’illusion de profondeur extrême comme la recherche d’une surface pure dépossédait le spectateur de sa position habituelle en régime narratif classique, cette position souveraine où il est le point fixe d’une représentation en perspective et s’organisant pour n’offrir de (rares) troubles perceptifs que dramatisés. L’Homme y perdait sa majuscule, matière presque indifférenciée tramée de rouille et de limon interstellaire. Cette année, Godzilla, blockbuster de circonstance tourné pour le soixantième anniversaire de la bête, a peut-être été l’un des films hollywoodiens à reconsidérer le plus subtilement cette place de l’humain. Parce que, par définition, il ne peut être dans cette série de films que le spectateur impuissant de la lutte entre des monstres figurant des puissances naturelles, la question du regard y est déterminante. L’expérience de la catastrophe est ainsi vécue selon diverses modalités : à travers des écrans, des radars, des témoignages, de manière directe, mais aussi de façon « intermédiaire », comme lorsque par une vitre, un enfant voit une centrale nucléaire s’effondrer. Le cadre offre alors encore une protection, et donne une mesure aux évènements. A contrario, il arrive souvent que des monstres, gigantesques, nous ne voyions que les pattes. Un long panoramique est alors nécessaire pour parcourir ces corps. Epreuve de l’incommensurable, du sublime. Mais le rapport le plus beau entre l’humain et le monstre-catastrophe, s’établit dans un entre-deux. Il est affaire de cache, de cache-cache. Bazin, posant la différence entre peinture et cinéma, disait de l’écran qu’il était un cache, ne pouvant donc « démasquer qu’une partie de la réalité ». C’est cela même que montre Godzilla lorsque son héros regarde le combat des monstres à travers l’encadrement de la vitre d’une voiture. Caché, il ne peut se faire une image de la situation qu’à la condition de déplacer le cache, d’admettre donc la partialité et la précarité de son point de vue. L’humain alors n’est plus ni le point central de l’univers, ni une poussière parmi les poussières : simplement un corps, fragile, faisant peut-être paradoxalement, face aux combats de ces animaux monstrueux, l’expérience même qui est celle des animaux dans le monde qu’il domine. « Vivre en effet, c’est pour chaque animal traverser le visible en s’y cachant. […] Au caché, d’où ils viennent, ils retournent[.] » (Jean-Christophe Bailly, in Le Parti pris des animaux). Avec Godzilla disparaissant en silence dans la mer, l’humain se retrouve face à lui-même – non comme maître et possesseur de la nature, mais responsable de sa propre survie.
R.N.
***
Jeunesse. C’était en mai dernier : Xavier Dolan recevait à Cannes le Prix du jury pour Mommy. Il entamait alors un discours-fleuve, qui, dans sa partie la plus lyrique, s’adressait à la jeunesse (« my generation », clamait-il). Ce qui se produit ce jour-là sur la scène du Palais des festivals est un acte de langage d’une puissance inouïe : un jeune cinéaste de vingt-cinq ans veut emporter avec lui toute la jeunesse, l’incarner, la représenter. « Il n’y a pas de limite – dit-il – à notre ambition ». Quatre mois plus tard, une scène de Mommy vient résonner avec ce discours : il s’agit de la séquence du karaoké sur Vivo per lei. J’ai déjà dit à quel point elle était pour moi embarrassante, mais j’ai oublié de la mettre en relation avec le discours de Cannes. De la scène du Palais des festivals à celle du karaoké se pose pour Dolan la même question : comment affirmer quelque chose de soi tout en étant aussi la voix d’une génération ? À cette grande ambition, qui – il faut le reconnaître – n’a pas d’équivalent chez les jeunes cinéastes français, le film répond par une chanson. Lorsque le karaoké commence, l’éclairage très cru de la scène place Steve en représentation, dans la lumière, comme Dolan au Palais des festivals. Steve a quelque chose à dire, personne ne l’arrêtera. Tant pis si les autres, réduits à un « on » indifférencié et globalement haineux, ne veulent pas entendre Vivo per lei, Steve s’exprime et cette expression de soi n’a pas de limite. L’hôpital (institution qui représente un régime répressif) se chargera ensuite de le faire taire et le jeune garçon – sorte de Chatterton québecois – se libérera finalement de sa camisole pour mourir en incompris.
La chanson de Steve a trouvé un étrange écho, quelques semaines plus tard, dans Hanging Tree, le « chant des partisans » inventé par Katniss, l’héroïne de Hunger games : Mockingjay. Bien que les films soient esthétiquement très différents (Hunger games est un produit industriel assez impersonnel alors que Mommy veut toujours être lyrique), ils posent, par la chanson, une même question : celle de savoir comment une jeunesse peut s’exprimer aujourd’hui dans des sociétés représentées comme aliénantes. Dans Hunger games, Hanging Tree résonne plusieurs fois comme un chant révolutionnaire – fonctionnant même, dans l’une des séquences, comme le signal d’une opération de résistance – tandis qu’à travers le personnage de Peeta, le film illustre les ravages d’un conditionnement orwellien (comme Winston, le héros de 1984, Peeta pourrait très bien soutenir que 2+2 = 5). Alors que Hunger games : Mockingjay nous est apparu comme un simple épisode de transition misant sur le succès économique d’une franchise, le film a pris une autre dimension en Thaïlande, où Katniss est devenue le symbole de la protestation des étudiants de Bangkok contre le coup d’état militaire du printemps dernier. Etrange destin d’une héroïne de film industriel qu’une jeunesse contestataire a arrachée aux gravats de son district pour lui faire jouer le rôle de La Liberté guidant le peuple. Cette récupération politique ne fait pas de Hunger games : Mockingjay un bon film, mais la révolte dont Katniss est devenue l’allégorie (le film ne raconte, au fond, que la création de ce symbole) laisse entendre que la jeunesse a peut-être besoin de s’exprimer sur d’autres scènes que sur des podiums de karaoké. Entre Vivo per lei et Hanging Tree, ce sont deux modes d’expression radicalement opposés que le cinéma a proposés, cette année, à la jeunesse : d’un côté, une position néo-romantique d’affirmation d’une sensibilité, de l’autre, une parole politique certes très simple, mais dont la simplicité même se prête à tous les usages. Tandis que le public français a été largement déçu par Hunger games – en témoignent les notes très basses que le film récolte sur divers sites de critiques en lignes -, la jeunesse thaïlandaise a su s’emparer du potentiel symbolique du film (et notamment du salut de Katniss) pour narguer le pouvoir en place. La belle promesse portée en 2007 par le refrain de The Youth, un titre du premier album de MGMT, s’est peut-être réalisée cette année à travers un film dont on n’espérait pas tant: « The Youth is starting to change. »
J-S M.
***
***
Quel horizon se donner ? En cette année 2014, il est bien difficile de ne pas revenir sans cesse à Adieu au langage tant son inventivité dans l’élégie bouleverse chaque plan. Dans les dernières secondes du film, Godard nous surprend ainsi en repensant l’idée simple d’horizon. Alors que s’est affiché le tout dernier carton du générique, le cinéaste reconvoque ultimement son fidèle Roxy sous la forme de deux instantanés. Un premier plan, classique, livre le chien tout à l’horizon d’une forêt qu’il arpente, flairant et remuant la queue, aux aguets. Mais cette figure définitive d’un monde s’offrant dans le champ de ses possibles se voit aussitôt retournée : dans un second et tout dernier plan, déboulant du point d’horizon de l’image en une course folle, le chien « file » et quitte le cadre, devenant noir sur ses pas, par le bas de sa bordure gauche.
Cette première image d’une figure rendue à l’infini de ses possibles est aussi celle que s’est choisie Xavier Dolan comme dénouement à Mommy : un autre « chien fou » s’y défait de sa camisole pour courir droit devant lui, embrassant de tout son élan, dans un ralenti extatique, la ligne de fuite que lui offre le couloir d’un hôpital psychiatrique. Ligne droite du désir sans fin qui se trouve émoussée par l’envers que pose ce chien surgi de l’horizon et qui suit son fil, passant seulement pour un instant encore dans notre orbite. Dans cette seconde image, l’horizon ne tient plus au dessin d’une perspective donnée mais à sa poursuite – à un élan plutôt qu’à une pose ; plutôt qu’une ligne, son cours. Des profondeurs du champ de l’image à son hors-champ, les foulées de Roxy Miéville ont esquissé pour nous, dans cet ethos de chien fureteur et de fronde joyeuse, un sentiment de l’infini du monde.
À la mesure de cet horizon, la fin pensée par Dolan révèle, dans le circuit de romantisme fléché qu’est Mommy, l’écueil d’univoque qui peut frapper le champ des possibles : y a-t-il vraiment toujours vertige dans ce motif d’une figure portée vers l’infini ? L’impression d’une toile de fond dressée en gage de « liberté » dont l’effet repose sur un investissement émotionnel dirigé vers le seul personnage donne parfois le sentiment que le motif du champ des possibles est la résolution la plus faible, en étant tout et rien à la fois – et l’élan romantique de s’échouer un peu vulgairement en une image de satisfaction, contre toute affection (voir le statu quo de La Vie d’Adèle l’an dernier).
À l’empathie exigée par Dolan répond la démocratie chez Godard. À rebours d’un champ des possibles s’ouvrant large sur son passage, la course du chien perçant l’image fait sourdre une sensation de relief de la dimension immémorielle et vertigineuse portée par cette pulsion de vie en action et qui se dérobe ainsi, irréductible, à la clôture du film. La volte de ces dernières galopades entraîne dans le hors-champ d’un point imaginaire qui est autant celui propre au chien que celui, en retour, du spectateur, faisant résonner à nouveau la maxime ouvrant Adieu au langage : « Tous ceux qui manquent d’imagination se réfugient dans la réalité ». C’est tout à cette troisième dimension ouverte que Godard, dans la course de son chien Roxy, nous a livrés cette année.
S.C.
***
***
D’un chien. Adieu au langage, Ah dieux, oh langage : film en stéréo, et d’abord stéréophonie de l’image, où le passage à la 2D engloutit un plan qui n’existait que par la vue double du relief. Mais aussi stéréophonie du son, un coup giflé sur la droite, un autre griffé sur sa gauche, et, surtout, dédoublement du signifié qui répète le mantra godardien : il n’y a jamais juste une image, car une image est la tension entre deux plans. Image du ciel, de la terre, du corps et des visages, d’un lieu et d’une prière, d’une maison et d’une forêt, de la langue et du monde. Mais comment ? Vingt ans auparavant, dans JLG/JLG le vieux disait pourtant déjà « la stéréo est faite pour les chiens et les aveugles ». Qui sont les aveugles ? Et bien nous, bien sûr, nous en 2014 avant que le docteur Godard inspecte nos pupilles pour nous déciller les yeux. Il nous a rendu la vue en poussant le relief dans ses retranchements, en tirant sur les coutures pour y glisser de nouveau le montage, c’est à dire la différence (un homme / une femme), le contre-champ et la dialectique. Soit tout ce que la stéréo hollywoodienne pensait avoir évacué. L’ermite de Rolles a fait plier l’Amérique en envoyant sa lettre. Une lettre – un courrier – qui détrousse des lettres. Celles d’un nom, le nom de Godard. Godard le maître, Godard le génie, le vieux sur sa montagne de mélancolie qui se défait enfin sous les coups les plus joyeux de son cinéma, des cris d’enfants et le regard d’un chien. Mais d’ailleurs, qui est le chien ? En 1990, le cinéaste lançait dans un entretien : « Je suis un chien et ce chien suit Godard ». Et donc nous y sommes dans ce film-lettre envahi de couleurs et de chants, qui s’achève sur les vagissements d’un nouveau-né et les hululements d’un animal : le chien a rattrapé Godard, comme l’art, qui est la joie et l’enfance, a fait exploser la culture. Voilà Noël, la naissance retrouvée d’un enfant et d’un chien, et bonsoir.
G.O.
***
Textes de Raphaël Nieuwjaer, Jean-Sébastien Massart, Gabriel Bortzmeyer, Florent Le Demazel, Jean-Marie Samocki, Romain Lefebvre, Murielle Joudet, Sophia Collet et Guillaume Orignac.
Montages de Raphaël Nieuwjaer (sauf 6 et 9 : Romain Lefebvre ; et 7 : Jean-Sébastien Massart).