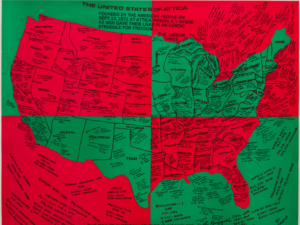Edito # 02
La critique a déjà commencé
Dans notre premier édito, nous faisions de la critique un art, non du clin d’oeil, mais du clignement d’oeil. Suggérera-t-on désormais de se boucher les oreilles ? Oui, en effet.
Vu trois ou quatre jours après sa sortie, Holy Motors de Leos Carax nous semblait déjà un « vieux film ». Fatigué, épuisé, corrodé par la pluie de critiques et d’éloges reçus à Cannes puis dans les 48 ou 24 heures précédant sa diffusion. Pris dans le temps de la communication, il basculait immédiatement, une fois visible, dans celui de l’archive, ce qui, à l’heure numérique, n’est pas loin d’équivaloir à l’oubli. Ce sentiment, sans doute l’éprouvons-nous d’autant plus que nous essayons d’écrire sur, autour et avec le cinéma. Sans avoir rien lu que les titres, avant même d’entrer dans la salle, la question se posait déjà, accablante : que reste-t-il à écrire ? Et, plus terrible encore, que reste-t-il à voir ?
Après avoir découvert Drugstore Cowboy, « d’un certain Gus Van Sant Jr. », Serge Daney écrivait : « Plaisir de voir les films comme on devrait les voir : sans aucune image préétablie, sans rien pour se raccrocher a priori, sans avoir à lutter sourdement contre le « concept » de tel ou tel film. Imaginer un monde à l’envers : le film aurait une semaine d’exploitation avant que les premières critiques paraissent. » C’est sans doute l’une des notes les plus banales de L’exercice a été profitable, monsieur[11][11] DANEY Serge, L’exercice a été profitable, Monsieur., p. 275, POL, Paris, 1993., mais elle pose, pratiquement, la question du temps de la critique – celui qu’elle doit laisser et celui qu’elle doit prendre, qui ne sont pas exactement les mêmes.
La question évidemment n’est pas simple. Les premiers jours (voire heures) d’exploitation sont décisifs pour l’avenir de films commercialement « fragiles », et/ou n’ayant pas accès aux moyens de promotion dominants. S’aligner pourtant sur le rythme des sorties, c’est prendre le risque de chasser l’un par l’autre (le « chef-d’oeuvre de Sokourov » par celui de Carax par celui, qui les balayera tous, de Nolan, etc.). Ces questions et ces doutes ne sont pas neufs. À la faveur parfois de polémiques sans retentissement, elles ressurgissent (Delorme – Kaganski). Il nous semble, pour notre part, qu’une revue, un site, etc., est également un lieu où se crée, avec le discours, du silence. Où, contre l’aveuglante blancheur des projecteurs, s’imposent comme résistances les lueurs des lucioles[22][22] Nous reprenons l’image à Georges Didi-Huberman. Survivance des lucioles, Editions de Minuit, Paris, 2009..
Silence : celui qui « passe sous », mais aussi – surtout – qui produit de l’audibilité. Qui interrompt le flux de l’information pour renouer le fil de l’échange. Ecrire sur, sous, à côté – à et avec ou contre un film, un cinéaste, une certaine idée du cinéma et des images. Cela peut consister à faire un entretien à propos d’un film des semaines ou des mois après sa sortie, ou à publier des textes introuvables parce que malgré tout, ça continue à travailler. Et, dans l’écriture même, à ne pas vouloir étouffer le désir du spectateur sous la dithyrambe, la formule, le « kit-de-pensée ». Sans doute n’y arrivons-nous pas toujours, mais nous essayons.
Si le silence est souhaitable, il n’est néanmoins pas toujours voulu. Faute de temps, d’auteurs, des films que nous avons aimés n’ont pas été critiqués, ne seront pas critiqués (The Deep Blue Sea, de Terence Davies, pour ne citer qu’un exemple récent). Ils continuent à nous animer, à resurgir ici ou là, dans d’autres textes, à propos d’autres films. Des liens se tissent, sous terre ça s’agite. Il ne s’agit pas d’épingler des papillons, de se faire un tableau de chasse, mais de vivre avec les films et de les laisser vivre en nous – cinéma body-snatcher. Tant pis, tant mieux s’ils nous échappent. Ce silence non-voulu est aussi celui, regrettable, qu’impose le fait d’écrire non dans le ciel de la critique « nationale » (festivals, projections de presse à Paris, etc.), mais ici (ce qui, pour la plupart d’entre nous, signifie à Lille, où, malgré de nombreuses salles de qualité, certains films passent tardivement, pas du tout ou uniquement en VF). La frénésie de l’actualité n’existe que dans la négation ou l’ignorance de la non-uniformité des territoires. Si nous sommes encore trop attachés, par habitude, convention, à cette perspective tronquée de la “sortie nationale”, nous tenterons de nous en émanciper[33][33] Et Internet ne crée que des effets partiels, “locaux”, de déterritorialisation. Il est possible d’y trouver par exemple une comédie peu ou mal distribuée en France, mais elle sera américaine..
Il serait évidemment stupide de supposer que ces problèmes se posent dans les mêmes termes aux Cahiers du cinéma, à Trafic, aux Inrocks, à 1895, à un blog ou à une revue en ligne. Il faut néanmoins ré-affirmer la valeur du silence, de l’intermittence, des écarts – et donc des rapprochements, montages inattendus, foudroyants (reflux et débordements…) – afin que l’écriture du cinéma, dans le temps de la critique, de la recherche ou de la création, soit oeuvre et circulation du désir.