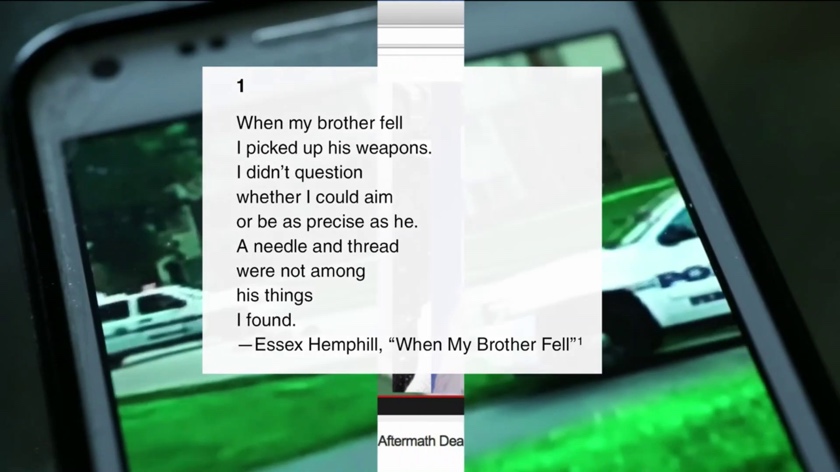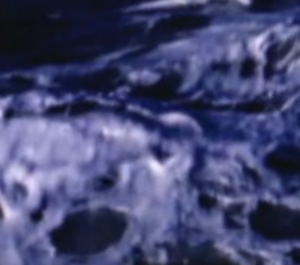Entrevues de Belfort 2020 (2/3)
Net Found Footage
Clément Marguerite,
Rosalie Tenaillon,
Malou Six,
Fanny Villaudiere,
Romane Carriere,
le 9 juin 2021
Le «Net Found Footage» désigne un pan contemporain du cinéma de montage dont le principe est d’agencer des fragments vidéos récupérés sur Internet. Cette sélection met ainsi en lumière des pratiques cinématographiques relativement nouvelles, qui peuvent désorienter de prime abord. Les films s’y présentent moins comme des fables que comme des dispositifs ; ils présentent moins des histoires que des assemblages hétérogènes d’images.
En un double mouvement parfois vertigineux ces images portent à la fois notre regard vers ce qu’elles montrent et vers la manière dont elles montrent. Le principe du Net Found Footage rend perceptible en même temps que l’image un ailleurs qui l’accompagne. Cet ailleurs, c’est le lieu de sa première diffusion, avant le remontage cinématographique. Pas de représentation « pure » ni de représentation « naïve » : chaque image est comme chargée d’une épaisseur qui lui vient de cette circulation, un peu à la manière d’une légende ou d’un hors-champ.
De là une pratique du montage en prise directe avec des enjeux propres au paysage visuel actuel. En mettant en scène le monde d’images dans lequel nous évoluons quotidiennement ces films renégocient leur rapport à l’intime et au politique. Ils renouvellent ainsi notre expérience du cinéma, et la manière dont celui-ci nous donne à voir et penser le monde contemporain. Qu’il s’agisse de produire de nouveaux liens entre des images disparates et hétérogènes (Black Code, The Uprising) ou de recycler des images qui racontent de façon fragmentaire une histoire (Un Archipel, Vie et Mort d’Oscar Pérez), le Net Found Footage devient un moyen de penser notre rapport aux écrans et à Internet ; un rapport en mutation du fait de la pandémie.
Récupérer des traces du monde sur Internet, lieu virtuel ouvert à tous où l’histoire est racontée au présent, permet de faire acte de résistance. Analyser les preuves, les doubler en recomposant ce qui s’est passé, peut devenir un outil de contre-pouvoir à l’heure où certains voudraient empêcher par la loi de prendre des images de violences policières . Le Net Found Footage devient un moyen de contester les mots en rendant visible une autre version de la vérité. Cette sélection apparaît ainsi comme un geste réflexif mais surtout politique : mieux comprendre le paysage visuel que nous habitons apparaît désormais comme l’étape nécessaire d’une appropriation des luttes qui se déroulent aujourd’hui en partie sur le terrain de l’image.
Clément Marguerite et Rosalie Tenaillon
The Uprising, Peter Snowdon, 79’, 2013
Déterritorialiser la révolution
«The revolution that this film imagines is based on several real revolutions». Dès son ouverture, The Uprising présente ses images dans un écart. Ce film de montage fait le récit d’une révolution imaginaire à partir de fragments vidéo mis en ligne par les acteurs de luttes bien réelles – celles du « printemps arabe ». Le film opère l’inverse d’une fabulation : il présente comme fictif ce dont l’authenticité ne peut faire de doute. En ce point il procède à rebours de l’injonction médiatique contemporaine à la transparence. The Uprising s’inscrit en faux contre le principe d’une représentation « en direct » des choses – qu’Internet et les réseaux sociaux réactivent pleinement, en fidèles successeurs de la télévision.
Pour le comprendre il faut prendre au sérieux le postulat fictionnel par lequel Peter Snowdon introduit la révolution montrée dans son film. À suivre les choses de près, The Uprising constitue le récit presque mythique d’un processus révolutionnaire imaginaire. En sept jours, nous assistons étape par étape aux premières insurrections, à leur répression, au renversement du pouvoir, etc. Difficile toutefois de ne pas sentir l’inscription viscérale de ces images dans la réalité qu’elles documentent. Sont disposés çà et là le portrait brûlé d’un président dictateur, le nom d’une ville ou d’un pays, et il est évident que le sang des victimes de la répression a bien coulé devant les caméras qui ont enregistré les images montées par Peter Snowdon.
Cette double situation singulière – images authentiques mobilisées au sein d’un montage fictionnel – investit d’une profondeur et d’une force proprement cinématographiques les images de The Uprising. En privant de tout contexte de longs fragments de chants, de cris, de combats et de célébrations, The Uprising nous pousse à envisager ce que montre le détail de ces images, au-delà de l’étiquette généralisante des « printemps arabes ». Des extraits vidéos de plusieurs minutes nous confrontent à ce que laissent très majoritairement de côté l’ensemble des représentations médiatiques de ce type d’événements. Une multitude de gestes : entrer dans le palais d’un dictateur, charger avec une pomme de terre ou un oignon un lance-roquette artisanal. Et une multitude d’enjeux : en premier lieu, comment construire le lendemain d’une révolution?
Par ses choix de montage, Peter Snowdon trouve la voie d’une représentation de la révolution qui échappe à l’ensemble des travers qui caractérisent sa mise en image : The Uprising déconstruit les représentations occidentales du « printemps arabe » pour dessiner des figures et des images susceptibles de toucher quelque chose de l’ampleur du moment où un peuple et un pays se libèrent et s’émancipent.
C. M
***
Un Archipel, Clément Cogitore, 11’, France, 2011
Naufrage de la vision
Les œuvres de Clément Cogitore témoignent d’une prédilection pour le mystère. Non pas un mystère fabriqué de toutes pièces, mais un gouffre secret, un trou noir, une part irréductible logée au cœur de la réalité. Dans Un Archipel, c’est sous la surface de l’eau, dans un sous-marin britannique, que se produit l’inexplicable : le commandant du bâtiment, très respecté dans la marine, prend en otage le reste de l’équipage et se cloisonne dans une cabine où il diffuse d’inquiétants messages radio. Tous ces éléments nous sont livrés par de nombreux intertitres, qui fournissent un contrepoint narratif aux images énigmatiques et mal définies que Clément Cogitore a glanées sur le Net. Les prises de vue extérieures, focalisées sur la masse grisâtre du sous-marin, sont parasitées par des visions souterraines (couloirs, cavernes, bunkers) qui semblent nous introduire, par une sorte de déplacement métaphorique, là où les caméras ne pénètrent jamais : à l’intérieur de l’engin. Le récit avance, lui, au rythme de l’intervention de l’armée, recette éprouvée du film d’action. De cette combinaison du familier et de l’étrange, le cinéaste et artiste plasticien tire un puissant principe dramaturgique.
Le sous-marin HMS Astute s’est bel et bien échoué au cours d’une opération de routine. Bien que déshonorant pour l’armée britannique, il ne s’agissait que d’un simple incident de navigation. Mais derrière ce fait divers, Clément Cogitore réveille des peurs enfouies, à commencer par celle de la menace nucléaire : dès les premières secondes, un carton annonce que le sous-marin « dispose d’une puissance de feu équivalente à la destruction d’une capitale européenne ». C’est le monde militaire qui est visé, et son dispositif de contrôle censé parer à toute dérive, à toute erreur. Il y a pourtant, et de façon régulière, des accidents : en avril 2011, alors que le film était déjà achevé, un officier a été abattu par un matelot, à bord de ce même sous-marin.
Si la fiction « prend », c’est donc qu’elle agite des inquiétudes réelles. Chez Cogitore néanmoins, la crise n’est pas seulement psychologique : d’autres forces plus profondes, plus impalpables, entrent en ligne de compte. Sur le mode du cinéma expérimental, la perception est brouillée par un chaos visuel et sonore, si bien que nous ne voyons à peu près rien de l’événement. Comme dans son long-métrage Ni le ciel ni la terre, Cogitore exploite le pouvoir d’étrangeté de la caméra thermique, qui en traversant l’obscurité ne produit qu’un amas de formes vertes et luminescentes. À mesure que le temps s’écoule, le statut de la lumière elle-même évolue : elle n’est plus « source lumineuse » mais flash brutal, rayon tremblant, tache laiteuse perçue au sein de la confusion ambiante. Ces expérimentations sur les conditions de la vision dotent le récit d’une vibration fantastique, métaphysique, qui emporte le spectateur toujours plus loin dans sa quête de réponses.
Elie Raufaste
***
Rémy, Guillaume Lillo, 31’, 2018
Les bois de l’imaginaire
Rémy, jeune homme sans le sou, est venu s’isoler dans une maison à la montagne, en plein hiver, loin de ses parents, loin de sa meilleure amie partie en vacances aux Maldives. Ce moyen-métrage de Guillaume Lillo se présente comme le journal intime du personnage éponyme. Mais la singularité de Rémy tient au fait que ce sont des images, des vidéos d’Internet devenues anonymes, qui dictent l’histoire et enclenchent le récit. Aussi, les vidéos recueillies deviennent l’occasion de faire vivre à Rémy toute une série d’aventures, allant des habituelles mésaventures domestiques jusqu’aux rencontres inattendues et déconcertantes. Car toutes ces péripéties sont à l’image de l’hétérogénéité d’Internet, peuplé d’images faisant état tantôt d’un quotidien banal et exaspérant, tantôt d’un monde mystérieux et inquiétant. Prenant le relais des cabinets de curiosités d’autrefois, où s’accumulaient trésors exotiques et objets excentriques, témoins de la variété de la nature, Internet devient alors le lieu, le réceptacle par excellence des mirabilia, des merveilles de notre temps. Merveilleux et étranges, ce sont d’abord les animaux que rencontre Rémy, façonnant tout un bestiaire hétéroclite et bizarre : chouettes scrutant la forêt, biche estropiée, une autre gisant à demi-morte dans la neige, crottin de chevreuils, araignée noire s’extrayant d’une motte de neige, ou encore ces fascinantes chorégraphies d’animaux aquatiques, de l’étrange animal flottant tel une algue dans l’eau azurée au curieux ballet mécanique d’une horde de requins.
Face à ce flot d’images muettes revient à la voix la lourde tâche d’agencer, ordonner, rassembler les bouts épars afin de retrouver une cohérence, un fil rouge. Cette voix, c’est celle, fictionnelle, de Rémy, racontant sa solitude, son quotidien désœuvré et les aléas de la vie sauvage. La voix relie et raccorde les images mais également le corps multiple, diffracté et démembré du narrateur : c’est par la puissance invocatrice de la voix que s’invente un corps, dont les extrémités n’apparaissent que ponctuellement à l’image, tout le reste étant relégué hors champ. La voix permet de sans cesse ré-assurer, ré-actualiser un corps qui n’est jamais visible dans son intégralité mais dont la présence tangible ne cesse d’affleurer. Mais troublante, cette voix l’est encore plus par sa capacité à transformer les êtres en objets interchangeables, à l’image du chat de Rémy, un chat roux orangé, chat de gouttière rien de plus quelconque, dont les multiples apparitions (ce ne peut jamais être le même) soulignent à quel point un chat peut être facilement confondu avec un autre.
Si la voix assure l’unité du corps de Rémy et déploie tout une cartographie imaginaire, elle peut également rompre, disloquer le lien avec autrui. Dès lors, la tentation du soliloque est grande : la voix de Rémy finit par s’épuiser, par devenir redondante, par tourner en rond. Rémy ne peut interagir avec les autres corps qui apparaissent à l’image. Lorsqu’il interpelle un chercheur de métaux ou un enfant s’apprêtant à dévaler une pente en luge, il n’obtient pas de réponse, ni même un regard. Cette solitude inhérente aux images est redoublée par l’entrelacement des contraires dont joue Rémy. Ainsi, le film orchestre une opposition entre un tropisme du Nord, avec ses montagnes enneigées et ses animaux sauvages, et un tropisme du Sud, mêlant paysages paradisiaques et mers turquoise peuplées de créatures aquatiques, l’un charriant le mythe de l’homme des bois venu se confronter à lui-même au contact d’une nature rude et indomptable, l’autre le mythe du touriste en perpétuelle quête de soleil, de plages de sable blanc et de palmiers de carte postale.
Voué à la solitude, Rémy rencontre pourtant un alter ego, un autre Rémy qui lui tatoue une chouette, en écho discret à celle qui ouvre le film. Puis les deux hommes prennent la route et finissent par trouver une plage, où ils font l’amour et où se côtoient les paysages septentrionaux et une mer aux reflets bleutés, conciliant les deux extrémités du globe. Une mer aux flots apaisants et étincelants, où les corps peuvent enfin se retrouver.
Romane Carrière
***
Fraud, Dean Fleischer-Camp, 52’, 2016
Malaise dans la consommation
Pour fuir les conséquences d’une accumulation de crédits à la consommation impayés, une famille décide un jour de quitter le pays après avoir brûlé sa maison pour récupérer l’argent de son assurance logement. Complètement fictionnelle, cette descente aux enfers d’une famille de la middle class américaine nous est donnée à voir dans un film qui n’a pourtant de cesse de jouer des effets suscités par la texture “réaliste” de ses images. Pour réaliser Fraud, Dean Fleischer-Camp a en effet travaillé à partir de centaines d’heures de vidéos amateures postées sur Youtube, où un certain Gary filme le quotidien de sa famille. Mais ces images intimes se rapprochent par moments d’une esthétique publicitaire et télévisuelle. En une accumulation de gros plans extrêmement brefs et hachés, elles mettent à égalité les corps des membres de la famille de Gary avec des marques et des produits de consommation. Toutefois, à réduire le film à la sempiternelle critique du « toujours-plus » qui caractérise la société de consommation américaine, on risque de l’envisager un peu vite comme une charge grotesque, presque grossière.
Il est tentant de comprendre Fraud comme un geste de montage qui met en évidence la superficialité du quotidien consumériste de Gary et sa famille. Dean Fleischer-Camp mettrait en lumière ce qui transparaît des dérives de la culture capitaliste nord-américaine au travers du regard fixé par la caméra de Gary : le montage de Fraud serait un moyen de révéler ce qui se cache sous la pulsion scopique du père de famille. Il s’agirait ainsi de retourner l’excès de lisibilité proprement publicitaire de ces images pour révéler la morbidité d’un inconscient consumériste.
Le projet de Dean Fleischer-Camp semble tout autre. Pour le comprendre, il suffit de considérer que le montage de Fraud n’a de cesse de tordre la contextualisation de ces archives familiales pour construire une trame narrative totalement fictionnelle, et pourtant indiscernable. Il s’agit dès lors moins de révéler (dans une logique de lisibilité informative qui caractérise les esthétiques télévisuelles et publicitaires) que de construire (logique créative et artistique). Le montage est proprement frauduleux, et propose moins de montrer le malaise latent qui caractérise la société de consommation américaine contemporaine, que de le donner à ressentir. Fraud se livre pour cela à un jeu d’affect et d’intensité qui transpose le quotidien de Gary et de sa famille dans un rythme propre au thriller, à la course-poursuite et au film policier. En cela, Dean Fleischer-Camp soumet notre regard à une véritable lisibilité sensible, dépassant les impasses auxquelles se heurtent les démarches qui dénoncent encore ce que chacun sait – au moins depuis la crise des subprimes – des dangers du système financier américain.
C.M.
***
Vie et mort d’Oscar Pérez, Romain Champalaune, 45min, France, 2018.
Au service de la nation
D’emblée le policier vénézuélien Oscar Pérez intrigue et menace. L’homme stoïque tire de dos sur un mannequin qu’il touche en plein cœur, prouvant par là ses compétences extraordinaires de tireur d’élite. Cette première image surréaliste produit de la fascination : entre peur et pulsion scopique, le public se prépare à un voyage de 45 minutes en compagnie d’un homme armé qui se croit doté d’une mission. Pérez transmet par le biais des réseaux sociaux un message au peuple vénézuélien : faire preuve d’ordre et de morale. «Police scientifique / servante de la Nation / pour la paix et la vie / Dieu avec nous !» scandent ses élèves.
Oscar Pérez met continuellement en scène son quotidien sur les réseaux, aussi bien lors de ses entraînements de tir que lorsqu’il rend visite à des enfants malades. Pérez croit fermement être un modèle patriotique pour les autres et participe à des vidéos de propagande gouvernementale contre la drogue, pour l’obéissance civile et pour le respect des anciens. Réalisateur d’un film d’action dont il est le héros, il y donne à voir un combat militaire sous-marin et un sauvetage d’otages in extremis. Entre ultra-violence, narcissisme et charité chrétienne, Oscar Pérez cumule les paradoxes. Dans son désir d’impressionner les autres affleure une candeur enfantine parfois saisissante.
Dans la seconde partie du film, l’amour que le policier porte à sa nation l’entraîne vers une révolte violente contre le gouvernement corrompu de son pays. Cette révolte apparaît au spectateur comme un revirement surprenant puisqu’Oscar Pérez cherchait jusqu’ici à éduquer de futurs serviteurs de la nation. Un montage brutal par cut, de nombreux changements de formats, une multiplicité d’images intimes et guerrières – traces de l’ambiguïté du rapport de Pérez aux réseaux sociaux – produisent un déchaînement progressif de brutalité qui atteint des sommets à la fin du moyen-métrage. Pour autant, la violence inhérente à la vie d’Oscar Pérez et au film de Champalaune ne nous paraît pas gratuite : elle participe à l’interrogation générale sur l’idée de courage et d’engagement politique. C’est d’ailleurs sa rébellion qui vaut au policier d’élite de retrouver un peu de son humanité. Vie et Mort d’Oscar Pérez prend finalement l’allure d’un film de guerre, mais d’une guerre intérieure qui soulève les contradictions propres à un individu, un groupe, un pays.
Rosalie Tenaillon
***
La mer du milieu, Jean-Marc Chapoulie, 73’, 2019
Surveillance et défaillances
Un panoramique horizontal sur le port de Marseille. Hors-champ, une voix enfantine exprime son ennui devant ces images enregistrées par la caméra de surveillance d’un hôtel. Malgré cela, la prouesse technologique de la retransmission en direct fascine, attise une curiosité teintée de suspens. Le jeune garçon imagine ce qui pourrait rendre palpitant ce plan contemplatif, mécaniquement programmé pour faire des allers-retours entre la mer et la côte. Et si, tout à coup, un groupe de personnes débarquait avec des mitraillettes ? Cette scène d’action reste un pur fantasme, mais les images qu’observent Jean-Marc Chapoulie et son fils ne sont pas décevantes pour autant. La caméra de surveillance constitue en elle-même un événement pour le regard. Il suffit d’un mouvement brusque et inexpliqué de l’objectif pour créer la surprise. Le dysfonctionnement de cet œil supposé infaillible, le vol d’un oiseau, une mouche qui se balade sur l’objectif ou encore les mouvements délicats d’une araignée qui tisse sa toile, voilà à quoi peut ressembler un événement : c’est le réel avec sa part d’imprévisible qui fait irruption dans le formatage technologique.
La mer du milieu se donne comme un exercice de l’attention : il s’agit d’être toujours à l’affût, de guetter le moindre petit incident venant troubler l’ambition totalisante et l’aspect répétitif, voire aliénant, du dispositif de surveillance. Le montage y insiste en insérant des plans de résistance, contre-champ au regard panoptique du pouvoir. On y voit notamment des militant-es égyptien-nes ou syrien-nes dérober ces fameuses caméras juchées en haut des murs. On aurait apprécié une recontextualisation plus précise de ces luttes qui, sans cela, courent le risque d’être noyées dans un flux indistinct de « révoltes ou révolutions arabes ». Ces images contribuent néanmoins à creuser les histoires dont regorge le bassin méditerranéen. Les voix off de Jean-Marc Chapoulie et de l’autrice Nathalie Quintane parachèvent cette entreprise en donnant une épaisseur intime, culturelle et politique à ce territoire mythique, à la fois lieu de naissance de la pétanque, décor de cinéma depuis les frères Lumière, mais également espace de circulation, d’hommes et de marchandises.
Le film brosse ainsi le portrait d’une zone géographique, et dresse l’état des lieux des imaginaires qui y sont associés. Seule interrogation : le statut de ces voix off. Contrairement au Géant de Michael Klier (1983), dans lequel la simple juxtaposition des images de surveillance suffisait à nous en dire quelque chose, La mer du milieu propose une couche de discours supplémentaire. Sur un plan de paysage renversé, Nathalie Quintane s’adresse au spectateur : « N’allez pas vous imaginer des choses. Ici n’est pas le lieu de l’imagination ni celui du réel d’ailleurs. Pas de pépite de réalité dans les fluides techniques […] ». Cette réflexivité ne va pas sans lourdeur intellectualisante, mais c’est justement là que se loge le trouble. Quelle est la place de ce propos et à quel degré faut-il l’entendre ? Paraissant au premier abord fermer le film à certaines attitudes réceptives, Nathalie Quintane ouvre peut-être un flottement de sens et d’interprétation : sa tonalité affirmative nous invite en quelque sorte à la contredire et nous laisse finalement sur une ambiguïté, sans doute propre à un tel travail de net found footage.
Malou Six
***
Watching the Pain of Others, Chloé Galibert-Laîné (2018, 31 minutes)
L’image dans la peau
Un écran d’ordinateur. La webcam filme une jeune femme. Elle nous regarde. Une vidéo commence et montre une autre femme, plus agée, qui parle face caméra. Les deux visages se placent en vis-à-vis : le dialogue peut commencer. Dans Watching The Pain of Others, Chloé Galibert-Laîné décortique The Pain of Others, réalisé par Penny Lane. Cette documentariste indépendante américaine regroupe les témoignages postés sur YouTube de femmes atteintes du syndrome de Morgellons, une maladie de peau non reconnue par le corps médical et qui consiste en l’apparition de filaments et d’excroissances cutanés. Les trois protagonistes du film de Penny Lane créent ainsi des communautés web autour de leur maladie, partagent des remèdes artisanaux. Utilisant l’esthétique du desktop movie où l’écran d’ordinateur devient caméra et toile de cinéma, Chloé Galibert-Laîné livre un témoignage qui lie réflexions théoriques de chercheuse et expérience personnelle de spectatrice, sur l’image de cinéma mais aussi sur son propre corps.
«Pourquoi le film de Penny Lane me fascine-t-il autant ?» C’est à partir de cette interrogation que Chloé Galibert-Laîné réalise son film. Pour seules réponses, d’autres questions : quel crédit donner à la parole de ces femmes ? Quelle est la place de ces images sur Internet ? Et surtout, quel rapport au corps elles induisent ? Elle revenait ainsi sur sa démarche dans l’émission « La Grande table » sur France Culture : l’écran d’ordinateur sert de plateau et permet une réappropriation des images de YouTube dans le contexte même où elles ont été produites. On participe à l’enquête en gardant la trace du processus de création. De films en films, de vidéos en vidéos, les recherches avancent et Watching The Pain of Others se construit.
L’image, dans The Pain of Others, devient un outil pour scruter le corps : un corps qui évolue, vieillit et se transforme. Chaque micro-phénomène se fait événement. Une des protagonistes découvre une peau morte sur sa narine qu’elle filme en gros plan : la peau devient un nouveau territoire à explorer, une surface à examiner à l’aide de l’image et du partage massif sur les réseaux. Le syndrome existe à travers la fabrication d’images et Chloé Galibert-Laîné s’interroge : et si l’excès d’empathie face aux images était la cause du syndrome de Morgellons ? Mais l’excès d’empathie n’est-il pas ce qui caractérise un bon spectateur ? De là, la réalisatrice et chercheuse partage son expérience singulière de spectatrice, peut-être elle-même victime d’un excès d’empathie. Sur ses jambes apparaissent des petites plaies inexpliquées, qui ressemblent à si méprendre au syndrome de Morgellons. Ne pas spéculer, ne pas savoir, ne pas comparer, ne pas se laisser emporter par les images – ces images qui marquent le corps. The Pain of Others apparaît comme un film sur la viralité des images d’internet : le clic permet la propagation sur la toile et sur la chair.
Le film fait partager un point de vue rétrospectif et réflexif sur les images au spectateur, qui s’interroge sur sa propre position. Mais, regardant un film sur un film, il est parfois délicat de trouver sa place face au témoignage de Chloé Galibert-Laîné. La perspective analytique, voire « méta-cinématographique » prend le pas sur la sensation : difficile à décrire, l’expérience de spectateur reste en suspens dans la mise en abyme.
Fanny Villaudiere
***
Black Code / Code Noir, Louis Henderson, 21’, 2015
Moins voir, mieux regarder
« Plus belle que le jour, paisible en tout cas, la nuit constellée, savante et douce, est le meilleur modèle de connaissance et un bien meilleur modèle que le jour solaire, cruel, unique, blessant au regard, idéologique et opiniâtre. » Cette épigraphe annonce dès son ouverture le régime de visibilité déployé par le film de Louis Henderson : accumuler les documents visuels, sonores et textuels, moins pour les éclairer que pour en livrer un collage nocturne, véritablement chaotique.
Un femme qui parle de l’histoire révolutionnaire de Haïti, une émeute de manifestants de Black Lives Mater, l’assassinat de Michael Brown par des officiers de police, des extraits de l’ordonnance royale pour l’administration des colonies françaises à laquelle renvoie explicitement la seconde partie du titre du film, la reconstitution 3D d’une bavure policière, des incendies, des discours de politiciens, des threads twitter … Souvent décontextualisés, ces fragments s’accumulent, se superposent et se répètent sur un écran qui devient vite illisible. Cette confusion résonne ainsi rapidement avec les critiques inlassablement adressées à Internet, et à la manière dont y circulent les images et les informations.
Le film de Louis Henderson se déplie sous la forme d’une question, et questionner le regard suppose inévitablement de mettre en crise certaines de ses assises. Sur ce point, et dans la continuité de tout un pan contemporain du cinéma de montage, le déroutant collage que constitue Black Code / Code Noir s’apparente à un geste politique et réflexif, qui précisément travaille cette confusion par les outils du cinéma. Ce travail n’est pas celui d’un « décryptage » des contre-vérités qui jonchent les réseaux sociaux – celui-ci reste l’apanage revendiqué par les voix du pouvoir, par la lumière rationnelle du jour cruel et idéologique dénoncé par le carton introductif du film. Il s’agit plutôt de trouver un rythme et un mouvement susceptibles de relayer quelque chose de l’énergie contestataire qui circule entre tous ces fragments. Non pas un montage analytique pour comprendre, mais un agencement dynamique pour mettre en branle le sentiment d’urgence que devraient susciter de pareilles images – des images souvent révoltantes, qui sont pourtant systématiquement dévorées par le grand nivellement qu’impose leur accumulation dans notre quotidien.
C. M.
Coordonné par Elise Domenach.
Remerciements à Catherine Giraud, Elsa Charbit, Bruno Podalydès, et à l’ENS de Lyon.