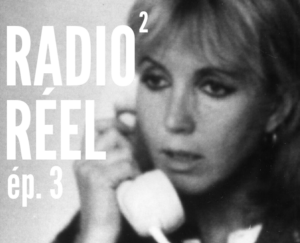FIDMarseille, 2025 (1/3)
To Doom and To Scroll
Ces deux termes anglais ont en commun de provenir de noms – la fatalité et le rouleau, par exemple, de parchemin – qui ont été métamorphosés en verbes par le dialecte numérique s’inventant au fil de l’évolution des pratiques en ligne. Ces dernières années, ces mots ont reçu, en français, une terminaison de verbes du premier groupe pour donner naissance aux expressions « doomer » et « scroller » : déprimer sur l’état du monde tel qu’il va, et faire défiler sans fin les fils d’actualité des différents réseaux sociaux sur l’écran de son téléphone. Ensemble, ils ont même fini par former un mot-valise, to doomscroll ou « doomscroller » : dévider le fil des catastrophes sous la pression désabusée de son pouce, l’œil rougi par la lumière bleue du rétroéclairage, le cerveau embrumé par le sentiment croissant d’impuissance et d’abrutissement algorithmique. Certains films projetés au FID entraient en dialogue avec cette désespérance et ce geste contemporains.
Pour son court film Abortion Party, Julia Mellen explique s’être inspirée d’une esthétique spécifique aux pratiques des boomers sur les réseaux sociaux – ou sur le réseau social Facebook – et leur goût pour les modélisations 3D douteuses. Aux bords du cadre, la réalisatrice se lance dans un story time ininterrompu de treize minutes – soit la durée du film –, face caméra, durant lequel celle-ci raconte l’organisation d’une fête pour célébrer son avortement. Ce format de récit de soi, né avec la plateforme d’hébergement vidéo YouTube avant de migrer et de rencontrer un succès plus important encore sur TikTok, fait quant à lui davantage signe vers les générations dont l’adolescence et la vie de jeune adulte s’est enchevêtrée avec le numérique. Pourtant, le cadre qui abrite cette véritable performance filmée en un unique plan séquence, ne cesse de rebondir d’un segment à l’autre d’un cadre plus vaste, reproduisant en 3D les souvenirs de l’artiste. Difficile de ne pas reconnaître, dans ce ballet mécanique, un économiseur d’écran du temps jadis, dont l’archéologie médiatique nous ramène aux lecteurs DVD d’antan. Ainsi le flux de conscience de Julia Mellen, qui redouble le flux de ses paroles, semble façonné par différentes strates de l’histoire technologique et intime de l’artiste. « Le personnel est médiatique » pense-t-on en voyant Abortion Party – puisqu’il démontre d’emblée, par son propos-même, ce que le personnel a de politique.
L’humour de la vidéaste se déploie ainsi le long de deux fils qui, entremêlés, réussissent un tour de force formel que, confusément, j’attendais depuis longtemps : le « burlesque d’interface » – le nom reste à trouver. Le mouvement parfaitement syncopé de l’incrustation du visage de l’artiste à l’intérieur du cadre, associé à son usage impeccable de la moue et de la grimace produisent un objet à même de faire surgir une subjectivité numérique, sans souris et sans desktop.
Un court-métrage, Some of You Fucked Eva, fonctionne comme le revers tragique d’Abortion Party. Dans ce film, Lilith Grasmug enquête, à partir d’images glanées sur YouTube, sur de mystérieux cas d’évanouissements collectifs d’adolescentes étatsuniennes. Peut-être est-ce le prénom de l’artiste, ou bien la trop longue fréquentation du cinéma d’épouvante de found footage nord-américain, ou alors l’exposition « Sortilèges » qui se tenait à Arles au même moment sur les grandes affaires de sorcellerie à travers le monde : tout semble rapprocher le film d’un Projet Blair Witch qui aurait quitté sa forêt de sapins pour le caoutchouc vulcanisé d’un stade scolaire. Les images des pom-pom-girls effectuant leurs figures, retravaillées au montage, ralenties et bruitées, deviennent les pièces à conviction d’un cas de possession collective. Les corps, épuisés, de ces filles tout juste sorties de l’enfance soumises à des entraînements d’athlètes qui hantent Internet, illustrent une fiction inspirée de l’une de ces épidémies de malaises survenues au début des années 2000. Aux côtés de ces silhouettes rompues de fatigue, rendues méconnaissables par la basse définition des images d’alors, reviennent tout un cortège de spectres de Columbine, de personnages des films de Gus Van Sant ou de David Lynch. Claire Lasolle compare le personnage d’Eva à la Laura de Twin Peaks, personnage allégorique de la dévoration des adolescentes par la société étatsunienne et de leur image par l’entertainment. Que reste-t-il de ces figures de cheerleaders tellement usées qu’elles menacent de disparaître ? Rien, ou si peu, qu’elles s’évanouissent, répond Lilith Grasmug.
« Une femme disparaît » aurait aussi pu être le titre du dernier film de Maryam Tafakory, گلهای شب ِدریا, Daria’s Night Flowers. L’artiste poursuit son patient travail mosaïque de remontage du cinéma iranien. Les images sont superposées, altérées, recoloriées suivant une méthode qui dessine ce qu’il faut bien appeler un style – style rendu particulièrement sensible par la carte blanche qui lui fut consacrée lors du dernier festival Cinéma du Réel.
Depuis Nazarbazi نظربازی (« jeu de regard » en français) en 2021, Maryam Tafakory a recours au collage d’images issues d’un vaste corpus de films iraniens réalisés entre la fin des années 1980 et le début des années 2000. Dans ces films, l’existence des personnages féminins à l’écran est frappée de plein fouet par la façon dont l’État entend façonner l’image des femmes. Cette pratique du found footage se double d’un usage particulier de l’écriture, tantôt poétique, tantôt fictionnelle, qui s’immisce dans la matière-même des images travaillées par le montage. Cet attrait du texte, du film lu, conduit l’artiste, dans son pénultième film, à croiser cette histoire des gestes de cinéma avec celle de la presse iranienne. Razeh-del راز دل (en français « secret du cœur ») met en scène la fascination de deux amies pour le journal Zan (« femme »), paru entre 1998 et 1999, le premier titre de l’histoire du pays publié par des femmes. Aux images des films se mêlent les coupures de presse, au grain de la pellicule se superpose la trame des pages imprimées et les jeunes enquêtrices retracent l’histoire de cet éphémère espoir éditorial.
Dans Daria’s Night Flowers, Maryam Tafakory radicalise ce retour au texte. L’artiste compose un herbier de fleurs éternisées par le cinéma, admirées, arborées ou cueillies par les personnages féminins que ses films ont coutume d’observer. Sur la table de montage, ces images rencontrent les fleurs enluminées du Kitab-e hashayish (کتاب حشايش), codex pharmacologique de 1595 aux illustrations multicolores, traduit de l’ouvrage de Dioscoride composé au premier siècle de notre ère.
L’introduction du règne végétal dans sa pratique du collage paraît influencer la texture même du film : un prisme jaune danse derrière certaines séquences, comme un voile de pollen prenant parfois la forme d’une main ou d’un visage – à moins qu’il ne s’agisse d’une paréidolie. Peu à peu, des motifs en formes d’efflorescences rouges et noires éclosent dans le fluide doré de deux images superposées – à moins qu’il ne s’agisse de la pollinisation d’une fleur observée au microscope. Une rafale transporte des cendres à travers le cadre, les personnages s’échangent des graines et des essences en secret, tantôt remèdes, tantôt poisons, tantôt plantes carnivores. Il semble exister une continuité entre la pharmacopée de Daria et l’étrange jardin où se perdent Camelia et Nahla, dans le film de Nour Ouayda, The Secret Garden (2023), qui voyait Beyrouth envahie de plantes fantastiques. On aimerait traverser les deux films ensemble et comprendre ce que les plantes qui soignent les vétérans de la guerre Iran-Iraq ont en commun avec celles qui percent les anfractuosités de la capitale libanaise. Ce que je prenais pour du pollen était peut-être de l’encre suintant d’un antique manuscrit – ou d’un journal féministe – s’immisçant dans les failles des images remployées par Tafakory.
Fatalité
Control Anatomy, de Mahmoud Alhaj, prenait en charge l’archéologie du lacis disciplinaire imposé par Israël aux Palestinien·nes. Ce film appartient à un genre dont les origines sont volontiers associées aux travaux d’Harun Farocki et ses continuateur·ices, tel le groupe de recherche Forensic Architecture. Le geste d’Alhaj s’inscrit pleinement dans cette architecture de la preuve – la première partie du film emprunte son titre à Eyal Weizman, fondateur du collectif d’enquête britannique – dont l’esthétique s’est déployée et popularisée, entre journalisme et art contemporain, ces dix dernières années : modélisations en 3D, reconstitution d’événements, montage d’archive. Control Anatomy est subdivisé en chapitres, s’appuie sur une grande variété de documents et un travail préparatoire plastique exposé par l’artiste sous forme de collages et d’installations. Lors d’une rencontre organisée par Débordements quelques mois après le début du génocide, Eyal Sivan, aux côtés du cinéaste Raed Andoni et de la chercheuse en charge de la Palestine pour Forensic Architecture Shourideh Molavi, faisait le lien entre leurs trois approches de l’occupation israélienne en les qualifiant de « forensiques ». Andoni venait de rappeler le mot de Godard, selon lequel Israël serait du côté de la fiction, là où la Palestine serait vouée au documentaire. Forensique, dans la bouche de Sivan, devenait le dépassement dialectique de cette opposition : désormais, plus que montrer, il faut prouver, sans relâche. Nous étions en janvier 2024 et devant Control Anatomy, je ne pouvais m’empêcher de me demander : que reste-t-il de cette espérance forensique aujourd’hui ?
No Title semble répondre à cette question en se plaçant à l’exacte perpendiculaire du point d’observation où se situe Control Anatomy : sur le sol, parmi les décombres. Le nouveau film de Ghassan Salhab paraît prendre la suite immédiate de Contretemps, réalisé en 2024 et montré au Réel, dans le cadre de la rétrospective-atelier qui était consacrée au cinéaste. Film fleuve de près de six heures, Contretemps faisait la chronique des quatre années séparant le soulèvement de Beyrouth et l’attaque israélienne lancée sur Gaza. No Title est un moyen-métrage, ni court, ni long, sans générique, ni titre, ni histoire. Il est ; et semble adresser, tout au long de l’errance négative qui le constitue, la même question aux spectateurices : que dire ?

La caméra est à bord d’une voiture qui circule dans les décombres de Beyrouth et du Sud Liban – on pense à D’Est ou Sud d’Akerman et aux routes où s’est abattue la violence de l’impérialisme et du racisme qu’elle filme en lents travellings, depuis une automobile. « Vous êtes en sens interdit ! » prévient un homme, hors champ. Au milieu de la désolation, cette mise en garde sonne avec la même ironie que l’enseigne lumineuse jaune, flambant neuve, d’un bureau de transfert d’argent Western Union croisé entre deux bâtiments effondrés – on reconnaît là l’humour cinglant de Salhab. Le montage, sobre, élimine parfois l’image au profit du son. Sur le fond noir, « Ici », en français et en arabe, apparaît par quatre fois. Jamais « ailleurs ». C’est d’ici, cloué au sol, que regarde et qu’écoute le cinéaste. La rumeur étouffée des travaux de déblayage parvient à l’intérieur de l’habitacle. Parfois, un camion ou un engin de chantier déboule sur la route, dans un nuage de poussière, comme un géant de métal. Une nuit, Salhab enregistre les hurlements des chiens, le vrombissement des avions militaires qui sillonnent le ciel de Beyrouth. Un jour, la voix d’un journaliste radio emplit la voiture et fait gravement état du sort des Gazaoui·es (comme jamais les média occidentaux ne le feraient) tandis que des explosions résonnent au loin. C’est tout.