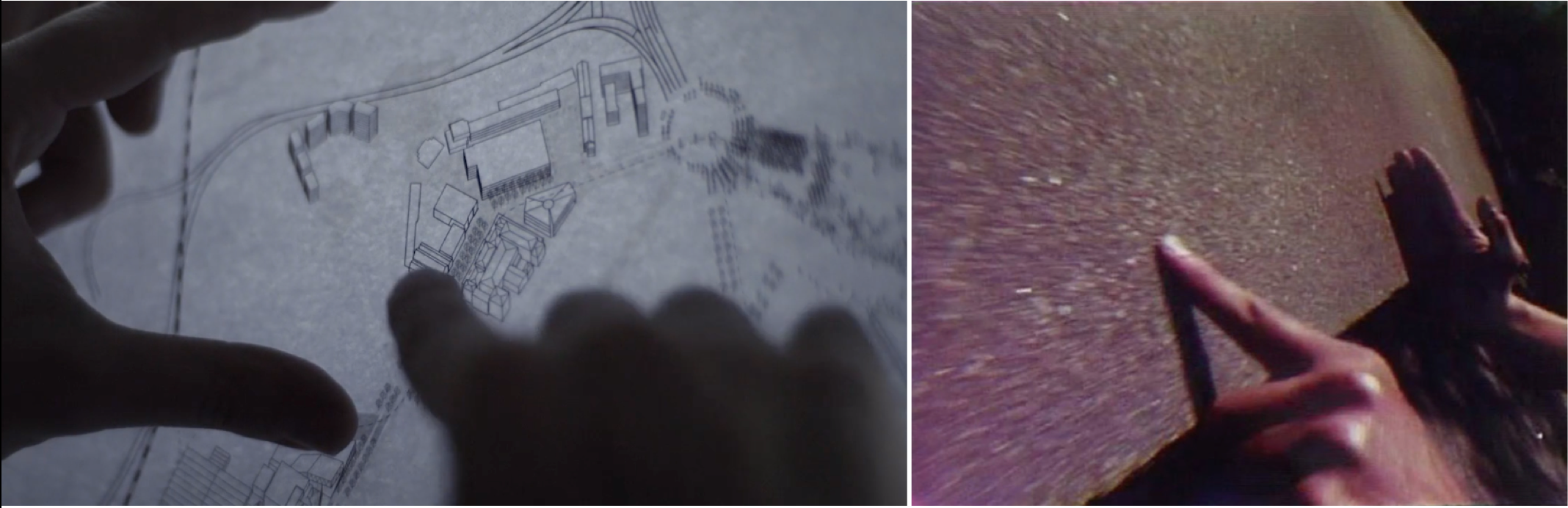Frontières à vif
A propos des Etats généraux du film documentaire de Lussas, 2019
Entre les huit écrans dressés autour du clocher de Lussas pour les États généraux du film documentaire, les chemins sont gemmés de tentes igloos. Au crépuscule, en redescendant le chemin du Bourgeon depuis la salle du Moulinage, on se surprend à marquer l’arrêt : elles luisent, multicolores et chuchotantes, tandis que les premières étoiles apparaissent dans le ciel. Le programme du festival laisse pourtant peu de répit au regard. Sa 31ème édition réservait de belles découvertes, d’innombrables rencontres (programmées ou non) et d’immanquables fêtes — la projection des Chroniques d’un été (1961) de Jean Rouch et Edgar Morin en était une. À Lussas, la mise en lumière de la création documentaire contemporaine s’accompagne de l’exhumation de corpus historiques, parfois rares et précieux. Au revers de la structuration officielle de l’ensemble (douze programmations et trois séminaires, auxquels s’ajoute la Nuit de la radio de la Sacem), spectateur·ices, cinéastes et bénévoles établissaient des relations souterraines d’un film à l’autre, en savourant les fruits du maraichage voisin. Territoires, environnement, frontières, places des cinéastes et de leurs subjectivités dans les films, organisations sociales et — en négatif — dynamiques de bannissement : sous-jacent à la programmation du festival, tout un dédale de thématiques se laissait parcourir. Il incluait les questions expressément soulevées par les conférencier·es invité·es et tout particulièrement celle du réel, distinct de la réalité en vertu de son mode d’apparition par « effraction » au cinéma (Alain Bergala), celle de la tension entre la vie ordinaire et la vie filmée (Monique Peyrière) et celle de l’animal qu’en l’humain le cinéma fait ressurgir (comme l’ont montré Muriel Pic et Erik Bullot).
Le village (Claire Simon)
Les cinéphiles allochtones qui s’y précipitent en raison de son festival peuvent regretter de n’avoir de Lussas qu’une vue parcellaire. Le hors-cadre des États généraux avait sa place à l’écran, cette année, grâce à la série de Claire Simon intitulée Le Village. S’y découvre le paysage humain sur lequel repose, entre autres choses, le festival de Lussas. Cinquante des 1200 habitant·es de ce village, réuni·es autour de l’association Ardèche Images et de l’école du documentaire de Lussas entre autres structures culturelles ardéchoises, vivent du cinéma documentaire et le font vivre toute l’année. Dans un contexte technico-économique transformé par les « nouveaux médias », cette pléiade de l’audiovisuel s’est mobilisée pour la création de Tënk, la plateforme dédiée au documentaire de création. Le Village en retrace l’histoire. Claire Simon se tourne aussi vers l’autre « rive » de Lussas : la communauté agricole — et en particulier vigneronne — historiquement implantée autour de cette bourgade ardéchoise et confrontée à l’évolution du marché et des techniques, ainsi qu’à l’exode de sa jeune génération. Dans Le Village, création cinématographique et agriculture locale se font écho d’une séquence à l’autre, et parfois se croisent autour de personnalités singulières ou à la faveur d’un cadrage, d’un mouvement d’appareil.
Le voisinage, à Lussas, de ces deux « cultures » (deux économies, deux imaginaires…) réputées désunies laisse rêver qu’elles s’y connectent plus solidement : le marché dominant n’est pas plus favorable à l’une qu’à l’autre. Mais bien que poreuse, une frontière, entre elles, reste sensible ; et Le Village invite à la considérer avec précaution. À l’arrière-plan, le point d’ancrage commun de ces cultures, Lussas, apparaît comme un écosystème à part entière, qui relève d’autres défis : la vie n’y est pas toute livrée au marché du tourisme, elle repose sur des établissements de proximité favorables aux rencontres et aux échanges. De la série de Claire Simon, il ressort subsidiairement que si Lussas offre un environnement très favorable à la réception des films de son festival, ce n’est pas seulement en raison de la douceur du climat et du bien-être général qu’apporte le fait de s’échapper quelques jours des métropoles. C’est aussi, et surtout, en raison des questions d’écologie et de société qui, à travers l’agréable bourdonnement des échanges sur la place du village, impressionnent de précision et de complexité pour peu qu’on leur prête l’oreille — il le faut car elles sont socle des « utopies réalisables » (pour citer le titre de l’ouvrage de Yona Friedman).
Charleroi, le pays aux 60 montagnes (Guy-Marc Hinant)
De l’avis général, la ville de Charleroi est tout à l’opposé de Lussas. Sombre, par ses murs, son ciel et son histoire industrielle, la cité wallonne souffre de la laideur qu’on lui attribue par habitude, et sans plus approfondir. Charleroi, le pays aux 60 montagnes (deuxième volet d’une trilogie commencée en 2015, avec Birobidjan, le nid est tombé dans les flammes), est bien loin d’entériner ces préjugés quant à la ville natale de son auteur, Guy-Marc Hinant. Le titre du film préfigure une vision frisant le merveilleux. Elle est pourtant fondée sur une connaissance approfondie de cette ville, et une importante documentation. Non que les soixante terrils qui essaimaient la province du Hainaut à l’époque de son exploitation minière puissent ressurgir comme par enchantement — au grand dam des urbanistes qui interviennent dans le film : ces reliefs auraient permis de faire varier le point de vue des voyageurs et des promeneurs sur l’agglomération, moyennant un plan de circulation approprié. Qu’à cela ne tienne, Guy-Marc Hinant se charge de transposer ce projet paysager en cinéma : lui ne cesse, dans ce film, de changer l’angle de vue et le point focal (au sens littéral comme au sens métaphorique) sur la ville, son histoire et ses habitant·es. Ni les évènements historiques les plus graves dont Charleroi fût le lieu, ni les aspects les plus éprouvants pour sa population d’aujourd’hui ne sont escamotés ; mais ils sont ressaisis dans une histoire politique, artistique et sociale qui frappera le néophyte par sa richesse.
Guy-Marc Hinant utilise son expérience personnelle de la ville de Charleroi comme pierre de touche (il dit « je », en voix off), mais son film fait se succéder de nombreux entretiens avec des élu·es politiques, des historien·nes, des artistes, des personnalités du secteur culturel, syndical ou associatif et des anonymes carolorégien·nes. Ils peuvent durer à l’écran ; le substrat humain qui les vivifie a été préservé grâce à l’organisation de leur tournage (exclusion des compléments d’éclairages artificiels, traitement de la photographie et du cadrage sur place, le jour-même). Si le film ne s’enlise pas dans la monotonie qui guette le documentaire d’entretien, c’est aussi parce qu’il évite le piège du va-et-vient itératif entre les propos des uns et des autres. Avec l’enchainement de ces points de vues sur la ville, c’est bien une boucle, et une seule, qui semble se dessiner autour de Charleroi. Héritier des « films de villes » des années 1920, Charleroi comporte également d’extraordinaires travellings tournés à pleine vitesse sur le ring belge R3, qui soulignent ce schème circulaire. Bien qu’il ne coupe pas à la rareté des « monuments historiques » carolorégiens (conséquences des guerres du XXème siècle), Charleroi doit beaucoup au paradigme de l’architecture et de l’urbanisme. Il fait valoir les infrastructures récentes et à venir de Charleroi, et surtout, ses monuments humains, collectifs — ceux qui ne sont pas faits que de pierres et de ciment. Entre les dimensions de la polis (propres à son sujet officiel : la capitale sociale de la Wallonie) et celles de l’autós (propres à « soi-même », à l’auteur et aux individus), chaque séquence de Charleroi, le pays aux 60 montagnes est une façon de tenir l’équilibre.
Trans-frontaliers
La programmation proposée par le réseau « Docmonde » a permis de découvrir les films issus de ses ateliers de développement de projets : transfrontaliers, à plusieurs égards. Tout d’abord, beaucoup de ces films sont des co-production (franco-belge, franco-réunionnaise, franco-malgache, franco-burkinabé…). Ensuite, leurs auteur·ices, déraciné·es ou issu·es de familles exilées, parfois brisées par l’histoire, ont choisi de traiter des sujets liés à leurs biographies personnelles. Cela les conduit à affronter des censures systémiques, à interroger leur identité, leur subjectivité et, corrélativement, à jouer de leur position — au sens géométrique du terme — dans la réalité qu’ils filment. Ainsi de Bawa Kadade Riba qui, dans son village d’origine (Mailo, au Niger) aujourd’hui scindé en deux camps religieux, décide de construire sa maison du « côté musulman » pour provoquer le dialogue (Étincelles, 2019). Ces cinéastes peuvent aussi franchir cette autre frontière, très sensible d’un point de vue cinématographique : celle du cadre, pour entrer dans le champ de leur caméra. À ce jeu-là — qui n’a rien de frivole — Artur Sokolov, l’auteur de Phalène qui faisait également partie de la sélection « Expériences du regard », s’est révélé particulièrement habile.
Phalène (Artur Sokolov)
Artur Sokolov, a grandi dans un village russe qui, plusieurs mois par an, n’est accessible que par bateau en raison de sa situation géographique, aux abord d’un fleuve de Sibérie. Il y retourne, aux termes d’une formation à l’écriture de documentaire, et tourne les images qui composeront ce film. Phalène doit son titre aux papillons célèbres pour leur capacité à s’adapter à leur environnement chromatique (ils prennent la couleur de l’écorce des arbres), qui se laissent enivrer par la lumière des néons dans la nuit, comme le montre un plan du film ; leur adresse écologique, et leur sensibilité optique sont tout à l’image de celles dont témoigne ce plan en particulier (techniquement remarquable, et poétiquement saisissant) et le film dans son ensemble.
Opérateur de prise de vue de par sa formation initiale, Artur Sokolov aime les plans composés, fixes et longs, ce qui tend à augmenter la distance entre lui et ce qu’il filme. Mais sur le tournage de Phalène, il était d’abord un « proche », du point de vue de sa famille et de ses amis. Sous l’influence des relations humaines, la frontière entre l’opérateur retiré derrière son optique et le monde qu’il filme se dé-raidit, se déchire. Sokolov peut rester discret, fondu dans le paysage, aussi naturellement qu’il peut se faire entendre, soudain, à quelques centimètres de son micro, ou se laisser reconnaître dans le cadre. La sempiternelle question de son statut (filmant, filmé ?) vis-à-vis de l’image ainsi produite peut toujours se poser ; mais il y a surtout que, d’opérateur et proche qu’il était en tournant les rushes de Phalène, Artur Sokolov est devenu cinéaste.
Qu’il soit dans le champ ou derrière sa caméra, Artur Sokolov n’est pas toujours identifiable. Il ne l’est véritablement qu’à l’instant où il surgit, ou disparait, lorsqu’il oscille, papillonne, ne tient aucune position claire ; lorsqu’il se précipite, à la fin d’une danse populaire, vers son appareil placé à plusieurs dizaines de mètres de la scène ; lorsqu’il répond à son aïeul, qui tout-à-coup le taquine au bout d’un rush de quelques minutes ; lorsqu’il déplace son pied de caméra pour rejoindre sa petite sœur dans la pièce voisine, quitte à détraquer tout son cadre (sa sœur est un relais actif de la culture musicale et visuelle de sa famille, et du village dans son ensemble). Le choix qu’Artur Sokolov a fait ensuite d’inclure ces instants, ainsi que des enregistrements sporadiques de son journal audio et des fragments de films de famille des années 1990, sans jamais faire de son ouvrage l’exposé de sa personne, font la singularité de Phalène.
Advocate (Philippe Bellaïche et Rachel Leah Jones)
Avec Rachel Leah Jones, Philippe Bellaïche (le directeur de la photographie d’Entre les frontières d’Avi Mograbi) a co-réalisé Advocate (2019). La personnalité volcanique et déterminée de l’avocate israélienne Lea Tsemel, défenseuse des droits des prisonnier·ères politiques palestinien·nes au Barreau de Jérusalem, y est dépeinte à travers la retranscription de son quotidien professionnel, entrecoupée de quelques entretiens et archives relatives à sa biographie. Tourné entre 2015 et 2016, Advocate permet de suivre les coulisses de différentes affaires dont Lea Tsemel s’est saisie sur cette période, et notamment celle du procès d’Ahmed (treize ans), accusé de tentative de meurtre ; alors, le film se voit partagé entre le portait, centré autour de la figure forte de Lea Tsemel, et la chronique judiciaire dans laquelle la vie de cet enfant palestinien se trouve enlisée. Ce partage se matérialise à l’image, en l’épaisse ligne qui la divise en deux parties dont l’une, rotoscopée, inclut Ahmed.
Une loi israélienne protège l’image des mineur·es impliqué·es dans une procédure judiciaire : iels ne doivent être reconnaissables sous aucun prétexte. Les médias ne respectent pas toujours cette loi et lorsqu’ils le font, c’est au moyen du bandeau noir, ou du floutage de l’ovale du visage — ces derniers, galvaudés, ont pour effets collatéraux de désigner la personne dans l’image en tant qu’accusée, tout en détournant l’attention du contexte dans lequel elle l’est. Dans Advocate, l’anonymat d’Ahmed est garanti mais ses attitudes et ses expressions apparaissent à travers le filtre de l’animation rotoscopique, sous la forme de traits chancelants et précaires. Sa jeunesse, ses émotions, sa fatigue restent ainsi sensibles. Par ailleurs ce « masque » ne s’applique pas aux seuls yeux, ni au seul visage d’Ahmed, ni même à son seul corps mais à toute la portion du champ dans laquelle il se trouve — tantôt à droite, tantôt à gauche de l’écran. Le fond de coupures de presse et de documents administratifs sur lequel évolue sa silhouette fragile représente l’espace paradoxal, médiatiquement sur-exposé et submergé par la procédure judiciaire dans lequel il se trouve précipité. D’autres sont amené·es à l’y rejoindre parfois — parent·es, proches et avocat·es — pour lui parler, le soutenir.
Cet appareil de solutions combinées (scission nette de l’écran, rotoscopie…) s’est construit peu à peu au stade de la post-production, pour répondre à des questions de droit impliquant le film, Ahmed et son image. Le résultat est que l’ « affaire Ahmed » n’est pas réductible, dans Advocate, à l’arrière plan du portrait de Lea Tsemel. Dérivant d’une partie à l’autre de l’image, le regard est tenté de se focaliser sur la ligne noire qui la traverse et contrarie sa circulation. Sa rectitude et son épaisseur pourraient incarner l’arbitraire de l’accusation (rien ne justifie la condamnation pour « tentative d’homicide »). Mais à force d’observer cette ligne, on s’aperçoit aussi qu’elle n’est pas absolument opaque. À travers la rainure ombragée qu’elle dessine sur l’écran, l’œil peut suivre les passages, les gestes furtifs de celles et ceux qui tiennent à rétablir le lien entre Ahmed et sa communauté : ce qui se joue dans cet interstice pourrait bien être le cœur du film.
Balkans
L’histoire du cinéma documentaire Yougoslave a fait l’objet, cette année, d’une « Histoire de doc » particulièrement pertinente. Un éventail de démarches affiliées à la Vague Noire des années 1960 et 1970 s’y est déployé : critiques, — ce qu’indiquait péjorativement, à l’origine, le qualificatif de « noire » appliqué à cette nouvelle vague Yougoslave — elles relevaient aussi bien de l’analyse sociale, du portrait ethnographique et/ou de l’essai cinématographique. Incidemment, cette programmation innervée par les thématiques du territoire des Balkans, de leurs frontières naturelles et historiques, fournissait une belle mise en perspective du récent long métrage de Goran Dević, On the Water (2018), auquel était consacré une séance spéciale. Le long de trois rivières — l’Odra, la Kupa et la Save — qui serpentent entre plusieurs pays ex-yougoslaves pour converger à Sisak (Croatie), la caméra de Goran Dević sillonne un paysage d’apparence paisible ; mais tandis qu’elle recueille le quotidien et les témoignages des riverains, l’histoire de l’éclatement de la Yougoslavie (1991-2008) refait surface.
Ladoni (Artur Aristakisian)
Sur ce versant balkanique, on peut aussi relever le rare Ladoni d’Artur Aristakisian, tourné à Chișinău (capitale de l’actuelle Moldavie) au début des années 1990. Sa projection a inauguré une journée de rencontres qui a permis de recomposer tout un jeu d’influences : celui-ci implique les cinéastes russes contemporain·es Nadia Zakharova (Feu, 2016), Elena Gutkina et Genrick Ignatov (Le loup et les sept chevreaux, 2017) qui ont suivi son enseignement au V.G.I.K., ainsi que le film de Lionel Rogosin sur les habitant·es du Bowery, quartier de Manhattan mis au ban du rêve américain (On the Bowery, 1956) qu’Aristakisian a souhaité montrer à Lussas. En effet, son Ladoni se rapproche d’On the Bowery par son sujet, mais plus encore par le point de vue qu’il nous propose d’adopter : plongé parmi les corps sans voix des déshérité·es quand les conventions sociales nous persuadent de nous en détourner.
Lodani dresse le portrait-fleuve de la population marginalisée de Chișinău (mendiant·es, infirme·s, ivrognes et fou·olles…). Aucun son « in » n’émane de son image. En voix off, un homme s’adresse à son fils à venir et lui fait l’ode radicale de celles et ceux qui, à la marge du « système », ne désirent plus se réinsérer. Il a souvent recours au modèle christique pour ce faire. Quelques grandioses mesures de Jour de colère de Giuseppe Verdi ponctuent cette bande-son ; Aristakisian cite aussi des séquences du spectaculaire Quo Vadis ? (1912) d’Enrico Guazzoni. Cet imaginaire chrétien (schéma de la trinité, martyr, jugement dernier, résurrection…) aux abords d’une question politique et sociale pourrait tracasser l’oreille athée si, à chaque instant, la voix anonyme qui y fait appel ne risquait d’être entendue comme celle de l’un des damnés que filme Aristakisian, et qui aurait renoncé à paraître raisonnable.
Dès l’ouverture de Ladoni sur le massacre des chrétiens dans Quo Vadis, l’œil du spectateur est comme exorbité de son référentiel social contemporain. Sans détour, il est ensuite confronté à la visibilité silencieuse des corps, des visages et des gestes des exclu·es de Chișinău. Ici, pas de filtre — sinon celui qu’instaure la matérialité du film (35 mm, noir et blanc). Tandis qu’en s’adressant à ce fils virtuel, le commentaire se tient à la lisère du délire mystique, au niveau spécifique de l’image le film atteint un paroxysme de matérialisme et d’extra-lucidité. Aucune « frontière » n’est examinée, dans Ladoni, entre la société conforme et la vie des exclu·es : elle se donne d’emblée pour franchie. Ladoni est absolument ailleurs et en même temps, plus radicalement ici, au plus près d’une réalité transfigurée dans l’opération-même de sa projection cinématographique, sa rédemption (pour reprendre le terme choisi par Siegfried Kracauer).
Reality’s Invisible (Robert E. Fulton)
Par sa biographie, Robert E. Fulton — arrière petit-fils de l’ingénieur Robert Fulton (1765 – 1815), considéré comme l’inventeur du bateau à vapeur — apparaît comme l’héritier direct d’un temps rêvé, celui des grands créateurs polymathes dont nous espérons qu’ils n’étouffent pas complètement sous la domination de l’esprit d’expertise contemporain. Pilote d’avion, saxophoniste de jazz, photographe et opérateur de prise de vue (auprès de l’anthropologue Robert Gardner, notamment) converti au Bouddhisme, Fulton est comme ses films : d’une ravissante polyvocité. Sur l’initiative de Federico Rossin et grâce à la numérisation récente de la filmographie complète de Fulton, Reality’s Invisible était programmé à Lussas cette année parmi quinze autres films, plus courts, de ce cinéaste méconnu.
Fulton filme bien des réalités sociales, humaines et naturelles, proches ou lointaines : l’eau et la roche (Swimming Stone), son saxophone (Street film, part 17), sa famille et sa femme (Aleph), les hommes, en Afrique de l’Est (Moonchild), en Amérique du Sud (Inca Light). Mais son travail n’est d’aucune reconstitution didactique : il œuvre à même la perception de ces réalités. À l’instar de celles de Stan Brakhage ou Teo Hernandez, sa caméra est extrêmement vive et ses angles de vues émancipés de la base orthonormale coutumière : horizontales et verticales ne sont ici qu’obliques parmi les obliques. Les circonvolutions de cette caméra découlent peut-être de l’expérience de Fulton en matière de prise de vue aérienne, mais elle procèdent aussi de sa connaissance de son propre corps et de ses possibilités kinésiques acquises via sa pratique du Tai-chi. Bien que Fulton ait recours à divers appareillages, le cœur de son cinéma est bien cette gymnastique, dont l’esprit et le corps humain (non-véhiculé, sans arme) se montrent capables ; d’ailleurs, caméra au poing, Fulton se laisse régulièrement séduire par les jambes de marcheurs anonymes, virevolte autour d’elles et ralentit leurs mouvements comme pour mieux saisir la façon dont le poids du corps se transforme en énergie de déplacement.
Reality’s Invisible a été réalisé en 1971 au Carpenter Center for the Visual Arts annexé à l’université de Harvard. Construit en 1963 par Le Corbusier, le bâtiment accueille une communauté d’étudiants, artistes et théoriciens en pleine émulation, dans un contexte marqué par les récents développements de l’art cinétique, de l’art vidéo, du land art et de la performance. Tout cela est irréductible au propos de Robert E. Fulton mais participe bien de l’écosystème de son film, du milieu architectural, humain et végétal qui l’accueille, et dont il se nourri. Fulton y prélève des gestes créateurs, des paroles d’artistes et des fragments d’énoncés sur les arts. Il ne les explique pas, ne les discute pas ; ils les reverse dans le généreux torrent de perceptions qu’est Reality’s Invisible. Tout se passe comme s’il en avait retenu l’énergie, pour la re-diriger contre toute appréciation conventionnelle et ségrégative de l’art. Les murs du Carpenter Center n’y font pas obstacle (rappelons qu’à la base de l’architecture du Corbusier, les murs de support des bâtiments sont remplacés par des rangées de colonnes, ouvertes sur l’extérieur) : le cinéaste s’en va fureter hors de l’espace réservé à l’exercice de l’art, dans les rues, entre les passants, sur le bitume, parmi les brins d’herbes ; et Reality’s invisible délie ainsi son arabesque prolixe, entre l’art et la vie.
Images : Le Village (Claire Simon, 2019) / Charleroi, le pays aux 60 montagnes (Guy-Marc Hinant, 2019) - Reality’s Invisible (Robert E. Fulton, 1973) / Ladoni (Artur Aristakisian, 1994) / Path of Cessation (Robert E. Fulton, 1974.