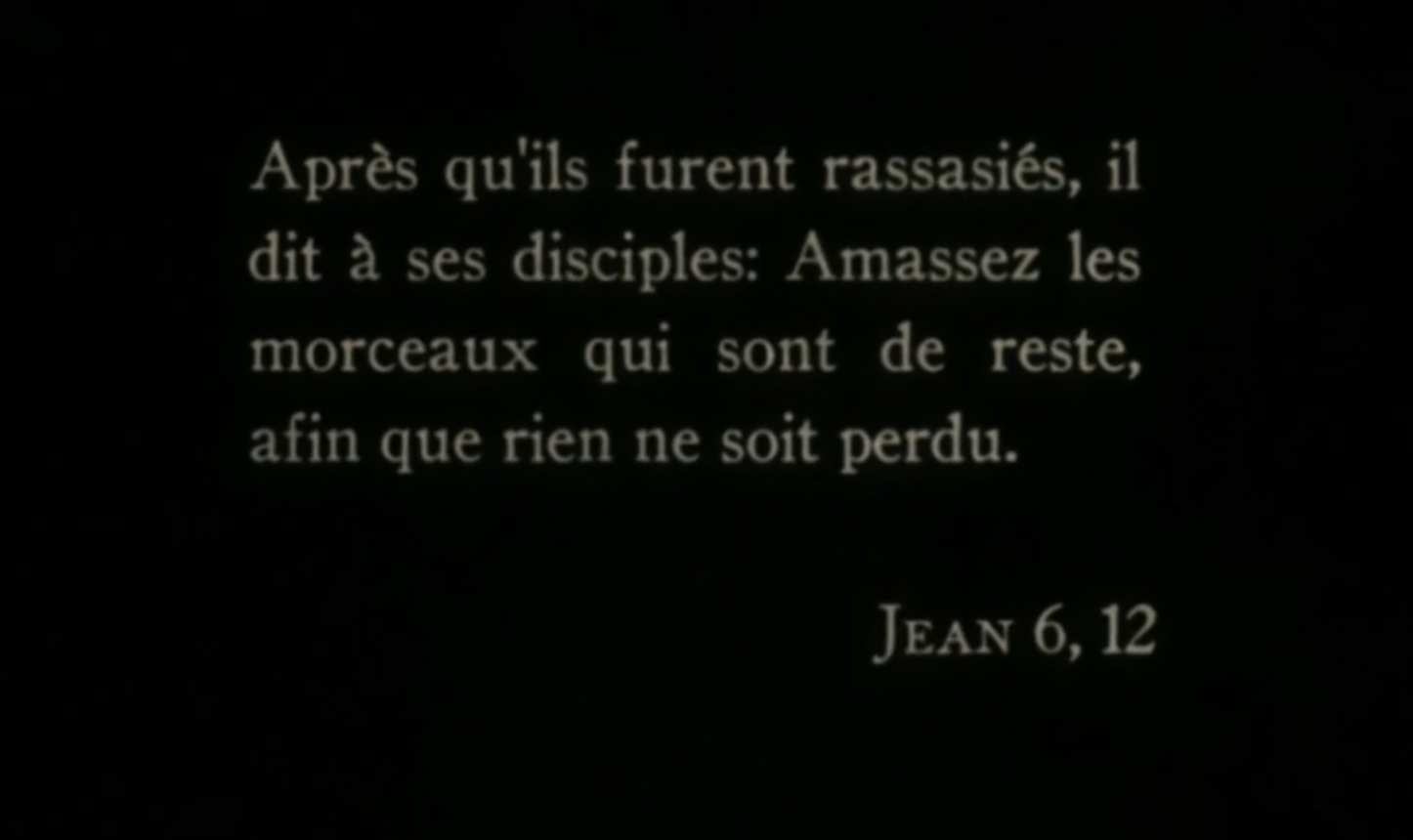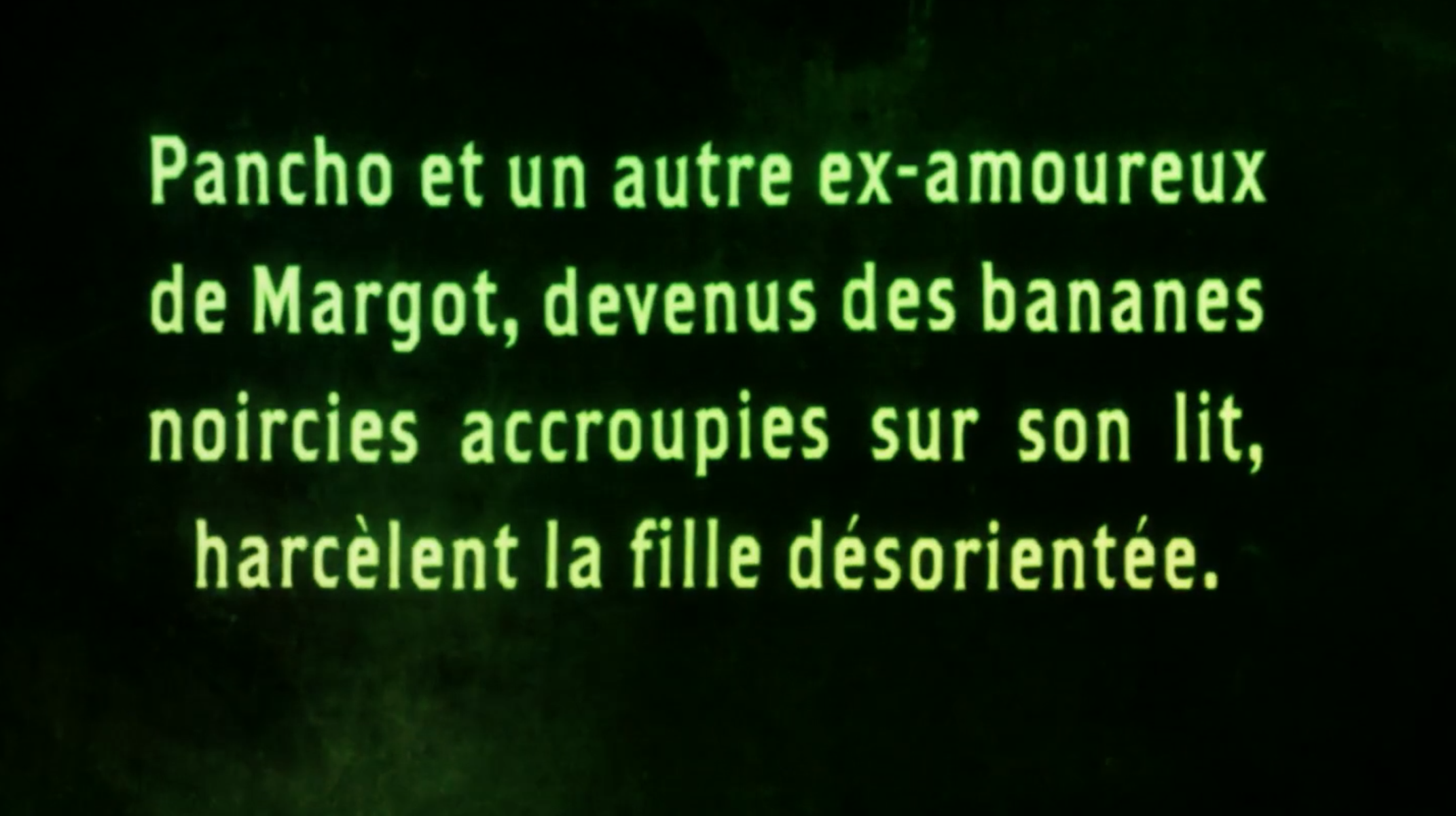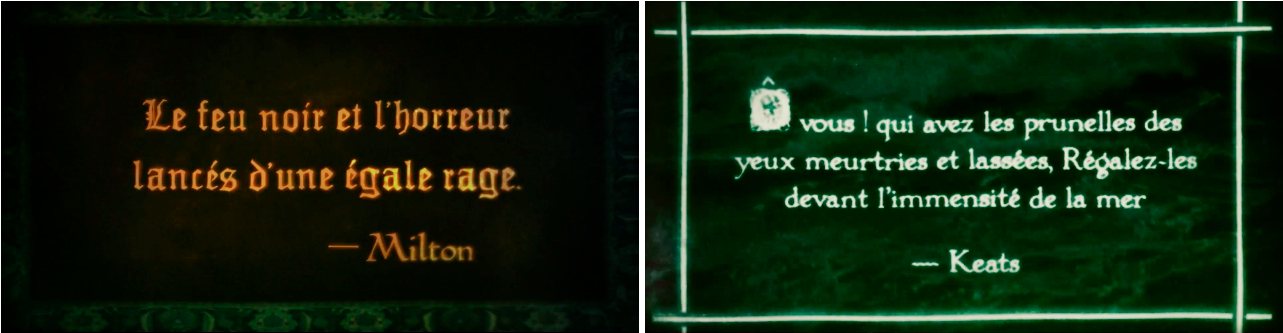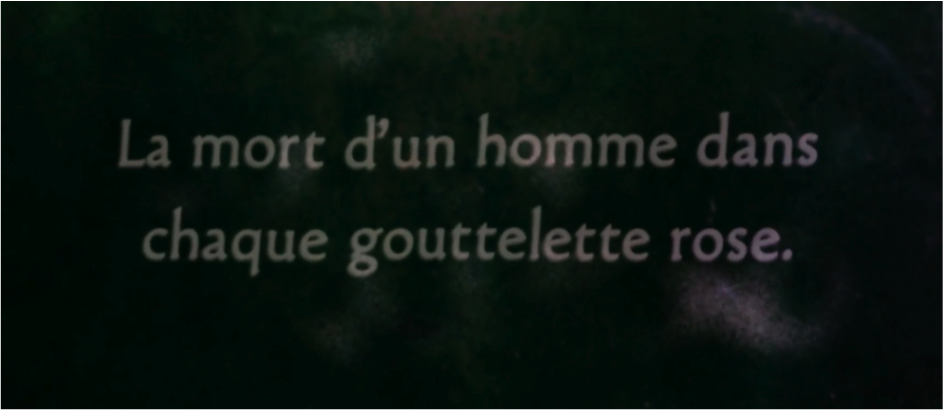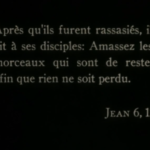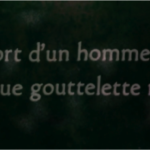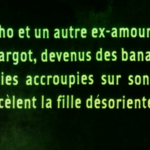Guy Maddin
Brown study : une conversation colorée à propos de The Forbidden room
Entretien-fleuve avec un Guy Maddin en grande forme, en dépit du marathon qu’a été l’élaboration de The Forbidden Room – nouveau chef-d’œuvre inénarrable où un documentaire sur la meilleure façon de prendre un bain se transforme en film de sous-marin à suspens et tiroirs infinis, au gré des délires et visions de protagonistes issus des dizaines de fragments de son projet d’invocation de films disparus, Séances.
Sous les feux croisés de Bruno Schulz et d’Abel Gance, un tour loquace et enlevé d’une œuvre aussi démentielle qu’incarnée, hantée, intime et carnavalesque, par Orsten Groom, peintre et cinéaste, chargé des éléments de décors sur le projet Séances ; et Élodie Tamayo, spécialiste d’Abel Gance et chercheuse en histoire du cinéma.
Orsten Groom : Bonjour Guy. Je connais ton intérêt pour Bruno Schulz : voici un bout du pro-logue de L’époque de génie qui me paraît une introduction épatante à ce qu’Elodie et moi voulons discuter avec toi à propos de The Forbidden Room – et quasi un synopsis du film :
« Les faits ordinaires sont alignés dans le temps, enfilés sur son cours comme des perles. Ils ont leurs antécédents et leurs conséquences, qui se poussent en foule, se talonnant sans cesse et sans intervalle.
Mais que faire des événements qui n’ont pas leur place définie dans le temps, des événements arrivés trop tard, au moment où le temps avait déjà été attribué, partagé, pris, et qui restent sur le carreau, non rangés, suspendus en l’air, sans abri, égarés ?
Le temps serait-il trop exigu pour contenir tout ce qui se passe ? Peut-il arriver que toutes les places du temps soient prises ? Préoccupés, nous courrons le long de tout ce train d’événements, vous apprêtant au voyage.
Avez-vous jamais entendu parler des voies parallèles du temps ? Oui, il existe de telles voies marginales, un peu illégales il est vrai, mais quand on transporte une contrebande du genre de celle que nous transportons, un fait supplémentaire inclassable, on n’a pas à faire la fine bouche.
Essayons donc de dégager à un certain point de l’histoire une voie sans issue, un cul-de-sac, afin d’y pousser cette histoire illicite. Surtout, ne craignez rien. L’opération sera imperceptible, le lecteur n’éprouvera aucun choc. Peut-être même qu’au moment où nous en parlons la manœuvre est déjà accomplie et que nous avançons sur une voie parallèle ? »
Guy Maddin : (En lisant) Oh ouais L’époque de génie : je pense souvent à cette nouvelle. Ma fille puis plus tard ma petite-fille ont toujours été de furieuses dessinatrices. La petite a 4 ans (il rit en poursuivant la lecture). Ça fait un moment que je ne l’ai pas lue, c’est vraiment magnifique. Celle-ci et les autres me font vraiment cogiter. Peut-être parce que je voyage tellement, mais sur de si petites périodes… Je suis souvent en Europe juste pour 2-3 jours ; je suis allé en Jordanie pour un week-end. Chaque fois que je suis ailleurs, je me retrouve complètement à côté de mes pompes à cause du décalage horaire. De retour chez moi je retrouve mon rythme de sommeil habituel, et les souvenirs de ces voyages semblent toujours hors du temps. J’ai vraiment une façon bizarre de mémoriser, vous savez… Faulkner parle aussi de ce phénomène de passé et de présent simultanés. Je ne parviens pas comme tout le monde à juguler le flux du temps : on me dit « Tu te souviens de ceci cela ? », « Non je ne peux pas ! ». C’est peut-être un genre de démence, une malédiction, mais j’ai toujours été comme ça. Du coup on me prend pour un sociopathe qui se fout de tout, mais c’est faux.
Voici le plus étrange : la maison où j’ai passé mon enfance a été vendue en 1987. J’étais déjà adulte. J’avais 31 ans et c’était il y a 28 ans. Eh bien je situe la plupart des choses importantes de ma vie ces 28 dernières années dans cette maison d’enfance – même si je sais que c’est impossible. Je me revois très bien lire un livre découvert il y a 10 ans dans ma maison d’enfance, voir un film récent dans ma maison d’enfance, y rencontrer ma copine actuelle… Je ne sais pas pourquoi ma mémoire aboutit à tout fourrer dans cette grande réserve.
O.G. : Un espace de projection privilégié, une « chambre » quoi.
G.M. : Faut croire, oui. Cet endroit me rend heureux. Quand je l’ai vendu, je n’étais pourtant pas si bouleversé que ça… Je me souviens m’être dit que je devrais prendre des photos, et j’en ai fait quelques-unes, mais l’appareil s’est mis à merder et je me suis dit « Bon ça va comme ça ». Et puis j’ai commencé à en être hanté. C’est pas juste dans mes rêves, c’est aussi la mémoire. Des gens nés après la vente de la maison s’y trouvent, dans ma mémoire. Bizarre…
O.G. : Tu n’es donc pas victime de cette « amnésie pan-je-sais-plus-quoi »… Comment t’appelles ça dans le film ? (Dans le film : « Une maladie qui laisse votre mémoire intacte mais affecte celle de votre entourage, si bien que vous pouvez vous retrouver parfaitement oublié à votre retour chez vous »)
G.M. : Pan-Fallopian Neglect ! Les Fallopes…
Elodie Tamayo : Ton travail sonde des questions de mémoire, de conservation, d’autobiographie – mais tu n’as jamais été du genre à tout enregistrer dans un journal comme Jonas Mekas.
G.M. : Non mais ça aurait été chouette. Il y a plein de photos de ma maison d’enfance, mais surtout du salon à Noël et des trucs dans le genre… Y a peut-être que deux photos de ma chambre, et rien de l’entrée ou du couloir qui sont pourtant vachement importants. Je relisais Bachelard récemment : il parle de tous les espaces qu’une maison peut contenir et ça m’a vraiment aidé à les revisiter. Je suis même retourné là-bas, et j’ai demandé aux gens qui y sont maintenant de pouvoir entrer. Mais c’est bizarre… altéré. Dans mes rêves, c’est intact. Je ne sais vraiment pas pourquoi ça m’importe autant. Beaucoup de gens s’intéressent à leur maison d’enfance mais pas mal disent « ah ouais c’était une maison rigolote ». Ils ne sont pas torturés de ne plus pouvoir y vivre. Si ça se trouve, c’est du « Pan-fallopian neglect », mais je ne suis même pas sûr d’en connaître les symptômes.
O.G. : On a pas mal pensé en regardant le film à tous ces espaces, ces chambres obscures, la camera obscura, etc.
G.M. : Et comment !
O.G. : Elodie va te brancher dans un instant sur les considérations géniales d’Abel Gance à propos de ça. Mais une des raisons pour lesquelles je tenais à ce passage de Bruno Schulz est que je te soupçonne de bien connaitre sa biographie, et la façon monstrueuse dont il est mort : engagé par son bourreau nazi pour peindre les murs de la chambre de son fils.
G.M. : La garderie, oui !
O.G. : À quel point tu fantasmes ce que tu sais de cette chambre, en quoi ce genre de savoir influe sur ton écriture ?
G.M. : Cette chambre, cette « garderie »… J’essaie de ne pas trop y penser, c’est trop dérangeant. Schulz pouvait remonter le cours du temps de façon si immédiate qu’il pouvait littéralement recréer la façon dont on pense enfant, comme un phénoménologue. Il y a tellement de métaphores mêlées dans ce texte que la plupart des écrivains trouveraient ça désastreux. Mais quand les gosses font des maquettes de l’univers, ils ne pensent pas en termes de métaphores – même s’ils les captent de toute façon en construisant leur truc dans ce style pseudo-désastreux – et ils savent créer des émotions. Être renvoyé dans l’enfance avec un flingue sur la tête, c’est en effet carrément schulzien. Les rares images que j’ai vues de ces fresques… c’est trop pervers pour moi ! Rien que d’imaginer être ce petit nazi (haha) grandissant dans cette chambre…bon. Je ne sais pas pourquoi mais Schulz est le seul auteur que je ne me revois pas lire dans ma maison d’enfance : c’est très étrange.
Ça me rappelle un autre épisode. On était à Mexico avec l’équipe pour Brand upon the Brain (Des trous dans la tête), avec un orchestre, des chanteurs, Géraldine Chaplin qui faisait le narrateur, etc.… Tout ce petit monde est sorti de l’opéra où était projeté le film et quelqu’un a lancé « Allez on immortalise ça ! ». On s’est donc disposés autour de la fontaine centenaire qui se trouvait là, le type avait une super-8 avec du film noir et blanc et nous a proposé de poser le temps de la bobine. Ça fait 3 minutes, et j’ai immédiatement senti… je ne suis pas mystique à ce point mais je sentais quelqu’un dans 100 ans regardant ce film et je me suis senti mort. Je nous sentais tous morts, et je l’ai dit : « Vous vous rendez compte qu’on est tous morts ? ». 3-4 mecs souriaient, ils voyaient ce que je voulais dire. Il n’y avait pas de son ni rien, on était juste là à sourire et gigoter tant et plus et on avait l’air insouciants et on était morts. Comme si… ce n’était pas triste, un peu morbide peut-être, et j’ai éprouvé cette étrange empathie revenue d’un siècle plus tard, et le fait que les gens des vieux films sont réels. Normalement, on ne considère pas ces gens sur les vieilles photos comme « réels », mais soudain, cette étrange étincelle d’empathie était arrivée du futur. Je savais qu’elle était unique. Et puis c’est passé.
O.G. : J’ai vécu au Mexique une année, et ça m’a vraiment marqué, cette culture du macabre, c’est-à-dire le contraire du morbide. Le macabre s’empare de tout ce que le morbide draine de funeste ou d’affligeant, et le réactive, comme un jouet…
G.M. : C’est exactement ça, oui.
E.T. : Enchainons avec du Abel Gance à propos de « trous dans la tête ». Voici ce qu’il écrit dans les années 1920, après La roue, à la mort de sa femme et de son acteur fétiche Séverin-Mars : « Nos morts, nos chers morts creusent leur tombe aussi dans notre cerveau, et ils y font un trou noir où ils vivent en silence toujours… Toute ma tête est déjà un cimetière, et je ne sais même pas si je n’ai pas déjà été obligé d’enlever d’anciens morts pour y placer les nouveaux. »
G.M. : C’est superbe.
E.T. : Oui, et il mentionne que ce « trou noir » se fera bientôt camera obscura, emplie de morts. Gance n’a cessé de le répéter : le Cinéma est la machine à résurrection.
G.M. : C’est vraiment dingue, magnifique. Je ne sais pas si ça tient au caractère mélodramatique de Gance mais ça cerne exactement ce qui m’importe. J’accuse est sorti en 1919 mais il l’a tourné pendant la guerre, non ?
E.T. : Oui, en 1918. Cette idée de Gance a en effet l’air d’avoir toute sa place dans The Forbidden Room : l’espace privilégié pour accueillir les morts est l’œil, l’œil qui doit s’agrandir et se creuser puis mourir à son tour pour permettre la résurrection. Ton film dit à un moment que « La terre n’est pas solide mais creusée de chambres vides et de sentiers cachés ». Il y a ces bulles d’air dans les crêpes qui sauvent l’équipage de l’asphyxie, et ce n’est pas tout : il y a aussi cette intervention schulzienne du dieu Janus qui « voit dans les espaces vacants du temps » – ce qui sonne aussi très Gance, très « fosse à résurrection ». The Forbidden Room semble à l’évidence très investi et construit par ces motifs.
G.M. : Ces espaces vacants ne cessent d’égrener le film en effet, et tous mes films je suppose. Ils sont peut-être la matière même du monde, mais ils m’évoquent un intervalle de résurrection spécifique de mon enfance : la nuit où mon frère est mort. Je me suis réveillé dans ma chambre le lendemain matin, je pouvais voir son lit depuis le mien. Il était habituellement toujours défait et bordélique, mais ce matin-là il était parfaitement bordé, net. J’entendais mes parents s’angoisser car ils n’avaient aucune idée d’où il pouvait bien être. Sa chambre n’avait jamais paru si vide. Comme mes parents, ma petite cervelle de 6 ans s’est mise à s’emballer et cogiter : « Il rentrera bientôt, tout ira bien, mais où a-t-il bien pu passer la nuit ? », comme ça en boucle… On a découvert son corps plus tard dans l’après-midi. Cette nuit-là j’ai dormi dans sa chambre, dans son propre lit.
J’ai soudain hérité de sa collection de coquillages, de son radiocassette, d’une radio à ondes courtes et de sa bibliothèque, et même de ses vêtements dans lesquels je ne pourrais grandir que d’ici 10 ans. Je suis devenu lui. J’étais sa résurrection. Comme beaucoup d’enfants, j’ai passé de longues heures à me rêver mort, comme mon frère. J’ai toujours supposé que je m’ôterais la vie, comme lui, et cet itinéraire s’est extrêmement romantisé pour moi. Ces rêveries d’auto-commisération d’un garçon solitaire dans sa chambre, ou plutôt la sienne, étaient comme un texte sacré, une somme de mythes, LA légende de la mort de mon frère et de ma propre renaissance. La chambre était vacante, puis s’est rapidement emplie. Elle a toujours été emplie depuis.
E.T. : The Forbidden Room semble en effet « hériter » d’une vaste bibliothèque que le film convoque par citations, cartons, enluminures… de la Bible, aux sagas islandaises et jusqu’à ce « livre des apothéoses » qui clôt le film. Gance travaillait beaucoup ce type de circulation aussi, entre le texte et l’image.
G.M. : Je sais ! Et j’adore ça chez lui, cette volonté jusqu’au-boutiste. Je n’en connais pas tant sur Gance mais ces phrases sont magnifiques et mettent dans le mille. Quant à moi… j’ai un jour eu le malheur d’avouer que les références littéraires servaient à améliorer la « qualité du voisinage ». Quand les dix dernières minutes du film battent de l’aile, une citation prestigieuse peut vraiment relever le niveau. Je sais d’expérience qu’une image faiblarde peut être sauvée par le bon effet sonore ou la musique juste, mais aussi par le texte. Je m’en suis servi. C’est parfois de l’inspiration de bout de ficelle mais ça ne signifie pas que la citation n’est pas pertinente : il y a toujours un pro-cessus conscient et subconscient quand on choisit ces choses-là, ou qu’on les invente. On n’en a pas inventé pour The Forbidden Room, mais le projet interactif dont il est issu en est rempli : certaines sont générées par ordinateur ou inventées par des gens qui existent ou pas. Il est parfois plus aisé d’écrire une citation que de trouver celle qu’on cherche.
O.G. : Werner Herzog fait ça au début de Lessons of Darkness, une fausse citation de Pascal : « L’effondrement de l’univers stellaire se déroulera comme la création, dans une grandiose splendeur. » Selon Herzog, Pascal lui-même n’aurait pas mieux dit.
G.M. : Oui, ça accorde une tonalité, la couleur juste.
O.G. : Cependant, tu utilises quand-même le How to take a bath de John Ashbery pour planter le décor de ton film. Il y est question de « cercles savonneux s’élargissant » : il s’agit évidemment de son procédé et de sa méthode. Il y a carrément Saint Jean qui parle des restes, puis Keats prend le relai et juste après apparaît l’exposition du film, très belle, qui est certainement de toi. Plus tard on trouve une formule qui pourrait faire le gros titre du film : « une ‘‘Brown study’’ sur le Dieu Janus ». « Brown study » parlons-en, et puisqu’on est dans les poètes anglais, tu dois connaitre ça de T.S Eliot dans The Dry Salvages : « I do not know much about gods; but I think that the river is a strong brown god. »
G.M. : Ah génial. Ça me branche assez sur les couleurs : je crois que mon boulot sur le film – puisqu’Evan [Johnson, le co-réalisateur de The Forbidden Room] s’occupait de l’étalonnage – était de penser la palette. Je gérais aussi les intertitres, et rien que pour m’emmerder Evan me poussait à aller à toute vitesse. Je bossais donc de mémoire, et ce dont je me souvenais des tournages était plutôt affreux. J’essayais donc d’améliorer un peu les choses avec les intertitres. Sans que je sache pourquoi, l’expression « Brown Study » a jailli. Je crois que ça vient du dictionnaire… un énorme dictionnaire. Voilà l’histoire : j’ai enfin commencé à lire des livres à 24 ans, car j’avais trop honte de mon vocabulaire. J’ai compulsé tous les mots du dico pour les recopier dans un classeur, que j’ai gardé.
Quand je consulte ce classeur aujourd’hui, c’est vraiment humiliant. J’ignorais à 24 ans des mots qu’un enfant de 13 devrait connaître. Je les apprenais donc par cœur et l’un d’entre eux est « Brown Study ». C’est un terme que je n’ai jamais recroisé depuis. Cela fait donc 35 ans que j’attends de l’utiliser ! Je me demande d’où ça m’est venu… ça sonne comme un truc qu’Oscar Wilde pourrait concocter : « I was in a Brown Study… » (nasillard et chuchoté).
O.G. : Puisqu’on est dans la couleur et le marronnasse, voici le catalogue d’une exposition qui se tient en ce moment au Petit Palais : « L’estampe visionnaire de Goya à Redon ». C’est cadeau.
G.M. : Oh merci ! (Il tend la main).
O.G. : Pas si vite : il faut d’abord lire l’avertissement au dos. C’est une injonction d’Odilon Redon – dont tu es friand je crois – et elle est sévère : « Il faut respecter le noir. Rien ne le prostitue. Il est agent de l’esprit bien plus que la belle couleur de la palette ou du prisme. » C’est étonnant de la part d’un coloriste comme lui. Keyhole était « respectueux », mais pour le coup The Forbidden Room est très bariolé. Qu’est-ce qui t’a pris ?
G.M. : Je suis venu à la couleur de façon très indirecte. Quand j’ai commencé à réaliser des films, je ne faisais qu’imiter mes héros. J’essayais de reproduire la temporalité de Schulz dans mon premier court-métrage sur mon père mort, où il vit à nouveau et meurt à nouveau et vit encore. C’est ce dont je rêvais en permanence et je me suis dit : « J’ai des rêves à la Schulz ». Et puis j’ai commencé à imiter la façon dont le son y sillonnait, les craquements ambiants, et ça me faisait du bien parce que ça m’évoquait L’Âge d’or ou quelque chose comme ça. J’ai commencé comme une midinette qui dessine ses rock-stars préférées : Schulz, Buñuel… puis j’ai réalisé que ce que je choisissais d’imiter disait beaucoup de choses sur moi. Ce n’était plus imiter, mais choisir. Autre chose : quand j’ai commencé à donner des interviews en festivals vers 32-34 ans, je me suis fait le vœu pieu de ne jamais répondre deux fois la même chose (parce que c’est chiant). Alors je me suis mis à mentir. Beaucoup. Les mensonges sont restés, bien plus que les vérités, mais c’est devenu répétitif et ça a fini par m’épuiser. Ça m’a pris des années de comprendre ce que je suis en train de vous raconter : un nouveau film se faisait et avec lui un nouveau tas de mensonges, et j’ai finalement décidé de ne jamais dire la vérité. Mais ce n’est que récemment que j’ai pigé qu’après avoir baratiné à tout va pendant 30 ans, les mensonges choisis sont aussi éclairants que des vérités : ils finissent par me révéler.
Et voilà qu’à présent je me renifle de façon similaire par la couleur. J’ai fait un film en couleur en 1992, Careful, mais là encore c’est venu en copiant. Je me promène un jour au magasin de peinture que je fréquentais quand j’étais peintre en bâtiment, pour prendre quelques couleurs et jeter un œil sur les nuanciers, voir quelles maisons ont de l’allure, quand en papotant le vendeur m’apprend ce que sont les complémentaires. Evan et moi, on y connaissait que dalle en couleurs – on regarde des films, c’est tout – mais on s’est mis à les inspecter plus précisément et à récolter ces vieux films où la couleur était incontrôlable à cause de cette chimie qui proposait en gros un abricot, un turquoise, et voilà (les Soviétiques avait leur système à eux). On s’est donc mis à pomper Douglas Sirk, des palettes très sophistiquées. Certaines sont ravissantes mais il était temps pour nous d’y insérer les plus laides – un peu à la façon dont Buñuel décadre ses plans, ou tous ces films parfois un peu crapoteux. C’était assez cool de ruiner toute cette joliesse.
J’espère comprendre dans quelques années ce que je suis en train de foutre avec la couleur, parce que je n’en sais rien. Je le fais, c’est tout, mais je me connais suffisamment pour savoir que je rationaliserai rétrospectivement ces choix comme satisfaction de certains désirs, ou révélation de traumas, faiblesses, espoirs… Pour l’instant je me fais l’effet d’un imposteur qui en sait suffisamment pour faire un film qui ne ressemble à aucun autre. Je n’ai peut-être fait que ça. Ça m’a vraiment surpris de comprendre que tous mes mensonges sont en fait la vérité, et j’espère qu’il y a une vérité quelconque dans mon appropriation frauduleuse de la couleur. Ou bien la vérité est surévaluée.
O.G. : Cela me rappelle deux choses sur Magritte. La première est qu’il se plaignait à la fin de sa vie de ne pas être reconnu avant tout comme un grand coloriste (je t’accorde que ça ne saute pas aux yeux, et que comme la phrase de Redon sur la couleur, c’est étonnant); la seconde c’est une phrase qu’il répétait souvent, quasiment sa devise : « Chaque chose visible cache quelque chose d’autre de visible ». Ça sonne très Maddin avec tout ce que tu racontes.
G.M. : Wayne Koestenbaum a écrit un essai l’an dernier sur My Winnipeg. Il y a un moment dans le film à propos d’une émission tv quotidienne, Ledgeman, où ma mère empêche de se tuer un type qui se tient sur le rebord d’une fenêtre. Il y retourne le lendemain et c’est tous les jours pareil – un running-gag, quoi. J’ai mis ça dans le film car ça me semblait… drôle. Mais ça vient aussi d’un faux souvenir d’enfance : il y avait un show-suicide comme ça chaque semaine. J’étais trop jeune pour en être vraiment affecté mais j’ai un frère qui s’est tué quand j’avais 6 ans. Ce critique a écrit : « Guy insère ce spectacle quotidien du type à la fenêtre, afin que chaque jour son suicide soit remis au lendemain ». Que chaque jour une personne puisse ainsi être rappelée à la vie par la parole, tirée de cette fenêtre… ça m’a tellement surpris de lire ça. Mais je pense qu’il a raison. C’est tellement saisissant de comprendre ce qu’une vieille blague dissimule que ça m’a fait pleurer, à 50 ans d’intervalle. Ce critique est vraiment bon pour débusquer ces « choses visibles cachées derrière quelque chose d’autre de visible ». Il a lui aussi commencé à peindre, tu sais ! J’aime vraiment bien le lire, bon sang qu’il est bon ! Comme je vous l’ai dit, c’est lié d’une certaine façon à la résurrection… mais pas à la résurrection chrétienne. Je ne crois pas être chrétien. Il est probable que la disparition de mon frère se soit transformée en histoire : ça ressemble plus à une histoire qu’à une véritable mort pour moi. Mais ça a été L’HISTOIRE (à vrai dire une histoire incroyablement riche que j’ai aimé vivre).
O.G. : Comme il est dit dans le film : «That’s a story ! But regarding what’s happening in this subma-rine, I don’t know what it is but it makes me nervous ». Les mythes de ton frère, et de ton père…
G.M. : Oui celle-ci est très élaborée… Je me sens si immature, comme si j’avais 7 ans. Comme une grande et longue berceuse.
E.T. : Pour revenir à Gance, le cinéma se joue exactement là, comme lieu rituel et mystique de résurrection. La nature et la confection de The Forbidden Room, fait de films-fantômes qui se hantent les uns les autres, m’évoque cette phrase de lui : « Moderne iconoclaste, j’offre chacune de mes images en holocauste à la suivante et celle-ci brûle celle-là comme ma pensée de demain brûlera celle qui me dicte cette lettre. »
G.M. : Il n’y a que Gance pour savoir dire les choses comme ça. J’ai trouvé un discours qu’il a donné à son équipe pendant le tournage de Napoléon. Incroyable, un must. Je me revois le lire et me promettre « Je DOIS donner ce speech avant de tourner ! »
E.T. : Il a même écrit une prière pour la production pendant La Fin du Monde, afin d’obliger son monde à suivre ses ordres comme étant sacrés. Il a tout sacrifié au cinéma, et c’est ce qu’il a fait avec tous ses projets abandonnés et non-réalisés. The Forbidden Room provient aussi du sacrifice des films du projet Séances, personnifié par le volcan. Dans le film on lui offre un hareng, du tapioca, un pneu…
G.M. : La lave ressemble à de l’émulsion, et selon moi à un ectoplasme. L’émulsion ressemble vraiment à un film agonisant vers l’irregardable. Vous connaissez ce film de Bill Morrison, The Light Is Calling ? Ça fait 9 minutes et on en a pris quelques photogrammes vraiment mal barrés pour les scanner. Ça rend comme s’ils étaient projetés sur des draps rougeoyants sous la tempête et tout d’un coup la moisissure apparaît et la lave est en ébullition. Pour moi le triangle a toujours été : Émulsion / Ectoplasme / Mort – et au-delà. La matière film est remplie de fantômes car c’est le médium idéal pour les convoquer et démontrer que plus cette relation est menacée, plus l’ectoplasme est instable. C’était vraiment mon sentiment quand on a décidé que l’esthétique du film serait comme ça, et pas autrement. Bien sûr les œillades et les lumières tordues et les ombres m’ont toujours beaucoup importé. Dans Archangel, un gaz fournit l’amnésie ambiante, et pour moi l’amnésie est plus qu’un truc pratique et mélodramatique. À mon sens, c’est un moyen narratif nécessaire afin d’oublier toutes nos saloperies et le deuil tétanisant qui en résulte… Borges parle de ça : « oublier afin de pouvoir avancer dans le temps ». Si votre mémoire est trop bonne, vous vous remémorez chaque instant à 24 images par seconde, de façon séparée plutôt que continue.
Je pense aux fantômes en tant que souvenirs ratés, ou culpabilité. Il faut quand même admettre qu’il y a de quoi se demander si l’on se souvient vraiment du même souvenir chaque fois que l’on s’en souvient, comme si c’était écluser une pinte d’un tonneau… Bon, c’est une métaphore à la noix, mais quelque chose doit forcément s’altérer à chaque fois que l’on se souvient : je pense que l’on se souvient toujours de la dernière fois dont on s’est souvenu. Chaque souvenir est celui de la dernière remémoration.
C’est comme un film : ça vieillit puis ça pourrit. On ne sait pas encore si le numérique pourrit, mais on sait au moins que le film est physique. Le numérique semble magique d’une certaine façon, mais c’est encore plus semblable à la mémoire : c’est neurologique. Ça bouge peut-être imperceptiblement. Nous savons tous que nos mémoire sont douteuses… je vais pisser. (Pause)
O.G. : Il y a une progression spatiale particulière dans le film, à commencer par la situation du bain, l’eau dans le sarcophage savonneux, etc., et d’un coup on se retrouve dans un sous-marin, soit sa réversion formelle point par point : l’eau à l’extérieur, et la menace d’une « gelée explosive » qui fait suite au savon.
G.M. : On a tellement galéré à lier ces choses entre elles… On ne savait pas quand on a tourné « How to take a bath » que ça ferait partie d’un long-métrage, mais quand on en est arrivé au sous-marin, si. On ne savait ni où ni comment précisément, mais j’adorais ce passage qui est en fait une adaptation d’un vieux film de sous-marin de 1915, qui s’appelle The Forbidden Room (Alan Dwan). J’aimais cette progression de l’arrière à l’avant de l’engin, avec cette gelée au fond, et comme par hasard une baignoire à l’autre bout. Je ne sais pas si je l’ai rationalisé comme tu le fais, mais ça initiait une progression : une première histoire dans l’histoire, puis un type pénètre une grotte, en fait le tour puis en sort. La façon dont le film est structuré fait qu’il y a 6 histoires dans les histoires au 1er acte, puis 9 quand on progresse dedans, dont une depuis le bain : « How to take a bath » et le sous-marin, puis dans la grotte des Loups rouges, puis il y a un champ de fleurs puis une jungle puis un night club, ça vire en chanson, et au centre de la chanson une espèce de Mother blobbing (*intraduisible) – une version gélatineuse explosive de la mère, quoi, et puis ça ressort encore – et donc ça fait 6 de profondeur si tu comptes la mère parce qu’elle vient de l’histoire centrale du dernier acte, The Dream woman, ce film perdu d’Alice Guy (Charlotte Rampling en figure maternelle). Donc on ressort de tout ça et d’une façon ou d’une autre c’est toujours plaisant de s’extraire. J’étais en rapport intime avec ma peur pendant ce film : il y a une chambre interdite et tu en as peur, mais tu dois y aller, mais ça fait vraiment du bien de s’en tirer !
O.G. : Et la chambre précédant LA chambre interdite est celle de la mère par-dessus le marché !
G.M. : Je sais, c’est ridicule ! Pour regarder ce film il faut y rentrer, en sortir, re-rentrer, re-sortir, y retourner puis sur le chemin de la sortie il y a un « Livre des apothéoses » puis c’est fini ; et la plupart des hommes sont terrorisés : untel a peur mais le dissimule avec une drogue, sucer de la sève ou quelque chose comme ça. On voulait se tourner en ridicule en tant qu’hommes et on a longtemps considéré ce sous-titre pour le film : « Confession et suicide d’un patriote », du genre type qui s’impose aux femmes en permanence, où qu’elles soient, qui psychanalyse une femme de force dans un compartiment de train, ou qui en sauve une qui lui a rien demandé. J’aimais assez la progression que ça induisait, mais à cause de notre trop plein d’imagination c’est parti dans tout les sens. Aussi c’est devenu plus maniable quand on a décidé d’en faire un long-métrage, car ça devenait assez systématique : des hommes qui fuient comme des lâches, qui ont peur d’entrer dans des choses, la pénétration, tout ça… les baignoires…
O.G. : Et cette satanée gelée explosive !
G.M. : Gelée explosive ROSE !
E.T. : Pour arrêter de déconner plus ou moins une minute : comment ne pas associer ta gelée avec le celluloïd, le bain de révélation et tout ça ? Tu sais qu’on est très branchés Abel Gance…
G.M. : Vous êtes dans mon camp les gars ! Au fait, merci d’avoir regardé le film aussi précisément.
E.T. : Tu connais La Vénus aveugle ? C’est sur une aveugle qui se fait embarquer sur un navire par une troupe d’hommes pour un voyage immobile : ils lui font toute une mise en scène avec des sons et des trucages pour lui faire croire que ça vogue, et elle finit par recouvrer la vue. Le truc c’est que c’est vraiment un film sur les pleurs, les larmes, l’humeur de l’œil, la gelée explosive !
G.M. : Oui. J’en ai vraiment bavé pour obtenir une copie de La Vénus aveugle. Pour ma rétrospective au Centre Pompidou je l’avais réclamé à un type très haut placé là-bas : « Do you know La venou aveug’ ? », et le mec m’avait rétorqué : « Ce gros tas de merde !? » (Rires). J’ai dû batailler : « Noooon, je DOIS voir ce film ! » d’autant plus que ce type le qualifiait de vieille merde. Gance fait vraiment des films dans une langue autre, avec un vocabulaire cinématique spécifique. Quelqu’un de similaire aux États-Unis serait peut-être Joseph von Sternberg, cette propension mystique…
O.G. : Pour nous c’est toi le similaire.
G.M. : C’est pour ça que j’ai fait mes propres adaptations de Gance, d’après La Roue et La Fin du Monde ! (Odilon Redon & The Heart of the World) Je les croyais perdus…
E.T. : Ils le sont : La Fin du Monde a été charcuté, Gance ne l’a pas monté et l’a carrément renié. C’est plutôt un document sur ce que le projet devait être, et ça devait être bien plus qu’un simple film – comme toujours avec lui. La Roue n’est pas perdu mais il y en a tellement de versions qu’on ne sait plus à quoi ressemble le montage originel.
G.M. : J’en ai une version de 4 heures. C’était censé être quoi de bien plus, La Fin du Monde ?
E.T. : Une société mondiale de cinéma mystique.
G.M. : Oui il voulait faire du cinéma une religion mais il a eu des problèmes de fric. Même dans ses petits films, Dieu est à l’horizon. Beethoven n’est pas simplement un génie : le voilà au piano dans la première scène et le film devient un orchestre symphonique.
O.G. : Dans ton film, la déité du volcan joue un rôle similaire: il génère ses propres rêves, des visions, d’où jaillit le climax : carrément un « Livre des apothéoses ». C’est en quelque sorte une compilation de chutes et de climax formidables, où il est d’ailleurs beaucoup question de chutes. Tu sais ce que signifie « Chutes » en français ? Littéralement les restes de la pellicule.
G.M. : Vraiment ? C’est exactement ça ! Comme à la fin de ce film espagnol, Vampir Cuadecuc. « Cuadecuc » signifie « restes », « chutes » – et c’est un film génial. Sinon vous connaissez ce film de 1933, Déluge ? C’est un peu un cousin lointain de Gance. Il a été perdu pendant des années, et vers 1990 on l’a retrouvé en Italie, où il n’a survécu que dans une version doublée. Les acteurs sont américains, mais doublés en italien. Il y a des années accumulées de rayures et de merdes sur la pellicule, mais pour une fois le doublage colle parfaitement parce qu’on voit pas très bien les lèvres. Les acteurs sont pas très connus (y’en a un qu’on retrouve dans Rosemary’s Baby 30 ans plus tard mais il est méconnaissable), et donc tout le monde a l’air plus italien – à tort : on se met donc à imaginer les mains qui gigotent mais elles ne gigotent pas vu qu’elles sont américaines. Il y a des effets spéciaux, c’est de la même année que King Kong, juste après La Fin du Monde, et il est aussi question de fin du monde, ça a une grosse aura gancienne. Ça me surprendrait pas de découvrir qu’ils ont pompé La Fin du Monde : les dix premières minutes sont démentielles, sans personnages, sauf peut-être l’acteur principal, un baromètre. Ces types prédisent plus ou moins l’apocalypse avec ce baromètre, et il y a tout ce tas de scientifiques, de fils électriques, de tours de radio et des gens qui les écoutent et qui flippent et se mettent à courir partout, puis le climax, puis le titre du film déboule et… détruit New-York. À partir de là on entend plus parler du monde : c’est juste un gros bordel post-apocalyptique et la civilisation recommence à la fin. C’est aussi très dingue, on est complètement désorienté par ce langage. J’ai pas l’habitude de ça, peut-être que vous l’êtes en Europe, mais ça ne ressemble pas à un film hollywoodien avec ce doublage. On dirait le petit frère de Gance, c’est vraiment drôle et il y a une espèce de résurrection… Je vous enverrai une copie.
E.T. : Tu connais dans le genre ce film danois A trip to Mars (1918, Holger-Madsen) ? Il y a une civilisation martienne de paisibles prêtres végétariens qui baisent pas…
G.M. : Pas de viande, pas de cul, tirez-moi de cette planète !
E.T. : …Les gars de la Terre y arrivent et comme toi ils veulent du sexe et de la viande…
G.M. : Ouais ils se mettent à violer à tout va… (rires)
E.T. : Ouais mais finalement il y a un tribunal qui s’instaure et qui consiste à se juger soi-même, et ils comprennent que les martiens ont tout bon.
G.M. : « Encore un steak et on se casse » ! Le seul Danois que je connaisse est Urban Gad, parce qu’il a des films perdus vraiment très cool.
O.G. : Est-ce que tu sais que Lars von Trier décrit Nymphomaniac comme du « Digressionisme » ?
G.M. : « Digressionisme » ? Han !
O.G. : Tu es jaloux.
G.M. : Je suis souvent jaloux de Lars von Trier, mais je ne suis pas bien certain de ce que c’est, « Digressionisme »… « Digressionisme » ?
O.G. & E.T. : « Digressionisme ».
G.M. : « Digressionisme » ?? C’est ce qu’il a dit lui-même ? Bordel de dieu je suis trop jaloux de sa formule ! Sans déconner, il veut dire les digressions dans l’histoire, mais c’est toujours le même personnage, non ? Je me dis parfois que j’aimerais encore plus ses films dans quelques années, quand ils m’auront plus accompagné, mais pour l’instant mon préféré c’est son Médée de 1987. Lui aussi il fait des films dans une autre langue, leur surface est tellement belle. Il est si investi avec les femmes que ça m’intrigue complètement : je connais un tas de femmes épatantes et cinéphiles qui disent « Il a tout compris » – Polanski fait un peu ça – et j’en ai fait mon but ultime.
Il est encore trop tôt pour en parler mais mon prochain film ne sera probablement pas fait avec les fragments de 70 films, mais de quelque chose de plus évident, et je veux une femme. Mais je lui réclame une trajectoire apocalyptique à la Gance. Je m’en crois capable parce que j’ai une situation que je peux comprendre : une minable jalousie sexuelle qui devient globale et change la face du monde.
Toutes les images proviennent de The Forbidden room (Guy Maddin, 2015).