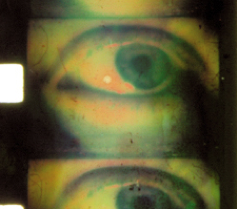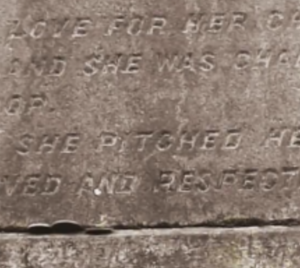Journal de France, Raymond Depardon et Claudine Nougaret
Portrait d'un enfant du siècle
Outre que le dernier film du couple Depardon-Nogaret datait déjà de 2008, Journal de France attisait l’attente du spectateur par sa forme inattendue. Pour la première fois en effet, les auteurs – depuis leur rencontre pour le tournage d’Urgences en 1987, Claudine Nougaret est l’ingénieur du son attitrée du documentariste – se proposaient de replonger dans la masse d’images tournées, depuis les balbutiements à la caméra de Depardon jusqu’aux derniers projets, la trilogie paysanne (2001-2008) et l’exposition Terre Natale à la Fondation Cartier (en collaboration avec l’urbaniste Paul Virilio, en 2008). Cette démarche pouvait aussi inspirer une crainte : Depardon nous a habitués à donner régulièrement de ses nouvelles, et, dans ses livres photographiques, à jeter un regard réflexif sur l’ensemble de son œuvre[11][11] Citons Depardon : Voyages, Hazan, 1998, somme rétrospective de plus de 600 clichés agrémentés de textes, dont quelques inédits, ou Errance, Seuil, 2000, commenté ici même.. Qu’est-ce que le film aurait de plus à proposer ? Face à la somme d’évènements petits et grands couverts par le couple, comment donner la mesure d’une pareille carrière sans décevoir ? Comment échapper à l’effet compilation, et à la tentation de résumer la vie d’un homme à ces images ?
A la base du film, une sélection, un tri, afin de s’y retrouver parmi la centaine d’heures de rushs personnels retrouvés à la cave (bénéfice des indépendants qui restent maîtres de leur pellicule). Ce Journal livre ainsi un archivage de la seconde moitié du XXème siècle sous l’œil d’un reporter débutant : investiture de Bokassa, coup d’état au Vénézuela, campagne de Giscard, etc. La teneur historique de ces séquences mise à part, ces archives témoignent surtout d’un apprentissage du cinéma direct : à voir ses premiers plan-séquences, dans Paris ou dans un défilé centre-africain, on comprend qu’il s’agit pour Depardon de ne pas couper, de filmer en continu et en marchant, quitte à sacrifier précision et lisibilité. Déjà, le cinéaste novice affiche sa volonté de sortir de l’actualité pour tracer sa propre voie, qui passe par une différenciation nette entre deux pratiques : la prise d’image ponctuelle du photographe, les plans longs du cinéaste. Serge Daney écrivait que Depardon filmait précisément le contraire de ce qu’il photographiait : « Il photographiait des individus, il filmera des institutions. Il les filmera comme des grands corps agités de micro-événements, entre le mensonge structurel et la sincérité du détail. »[22][22] Serge Daney sur Faits Divers, Libération, 9 mai 1983
Entre la matière brute du cameraman débutant, souvent en mouvement, et les longs plans fixes du triptyque rural, l’évolution semble évidente. Pourtant, c’est un même dispositif à l’œuvre, basé sur la croyance dans le filmage en continu, et l’enregistrement d’un « discours frais » (termes que le cinéaste emprunte à Erving Goffman) : une parole douloureuse et sincère, qui ne pourra être dite qu’une fois tant elle est nourrie de spontanéité. Ce qui s’apprend, ce n’est pas tant l’outil que le regard, qui gagne en acuité. Belle façon d’esquiver l’album souvenir, la succession d’archives est entrecoupée de séquences tournées par Nougaret sur le dernier projet photographique de Depardon (La France de Raymond Depardon, Seuil, 2010, qui a aussi donné lieu à une exposition à la BNF). Le film montre l’auteur au volant de son camion, cherchant de son regard bleu un lieu à photographier. La photo, comme le documentaire, c’est d’abord le choix d’un sujet et de la place pour l’appareil (souvent la seule possible). Ce qui rend ce film précieux, c’est de montrer la fragilité du choix : dans une belle séquence, Depardon hésite à s’arrêter en croisant le café d’un village, poursuit sa route, et revient finalement sur ses pas. Le photographe est faillible : des choses lui échappent, et s’il peut parfois revenir en arrière, il est toujours contraint de laisser des facettes du réel lui échapper.
Siegfried Kracauer parle de « camera-réalité » pour qualifier la réalité particulière, telle qu’elle est enregistrée (et diffusée) par l’appareil, et qui est en partie affaire de contingence, de hasard, ce que le film illustre avec humour. La première scène de photographie, à Nevers, montre ainsi le photographe attendant patiemment qu’un coin de rue se vide de ses passants. Petit moment de burlesque où le photographe ne cesse de voir son cadre traversé par le passage inopiné d’une voiture ou d’un vieillard. L’appareil photo à chambre qu’utilise Depardon pour son portrait de la France nécessite un temps de pose d’une seconde, et l’un des principes forts de ce portrait du territoire français est de proposer des lieux publics vidés de leurs habitants, d’où cette attente qui rappelle les photographes du XIXème siècle. Ce temps de pose offre un contrepoint direct au 24 images/seconde du cinéma. Au filmage en continu du cinéma direct qui enregistre, dans l’attente du micro-évènement ou de cette parole spontanée, s’oppose l’attente du photographe, qui elle n’est pas visible dans le cliché : attente de la lumière propice, de la situation idéale, de la seconde déterminante.
Or, ce que révèle le film, c’est que cette contingence prend une forme différente selon le médium : si la pose de l’appareil photographique oblige le photographe à attendre le bon moment, le filmage en continu le pousse quant à lui à ne jamais couper. Une première sélection se fait au regard : on choisit ce qu’on filme (de même que le photographe choisit où il arrête son camion) ; la seconde en revanche se fait au montage : selon le rythme du film, la vision sociale du cinéaste, et jusqu’à son humeur. Tout un faisceau de hasards orientent de manière plus ou moins consciente les choix de l’œil de celui qui vient après. C’est ainsi que Jacques Rancière qualifie le metteur en scène de cinéma : « un artisan s’efforçant d’imprimer sa propre marque sur un scénario à illustrer avec des acteurs imposés »[33][33] Jacques Rancière, La fable cinématographique, Seuil, 1998, p18.. Depardon et Nougaret, documentaristes indépendants (ils possèdent leur société de production, Palmeraie et Désert), sont relativement libres de ces contraintes de production, mais n’en demeurent pas moins soumis aux contingences du réel. En exhumant ces bandes inédites, le film laisse deviner l’immense virtualité de l’objet qu’il aurait pu être, et plus encore, il rend songeur quant à ce que toute la filmographie de Depardon aurait pu avoir de différent.
Une séquence touchante centrée sur Marie-Thérèse, jeune femme mentalement déficiente et semi-SDF avait sa place dans Urgences . Pour des questions de rythme, elle ne s’est pas intégrée au film, mais aussi parce que les choix de Depardon obéissent à une conscience politique, en prise avec son époque. Si Marie-Thérèse n’a pas été gardée dans le montage d’Urgences, c’est que le portrait n’était pas représentatif d’une population, qui a aujourd’hui changé, si bien que si le cinéaste remontait le film, on l’y verrait sûrement. En exhibant cette question du choix, le film touche un point sensible, que Depardon a tenu très tôt à rappeler dans ses productions : que derrière l’image, il y a toujours quelqu’un qui choisit ce que nous allons voir, et que ce choix est souvent le fait, en partie du moins, d’un grand nombre de hasards[44][44] Nous nous permettons ici de renvoyer à nos études sur les ouvrages de Susan Sontag et de Raymond Depardon.
Il serait réducteur pourtant de résumer la filmographie du couple à un arrangement avec les contingences. Ce que le film peut avoir de systématique dans sa succession chronologique d’archives, il le compense par une méthodologie qui s’affine, la recherche du bon sujet, de la bonne place, c’est-à-dire de la distance qui convient au sujet filmé. Et, si les hésitations des séquences des années 60 et 70 trahissent un regard qui se cherche là où les photographies de la France moyenne sont à la fois totalement maîtrisées et très personnelles (ni nostalgiques, ni platement scientifiques), chacune des deux séries affiche une volonté de montrer ce qui échappe habituellement au spectateur. Bokassa commentant un match de football, des mercenaires belges discutant d’une embuscade sur Brazzaville : autant d’évènements qui se trament en coulisses, peignant en quelque sorte une histoire souterraine, une « histoire des sous-préfectures », pour reprendre l’expression qualifiant cette France photographiée plusieurs années durant.
Ce portrait géographique haut en couleurs résulte d’une pratique de l’image similaire, et ce dès le choix de la technique. Ce fameux appareil à chambre qui semble anachronique est en fait un outil de pointe servant pour des publicités de cosmétiques. Il permet ici de photographier avec « des couleurs éclatantes, une lumière ultra-définie, la petite boulangerie du coin qui le vaut bien ! »[55][55] Raymond Depardon, Télérama horizons, La France de Raymond Depardon, Entretien avec Raymond Depardon, p18. Non seulement la photo montre cette France qu’on traverse ou qu’on habite et ne voit plus, mais elle révèle aussi ses potentialités esthétiques, toute une palette de couleurs qui bordent notre quotidien. Manière, là encore, d’éclairer d’une lumière nouvelle des «lieux communs », et ainsi d’éduquer le regard du spectateur. Apprendre soi-même à regarder pour apprendre à ses semblables à mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent : des hôpitaux aux tribunaux, des faits divers aux carrefours, en passant par les hors-champs de l’histoire, autant de zones sombres, de détails invisibles que l’objectif vient ausculter, faisant de l’homme d’images un témoin de son temps. Là où le film est le plus réussi, c’est dans cette façon de montrer comment ce geste politique, aussi discret que fort, guide depuis le début le travail de Depardon.
Godard proposait de faire l’histoire des films qui ne se sont pas faits. On pourrait aussi retracer l’histoire des chutes qui ont été tournées et qui dorment dans des caves. Et puisque le film entraîne l’imagination vers cette somme hors-montage, on peut encore penser à ce qui échappe à toutes ces histoires : la mémoire de l’homme d’image. Mémoire pleine de tout ce qu’il a vu et qui a échappé à l’objectif, des repérages à ce qu’il a choisi sciemment de ne pas filmer, quitte à le regretter sans pouvoir reculer. Et l’on comprend alors que si déception il y a, elle n’est pas tant le fait du film que celui du cinéma : la vie du citoyen Depardon, comme celle de Kane avant lui, n’est pas soluble dans des images. Ni dans celles des autres, ni dans les siennes.
Photographie : Raymond Depardon, Claudine Nougaret / Montage : Simon Jacquet, Claudine Nougaret / Son : Claudine Nougaret, Guillaume Sciama
Durée : 100 min
Sortie : 13 juin 2012.