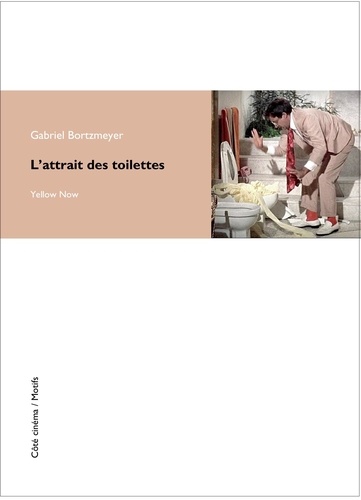L’Attrait des toilettes, Gabriel Bortzmeyer
Au chevet des chiottes
L’auteur de ces lignes prétend bien connaître celui des pages dont il rend compte, aussi n’est-il pas surpris de le voir tourner autour du pot. Récemment converti aux cuvettes après avoir spéculé sur le peuple (voir notre entretien à propos de son précédent livre), ce spéléologue égoutier cultive de longue date un goût tout théorique pour l’infâme, dans les figurations duquel il pense pouvoir glaner quelques symptômes d’époque. Si des hasards biographiques ont décidé de ses tropismes intellectuels, puisque, comme il le rappelle assez tôt dans son Attrait des toilettes, c’est à force de changer quotidiennement des couches qu’il en venu à méditer sur le rôle matriciel des W.-C. dans la formation de l’imaginaire contemporain, force est de constater la continuité entre ses travaux sur le peuple et celui sur le trône. On y retrouve une même interrogation autour de figures à la fois centrales et éclipsées, piliers d’une configuration moderne qui n’a de cesse d’en déformer le spectacle : du peuple comme sujet souverain fondant la politique mais absenté de sa représentation au sanctuaire génital où l’individu s’invente via une intimité dérobée à tout regard, le problème reste celui de la figuration contrariée.
L’autre dénominateur commun à ces deux synthèses, qu’on mettra au compte de l’activité de critique de l’auteur, réside dans le flou entretenu quant aux causes des échos supposés entre les films et leur temps (c’est la marque du « réflexionnisme » vague propre à l’écriture critique, toujours soucieuse de dessiner les contours d’un monde commun aux films et à la cité au prix, parfois, de sacrifier à la rigueur dans l’exposé des analogies). Dans Le Peuple précaire du cinéma contemporain, l’hypothèse aussi hardie que hasardeuse d’un « isomorphisme » entre figures cinématographiques du peuple et agencements collectifs « IRL » n’a pour la soutenir que la piété de son vœu. Or, il faut une bonne dose de quichottisme conceptuel pour tirer de l’analyse de quelques films un portrait d’époque, et si certains commentaires ont du charme – en particulier le bref passage sur les comédies françaises et le peuple de l’apéritif –, suivre totalement l’auteur exige de partager sa croyance en la consubstantialité des figures filmiques et mondaines. Libre à lui de s’encourager dans ses recherches par l’espoir de telles adéquations, dussent-elles rester à jamais invérifiables. Le même présupposé autorise L’Attrait des toilettes à chercher dans le magnétisme refoulé, aseptisé ou fétichisé de son objet la matière d’une anthropologie de la souillure, sur les pas de Mary Douglas dont le livre de 1966 associait déjà pureté, tabou et pollution. Croisé à un calibrage historique aux contours indécis, ce découpage de la sectorisation de la saleté à l’époque « moderne » (mot-mana et mot-millefeuille s’il en est, et dont l’auteur abuse) renseignerait sur la perception dominante des enjeux environnementaux. Pour en résumer l’argument, certes un peu vite (l’auteur me pardonnera) : dans la cuvette et tout ce qui s’y attache – la chasse d’eau, le tout-à-l’égoût diffusé aux premiers temps du cinéma – se cristallise une idéologie ingénieuriale de la maîtrise conditionnant encore largement les pratiques et conceptions écologiques. Tirer la chasse, liquider les reliquats, externaliser les déchets et cultiver le fantasme d’une consommation sans restes iraient de pair, dans un même élan d’optimisme sanitaire (l’auteur parle parfois de la modernité comme d’une sanibroyeuse) cautionnant aujourd’hui une inaction trop confiante dans cet idéalisme du transit. Si la première question de l’écologie consiste à se débarrasser de ses merdes (métaphore ultime de toute pollution[11][11] Voir mon entretien avec Hervé Aubron, « De la merde »), le trône démocratique et cellulaire représente un observatoire de choix pour mesurer l’empire perceptif de l’esthétique de la désinfection, lequel préside encore à une grande part de nos relations environnementales. Aller au fond du trou pour trouver le climat : chemin inattendu, en tout cas souterrain et de ce fait peu vérifiable, mais auquel il n’est pas interdit de concéder des vertus heuristiques.
Et humoristiques. Il est vrai que les toilettes se prêtent plus à la blague que le peuple, et, en la matière, le raffinement doctoral des mots d’esprits avec lesquels l’auteur a cherché à égayer la lecture n’entrave pas plus la marche des idées qu’il ne s’égare dans le registre troupier, même si l’on peut lui reprocher des calembours comme « Deux selles, deux ambiances » (signalons au passage que Yellow Now a eu la riche idée de publier le même jour un ouvrage désopilant d’Olivier Smolders, Modeste proposition pour un précis de flatulence, formidable traité de classification du lyrisme sphinctérien). Dans l’ensemble, on sent que, mû par l’estimable désir de divertir, Gabriel Bortzmeyer s’est essayé à une sorte de comique discursif cousu à même l’analyse filmique et basé sur des jumelages lexicaux incertains, qui transforment la parade des idées en carnaval verbal. S’il y a parfois quelque excès dans la mise à distance – l’auteur fait à tout point de vue dans le secondaire –, cette langue fleurie et survoltée s’amuse gaiement des dissonances entre la trivialité ordurière dont elle traite et le jargon spéculatif qui l’enrobe. La lecture n’en est que plus plaisante et fluide, peut-être parce que conçue pour accompagner cet état de tension distraite que favorisent les passages prolongés aux toilettes (d’aucun.e.s pourraient d’ailleurs soupçonner l’auteur d’ambitions vénales inavouées, tablant sur l’encanaillement conceptuel garanti par ce saupoudrage référentiel par-dessus un meuble fatalement lié aux vulgarités régressives : à celleux-là, moi qui de l’auteur connaît au fond mieux le cerveau que le cœur, je peux jurer qu’il n’a jamais troqué un concept contre un kopeck). L’ouvrage n’ambitionne bien sûr aucune vocation thérapeutique, et rien n’y est dit des effets de la circulation des idées sur le transit intestinal. L’essentiel tourne de toute façon davantage autour des toilettes comme médiation entre une société et ses égouts. Mais, foi de lecteur, c’est là un texte tout en détente, tant intellectuelle – les bonds analytiques – que nerveuse ou musculaire – il y dans les sourires arrachés par certaines formulations et dans le plaisir transgressif à disserter sur le trône quelque chose d’extrêmement décontractant. C’est déjà assez de ce que l’on peut souhaiter d’un livre.
La promenade plombière passe par toutes les régions du cinéma, expérimentale avec Toshio Matsumoto, camérale avec Cavalier, tropicale avec Tsaï-Ming Liang ou castratrice chez Kubrick, parmi quelques dizaines d’autres dont il ne m’appartient pas de gâcher la découverte. Je ne parlerai que de ce qui manque, du moins le plus manifestement : les pissotières de Querelle de Fassbinder, et surtout la très belle variation qu’en a proposée Patric Chiha avec Brüder der Nacht, où le même lieu devient le théâtre des récits sexuels que se content de jeunes immigrés prostitués. Il est regrettable que l’auteur n’ait pas inclus ces films dans les pages consacrées à João Pedro Rodrigues et au méconnu mais génial Urinal de John Greyson. Plus frappante encore est l’absence de Paul Verhoeven, qui s’est pourtant plu à varier les visages du siège. Dès Turkish Délices en 1973, un peu de sang mêlé aux selles et à l’eau au fond de la cuvette servait de memento mori à l’héroïne, et tout récemment, dans Benedetta, l’intimité des deux nonnes appelée à s’embraser naît dans les communs du couvent où, culs nuls côte à côte sur des trous, elles pètent sororalement. Entre-temps et parmi d’autres, l’inspecteur de Basic Instinct aura certifié sa santé mentale à ceux qui l’interrogeaient en leur affirmant que, jeune enfant, « I didn’t look at it » (it désignant le trophée des premières maîtrises infantiles). Un cinéaste brassant avec une générosité sans mesure les signifiants thanato-érotiques ne pouvait que s’arrêter aux toilettes, tombeau de la chair et autel des organes. Il n’est pas impossible que cette insistance un peu grasse de Verhoeven sur tout ce qu’il suppose basique ait motivé le silence de L’Attrait des toilettes à son propos : qui sait, peut-être que l’auteur, y voyant une matière au fond plus viriliste que rabelaisienne, a préféré n’en piper mots. Plutôt qu’à des films pétant trop haut, il s’est attaqué à des nanars outranciers comme Poultrygeist. Night of the Chicken Dead, ou, dans une version plus dandy, l’œuvre d’un Tarantino obsédé à l’idée d’être celui qui tire la chasse de l’histoire du cinéma. Car après tout, si les toilettes sont à l’origine de la civilisation – l’enterrement des morts et l’enfouissement des selles ont possiblement coïncidé –, elles en dessinent aussi le terme : tout va à l’égout, et l’apocalypse prend d’abord la forme d’un débordement des merdes mal évacuées. L’Attrait des toilettes se finit mélancoliquement sur cette identification des chiottes à la fin des temps ou à la régression éternelle. Si l’ange de l’histoire jadis invoqué par Walter Benjamin existe encore, il doit aujourd’hui être assis sur ce trône, à regarder les humaines immondices qui, une fois l’époque bouchée, débordent sur la scène historique. Pour le dire à la façon de l’auteur, les toilettes sont le nomos de la post-modernité. Nous ferions bien de tou.te.s nous y pencher, et il est peu de livres plus voués à l’égout que celui-ci.
Editeur : Yellow Now, collection "Motifs".
Date de parution : 2 juin 2023.
Nombre de pages : 110.