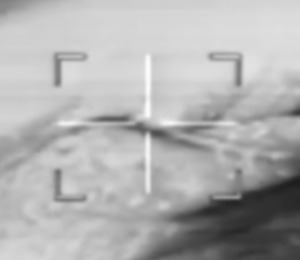Noël Herpe
Le fantôme du récit
Troisième film de Noël Herpe, La Tour de Nesle, sorti en salles en 2021, en DVD en avril dernier (et diffusé cet été sur Ciné +), confirme le déploiement d’un style unique dans le cinéma français contemporain. Rendant passionnément leur fraîcheur à l’héritage du muet, à la tradition française de l’adaptation théâtrale, aux intrigues rebondissantes du mélodrame, l’œuvre herpienne s’inscrit sous le signe de la fantaisie, de l’imaginaire et des plaisirs magiques de la fiction.
Grâce à un récent recueil d’articles et d’entretiens, Les films me regardent (2021), on redécouvre, en amont de ce travail de cinéaste, une réflexion d’écrivain et d’historien, attaché à se frayer un chemin dans les images qu’il aime. Je l’ai rencontré dans son atelier du 11ème arrondissement, qui tient lieu de décor à son nouveau film, pour revenir avec lui sur ses sources d’inspiration, son économie singulière de tournage, son regard volontiers polémique sur l’évolution du cinéma français.
Débordements : Pour commencer, j’aimerais aborder la dimension fantastique, voire surréaliste, de votre cinéma. Elle est manifeste dans votre premier film C’est l’homme (2010), et plus subtile dans les deux autres, Fantasmes et Fantômes (2017) et La Tour de Nesle (2021). Ce côté fantastique provient surtout d’un sentiment de terreur diffuse qui semble les organiser – et qui est, je crois, à l’origine de votre désir de cinéma.
Noël Herpe : Plutôt que de fantastique, je parlerais d’une mise en scène de la peur, qui est commune à ces trois films. On ne peut pas vraiment dire que ce sont des situations fantastiques, dans la mesure où je ne montre rien de surnaturel. Tous les événements qui traversent ces fictions sont des événements fondés en réalité. Je les relierais plus largement au registre de la peur et du suspense. C’est un répertoire auquel, l’âge venant, je suis de plus en plus sensible. Cela va des maîtres incontestés (Hitchcock, Kubrick, Jacques Tourneur) à d’obscures séries télévisées comme Thriller de Brian Clemens, que j’ai redécouvert récemment. J’adore ces histoires de femmes isolées dans des cottages, avec des serials killers qui rôdent autour… J’y trouve un rapport entre la peur et la convention (des décors vieillots, un personnage féminin stéréotypé, mis en danger par un méchant masculin) qui me fascine.
D. : Si, dans tous vos films, vous tenez le rôle principal, vous piégeant vous-même dans une situation telle qu’un enlèvement dans C’est l’homme, n’est-ce pas une façon de vous faire peur ? Je pense aussi au second épisode de Fantasmes et Fantômes, où un assassin invisible attaque une famille dont le mari est absent.
N. H. : C’est vrai. À force d’avoir vu tous ces films à suspense, j’ai sans doute voulu me retrouver dans le rôle de la fille en détresse. Il y a chez moi, historien du cinéma et cinéphile obsessionnel, l’envie d’entrer à l’intérieur du film, de devenir un personnage du film, à mille lieues de ma raison sociale d’universitaire respectable. A priori, je coche toutes les cases du mâle blanc dominant et conventionnel. Quand je fais cours à la fac, je n’expose pas mon goût pour le bondage et je ne viens pas en talons hauts (j’ai peut-être tort, d’ailleurs !). En faisant des films, je me mets en danger, je m’expose à des situations dont je rêve d’être prisonnier : dans C’est l’homme, je suis un travesti que kidnappe une bande de voyous ; dans Au téléphone (le deuxième sketch, dont vous parliez, de Fantasmes et Fantômes), c’est plus complexe, car ce sont les femmes qui sont attaquées dans une maison isolée, tandis que mon personnage est pris en otage par le téléphone qui l’empêche d’intervenir (situation fondatrice du suspense, telle que l’élabora Griffith dans sa version 1909 de la pièce d’André de Lorde) ; dans La Tour de Nesle, je suis jeté au fond d’une geôle mais je n’ai pas dit mon dernier mot… Je constate une certaine évolution en fait. On pourrait dire que de film en film, je prends le pouvoir sur mes peurs.
D. : Vous triomphez de vos peurs à travers la réalisation ?
N. H. : Disons que je les organise davantage. Je passe du rôle de la fille en détresse au grand méchant manipulateur. Dans La Tour, c’est mon tour de faire peur aux autres. Le moment qui m’impressionne le plus dans ce film, le plus terrifiant, c’est quand, appuyé à la fenêtre, je lance à Marguerite : …mon secret surnagera sur la Seine ! Et demain ! Demain ! À la dixième heure… Il s’agit moins de violence que de menace, à l’état pur. La menace de quelque chose de terrible qui pourrait arriver, et qui reste en suspens.
D. : Passer de celui qui a peur à celui qui fait peur, et qui joue à effrayer le spectateur comme un Hitchcock, n’est-ce pas devenir metteur en scène ? Dans La Tour de Nesle, on constate une maîtrise de la mise en scène, une direction de l’émotion du spectateur, qui confirment votre trajectoire de cinéaste. Vous avez commencé par incarner vos expériences de spectateur, et aujourd’hui, par le truchement du personnage de Buridan, vous vous projetez dans la figure du metteur en scène, qui prémédite, intrigue, dirige.
N. H. : Dans C’est l’homme, la situation, assez basique, visait à me procurer le plaisir de la peur, ou le frisson de l’humiliation. Il y a encore un peu de cela dans La Tour quand je suis ligoté, mais c’est pour mieux reprendre le pouvoir, jouer de ces stratégies de la peur et les montrer comme une procédure de la parole. Dans C’est l’homme, il n’y avait pas beaucoup de paroles, c’est presque un film muet (il aurait dû l’être encore plus). Dans La Tour, j’utilise la parole pour créer de la peur, ou l’imaginaire de la peur. A travers les chantages que Buridan ne cesse d’exercer sur autrui, je me souviens plus ou moins consciemment de mon mon père qui n’arrêtait pas de faire des scènes, dans tous les sens du terme : il arrachait le fil électrique de la télé pour m’empêcher de voir un film, il déchirait mes partitions de musique… Ces “scènes primitives”, je les retourne en principe de plaisir – et de mise en scène. Je me réapproprie le pouvoir sur elles. Il ne s’agit pas pour moi de décliner le thème, à la mode, de la masculinité toxique. J’essaie plutôt de montrer combien, dans ces situations de peur, il y a un enjeu de fiction crucial. Je renvoie à des émotions primaires de l’enfance, vécues ou fantasmées, pour en faire l’objet de récit par excellence. C’est pour moi lié au suspense, à l’idée d’une chose absente et qui va, enfin, apparaître. C’est ce qui m’intéresse le plus, sans doute : retarder le plus possible l’avènement de la peur en passant par la parole, la suspendre aux mots. Ce que j’ai commencé à développer dans Les Mentons bleus (premier sketch de Fantasmes et Fantômes), et que j’ai approfondi dans La Tour. En même temps, je retourne dans ces films à une tradition du muet : celle de Griffith, on l’a dit, qui donna au suspens une valeur rythmique et dynamique, celle de Feuillade, qui réinventa le suspens à la Corneille, un jeu de frustration du spectateur où s’annonce Hitchcock. Tout cela n’est plus guère à la mode aujourd’hui, peut-être parce qu’on redoute la dimension sado-masochiste du suspense, qui met le spectateur dans une position de plaisir coupable.
D. : Dans quel sens aimeriez-vous pousser l’expérience du suspense ?
N. H. : Mon travail vise à sauver, à sublimer par l’art un certain désastre de la vie, et les désillusions de mon enfance. J’ai commencé à expérimenter le suspense de manière spectaculaire à travers la performance. Je me faisais ligoter en public dans des concerts rock, je jouais au briseur de chaînes sur le plateau Beaubourg. Et puis je me suis lassé de cet exercice, un peu comme du théâtre, parce qu’il ne laisse aucune trace. En outre, dans la performance, il manquait à l’exhibition masochiste la dimension sophistiquée du suspense fictionnel, le jeu avec les obsessions, le lien avec le spectateur. Même dans C’est l’homme, cette médiation par la fiction était insuffisante, la cruauté brute des situations mettait le spectateur dans l’embarras. Dans La Tour, l’importance du récit vient transcender ce que l’histoire peut avoir de cruel. Je ne suis pas sûr d’avoir envie de faire un film aussi détestable (bien qu’admirable !) que Funny Games de Michael Haneke. Peut-être me tournerai-je vers le documentaire, vers un mode de performance renouvelé par le cinéma, ou d’autres modèles théâtraux que j’ai envie de revisiter : le vaudeville, l’opérette, la scène amoureuse où j’aimerais bien, par exemple, investir le rôle de la femme abandonnée… Dans le thème de la rupture, il y a encore de la peur.
D. : Allez-vous continuer à mettre en scène des situations à l’intérieur des décors stylisés de votre studio ? Vous en avez fait, d’un film à l’autre, un espace dévolu à l’imaginaire.
N. H. : J’aime ce mot de situations. Il faut qu’elles soient le plus conventionnelles possibles, pour en extraire toute la poésie. Et j’aimerais en effet continuer à tourner dans mon atelier de la rue Saint Ambroise dans le 11eme arrondissement de Paris. C’est un lieu peu spacieux, mais pas trop bruyant et permettant des lignes de fuite (baie vitrée, couloir, entrée d’immeuble ou sous-sol). C’est une formule heureuse, un white cube de la fiction cinématographique, une boîte à musique qui me permet de faire un peu ce que je veux. J’ai aussi pris mes quartiers dans une maison en Corrèze, où j’ai aménagé, sans trop m’en rendre compte, un studio à fond vert. Chaque fois que je m’installe quelque part, je projette un désir de tournage.
D. : N’avez-vous pas envie de filmer un lieu réel ?
N. H. : Ce n’est pas évident. Même quand nous tournions Au téléphone dans une vraie maison de campagne, j’ai tout fait avec mon décorateur Cyril Duret pour la transformer en studio, pour la styliser. Concernant La Tour, j’ai quelque temps songé à telle ou telle version qui aurait pris place dans un vrai château (ou dans une maison, avec une partie contemporaine qui se serait mêlée à l’affabulation de la pièce de Dumas)… Mais c’est naïf de croire qu’un lieu va vous donner la réponse. Ce que je recherche est un lieu intérieur, un lieu mental que je veux maîtriser totalement. Mon questionnement est surtout celui de la forme, aussi bien au plan économique qu’esthétique : fiction ? Clip ? Expérience d’art contemporain ? Au lieu d’entrer dans le moule de la fiction mainstream (ce à quoi je résiste de toutes mes forces), je devrais peut-être investir d’autres champs que celui du cinéma. Je pense au travail de Jean-Luc Verna, quand il reprend des personnages féminins de films connus, ou aux “scènes conjugales” de Valérie Mréjen… J’ai envie d’explorer ces chemins de traverse, car je me sens terriblement à l’étroit dans le système de production (et de réception) actuel. On peut toujours produire des films comme je les fais (avec peu d’argent et tournés chez soi), on peut plus difficilement trouver, comme je l’ai fait, un distributeur et un diffuseur – mais ensuite, la réception n’est pas à la hauteur. Les festivals qui ont pignon sur rue, et la critique institutionnelle, ont un horizon d’attente qui est celui des films calibrés, préfinancés, soutenus par le CNC. Cela implique un cahier des charges sociologique, un certain type de sujets qu’il faut traiter. Ne m’intéressant, pour ma modeste part, qu’à la mise en scène du fantasme, je suis peut-être voué à assumer mon côté expérimental.
D. : Vous qui êtes d’abord l’auteur d’une oeuvre autobiographique conséquente, et notamment d’ouvrages empruntant la forme du journal, n’avez-vous pas le désir de vous appuyer, pour faire des films, sur ce registre de l’écriture de soi ?
N. H. : C’est une piste à creuser… Dans mon livre Souvenirs/Écran (2019), je racontais une sorte de pérégrination dans la France profonde, pour y présenter des films de Clouzot, suite à l’exposition que j’avais conçue à La Cinémathèque française. Je m’y représentais comme un petit personnage mélancolique, qui se balade de ville en ville, et secoue la poussière des salles de cinéma désertées. Quand le livre est sorti, Laure Adler m’a reçu dans son émission et a esquissé un parallèle avec le cinéma d’Alain Cavalier. Cela m’a fait entrevoir une possible expression cinématographique, à partir d’un travail littéraire inscrit à côté du cinéma. Le documentaire introspectif me tente, mais je crains les poncifs du genre. J’ai sans doute envie d’être seul dans mon royaume, je veux continuer à faire ce que personne d’autre ne ferait à part moi. Personne d’autre n’aurait cherché à faire aujourd’hui un film de La Tour de Nesle, et n’en aurait fait, en tout cas, un objet aussi solitaire et bizarre.
D. : Ce qui est spécial dans votre cinéma, c’est avant tout votre inspiration, puisée dans des références théâtrales qui ne sont plus communément partagées. Mais aussi dans des références de cinéma qui s’inscrivent à rebours du goût dominant. Qu’il s’agisse du vaudeville 1900 ou du réalisme poétique français des années trente, qu’est-ce que vous trouvez de neuf et de moderne dans ces œuvres du passé ?
N. H. : Il faut faire la distinction entre mes goûts de cinéma et mes goûts de théâtre. S’il est vrai que je m’appuie sur un répertoire théâtral tombé dans l’oubli pour éprouver ma vitalité de cinéaste, je crois m’inscrire dans une histoire du cinéma qui n’est pas figée. À trente ans, j’étais quasiment le seul à m’intéresser à René Clair, à René Clément, à Henri-Georges Clouzot ou à André Cayatte. Ils sont largement redécouverts aujourd’hui par de jeunes générations de cinéphiles. Tout ce qu’on peut dire, c’est qu’à la différence de beaucoup de gens de mon âge, mes références remontent à des périodes qui précèdent la Nouvelle Vague. Je n’ai jamais considéré celle-ci comme un aboutissement, ou une apothéose indépassable. Je la considère comme une école parmi d’autres, peut-être la dernière école prestigieuse du cinéma français (peut-être, justement, parce que personne n’a osé la dépasser et qu’elle nous a tous enterrés sous ses ruines). Il y a eu des francs-tireurs comme Eric Rohmer, ou des électrons libres comme Jean Eustache et Maurice Pialat, vers qui va davantage ma tendresse. Ce qui me gêne dans la Nouvelle Vague, c’est la tendance paresseuse qu’elle a générée chez ses descendants : un dogme réaliste ou impressionniste non revisité, correspondant à ce qu’on croit devoir faire pour rester dans les clous du grand cinéma français des années soixante.
D. : C’est une question de génération ?
N. H. : Déjà, mes parents ne juraient que par Jean-Luc Godard – alors que moi, j’allais regarder Julien Duvivier ou Marcel Carné. Déjà, j’étais un peu tordu. J’allais chercher des films des années trente et quarante par esprit de contradiction, mais aussi parce que je développais, très fortement, un rapport à la poésie du passé. J’y voyais un extraordinaire gisement de poésie, justement parce qu’il était en déshérence. Pour écrire un texte sur Gérard Philipe, j’ai revu ces jours-ci La Chartreuse de Parme et Les Orgueilleux. C’étaient des films que je découvrais vers 1976, ils avaient vingt, vingt-cinq ans, mais ils me paraissaient antédiluviens, aussi anciens qu’aujourd’hui. Justement parce qu’entre temps, il y avait eu la Nouvelle Vague, la couleur, un jeu d’acteurs qui n’était plus celui de Michèle Morgan ou de Renée Faure… Je suis tombé amoureux de ce cinéma par un désir de renouer un lien rompu, de déchiffrer un message effacé. Des films comme Le Corbeau ou Quai des Orfèvres paraissaient bien plus loin de nous que ne l’est, de nos jours, un film des années quatre-vingt ou quatre-vingt-dix. Il y avait comme un fossé à franchir pour tendre la main au passé, comme si le passé m’attendait pour exister à nouveau. Après coup, j’ai rationalisé tout cela, en critiquant la notion de qualité française, ou l’académisme rampant des suiveurs de la Nouvelle Vague, mais c’est d’abord une histoire d’amour presque fou.
D. : Ce goût pour le passé qui vous caractérisait a peut-être préfiguré la nouvelle cinéphilie dont vous parliez, et le regain d’intérêt pour un certain romantisme au cinéma.
N. H. : Un certain nombre de cinéphiles s’intéressent de plus en plus au cinéma des années quarante et cinquante. L’autre jour je présentais Le silence est d’or de René Clair à La Filmothèque du Quartier Latin. Ce cinéaste qui fut en son temps l’un des plus célèbres du monde entier, je m’étais résigné pendant des années à être un des derniers à le défendre, face à des auditoires polis ou mollement nostalgiques. Cette fois, je me suis retrouvé au milieu d’un essaim de jeunes filles qui se sont révélées complètement incollables sur Maurice Chevalier, François Périer, ou le thème de la fenêtre dans Sous les toits de Paris. Et combien de jeunes cinéphiles, de blog en blog, qui redécouvrent jusqu’aux nanars de Christian-Jaque ! L’offre en DVD et en streaming permet à présent de battre en brèche les anathèmes truffaldiens (qui avaient rejeté tant de cinéastes dans les ténèbres, sans autre forme de procès), et de revoir les films d’un oeil neuf. J’espère, humblement, proposer de nouvelles formes à partir de ce retour aux sources d’avant la Nouvelle Vague. Et je rappelle que dans les années quatre-vingt, avec la mouvance Diagonale et les films de Paul Vecchiali, Jean-Claude Guiguet ou Guy Gilles, l’adoration du cinéma des années trente s’était frayée un chemin. Je ne peux pas dire que j’adore le brechtisme un peu brouillon de Femmes Femmes ou de Faubourg Saint-Martin, mais le sentimentalisme flamboyant de ces cinéastes me touche.
D. : Ce qui est unique chez vous, c’est l’articulation, dans votre mise en scène, du vocabulaire du cinéma muet (ou du premier cinéma parlant) avec une modernité singulière. Le cinéma des années vingt ou trente n’est pas une vieille chose poussiéreuse, c’est un langage auquel vous vous attachez à rendre sa fraîcheur.
N. H. : Mon goût du passé, j’ai moins envie, aujourd’hui, de le décliner en tant qu’historien que de lui rendre, en tant que cinéaste, cette fraîcheur dont vous parlez. C’est pourquoi (à moins d’un gros malentendu !), je ne crois pas être perçu comme un cinéaste académique. Sans être systématiquement occupé de modernité, j’essaie de faire en sorte que le passé vive à nouveau, d’une manière qui parle à notre époque. C’est pourquoi je n’aimerais pas mettre en scène ces pièces au théâtre, cela m’entraînerait dans une démarche archéologique (Eugene Green) ou fétichiste (Michel Fau), qui n’est pas vraiment la mienne. Cela ne m’intéresserait pas non plus, à la Stéphane Braunschweig, de solliciter dans une pièce ancienne des thèmes contemporains, de faire de Marguerite de Bourgogne (dans La Tour de Nesle) une féministe avant la lettre, que sais-je ? Ce qui donne à mes films une certaine fraîcheur, c’est le fait que je m’y donne complètement. C’est ma double implication d’auteur et d’acteur : je suis tellement investi dans ces textes, j’ai une telle foi dans ces situations périmées (et devenues miennes) que le spectateur, à moins d’être totalement réfractaire à cet univers, peut accepter d’y rentrer. Ce qui empêche mes films d’être des objets de musée, c’est ma folie. S’il n’y avait pas la folie de Noël qui déboule dans le grenier, ça n’aurait aucun intérêt. Dans un cadre assez figé et rhétorique (et que souligne la sophistication du dispositif, par exemple la carte postale/toile de fond de Mentons bleus !, premier sketch de Fantasmes et Fantômes), mon inconscient s’engouffre. Je ne fais peut-être du cinéma que pour cela : donner une forme à ma folie. Au fond, il s’agit moins de modernité ou d’archaïsme, de présent ou de passé, que d’un jeu de cache-cache entre la raison et ce qui la déborde.
D. : La première étape pour rendre la vie à ces conventions, ce serait donc d’élaborer un regard personnel et créatif sur les films : des films que nous ne savions plus regarder, et dont la vision nécessite d’être réinventée.
N. H. : Je m’y efforce. Dans mon dernier livre Delair/Clouzot, j’aborde Quai des orfèvres, un film qu’on croit bien connaître. J’essaie d’y déchiffrer une structure inconsciente dont personne n’a parlé jusqu’ici : une dialectique entre la désuétude rassurante du théâtre et les pulsions de mort que dévoile le cinéma. Même jeu pour Miquette et sa mère, du même Clouzot, un de ces rosebuds qui ont inspiré mon désir de réaliser des pièces filmées. Ce film génial, personne ne l’avait regardé jusqu’alors. Dans une préface que j’ai écrite à une réédition de la pièce, j’ai confronté celle-ci à ses différentes adaptations à l’écran, jusqu’à Clouzot, pour mettre en valeur la poésie (et la drôlerie) qu’il a tirée d’un vaudeville oublié. Je m’appuie, je crois, sur une certaine innocence du regard qui m’aide à m’immerger dans ces fictions. J’y traque des archétypes, une dimension mythique qu’on a trop longtemps laissée de côté (à cause du noir et blanc, du côté soi-disant vieillot, ou du gimmick “Truffaut a dit que”)… Disons que je fais résonner ma propre folie avec celle du film que je regarde. Un autre exemple : Avant le déluge, à mes yeux l’un des grands films d’André Cayatte. En général, on parle de ce cinéaste à travers les lunettes malveillantes de Truffaut, et toute la doxa qui en découle. Pour ma part, je suis très sensible à l’extraordinaire cruauté des situations que met en scène ce film sur la jeunesse délinquante. Il y a ce plan final où, après le procès et l’incarcération des gamins qui ont volé et tué, la mère d’un des garçons (une femme étouffante et castratrice) se retrouve toute seule. Filmée de l’autre côté des barreaux du Palais de Justice, elle tâtonne, en perte de repères, dans la rue. Cette image me bouleverse à chaque fois, je me projette complètement dans une telle situation. Pour des raisons autobiographiques, et aussi par empathie pour les Français de cette époque. Elle n’est pas aussi loin de nous qu’on l’a cru (que je le disais tout à l’heure). Elle me parle, j’y lis un inconscient historique qui nourrit, en parallèle, mon travail d’artiste. La fiction est un territoire où je suis chez moi.
D. : Vous vous projetez dans vos films, comme un spectateur-créateur, avec la même foi en la fiction. La mise en scène devient une manière de concrétiser en images son propre regard.
N. H. : J’ai tellement été hanté par des scènes de fiction, venues transcender ou sublimer les scènes de mon enfance, que j’en suis devenu prisonnier. Au lieu d’essayer d’y échapper, je les réinvente et les réincarne. Je cherche ma liberté à l’intérieur des ruines. Ces scènes qui m’ont pris en otage, elles sont en même temps un espace infini d’imaginaire. Mon amour pour un certain théâtre, un certain cinéma a été tel que je voudrais, à la lettre, vérifier leurs situations. Qu’elles ne soient pas de vieilles choses mortes, qu’elles vivent encore. Ce qui assure une place cruciale au regard, jusque dans mon jeu d’acteur. L’intensité de mon regard d’interprète, me semble-t-il, est ce qui fait tant bien que mal tenir mes films. Plus ou moins consciemment, je convoque cette dimension autour de laquelle s’organisera le plan. C’est vrai dans C’est l’homme, lors de la séquence du lynchage où seuls mes yeux traduisent une intériorité. Et dans La Tour de Nesle, au moment où j’ouvre le mystérieux coffret à l’intention de Gaultier d’Aulnay. J’ai trouvé là, sans l’avoir forcément prémédité, un regard où se croisent le machiavélisme, la nostalgie de l’amour perdu, l’amour (incestueux ?) pour le fils rêvé… Le regard s’avère plus riche que la parole. Il est porteur d’une polysémie qui m’a beaucoup aidé pendant le tournage. Je ne savais pas trop, au départ, comment jouer certaines machinations incohérentes mises en place par Buridan. Eh bien, je me suis appuyé, à travers le regard, sur la force du désir de ce personnage. A travers toutes ses stratégies tordues et foireuses, il cherche quelque chose de caché et de mystérieux. C’est sans doute de l’ordre du récit. Faire de sa vie un récit, qui puisse enfin tenir debout. Cela ne marche jamais, et c’est cela qui est beau. Le récit se promène au bord de l’abîme, il n’est qu’un désir qui tâtonne. Dans C’est l’homme, si je sors dans la rue habillé en femme, c’est moins par goût du travestissement que pour m’embarquer dans une histoire.
D. : A contrario, le naturalisme qui règne sur le cinéma français ne fonctionne-t-il pas (grâce au système de financements qui le favorise) comme une forme de censure de la fiction, ou plus largement de l’imaginaire ?
N. H. : Le naturalisme est une vieille tradition du cinéma français. Elle remonte au moins aux années trente, avec les adaptations de Zola ou de Simenon qui portaient un regard sur la société. La Nouvelle Vague a prétendu bousculer ce modèle, qui a resurgi bon an mal an sous des oripeaux s’inspirant d’elle (caméra à l’épaule, style documentaire…). Je ne suis donc pas sûr qu’on en soit tout à fait sorti. On lui doit de grands et bons cinéastes (de Duvivier à Henri Decoin, de Pialat à Claude Sautet), mais c’est un modèle qui s’essouffle. Plus récemment, il y a eu des gens comme Yann Gonzalez, Bertrand Mandico ou Serge Bozon, qui proposent des chemins des traverse, un jeu sur l’artifice, voire la caricature. Ce qui me manque dans ce paysage, c’est peut-être surtout le genre, en tant qu’instance de fiction. Je ne parle pas du cinéma du samedi soir mais des films d’auteur (où l’auteur, justement, s’est cru plus fort que le genre, à la différence des Clouzot et Jacques Becker de naguère qui ne craignaient pas de se confronter à ses contraintes). L’imaginaire lié au genre s’est estompé, au profit d’un auteurisme qui prend toute la place. Cela nous ramène à la question de la croyance. La plupart des films français actuels que je vois (et j’en vois beaucoup, par acquit de conscience et par espoir fou) ne croient plus à la fiction. Ils font la chronique d’individus qui occupent l’écran, et y traînent leur désillusion. A l’exemple de Rosetta des frères Dardenne, un opus paradigmatique de cette tendance française et francophone, on y voit un garçon ou une fille qui fait la gueule pendant une heure et demie, quitte à esquisser un timide sourire à la fin. On reste dans le registre du portrait, vaguement décousu, et le montage, à travers des ellipses devenues un poncif, va dans le sens de cette défaite du récit. Cela fourmille d’états d’âme, de clins d’œil sur la société, d’aperçus psychologiques ou sur les rapports entre les sexes. Même quand certains (je ne citerai pas de noms !) prétendent restaurer le genre, celui-ci n’apparaît que comme un pur dispositif, aussitôt dénoncé comme tel parce qu’il faut se démarquer en tant qu’auteur. Si j’ai fait des films, à mon humble niveau, c’est peut-être parce que je ne trouvais pas mon compte dans ces propositions. Parce qu’il me fallait, obscurément, renouer avec l’innocence et la naïveté du genre.
D. : N’y a-t-il pas dans le paysage que vous décrivez un manque de curiosité pour le merveilleux qui peut surgir du quotidien ? Un cinéaste comme Feuillade mettait sa caméra dans la rue, et y projetait des aventures grandioses qui transfiguraient le banal.
N. H. : C’est une autre grande tradition du cinéma français, celle qui consiste à susciter le merveilleux à partir du décor urbain. Il en est sorti L’Atalante, Le jour se lève, aussi bien que les films de Georges Franju ou, plus récemment, de Jean-Claude Brisseau, de Léos Carax… Si ce merveilleux se raréfie, c’est dû en partie à l’horizon d’attente des commissions de financement. On attend des films à sujet, à message, qui montrent les banlieues ou l’adolescence comme il est convenu de les montrer depuis les hautes sphères.
D. : Cette sélection arbitraire par le soin des commissions vient freiner la spontanéité qui caractérisait les meilleurs films de la Nouvelle Vague. Si on veut faire financer son film en passant par ce processus long, laborieux, semé d’embûches, on ne peut guère plus s’en remettre aux joies de l’inspiration.
N. H. : Prenons l’exemple du Signe du Lion de Rohmer. C’est un film a priori strictement réaliste, où il ne se passe à peu près rien qu’un homme qui marche dans la rue – et où pourtant s’invitent la force de l’imaginaire, des échappées presque mystiques. On peut en dire autant de Cléo de 5 à 7 d’Agnès Varda, ou du Feu follet de Louis Malle…Ce sont des films qu’on ne se lasse pas de revoir. La “nouveauté” des années soixante n’a pas tant consisté à descendre dans la rue (Feuillade et Léonce Perret le faisaient déjà) qu’à retrouver ce surgissement de la poésie, au-delà du réel, qui est un secret du cinéma français. Au lieu de quoi on subit, à présent, un nez collé contre la vitre qui fait considérer les choses sous un seul angle. Certes, c’est lié au formatage dont vous parlez en termes de financement, mais aussi à l’état actuel de notre société. Le cinéma français ressemble à la société française. Une société que l’utopie a désertée, et où le discours sociologique est devenu l’unique grille d’analyse du monde.
D. : Ce qui nous renvoie, en dernière analyse, à une certaine censure institutionnelle, dès lors que les films sont voués au “témoignage sociétal”.
N. H. : Pour ma (petite) part, j’ai renoncé à prétendre au cinéma avec un grand C. A répondre aux attentes de la commission Poitou-Charentes, ou du producteur qui n’aspire qu’à se faire des marges en gonflant les budgets. Je fais des films à partir de ce que je suis. A partir de mes désirs, à partir de mes moyens, même s’ils sont faibles et même si je dois réaliser mon film sans la moindre aide publique. Quand je cherchais un producteur pour La Tour de Nesle, l’un me déniait la possibilité de jouer le rôle principal (il y aurait beaucoup à dire, aussi, sur la tyrannie des acteurs bankable), en m’opposant qu’un metteur en scène ne saurait jouer dans son film. Un autre voulait tripatouiller le scénario, remettant en cause ma fidélité au texte de Dumas. Un troisième me suggérait même de gommer le thème de l’inceste, maniant les ciseaux d’Anastasie avec plus d’empressement que les ministres de Louis-Philippe !!! J’ai fini par comprendre que je devais inventer ma propre économie, si je ne voulais pas trahir mon désir.
D. : A-t-on jamais vu, d’ailleurs, une fois l’argent public obtenu, un réalisateur suivre son désir en s’écartant du projet validé par l’institution ?
N. H. : À partir du moment où l’on accepte la logique des notes d’intention et des scénarios calibrés au long d’une douzaine de versions, la mise en scène risque quand même de se vouer à illustrer le texte écrit… Je m’étonne qu’on remette si peu en cause le fonctionnement pyramidal du cinéma français, alors qu’on n’hésite pas à le faire pour le système universitaire – que je connais bien aussi, et qui en est un peu le paradigme : sélection sur dossier, intrigues de couloir, jeux d’influence, de pouvoir et de cooptation… Croit-on vraiment que les sélectionneurs des festivals ou des instances du CNC soient plus irréprochables que leurs homologues en milieu académique ?
D. : En tant que maître de conférences en cinéma, qu’attendez-vous de ce champ d’enseignement, notamment face à la reproduction des élites qui perdure à la FEMIS (à travers des étudiants préparés à se conformer aux attentes de la profession) ? N’y aurait-il pas, par exemple, un pont à rétablir avec la Cinémathèque, qui fut, dans les années cinquante, la plus formidable des écoles pour les futurs auteurs de la Nouvelle Vague ? Un lieu libérateur des tendances contraignantes du présent, un espace d’ouverture à l’imaginaire.
N. H. : Ce qui manque le plus cruellement aujourd’hui, en effet, c’est la curiosité pour l’histoire du cinéma. La plupart des cinéastes de ma génération ne connaissent du cinéma français que la Nouvelle Vague. Même si l’offre de cours à l’université (ou de rétrospectives à la Cinémathèque) est très diverse, je constate un certain rétrécissement des références. Encore plus sensible, je ne saurais le nier, chez les étudiants. Le goût légitime pour les séries ne devrait pas rendre ringards Griffith ou Fritz Lang.
D. : Selon André Bazin, la théorie, lors des périodes les moins intéressantes du cinéma, devait jouer son rôle et préparer le terrain pour l’avenir. Est-ce que la critique joue pleinement ce rôle à l’heure actuelle ?
N. H. : Bazin a eu Roberto Rossellini ! Il faut qu’un cinéma nouveau émerge pour qu’une critique nouvelle en fasse son miel, et en déduise non seulement des choix critiques, mais des propositions théoriques nouvelles… Et si, pendant les années cinquante, le cinéma français était très corseté, il l’était moins qu’on ne l’a dit. En tout cas, il était suffisamment vivant pour inspirer les fulgurances théoriques de Bazin (je pense à son admirable texte sur Cayatte), ou les impertinences critiques de Truffaut (qui est brillant même lorsqu’il attaque un film aussi brillant que Monsieur Ripois). C’est peut-être la réponse à une question que je ne suis pas seul, je crois, à me poser : pourquoi n’assiste-t-on pas à l’émergence de nouveaux Truffaut, qui reprendraient le combat jamais fini contre l’académisme ? Quelles que fussent les pesanteurs qui ont repris le dessus, l’immédiat après-guerre (en France comme en Italie ou aux Etats-Unis) avait favorisé des propositions de cinéma. Nous traversons depuis pas mal d’années une période de glaciation – et surtout de peur. Peur d’exprimer quelque chose d’original, de choquer, d’être mal noté… Tout le monde a peur. C’est un thème, on l’a vu, auquel je suis particulièrement sensible, mais avec lequel je joue. Dans ce registre, j’avais bien aimé le film de Vecchiali, À vot’ bon cœur, où son personnage allait assassiner tous les membres de la commission d’avance sur recettes du CNC qui avaient refusé de financer son projet ! Ce pitch devait beaucoup amuser Rohmer, qui a d’ailleurs permis à ce film de se faire – et qui, pour sa part, n’a jamais trop compté sur l’argent public. Il a créé sa propre structure de production pour travailler comme il le souhaitait, et n’a cessé d’alléger cette structure pour rester au plus près de son désir. C’est une façon de considérer le cinéma comme un écrivain, qui fait ce qu’il veut. Peu importe que l’on s’appuie (comme l’a souvent fait Rohmer) sur un texte préexistant. Quand je mets en scène, avec mes menus moyens, une pièce de Georges Courteline, d’André de Lorde ou de Dumas, j’exprime mon amour de la littérature, et en même temps, je développe une écriture qui passe essentiellement par la mise en scène : le découpage, le cadre, le hors-champ… Alors oui, le scénario me fait peur, dans la mesure où c’est un exercice artificiel. Il implique de tout prévoir à l’avance, il freine la spontanéité. Quand j’écris, je m’adosse à une construction assez lâche, au coeur de laquelle j’essaie de libérer mon inspiration ou ma folie. Je crois fermement à ce qui se passe dans le présent de l’écriture, à un rythme intérieur qu’il ne faut pas enfermer dans la préméditation. A partir d’un texte écrit par un autre, je peux en tant que metteur en scène laisser aller mes intuitions – et de plus en plus à chaque étape, jusqu’au montage qui est pour moi un moment merveilleux. Je contourne aussi les exigences des acteurs professionnels en tournant avec des amis, dans une économie qui (contrairement à ce qu’on pourrait croire) me permet d’avoir les coudées franches, et d’évoluer en cours de route. Pour La Tour de Nesle, par exemple, le découpage préparé en amont, et mis à l’épreuve avec mon assistant (sous forme de story boards filmés) a été modifié plusieurs fois pendant le tournage, et encore davantage pendant le montage, en gardant la liberté de s’adapter aux imprévus. Je voudrais aller aussi loin que possible à l’avenir dans cette liberté, et cette légèreté.
D. : Cette liberté vous permet également de jouer vous-même dans vos films, de donner corps aux fictions que vous mettez en place.
N. H. : Je mets en place un piège, avec un découpage très précis, un lieu clos où sont conçus des décors, des répétitions… pour qu’advienne un moment d’écriture, qui passe, je l’ai dit, par la mise en scène, mais aussi par mon jeu d’acteur. Je retrouve dans le jeu cette fraîcheur de l’écriture que je recherche avant tout. Elle consiste à aller vers quelque chose que je ne connais pas encore, vers l’inconnu, l’altérité, le bouleversement.
D. : Cette écriture qu’est le jeu d’acteur, il vous faut, pour la libérer, ce studio que vous avez créé dans votre atelier.
N. H. : Un piège à imaginaire. Cela peut être compliqué pour mes partenaires. Pour La Tour de Nesle, il m’arrivait de leur infliger vingt-trois prises – parce que j’étais en train, en tâtonnant, de chercher quelque chose qui me déborde. Quelque chose que viennent révéler ma voix, mon regard, mon corps. La liberté est un fantôme, je ne sais pas trop ce que cela veut dire : je ne la conçois que dans un jeu de cache-cache avec la contrainte. Du coup, les autres interprètes sont un peu menacés par ce que j’appelle l’effet musée Grévin. Ils ont des rôles et des places bien assignés, un texte à dire exactement, une articulation particulière à respecter – et j’ajouterais même une certaine idée du passé, à quoi je tiens. Face à eux, je me comporte comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Pour moi, la création artistique est toujours plus ou moins un piège, d’où l’on s’échappe. On est prisonnier d’un certain nombre d’obsessions, de tropismes ou de conventions, sur les ruines desquelles on invente sa fantaisie. Cette invention se fait, dans mon cas, sur un mode autobiographique et égocentrique, et je me demande si je ne devrais pas radicaliser cette logique, cet usage du cinéma comme voyage à l’intérieur de soi-même. J’aimerais notamment porter à l’écran une pièce de Labiche, où je jouerais tous les personnages.
D. : L’autobiographie est le lien entre vos livres et vos films.
N. H. : Mes livres sont des fragments d’autobiographie, mes films déclinent mon goût pour les fictions des autres. Ceux-ci, pourtant, sont peut-être encore plus impudiques que ceux-là, dans la mesure où j’y exhibe mes flottements et mes angoisses identitaires. Je ne sais pas qui je suis, je n’arrive pas à trouver ma limite.
D. : Dans C’est l’homme, votre théâtre était un petit village, dont vous faisiez le lieu d’une passion christique, d’une procession cruelle. N’aimeriez-vous pas quitter votre studio, et, vous rapprochant de l’esprit “documentaire” de vos derniers livres (Dissimulons ! ou Souvenirs/Écran), chercher dans le monde extérieur un dépassement des apparences ?
N. H. : Si le cinéma français, on l’a dit, manque d’imaginaire, de mon côté je manque cruellement d’imagination. C’est l’une des raisons qui me tiennent à distance de l’écriture de scénarios. Dans C’est l’homme, la narration procédait moins de l’imagination que du fantasme : enfiler des vêtements féminins, se faire enlever, ligoter… Ce n’était qu’une série de situations, au sens primaire du terme, auxquelles la mise en scène donnait forme. De ce point de vue, je suis peut-être pleinement un homme de mon temps : je ne m’essouffle pas, après la bataille, à faire semblant de réinventer la fiction. Je ramasse des traces, et je joue avec. La Tour de Nesle reste tout aussi théorique que C’est l’homme. J’essaie d’y rendre sensible le récit à l’état pur, ou plus exactement le fantôme du récit.
D. : Ce fantôme de récit se décline sur internet, à travers les figures de soi qu’on peut multiplier à l’infini.
N. H. : Je ne m’en prive pas, à travers les identités que je m’invente sur les réseaux sociaux, aux antipodes de ma raison sociale dans la vraie vie… A partir de photos de C’est l’homme, je me fais passer pour un escape artist, que son méchant patron force à parader dans les rues en tenue d’Adam enchaîné ; ou, grâce aux images de La Tour de Nesle, pour un danseur de ballet dans le style ORTF… Être moi-même m’ennuie.
D. : Il reste que sur internet, l’imaginaire se retrouve captif de ses virtualités : il ne s’incarne pas dans une forme.
N. H. : Pourquoi pas ?
Images : C'est l'homme, 2009 ; La Tour de Nesle, 2020 ; Au téléphone, 2017