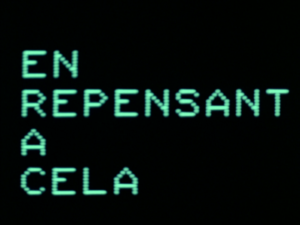Notes sur la Palestine (5)
Video-Tracts for Palestine
Ce texte est la cinquième page de nos Notes sur la Palestine.
En novembre, un groupe de vidéastes s’est formé autour d’un compte Instagram, @videotraceforplstn. Ensemble, à distance, depuis la Tunisie, le Liban, l’Iran, l’Italie ou la France, ils et elles ont entrepris de produire de courtes vidéos, des tracts. Ces quelques minutes sont arrachées au flux des images qui ne cessent de nous parvenir de la Palestine, puis relâchées sur les réseaux sociaux, contre la propagande qui tente de les faire mentir, comme autant de gestes résistance formulés dans la langue de l’image en mouvement. Plus de 130 vidéos plus tard, quelques membres du collectif (les initiales ont été modifiées) ont accepté une discussion avec nous, en forme de table ronde numérique.
1. Résister par l’image
Débordements : Avant tout je voulais en savoir plus sur le lien que vous entretenez avec le monde du cinéma. Est-ce que ce sont vos métiers qui vous ont rapproché·es et qui ont déterminé la forme de votre engagement ?
Y. : On est autour du cinéma, d’une certaine manière.
W. : Moi je suis réalisatrice, c’est plus simple.
Z. : On ne se connaît pas tous, je n’ai même pas d’idée précise de ce que font tous les membres du collectif. Je sais que certain·es sont pleinement dans le cinéma, mais nous avons tous un rapport avec l’image en mouvement. Ce qu’est chacun·e ne m’a jamais vraiment importé, ce qui m’importe c’est ce que chacun fait.
W. : Nous nous sommes rejoints de façon très désordonnée. D’abord, quelques vidéos circulaient, mais c’est quand le compte commun [@videotraceforplstn sur Instagram] a été créé que tout a véritablement commencé. Plusieurs personnes ont été contactées au moment de sa création, et très naturellement des gens sont venus. La chose la plus symptomatique est la façon dont des personnes ont tagué le compte sur des vidéos qu’elles faisaient puis ont rejoint le groupe.
Z. : S., par exemple, s’est invité lui-même : il n’a rien demandé à personne et a tagué le compte commun.
X. : Moi aussi j’ai fait la même chose, je suis arrivé, j’ai posé mes bagages et avec les autres, nous avons simplement consacré nos mains et nos corps à cette cause, sans réfléchir à ce que nous faisions avant.
W. : Beaucoup d’entre nous viennent du monde de l’image, car il faut bien les faire, ces images. Mais le moyen employé est essentiellement le téléphone, pour filmer ou pour monter, or c’est un moyen qui n’est pas réservé aux personnes qui font de l’image leur métier, ce qui permet d’élargir notre groupe au-delà du champ du cinéma. Le seul dénominateur commun est une sensibilité à l’image.
Je pense que ce qui nous a uni·es, par-delà le choc émotionnel de savoir qu’un génocide a bien lieu, il y a aussi la conscience de la propagande. Autrement dit, le danger que le massacre soit toujours relégué en arrière-plan par des images qui faussent la réalité ou qui interdisent toute possibilité de saisir ce qui a lieu. On a tous et toutes été saisies par cette propagande et aussi par la censure généralisée qui nous empêchait de parler. Alors la réponse par l’image, c’est une réponse à l’existence d’une autre image, d’une image de propagande.
Les gens qui ne font pas de vidéo-tracts mais qui ont commencé, naturellement, à partager des vidéos, ont compris leur importance, au cœur de l’impuissance dans laquelle nous nous trouvons. Car ce n’est pas seulement que les médias ne montrent pas ces images, ce n’est pas qu’on n’en parle pas. Le problème, c’est qu’on en parle. Le problème, c’est qu’il y a un discours, un discours de propagande, un discours très dangereux qui masque ces images.
J’ai vu beaucoup de personnes adopter une démarche pédagogique vis-à-vis de ces images : ce ne sont pas des images que tu partages pour toi, mais plutôt pour convaincre leur destinataire.
Y. : Je pense que ça a aussi à voir avec ce sentiment d’impuissance qu’on a toutes et tous éprouvé d’une manière très violente au début. Cette impuissance s’est finalement révélée relative parce que lorsque l’on suit l’évolution purement statistique de ce que font ces images que l’on partage sur les réseaux sociaux, on s’aperçoit en fin de compte qu’on n’est pas si impuissant que ça dans la guerre virtuelle, dans la guerre des images. On est impuissant·es à arrêter le génocide, ça c’est évident, mais je pense que c’est important d’avoir conscience que faire et faire circuler ces images relève malgré tout d’une forme d’action.
Depuis longtemps, la guerre s’est déplacée dans l’espace virtuel, on est, à notre manière, des petits guerriers, des petits guerriers d’Instagram [rires]. Je n’aurais jamais imaginé que j’allais poster vingt stories par jour à propos de la Palestine… Mais quand on s’aperçoit, collectivement, de ce que ça commence à engendrer, on voit se dessiner un rapport de force.
Après, peut-être que je me dis ça pour me rassurer et me dire que je ne suis pas complètement aliénée, je ne sais pas [rires].
T. : Si je devais parler d’un point de vue personnel, je me présentais sur Instagram avec mon nom et mon prénom, je partageais mon travail. Récemment, j’ai tout changé. D’« artiste visuel », je suis devenu « poète » car après tout ce qui s’est passé dans le milieu de l’art, les prises de positions de différentes institutions, j’ai voulu quitter l’image. Je me suis choisi le nom de « Son of Terror » pour dire que je suis le fils de toute cette terreur qui ne vient pas juste de commencer, qui remonte au début de la colonisation de mon pays par la France et de tous les autres pays par l’Occident. Cette guerre au moins a dénudé pas mal de suprématies dans cet univers et j’ai trouvé dans les vidéo-tracts une excellente forme pour parler de tout cela.
F. : Je pense aussi que nous sommes tous des « sons of terror », on a tous et toutes grandi avec ces images, et il fallait, d’une certaine manière, répondre au choc par le choc. Pour moi, c’était une question d’image et aussi une question de montage. Il fallait monter des images pour reproduire ce que nous sommes en train de subir.
W. : Pour ma part, je suis toujours critique de ce que peut faire le montage par exemple. Mais c’est ça qui est intéressant, c’est qu’on n’est pas obligé·es d’être d’accord. On n’a pas de charte esthétique, chacun·e répond à sa manière, ou avec son rapport à l’image. Il suffit de voir les vidéos pour voir à quel point il y a différentes façons d’entrer en relation avec ces images.
Y. : Et aussi d’interpréter ce que serait un vidéo-tract.
W. : Oui, le nom vient des ciné-tracts.
2. Qu’est-ce qu’un tract ?
D. : C’est la question que je me posais : quel est votre rapport avec la forme historique du ciné-tract ?
W. : Notamment la durée et l’anonymat. À l’époque, la durée était contrainte par la pellicule, aujourd’hui, la forme reste simple car l’outil principal est le téléphone portable.
Y. : Il me semble que certain·es montent quand même sur ordinateur mais, oui, les tracts sont majoritairement faits pour être vus sur téléphone portable.
Z. : Il est évident que des sensibilités, des actes, des gestes différents les uns des autres, s’expriment – et heureusement sinon on serait une stupide armée à la con… Donc on est des petits combattants comme dirait Y., des résistant·es à notre manière. Évidemment, malheureusement (ou pas) nous ne sommes pas plus que ça.
Mais ce que je voulais dire c’est que la différence avec les fameux ciné-tracts de l’époque, c’est les images, leur “état”. À l’époque, il n’y avait pas ce flux d’images. Il y avait l’image officielle et les ciné-tracts étaient là pour dire que les images officielles n’étaient pas les images. Il y avait presque quelque chose de sacré dans la conception de l’image. Une conception qui a depuis reçu un grand coup de pied au cul, et même plusieurs – l’image, le sacral et tout ça…
Je suis assez proche de ce que dit F. par rapport au montage, même si je monte très peu les vidéo-tracts que je fais, c’est très souvent en un seul plan. Parce que quand tu prends une image, c’est déjà du montage, même si tu n’en fais rien, tu prélèves dans ce flot d’images insensé – et je pense que ça nous turlupine tous·tes : je n’ai jamais vu autant d’images, un tel déferlement, de toute ma vie.
D’une certaine manière, on plonge et on recherche dans ce flux d’images, sur les réseaux sociaux : on parle d’Instagram, mais il y a aussi Twitter (je viens de m’ouvrir un compte Twitter mais je ne suis pas loin de le fermer tellement ça m’épuise). Je me retrouve même à regarder Al Jazeera parce qu’en tant qu’Arabe j’ai besoin de “voir” en direct les gens sur place (même si je n’aime ni le Qatar ni Al Jazeera), j’ai besoin de l’illusion d’être au plus proche.
L’un d’entre nous a dit un jour : « C’est comme si tout ça avait renouvelé notre cœur. » Parfois dans l’existence, il faut être confronté·e à une incroyable charge émotionnelle pour se rappeler que nous sommes en ce monde, au cœur-même.
Pour revenir aux images, est-ce que nos différents vidéo-tracts parviennent à reposer la question de l’image ? C’est-à-dire : quelle image nous donnons d’eux ? De cette horreur absolue que vivent les Palestinien·nes ?
Quand on voit les différents comptes des journalistes qui survivent/filment aujourd’hui à Gaza, ce qu’ils et elles filment, c’est du brut de chez brut, du réel de chez réel. Je ne sais pas comment on s’inscrit dans ces images-là, je ne suis même pas sûr qu’il faille chercher à savoir.
Ce qui est sûr, c’est que nous sommes dans une sorte de guerre virtuelle, médiatique, dans laquelle nous nous sommes instinctivement lancé·es, jeté·es. Face à l’insensée machine de guerre israélienne, “notre” geste, à la fois commun et individuel, me semble essentiel.
Y. : Moi je parle de nécessité intérieure, à chaque fois que j’essaie de réfléchir à ce qui nous lie, au-delà d’un espace virtuel commun dans lequel on met les choses ensemble. C’est cette nécessité intérieure qui nous a tous·tes conduit·es, à un moment, à faire quelque chose.
S. : Pour moi, c’est la première fois que je rentre dans une pièce où je ne connais personne (je ne connais ni les visages, ni les professions, ni les identités…) alors que je suis quelqu’un d’assez timide, qui n’aurait jamais osé entrer dans un groupe de cinéastes. La différence ici c’est qu’il est question de politique, qu’il est question de lutte voire une question de survie. Car je sentais ce danger imminent qu’on parle à ma place à nos places – quand je dis « nous », je parle du monde arabe –, je sentais cette aliénation du mot, de la parole et de l’image.
Y. : Nous sommes tous·tes dans une position d’humilité qui nous oblige à apprendre.
X. : Pour moi la question a tout de suite été « qu’est-ce qu’un tract ? », il y a bien sûr la référence à Cinéma et idéologie d’Eisenstein, l’idée que le discours politique naît dans la confrontation entre deux images. Pour moi, cela relève de la poésie. Pour d’autres camarades, ça a à voir avec le combat. Un jour, un ami musicien qui vit à Paris m’a appelé en pleurant d’impuissance devant ce qui se passe à Gaza. Je lui ai dit, soit on décide de porter les larmes, je veux dire, les armes [rires] en Palestine, soit on décide d’agir en tant qu’artistes, de manière non violente. Dans tous les cas, en tant que Syriens, il faut faire quelque chose pour ne pas s’arracher les yeux.
W. : À ma connaissance, il n’y a pas de journaliste dans le groupe. Et selon moi, c’est assez symptomatique. Quand on parle d’une des choses les plus complexes au monde, c’est-à-dire, le statut de l’image, il est certain qu’il est quelque part question d’une réponse à l’image médiatique. Autrement dit, il est question de l’image créée par l’information, une image, qui est en réalité un mot d’ordre : celui que produit les médias et qui dicte la manière dont on doit voir le monde.
Quand on a commencé à parler de la Palestine – ce nom lui-même était interdit – ce mot d’ordre était celui d’une « guerre de civilisations ». À entendre les journaux et les médias, la guerre de civilisations était déclarée : une guerre dans laquelle étaient enrôlés non seulement les pays dits arabes, mais aussi la diaspora – j’habite en Europe, et c’était quelque chose d’extrêmement violent. Sans parler du discours officiel israélien qui compare les Palestinien·nes à des animaux et qui passe tranquillement, comme quelque chose de parfaitement acceptable, tandis que de l’autre côté, on ne pouvait même plus prononcer le mot « Palestine ».
Je pense que c’est aussi l’envie que ce mot soit prononcé qui nous a poussé·es à créer un espace virtuel où il pouvait l’être, malgré la censure – la restriction de la portée de nos publications par l’algorithme par exemple. À ce propos, je crois que c’est Debord (Débordements et Debord…) qui disait qu’au moment où elle est énoncée, l’information sépare de la réalité, la recevoir revient à être séparé·es du monde. Ce n’est pas tant que les gens ne savent pas, c’est que l’information qu’ils reçoivent les éloigne du monde.
Pendant ce temps, les Palestinien·nes disent : « Que voulez-vous de plus ? Vous voulez voir des gens mourir : vous les voyez mourir. Du sang ? Vous voyez du sang. Des bombes ? Il y a des bombes. » Mais dès lors que l’information s’approprie cela, elle rend tout irréel. Il faut donc réfléchir à un geste qui s’oppose à ce flux informationnel dans lequel ce qui est monté est une guerre de civilisation. Moi, je suis extrêmement choquée non seulement par ce qui se passe mais aussi par le fait qu’on en parle de cette manière.
S. : Pour moi, c’est vraiment l’image envers, contre et pour tous. J’ai été journaliste dans une de mes vies antérieures et le 8 octobre, j’ai démissionné.
Z. : Attends S., tu étais journaliste comme moi j’étais chanteur…
S. : À la radio, à Paris, on m’a demandé de couvrir le conflit qui commençait et j’ai refusé.
D. : Une autre différence avec les ciné-tracts tient au geste d’aller dans la rue, de faire ses propres images du mouvement social avec une petite caméra Super-8 ou 16mm et à partir de là, proposer des contre-images. Vos vidéo-tracts sont forcément faits à distance, avec des images filmées par d’autres, que vous récupérez et que vous faites vôtres en travaillant dessus.
Z. : Ce qui reste c’est surtout le mot tract : un contenu politique, conçu pour passer de main en main, avant et pendant une manifestation, une action, pour circuler, qu’il s’agisse d’un texte ou d’une image. On se réapproprie les images car rien n’appartient à personne. On ne s’approprie pas la parole de l’autre, on ne va quand même pas faire comme l’ennemi et parler au nom des autres ! Mais les images, dans ce flux, comme elles n’appartiennent plus à personne, alors elles appartiennent à tout le monde. C’est l’antithèse du copyright – c’est le copyleft.
Et ces images qui sont partout, finissent par ressembler à la rue – même si on aimerait beaucoup que des camarades à Londres, par exemple, nous rejoignent et fassent des vidéos à partir d’images des manifestations. Rien ne remplace la rue et les millions de gens qui descendent dans la rue… bien qu’il faille se souvenir que lors de la première guerre en Irak, les dirigeants n’en avaient rien à taper que des millions de gens manifestent contre cette guerre. Je ne dis pas pour autant que la rue n’a plus aucune importance, je considère encore qu’elle est fondamentale. Je ne dis pas que l’image remplace une manifestation, ni qu’elle est à côté ou avec, je dis qu’elle fait partie de la rue.
D’ailleurs, dans les images de manifs, on remarque beaucoup de gens avec un téléphone, non seulement pour filmer la manif elle-même, mais aussi pour voir en direct ce qui se passe en Palestine, “partager” ces images
C’est ça le truc tordu de l’Internet : l’Internet est cet immense pouvoir qui s’est tourné contre nous, les humains, mais qui aussi échappe au pouvoir. Les anars au départ étaient persuadés que l’Internet allait être l’outil idéal, celui qui allait enfin briser les frontières. Évidemment ils se sont fait avoir, les anars sont parfois de beaux utopistes, ils ont oublié que le pouvoir est plus tordu que jamais – c’est là où la réflexion de Guy Debord est fondamentale.
Malgré tout, les images sont aussi entre nos mains, on peut les arracher, les détourner, les travailler et les rebalancer dans le grand flux des images.
Y. : D’ailleurs dans les manifs tu vois souvent des pancartes faites d’images imprimées, des memes, des choses qui ont été dites sur Internet, des photos. Pour moi, c’est un phénomène très important qui rend une forme de matérialité à l’image. Elle n’est pas entièrement désincarnée, en tout cas elle s’incarne d’une certaine manière dans la manifestation.
D. : Il y a même ce manifestant à Paris qui a fabriqué une pancarte articulée qui rejoue la vidéo très connue du journaliste qui lance sa chaussure sur George W. Bush.
W. : Parmi les trucs tordus dans le flux des images, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais après le 7 octobre il y avait cette image aérienne de Gaza bombardée avec par-dessus « Pray for Israel ». Je pense que se réapproprier des images s’est se confronter à l’un des mots les plus complexes et que l’image peut le plus subvertir, c’est le mot « vérité ». Et ce mot est au cœur de la relation entre cinéma, information et propagande au cœur de laquelle nous essayons d’agir.
3. Les images des corps
Y. : Et puis il y a beaucoup de questionnements, plus ou moins conscients, autour de la question du remploi. Par exemple, j’ai remarqué, quand je regarde nos vidéo-tracts, qu’il n’y en a aucune qui montre des cadavres, des corps mutilés, alors que ça constitue la très grande majorité de ce que l’on reçoit de Palestine. Peut-être que nous sommes aussi rélié·es par le fait de considérer ce matériau comme totalement hors du champ de ce que nous pouvons utiliser ou détourner.
La question de la dignité des victimes est omniprésente dans les guerres dont les images nous sont parvenues. Les Palestinien·nes montrent ces images dans l’espérance qu’elles vont susciter une action, mais nous, nous savons que nous ne les montrerons pas, consciemment ou inconsciemment.
W. : Les Palestinien·nes ont ce droit, car ils et elles montrent leur chair et leur sang. Ce sont les seul·es qui ont ce droit et il ne nous revient pas de les juger. Ce registre d’image n’est pas employable, mais en effet, nous n’en avons jamais parlé explicitement. D’ailleurs, nous ne parlons pas de ce que nous faisons. Il n’y a pas de comité de censure qui approuverait ou pas les vidéos. Cela rejoint aussi la question de l’humilité : dans l’anonymat du collectif, le « je » disparaît en même temps que le copyright.
Z. : Oui, d’ailleurs les vidéo-tracts ont été montrés comme ça quelque part à Tunis.
Y. : Les vidéo-tracts ont été projetés dans le cadre des Cinema Days of Resistance en Tunisie qui ont commencé à projeter des films sur le mur de l’Institut Français suite à une série d’événements : Free Palestine avait été tagué sur le mur d’enceinte, l’Institut a repeint le mur. Les Tunisien·nes sont retourné·es couvrir le mur de tags, alors l’Institut Français a lancé un concours sur Facebook disant : « Nous voyons que notre mur suscite de l’intérêt, alors nous lançons un appel à projet pour savoir quoi en faire. » Alors non seulement les habitant·es de Tunis ont trollé sous la publication mais ont carrément organisé des projections sur le mur lui-même, pour rappeler que ce mur d’enceinte leur appartenait.
Z. : Quand je parle avec mes ami·es en Palestine, je m’étonne parfois de l’usage de ces images d’une violence inouïe brandies par les Palestinien·nes à Gaza. Un camarade qui vit à Naplouse m’a un jour dit: « C’est l’arme de celui qui n’a plus rien. Montrer ce qui nous arrive, ce que nous subissons, parce que personne ne nous croit. » Depuis, je me force à tout regarder, presque. C’est très nouveau dans l’histoire, une victime qui brandit l’image d’une autre victime – son enfant, sa compagne, son compagnon, son ami, son frère, sa mère, son père – sachant que ce sera bientôt lui ou elle sur cette image qui nous dit « regardez-moi ». La victime brandit sa propre image. Je me dis que je me dois de me violenter. Mais je n’arrête pas de me demander que faire de cette violence que je “vois”.
4. La vérité
W. : On pense forcément aux images de la Seconde Guerre mondiale, aux images des camps qui ne sont sorties qu’après la guerre tandis que pendant, les gens pensaient que ce n’était qu’une rumeur. C’était quelque chose qui me hantait quand j’étudiais l’histoire, quand je regardais des films, je me demandais toujours : « Comment a-t-on pu laisser faire ? », associé à l’idée qu’à l’ère de l’image, cela ne pourrait plus jamais arriver. Et là, on découvre que la prolifération de l’image ne suffit pas, on s’aperçoit qu’on est prêt à accepter, célébrer la Nativité alors que le pays où elle a eu lieu est massacré.
Ce n’est pas tellement que les gens ne sont pas touchés par ces images, je crois surtout que la déshumanisation est telle que si ces mêmes images parvenaient d’un autre territoire, elles feraient remuer le monde. L’Occident ne se rend pas compte que pour une partie du monde, plus rien ne sera comme avant. Il y aura sans doute une radicalisation des points de vue car nous avons compris que ça ne comptait pas, qu’un·e Arabe qui crève, ça ne compte pas, qu’il y ait des images ou non.
Z. : L’image ne dit plus la vérité, ou alors elle le dit tellement qu’on arrive plus à l’entendre, à la regarder. Déjà en Syrie, il y avait de terribles images, et l’Occident a versé des larmes de crocodile. L’Orient aussi (je parle de l’Orient officiel, pas des gens), car vouloir ne pas voir n’est pas propre à l’Occident, bien que l’Occident a tout de même écrit et continue d’écrire, directement et indirectement, les pires pages de l’histoire humaine et je doute fort qu’il le reconnaisse un jour… je serai mort d’ici là. « Le cinéma c’est la vérité 24 images par seconde », cette formule est cuite.
Je sais bien que les vidéo-tracts ne vont pas renverser quoi que ce soit, ne vont pas “montrer” la vérité, la révéler. Peut-être qu’ils donneront un peu de chaleur à ceux qui en ont besoin, un peu de rage “exprimée”. Mais je ne me leurre pas : la vérité est noyée.
X. : Pourquoi noyée ? La vérité a été relativisée. Ce conflit est un conflit entre l’absolu et le relatif. Nous sommes soi-disant dans l’ère de la « post-vérité » : c’est avant tout une expression qui vise à relativiser l’horreur. Personne ne relativise l’existence des peuples occidentaux, personne ne débat sur ce qu’il faudrait en faire. En Syrie par exemple, Assad a relativisé l’existence – et donc la vie – de certaines personnes, comme le fait Israël, en comparant des humains à des animaux. L’ultime résistance revient désormais à dire qu’il y a des choses absolues, la vie humaine par exemple, ou la justice.
W. : Le problème de l’Occident c’est qu’il veut parler au nom des autres, sur les autres. Et l’autre, c’est le lieu de la nuance, du relativisme.
Z. : On sait très bien que c’est le vainqueur qui écrit l’Histoire, qu’il en a toujours été ainsi, mais je pense qu’aujourd’hui tout est bouleversé : le récit officiel en a pris un coup, il est désorienté. Je ne sais pas ce qui va en sortir, mais ça ne me déplaît pas. Les Palestinien·nes ça ne les avance à rien aujourd’hui, mais le monde est en pleine désorientation, et ce flux des images n’y est pas pour rien.
5. Dégoût et espoir
Y. : Les images qui nous parviennent de la Palestine, filmées par les Palestinien·nes, obéissent aussi à des règles de cadrage, de manières de montrer, des codes qui sont ceux des réseaux sociaux et qui sont, par ricochet, les codes du spectacle, d’Hollywood, etc… Mais l’espoir que je trouve dans ces images – car j’en ai aussi beaucoup maintenant –, bien que façonnées et formatées, réside dans ce quelque chose qui échappe qu’elles portent en elles, et que je n’ai jamais ressenti aussi fortement. Je me l’explique par le lien que celles et ceux qui les fabriquent ont à leur terre, un lien qui leur permet de résister à tout récit, à toute fiction. Ça me fait penser à ce que disait Godard sur les palestiniens qui se retrouvent dans le documentaire (c’est à dire le réel) tandis que les autres se retrouvent dans la fiction (la propagande). Mais il est clair que l’Occident ne peut plus continuer à fonctionner (ou à dysfonctionner) de la même manière.
W. : Quelque chose a bien lieu. Quelque chose d’une conscience, d’un possible espoir a bien émergé. Par exemple le mot « colonisation », je ne l’entendais pas, ou du moins il semblait appartenir à un passé révolu. Ce mot est partout désormais et il désigne une réalité présente.
Je ne sais pas si faire des vidéo-tracts relève de cet espoir mais au moins ils nous donnent l’impression de faire quelque chose avec ce qu’on a. Et surtout ils permettent de survivre au dégoût. Car j’ai éprouvé un dégoût énorme vis-à-vis du monde de l’art, envers ce que c’est que l’art, envers le sens de l’art.
Y. : Je pense qu’on le partage, ce dégoût, on n’en a jamais parlé mais je pense qu’on le ressent toutes et tous.
Z. : Je n’ai pas de dégoût parce que je n’ai jamais eu l’inverse [rires]. Le monde de l’art pille allègrement au réel, il prend, mais il veut rarement le lui rendre. Alors je ne suis pas étonné de la réaction du monde de l’art.
Y. : Ce qui est surtout révélé c’est l’imposture qui consiste à faire de la Palestine le sujet ou l’objet d’une discussion ou d’une œuvre tout en n’étant pas capable de prendre une position claire depuis octobre c’est-à-dire de la délier de l’événement en cours – à savoir le génocide.
W. : Je ne pense pas qu’on soit obligé d’être engagé·e, on peut aussi se taire, c’est très bien le silence. Mais si je pense à une définition deleuzienne, l’acte de création est un acte de résistance, et il arrive des moments historiques où si l’on a la possibilité de parler, alors peut-être faut-il prendre la parole, user de ce privilège qu’est la parole. Je peux respecter le silence mais nous sommes dans une période où, avec le succès que rencontrent les études décoloniales dans les universités occidentales, on peut être frappé·es par le silence de toutes les personnes qui s’engagent dans ce type de champs de recherche. C’est une séparation pour le moins malheureuse, sinon bourgeoise, de constater que des personnes écrivent ou font des films sur des thématiques « engagées » mais n’ouvrent pas leur gueule. Rien que pour montrer de la solidarité : il faut être à la hauteur de ce qui a lieu.
D. : C’est la différence entre ceux qui préfèrent une image morte à fétichiser, à une image vivante de la lutte.
Z. : Être à la hauteur ce n’est pas tant affaire de prendre les armes ou non, ou même faire des vidéo-tracts, c’est au moins refuser d’être à un endroit où on fait semblant que ça peut continuer comme si de rien n’était. Refuser le silence, l’indifférence. Au moins.