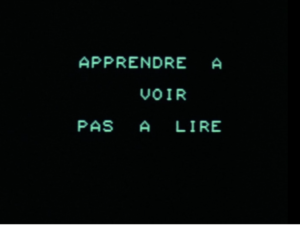Notes sur la Palestine (7)
No Other Land : destruction et répétition
Ce texte est la septième page de nos Notes sur la Palestine.
Il y a un an, le 31 janvier 2024, nous publiions notre sixième note sur la Palestine. Nous estimions, à l’époque, être à court de mots pour parler des images nouvelles qui nous parvenaient, et des images anciennes auxquelles nous repensions. A la même période, lors du festival Un état du monde, le Forum des Images nous avait d’ailleurs invité à organiser une discussion autour de ces images : ont généreusement participé Shourideh Molavi (Forensic Architecture), Yazid Anani (Qattan Foundation), Raed Andoni (cinéaste) et Eyal Sivan (cinéaste, auteur), dans une table ronde qui nous semblait être une forme de synthèse et d’ouverture. Mais la guerre, elle, ne faisait que commencer.
Des mois et des milliers de morts plus tard, alors que la guerre s’est étendue au Liban et jusqu’aux frontières de la Syrie, que la colonisation ne faiblit pas et que les instances internationales confirment jour après jour que l’on ne se trompe pas en parlant de « génocide », les gazaouis retrouvent leurs foyers, pour la plupart détruits, dans le cadre d’un cessez-le-feu dont les conditions semblent fragiles. Durant ces longs mois d’autres images ont émergées : parmi elles, celles du documentaire No Other Land, sorti le 13 novembre 2024 dans les salles françaises.
Débordements
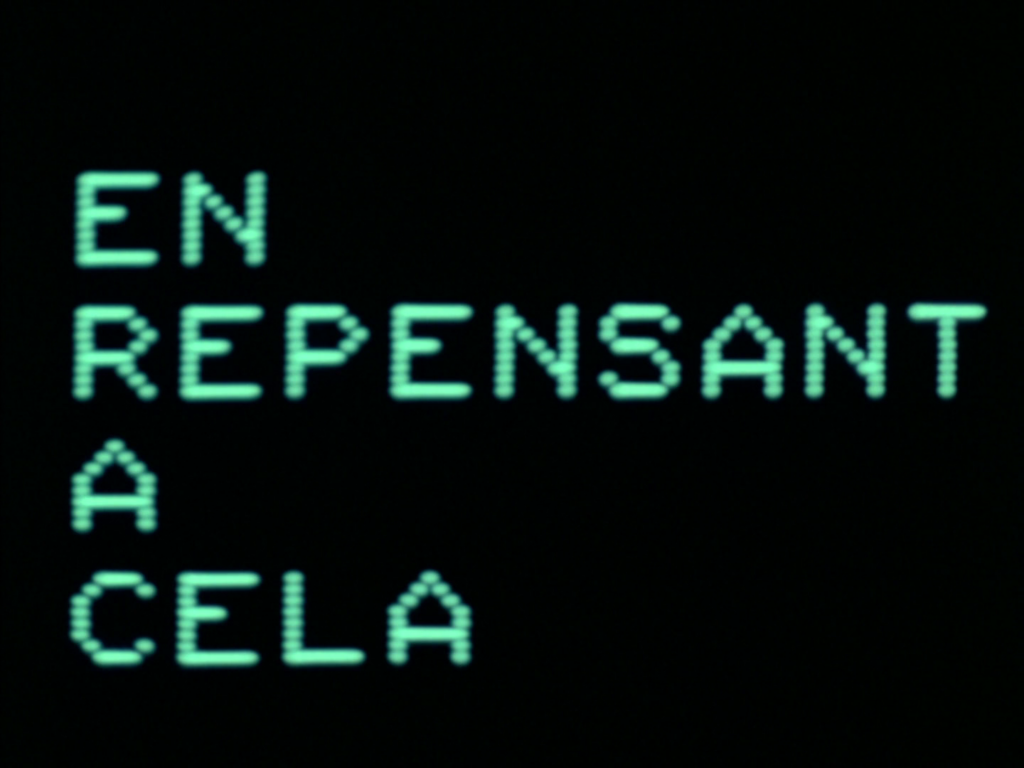
Basel Adra, co-réalisateur de No Other Land (2024), pose un constat que beaucoup partagent : nous assistons depuis le 7 octobre 2023 à un « génocide en direct[11][11] Voir l’émission de Mediapart « À l’air libre » consacrée à No Other Land. ». Les images de la disparition de Gaza, avec son lot de destructions continues et de souffrances incommensurables, se disséminent live depuis plus de quinze mois sur les chaînes d’information (principalement Al Jazeera), autrement encore sur les réseaux sociaux, parfois via les ondes de médias indépendants (comme Democracy Now!). On ne peut anticiper ce qu’il se passe à l’intérieur des cœurs et des esprits quand ces images sont découvertes : larmes, effroi, stupeur, colère, compassion… Les affects se mélangent et possèdent souvent une existence spectrale : un visage après un bombardement ne nous quitte plus, un cri enregistré dans un hôpital nous revient sans cesse.

Il y a un sentiment supplémentaire cependant, qui enveloppe peut-être tous les autres : celui d’une impuissance à laquelle on s’habitue insidieusement. Non pas notre propre impuissance au regard d’une situation génocidaire dont nous sommes les témoins au présent, mais l’impuissance de ces images elles-mêmes qui n’arrêtent rien de la folie destructrice mais raisonnée de l’armée israélienne. Et cette impuissance elle-même alimente un autre sentiment, que même une culpabilité légitimement éprouvée n’altère pas : un sentiment d’indifférence qui gagne les consciences en les anesthésiant. Comment sortir de ce cercle infernal où nous assistons à une stratégie exterminatrice sans que les images qui la documentent au quotidien ne permettent pas même d’envisager qu’elle s’arrête ?
Basel Adra et son co-réalisateur Yuval Abraham ont bien en tête ce problème, même si le tournage de leur documentaire a précédé les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité perpétrés par le Hamas le 7 octobre [22][22] Le cinéaste Hamdan Ballal et Rachel Szor font également partie de l’équipe de réalisation.. Ce ne sont pas des cinéastes de profession : Adra est un activiste palestinien qui documente l’ordinaire de l’occupation à Masafer Yatta, le village où il vit en Cisjordanie, et Abraham est un journaliste d’investigation israélien, spécialisé dans les actions militaires de Tsahal. No Other Land est leur premier film, qui scelle leur amitié en même temps que la rencontre entre les images et les mots. Il faudrait voir comment s’effectue le saut de l’écrit vers le documentaire pour Abraham, et si Adra a été tenté par un récit sans image pour parler de l’impossibilité de vivre à laquelle lui et ses proches sont asservis. Nous allons tenter d’étudier un aspect de la structure si singulière de No Other Land, et essayer de montrer comment sa construction engendre un effet de sidération qui contrarie l’indifférence devant des images dont le contenu devrait rendre celle-ci honteuse.
Avant cela, restons un instant dans l’univers de l’écrit, et relevons un trait stylistique parcourant les nombreux textes qui, malgré le mutisme qu’ils diagnostiquent devant la situation à Gaza, tentent de lutter contre ce même silence. Ce trait est celui de l’énumération. Pour apprivoiser sa dépossession devant l’horreur, les écrivain⋅es, les poètes, les intellectuel⋅les, les historien⋅nes font des listes : ils ou elles enchaînent les noms de bâtiments publics ou d’institutions qui ont été bombardés ou rasés par l’armée israélienne depuis le mois d’octobre 2023. Dans sa préface aux « poèmes de Gaza », Nada Yafi revient sur la fonction précaire et pourtant absolue, incompressible, de la poésie confrontée à une « telle entreprise éradicatrice » :
« Face à une offensive qui s’en prend aux forces de l’esprit autant qu’aux moyens de subsistance, en visant tant les habitations, les hôpitaux, les services sociaux que les lieux de culte et de culture, écoles, universités, théâtres, archives et musées, et jusqu’aux cimetières, lieux de mémoire, en ciblant parallèlement, parmi les civils, médecins, intellectuels et journalistes, eh bien face à une telle entreprise éradicatrice, la pensée poétique est à sa manière un acte de résistance, qui s’oppose à la volonté d’annihiler un peuple, une patrie[33][33] Que ma mort apporte l’espoir. Poèmes de Gaza, textes sélectionnés et traduits par Nada Yafi, Libertalia, 2024, p. 11. ».
Dans son introduction à Une étrange défaite, Didier Fassin est consterné par la manière dont les sociétés occidentales se complaisent dans une sorte d’omerta à peine coupable ; il y a en effet un effarement
« à ce que tant de celles et ceux qui auraient pu parler, voire s’opposer, détournent leur regard de l’annihilation d’un territoire, de son histoire, de ses monuments, de ses hôpitaux, de ses écoles, de ses logements, de ses infrastructures, de ses routes et de ses habitants, et même, pour beaucoup, en encouragent la poursuite[44][44] Didier Fassin, Une étrange défaite. Sur le consentement à l’écrasement de Gaza, La Découverte, 2024, p. 8.. »
Elias Sanbar pour sa part, dans un cadre historique plus général, remarque comment la pratique de l’inventaire est aussi une manière parfois désespérée de préserver la Palestine « dans toutes ses composantes ». C’est ainsi que, « en permanence », « des milliers de voix transmettent l’Histoire mais aussi les histoires du pays et des lieux » :
« Et, l’une après l’autre, des générations d’enfants nés au loin, privés de leur nom, apprennent dans leurs moindres détails les sentiers, les bâtisses, les champs, les arbres, les rochers, la flore et la faune de leur terre interdite. Plus, une personnification du monde perdu en résulte qui fera que désormais arbres, rochers, maisons et champs seront perçus comme des membres, perdus de vue, de la famille [55][55] Elias Sanbar, Figures du Palestinien. Identité des origines, identité de devenir (2004), Gallimard (Folio), 2024, p. 248.. »


Sanbar fait de ce geste d’inventaire un genre littéraire à part entière, et trouve son incarnation exemplaire en la personne du grand écrivain Moustapha Mourad al-Dabbâgh (1897-1989). Il salue en particulier son ouvrage encyclopédique Bilâduna Filastin, soit « la reconstitution dans ses moindres détails d’un pays englouti, un inventaire total, un projet démesuré de mettre une patrie par écrit : géographie physique, toponymie, géologie, climatologie, démographie, histoire, croyances, archéologie, structuration de la société en clans, tribus, familles…[66][66] Ibid., p. 217. »
L’inventaire est indissociable d’un monde partagé, et l’énumération comme pratique d’écriture est une tentative pour garder vive sa mémoire, éviter qu’il disparaisse même si son existence reste d’une extrême précarité. Cette figure de style, on l’a dit, insiste tout autant dans la Palestine contemporaine. Sa mise en œuvre aujourd’hui permet d’ajouter que la succession des noms est aussi le signe d’un épuisement de la langue, parallèlement à l’exténuation d’un territoire pris en étau. Les mots s’égrènent, tandis que la réalité à laquelle ils renvoient suit la voie d’un effacement forcé. Ils sont le pouls d’une société en lutte contre sa suppression. Leur simple juxtaposition dans une phrase renvoie aux destructions qu’ils ont vocation à nommer, même si ces destructions ont déjà eu lieu, et que les mots en l’occurrence viennent trop tard. L’énumération amplifie la désolation, c’est certain ; elle a aussi le privilège de l’ancrer dans un espace mutilé, martyrisé, comme une trace vibrante lancée à la face des bourreaux. Énumérer, ici, c’est faire la carte de l’innommable ; Gaza se meut et résiste encore au rythme des mots qui disent sa dévastation.
No Other Land dresse également un inventaire des destructions de maisons, d’arbres, d’écoles, de terrains agricoles, de canalisations d’eau organisées par l’état-major israélien à l’échelle de Masafer Yatta. La dimension locale du film a son importance, indépendamment d’une histoire longue de persécutions dont fait l’objet ce village du sud de la Cisjordanie, non loin d’Hébron. Elle permet de prendre la mesure de l’acharnement d’une armée qui utilise l’arbitraire de son pouvoir juridique pour forcer la population palestinienne à quitter le sol où elle vit, parfois depuis des générations. Yuval Abraham avance une idée forte sur ce point : la volonté de déloger les habitant⋅es de Masafer Yatta ne repose pas sur une action spectaculaire de soldats israéliens visant à traumatiser une fois pour toutes ses hommes, ses femmes et ses enfants pour les contraindre à fuir. Le traumatisme existe de toutes les façons, mais nous avons affaire, ici comme ailleurs, à une série de destructions qui se répètent inlassablement et s’échelonnent dans un temps distendu. L’hypothèse d’Abraham est la suivante : cette répétition coïncide avec la décision de détruire graduellement le village, et cette progressivité est la condition même de son invisibilisation. No Other Land est une réponse à ce plan diabolique. Sa réalisation ne vise pas seulement à rendre visible l’invisible, mais à mettre en lumière une tactique militaire qui, sans éclat et non sans lâcheté, réussit pourtant très efficacement à cacher cette chaîne infernale d’expropriations et de démolitions mêlées.

La force de No Other Land réside dans sa composition d’ensemble, laquelle épouse la morne temporalité d’un processus de déshumanisation ininterrompu. On pourrait dire que la structure de l’œuvre est fondamentalement plate. Il n’est pas nécessaire de dramatiser des conditions de vie déjà en elles-mêmes dramatiques. Ce serait réduire davantage encore les Palestinien⋅nes à un statut de victimes par ailleurs dominant dans l’imaginaire collectif : un statut qui les caractérise, bien sûr – comment en serait-il autrement ? –, mais qu’ils ou elles refusent le plus souvent avec une dignité qui accroît en parallèle la rage impuissante de l’occupant. Tout se passe comme si le montage du film cherchait à mimer une concaténation imperturbable de destructions. Semaine après semaine, mois après mois, année après année, c’est une même manœuvre militaire qui se répète.
L’inventaire de No Other Land dresse la carte de cette répétition mortifère, quand elle n’est pas mortelle (par exemple, lorsqu’un Palestinien s’interpose ou retrouve sur son chemin un habitant armé des colonies avoisinantes). Le film possède d’ailleurs son propre rituel. Souvent Adra repère au loin dans la montagne une colonne de blindés qui annonce le pire ; le pire advient peu après quand, d’objets minuscules ressemblant à des jouets, ces véhicules blindés laissent la place dans le champ à des bulldozers vus de près ; puis, une maison s’écroule sous le coup des pelleteuses ; une école est saccagée ; un puits qui alimente en eau un lopin de terre est bétonné. Il est important de signaler que les réalisateurs ne coupent pas ces scènes une fois la destruction achevée ; ils font la coupe quand cette dernière est en cours, ce qui augmente l’impression objective que, en définitive, le supplice de Masafer Yatta ne s’arrête jamais.
Notons que si l’intervalle entre une séquence de destruction et la suivante advenait une fois la démolition effective, nous serions dans une tout autre posture spectatorielle. L’imagination ne serait pas suscitée comme elle l’est quand la coupe survient dans l’action même de détruire : notre faculté d’imaginer s’active alors en effet, terminant pour ainsi dire le travail des forces israéliennes. En résulte bien une impression de dévastation sans répit, voulue par ces mêmes forces, et qui correspond à celle qu’éprouvent les Palestinien·nes au quotidien. De ce fait, la succession à l’écran de ces destructions inachevées débouche sur un présent continu d’où toute issue semble exclue. Le caractère suffocant de No Other Land en découle, qui en aurait été autrement atténué. Car montrer l’état de dévastation après le passage des bulldozers aurait sans conteste créé un sentiment de fatalité, lequel, en plus de s’approcher de cet état d’indifférence qu’il s’agit précisément de combattre, aurait été en contradiction avec le courage des habitant·es de Masafer Yatta, toujours prompt⋅es à reconstruire ce qui a été cassé, abîmé, écrasé.
Si l’on compare les deux types d’inventaire, en mots et en images, que nous avons relevés jusqu’ici, il est possible de remarquer que le premier esquisse horizontalement les coordonnées de territoires occupés, violentés, et la forme énumérative, voire encyclopédique qu’il prend parfois permet un télescopage des temps : celui, passé, d’une mémoire qu’il s’agit de protéger à tout prix et celui, au présent, d’une histoire contemporaine où l’anéantissement guette comme à Gaza. No Other Land, de son côté, s’efforce de rendre visibles les méthodes d’invisibilisation des destructions menées par Tsahal depuis des décennies maintenant. La répétition de ces dernières est éclatante, et elle détermine la structure envoûtante d’un film qui continue de nous accompagner après sa projection. Les espaces de Masafer Yatta en sortent meurtris, autant que sa population dont la persévérance face à un destin si tragique nous propulse dans une humanité insoupçonnable et insoupçonnée. L’espace réduit du village fait que l’enchaînement des destructions qu’il subit dessine cette fois un mouvement d’ordre plutôt vertical : leur accumulation surligne le déplacement de haut en bas des pelleteuses, jusqu’à donner la sensation de pénétrer sous la terre, tandis que les Palestien⋅nes se retrouvent à vivre dans des grottes de fortune une fois leurs maisons disparues. Est-ce encore une vie ?


Un dernier mot sur No Other Land et un affect de plus qu’il provoque : c’est que la mise à nu de ces procédés incessants de démolition entraîne irrésistiblement une forme de comique étrange, qui n’est pas sans relation avec l’humour salvateur des Palestien⋅nes. De quoi s’agit-il ? Bergson disait qu’il existe un comique de situation qui provient de la répétition presque mécanique de phénomènes gestuels, physiques ou langagiers. « Ce n’est plus de la vie, écrit Bergson dans Le Rire, c’est de l’automatisme installé dans la vie et imitant la vie. C’est du comique ». Qu’est-ce que la vie ? Quelque chose de toujours changeant, en perpétuelle variation. Dès lors qu’un même événement se répète, dès lors qu’une « combinaison de circonstances [revient] telle quelle à plusieurs reprises, tranchant avec le cours changeant de la vie », alors cette répétition déclenche un comique de situation. Celui-ci, dans le cas du film qui nous occupe, est l’effet indirect du constat d’un appauvrissement insoutenable de l’existence à laquelle sont soumis les hommes et les femmes de Masafer Yatta, dont les possibilités de vie, si on les leur accordait, sont pourtant immenses. Émanant d’un public transi, les rires involontaires que l’on pouvait entendre lors des projections de No Other Land n’étaient rien d’autre qu’une conséquence de ce spectacle de destructions infiniment répétées : « une mécanisation de la vie » dans l’horreur, que reflète son montage si tranchant [77][77] Henri Bergson, Le Rire. Essai sur la signification du comique (1940), Paris, P.U.F. 2007, p. 25, 69 et 77..
Sans doute No Other Land nous fait-il pénétrer dans cette mécanique de la destruction, tout en laissant entrevoir une sortie de l’indifférence que l’imagerie du « conflit israélo-palestinien » produit en temps normal. Mais en temps normal seulement.
*
Ce texte a été écrit avant la nomination de No Other Land aux Oscars dans la catégorie du meilleur documentaire, rendue publique le 23 janvier 2025. Deux jours plus tard, Basel Adra publie sur son compte Instagram une vidéo montrant des colons armés en train d’attaquer Masafer Yatta, comme si le film qu’il a co-réalisé ne s’était pas arrêté. Le supplice de son village natal se poursuit et ses images se prolongent sur les médias sociaux. No Other Land donnait déjà l’impression d’une œuvre inachevée. Son tournage, on le sait, s’est terminé à la toute fin du mois de septembre 2023. Puis survient le 7 octobre. En épilogue, les cinéastes choisissent alors de montrer comment les colons d’extrême droite, que l’on a déjà perçus à l’écran dans plusieurs séquences, reviennent sur les terres du village avec plus de hargne encore, et encore moins de contraintes (l’armée et la police israéliennes, supposées contenir leur violence illégitime, sont des figurants pour les colons). Fusil à la main, on voit l’un de ces extrémistes tirer à bout portant sur un Palestinien sans défense : un destin de plus effacé par la folie coloniale.
Comme le sang coulé n’est jamais suffisant, le cessez-le-feu décrété à Gaza a conduit le gouvernement de Netanyahu à accroître la pression militaire sur la Cisjordanie. Et à couvrir davantage encore les atrocités – humiliations, tortures, agressions sexuelles, assassinats… – que les colons ont l’habitude de commettre, et qu’ils peuvent désormais commettre avec l’aval du « meilleur ami d’Israël », le président américain nouvellement réélu, Donald Trump. Ce dernier a en effet signé, le lendemain de son investiture, un ordre exécutif rendant caduques les sanctions décidées par son prédécesseur à l’encontre d’une trentaine de groupes de colons portant atteinte aux droits élémentaires des Palestinien.ne.s. Nous sommes le 21 janvier 2025. Basel Adra ajoute dans son post du 25 janvier que ces mêmes individus armés sont revenus pour se venger de la sélection, par l’Académie des Oscars, de No Other Land à la compétition officielle. Ils n’ont pas apprécié qu’un film puisse représenter, dans son déroulé imperturbable, la réalité d’une occupation qui semble, de fait, sans fin.
En s’attaquant une nouvelle fois au village de Basel Adra, en cherchant cette fois à lui faire regretter la réalisation de No Other Land, les colons obtiennent exactement le contraire de l’effet escompté : ils montrent sans le vouloir la nécessité d’un film dont les répliques nous font pressentir que toute cette injustice ne pourra pas durer.
*
Le 3 février 2025, Basal Adra poste une nouvelle vidéo qu’il a prise dans la nuit à Masafer Yatta. On y voit un groupe de colons dévaler le flanc d’une colline en direction du village, petites silhouettes sombres, éclairées par les phares de leurs véhicules vus de loin. Ils détruisent une réserve d’eau, vandalisent la voiture de Nasser, un ami d’Adra, attaquent des maisons en lançant des pierres à l’intérieur, terrorisant des familles entières, prisonnières dans l’obscurité. D’autres colons viennent en renfort. Adra continue de filmer ; il ne peut s’approcher cependant, car il craint pour sa vie. Dans un moment de répit, il écrit : « We risked our life to film »