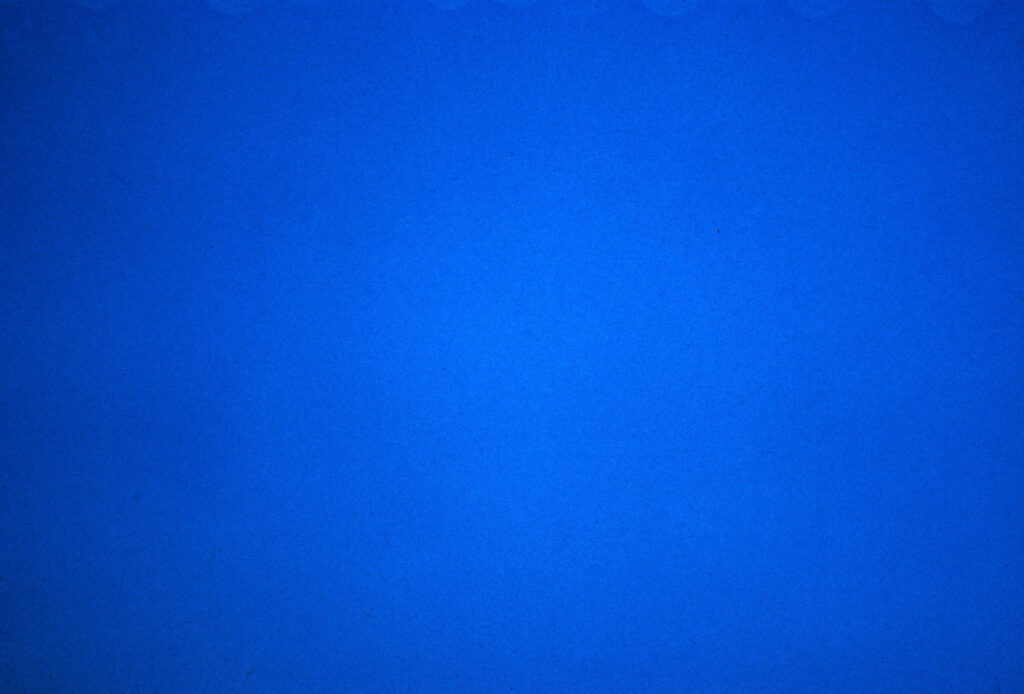Où en êtes-vous, Derek Jarman ?
Sur la rétrospective Derek Jarman du Centre Pompidou
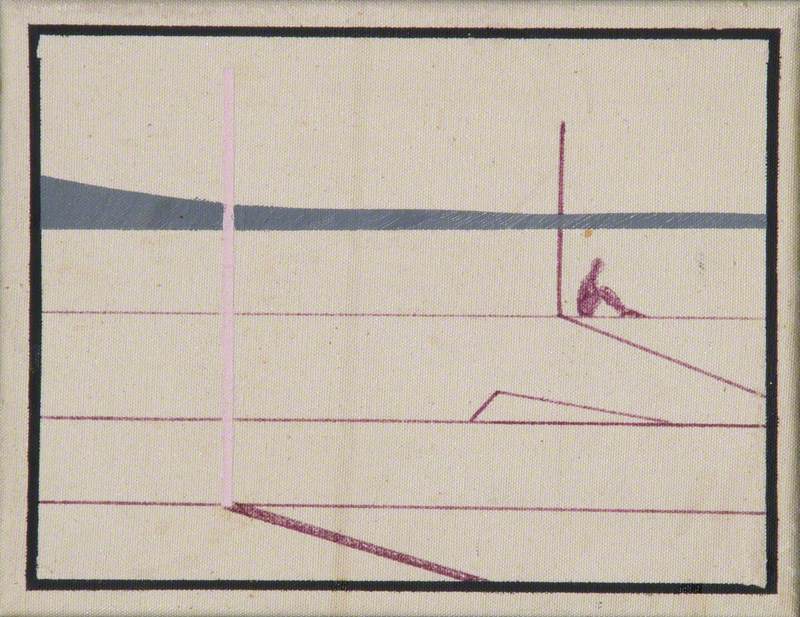
En novembre dernier s’ouvrait une rétrospective des cinémas du Centre Pompidou consacrée à l’œuvre filmique du cinéaste britannique Derek Jarman. L’occasion de (re)découvrir ses longs métrages et de voir certains de ses courts et une partie de son journal filmé – certains des films n’avaient jamais été présentés en France. Projeter cette face mal connue de son œuvre a fait de cette rétrospective un probable moment charnière d’une sorte de reconnaissance tardive (mais en cours) de Jarman par les milieux artistiques officiels – l’exposition de ses peintures au Crédac en avait posé une des premières pierres. En effet, s’il avait été possible de revoir ses films en salle surtout grâce à des festivals de cinéma LGBT (Chéries-Chéris en 2014, Ecrans mixtes en 2024), c’est la première fois qu’une institution de cette envergure lui consacrait une rétrospective, peut-être parce que l’esprit du temps invite à prendre conscience de l’incroyable actualité de sa filmographie et de ce qui l’entoure: les peintures de Jarman, son jardin au Prospect Cottage, ses écrits (Queer Life [1984], Modern Nature [1992], Chroma [1994]…), ses écarts vers la performance et son militantisme en faveur des droits des homosexuels et des personnes séropositives.
Courts métrages: visions, chroniques
Derek Jarman naît en 1942 en Angleterre. Il entre dans les arts visuels par la peinture, dans le cinéma par les décors de film – il est le chef décorateur des Diables de Ken Russell – et dans la réalisation par les courts métrages en super 8. Ces derniers oscillent en quelque sorte entre deux tendances. Dans la première, on trouve des films qui fonctionnent sur une (ou plusieurs) idée forte de vision (on pourrait dire, de tableaux) explorée en quelques minutes – un mode de fonctionnement que reprendront de nombreuses séquences de ses longs métrages où, bien souvent, une séquence ne vaut pas tant son aspect narratif que par l’idée visuelle forte qu’elle propose. Sulphur, dont c’était la première française, mélange ainsi plusieurs visions : une danse, un feu, des personnages masqués, des sculptures antiques… C’est une fusion dont il est assez difficile de distinguer les ingrédients tant ils sont liés par l’usage de la surimpression. Parmi ces couches, il y a des images venues d’un autre film, Art of Mirrors, dans lesquelles un rayon de lumière renvoyé vers la caméra par un miroir crée une forme blanche venant comme trouer les autres scènes. Ce cercle blanc, projection lumineuse, creuse ou masque des visages eux-mêmes masqués dans un étrange jeu de cache et de révélation. Cette figure du miroir tourné vers la caméra, qui se catalyse ici, reviendra dans des films plus tardifs, de même que la ballerine dansant autour du feu dans Jordan’s Dance dont l’extrait sera repris tel quel dans Jubilee et semble infuser jusqu’à la robe de mariée découpée par Tilda Swinton près d’un feu dans The Last of England.
La seconde face de ses courts métrages inclut des formes tirant plutôt vers le journal filmé : dans Sloane Square, le cinéaste pose sa caméra super 8 dans son appartement et donne à voir la vie amicale qui s’y déploie. Le chez-soi – le film est sous-titré A Room of One’s Own – est un lieu hospitalier : la première partie en stop motion laisse voir la succession des amis sur un canapé – on n’osera pas dire que le générique de la première saison de Friends s’en est inspiré. Puis se succèdent des détails de l’appartement tant aimé : des objets et des choses, puis des hommes, plus ou moins habillés. Le film se clôt sur une fête juste avant que le cinéaste soit expulsé de l’endroit : « requiem for sloane square », est-il écrit sur les murs qui ont été entièrement gribouillés. Le film garde la trace d’un lieu habité ensemble, entre amis ou amants, et ne conserve qu’un souvenir festif de l’expulsion (la « chambre à soi » qualifie d’ailleurs peut-être autant l’appartement que le film lui-même). Comment ne pas y voir cette amitié comme mode de vie dont Hélène Giannecchini a analysé la présence dans le travail de Donna Gottschalk (Hélène Giannecchini, Un désir démesuré d’amitié, Seuil, 2024), proposant de tisser des filiations amicales avec ceux qui nous ont précédés ? Ce désir démesuré d’amitié entre homosexuels – on dirait aujourd’hui entre queer – est déjà là et a eu, un temps, un lieu – un appartement – pour se développer.
Cette dimension diaristique du travail de Jarman se prolonge au passage dans ses écrits (voir la traduction récente de son Modern Nature), et Blue est en partie l’achèvement de ces deux tendances du journal, le texte et le film, grâce à cette voix off littéraire, en partie forgée à partir d’extraits de ses écrits et dont la transcription a d’ailleurs été publiée. Mais Jarman a aussi construit un véritable journal filmé auquel la rétrospective a fait la part belle en projetant trois de ses volumes. Le très rare It Happened by Chance, formidable découverte, journal filmé silencieux en super 8, donne lui aussi à voir la vie amicale (des amis dans le double sens que peut avoir ce mot dans les relations queer, comme le souligne Hélène Giannecchini) et la vie quotidienne et mondaine du cinéaste.
C’est un journal filmé hospitalier, où ceux qui passent par-là semblent pouvoir entrer facilement. Qui sont ces personnes ? Des acteurs de passage, stars, soudain, le temps d’un gros plan. La caméra super 8, extension du corps, crée elle-même des jeux de corps, s’approchant, s’éloignant, laissant ceux qu’elle filme créer leur propre jeu d’auto-mise en scène (ou sont-ils soufflés par le cinéaste ?), laissant libre cours à la créativité (ou au malaise) du moment. On insiste sur des regards, des expressions, comme ce garçon timide n’osant pas fixer l’objectif – la multiplication de ces gros plans n’est d’ailleurs pas sans rappeler les Screen Tests d’Andy Warhol et la variété des réactions qu’ils révèlent. La caméra est parfois sensuelle, zoomant sur les détails des poses des personnes filmées : une bouche, une épaule sous une veste en cuir, un regard. À celleux qui regrettent le manque de représentation queer dans l’histoire du cinéma, on aurait envie de dire : tout est là, il suffit de savoir regarder.
En plus de ces moments de proximité, It Happened by Chance présente des moments mondains avec des fêtes ou des spectacles, et des instants plus quotidiens (on repeint un mur, on montre les objets de l’appartement). Au milieu de tout cela figurent des extraits des autres films de Jarman, comme si tout s’entre-prolongeait, comme si l’on nous faisait voir ce qui entoure les « vrais » courts métrages. Et voir comment une même caméra peut participer en même temps de la vie et du film.
Petite et grande forme
On dit très souvent d’un film de Jarman qu’il est « à part » par rapport au reste ; force est de constater qu’on pourrait dire cela de la plupart de ses films tant sa filmographie est pleine d’hapax. Ses films sont d’une radicale variété, de forme, de genre, de style. Jarman passe au long métrage en 1976 avec Sebastiane, reprise soft porn gay de la vie de saint Sébastien, entièrement tournée en latin – au passage, si l’on peut penser que Jarman laissera quelque peu de côté le court métrage, c’est oublier tous les clips qu’il réalise à côté, et dont la rétrospective proposait une sélection. En effet Jarman a collaboré avec de nombreux artistes et groupes de musique : Les Smiths, Easterhouse, Pet Shop Boys… On y suit l’évolution de son style « super 8 ». Les incrustations et les superpositions d’images s’y radicalisent, de même que les jeux de vitesse. Dans le court métrage qui associe The Queen Is Dead, Panic et There Is a Light That Never Goes Out des Smiths[11][11] Celui-ci est disponible sur YouTube., le rythme de la musique semble permettre à celui de l’image de s’accélérer. Tout court – les lieux, les êtres, les instruments de musique – et tout tourne, comme ce bâtiment filmé à l’endroit, à l’envers, sur le côté, et dont on ne sait pas s’il s’effondre ou s’il s’érige, comme si la musique finissait de libérer le film des contraintes du temps et de l’espace pour le rendre fondamentalement instable. Cette projection permettait d’ailleurs de souligner combien la musique est importante dans toute la filmographie de Jarman : il collabore quasi systématiquement avec des compositeurs de musique de film, Simon Fisher Turner et Brian Eno en premier lieu.

Sebastiane, premier long donc, amorce des thèmes et des motifs que Jarman explorera jusqu’au bout : le détournement du film historique en costumes, l’intégration de figures historiques à un panthéon homosexuel (saint Sébastien, Wittgenstein, Le Caravage, Edward II), quelque chose de l’ordre de l’excès qui flirte avec le kitsch. Mais en même temps, ce grotesque a déjà toujours une étrangeté et produit un vrai malaise ; en témoigne cette figure de Maximus, vulgaire et hypersexuel, à la fois ridicule et terrifiant. Chez Jarman, tout a un arrière-goût bizarre, queer. La scène d’ouverture donne le ton : des danseurs affublés d’immenses pénis dansent autour d’un homme au maquillage blanc et au string à strass rouge. Si ce premier long semble en écart avec ce qui l’a précédé et ce qui suivra, plusieurs séquences réactivent des moments de scènes-vision, par exemple la séquence de baignade des deux amants au ralenti dans une crique – le court métrage At Low Tide, projeté en avant-séance, où une figure masquée évolue en bord de mer, invitait à tisser de tels liens entre les super 8 et le reste.
On aurait d’ailleurs tort d’opposer courts et longs sur la question de l’expérimental, vue l’inventivité qui se déploie dans ces derniers. S’il a pratiqué le long métrage expérimental – The Angelic Conversation, The Last of England, Blue, The Garden – même ses films les plus narratifs expérimentent, notamment en ce qu’ils détournent le genre du film historique en costumes. Leur décor en est exemplaire : c’est cette page blanche des murs de Caravaggio, toile de fond pour les réinterprétations des peintures du Caravage, que l’on retrouvera dans Edward II, donnant l’impression que le film est tourné dans une carrière. Jarman pratique la boursouflure et l’hyperbole, oui, mais toujours au milieu de l’épure, comme pour la contredire – la richesse de la bande-son de Blue, film où l’écran reste bleu, en est l’exemple le plus abouti. Au passage, voir ce dernier en salle permettait de voir comment ce bleu lui-même, épure par sa nature monochrome, est traversé de fourmillements et de légers défauts, sortes d’apparitions subliminales et quasi-fantômes convoqués par le film.
La violence, l’abjection
Prospect Cottage : de loin, une femme s’avance et vient toucher une fleur au pied de la caméra. La scène se répète dans un « état de rush ». Ce film-installation de Pierre Creton, construit à partir de rushs non utilisés d’Un Prince (2023) et présenté en multi-écran dans le hall du cinéma, invitait à se placer sous le signe du déchet-rush au milieu du jardin. Le jardin, car Jarman y a fini sa vie, dans celui qu’il avait créé autour de Prospect Cottage, sa maison de pêcheur sur une lande à côté d’une centrale nucléaire. Il était venu s’y installer avant de se savoir séropositif et il s’y retrouvera doublement exposé, à la centrale et à la maladie, le sida, dont il mourra en 1993, après avoir milité publiquement pour les droits des personnes séropositives. Le déchet-rush, car Jarman a pratiqué la reprise, le déplacement, le recyclage des rushs ou des images de films précédents, et parce qu’il a toujours intégré le défaut à ses films.
La rétrospective proposait ainsi deux formes limites (car sont-elles des films ?) de quasi-captation: Will You Dance with Me? et ICA, semblent faits de rushs, d’images en partie détritiques. Le premier, incursion de Jarman dans le film de danse, filmé pour servir de repérage à un film de Ron Peck, est un étrange film : que peut-il bien repérer ? Tourné dans un bar gay, il documente moins les lieux que ses danseurs – comme ce moment où la caméra va et vient dans une sorte de valse avec l’homme aux cheveux blancs qu’elle filme. Les conversations y sont le plus souvent inaudibles, recouvertes par la musique, et souvent rien n’est reconnaissable ; Jarman s’amuse plutôt avec les effets de lumière créés par la boîte de nuit, filmée par une caméra tenue à bout de bras, une caméra dansée qui dessine des formes abstraites au rythme de la musique. Dans ICA, c’est l’étrange vernissage de l’exposition de peinture de Jarman à l’ICA que l’on filme, du moins en principe. On voit pourtant peu les peintures, mais une autre peintre, un modèle, un danseur, de nombreuses caméras, tandis que le grain brouille et fait fourmiller l’image. Une image trouble pour un événement troublant, plus performance que vernissage.
De ces rebuts d’images, le pas peut se faire rapidement vers une abjection plus sociale, vers un écart d’avec la norme : Gaveston marchant sous les crachats des lords dans Edward II, saint Sébastien tué par ses camarades dans Sebastiane, ou les scènes de lynchage de The Garden, celle, par exemple, où une personne court en talons hauts, tentant d’échapper à un groupe de femmes qui veut la dénuder et la frapper. Cette violence omniprésente est souvent lue comme une réponse, ou une conséquence, de la violence de la société thatchérienne envers ceux et celles qu’elle n’acceptait pas.


The Garden est exemplaire en ce sens, juxtaposant jusqu’au vertige des scènes de violence. Tourné dans et autour du jardin de Jarman et sorte d’évocation d’un jardin d’Éden des enfers, il noue une série de visions (une Vierge et son enfant sont harcelés par des paparazzi, une Cène, Jarman allongé sur un lit d’hôpital entouré de figures portant des flambeaux, un Christ marchant sur une lande où s’élèvent de grands poteaux électriques…) autour d’un fil « principal » où deux hommes qui s’aiment se marient puis sont arrêtés, humiliés, battus et finalement tués. The Garden mélange des scènes bibliques – le grand genre – avec une forme d’amateurisme ou de bricolage – comme lorsque la Madone Tilda Swinton apparaît sur fond vert derrière la Cène, une incrustation visible comme telle. Ces imperfections viennent bien sûr des conditions économiques de financement des films – Jarman est un cas exemplaire d’un cinéaste du petit budget – et de l’inventivité à l’intérieur de ces conditions, mais elles produisent un choc, un malaise. Le film est comme ouvert, blessé à plusieurs endroits, montrant ses plaies béantes – il débute au passage par une mise en abyme, montrant les lumières et laissant entendre les phrases qui accompagnent un début de tournage. Comme une Incrédulité de saint Thomas, le film, pourtant repoussant, force son spectateur à mettre les doigts et les yeux dans la violence.
Pendant les tables rondes du week-end d’ouverture, un constat est revenu plusieurs fois : on connaît mal Derek Jarman et, surtout, quand on commence à regarder, on n’aime pas toujours ce qu’on voit. Derek Jarman est à la fois trop sexuel et trop soft, trop militant mais pas assez radical, une forme à la fois trop boursouflée et trop pauvre. Jarman, cinéaste sans style, aurait « mal vieilli » et ferait des films « kitsch ». C’est que les éléments que nous avons soulignés – l’amateurisme, la violence, le grotesque – font de cette filmographie une œuvre qui fait violence, et c’est bien là sa qualité. Point de douceur ni de sécurité : Jarman déplace et dérange encore aujourd’hui.
Ainsi, s’il fait souvent figure de lieu commun de souligner l’actualité d’une œuvre et l’urgence de lui consacrer une rétrospective à un moment T, il était frappant de constater la résonance de Jarman avec les thèmes qui nous meuvent aujourd’hui. « Où en êtes-vous ? » demande habituellement le centre Pompidou aux cinéastes contemporains qu’il invite. Les films de Jarman semblaient nous retourner la question : où en sommes-nous ? Ses formes pauvres, écologiques, queer, et son jardin à la fois havre et lieu de combat – sa filmographie se clôt d’ailleurs sur une fleur-tombe : « I place a delphinium, Blue, upon your grave. » – se redécouvrent comme une œuvre de notre temps. Revenons à Jarman, donc, et laissons-le nous déranger.