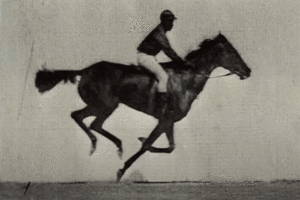Pocahontas numérique
Sur Avatar de James Cameron
Encore mal connu en France, Klaus Theweleit (prononcer « té-veu-laït’ ») bénéficie outre-Rhin si ce n’est d’une solide réputation, du moins d’une certaine notoriété, pour ne pas dire d’une renommée : celle d’un « théoricien de la culture » se revendiquant écrivain, aux idées et au style non-conventionnels, faisant fi des genres consacrés et des frontières disciplinaires. Männerphantasien, son maître ouvrage paru en deux volumes en 1977 et 1978, accède rapidement au statut de livre culte en Allemagne de l’Ouest, et connaîtra de nombreuses rééditions, la dernière datant de 2019 (augmentée d’une postface de plus de 70 pages…). Sur fond historique de révolution et contre-révolution allemandes entre 1918 et 1923, le livre étudie dans le détail, à travers plus de deux cents mémoires, romans, journaux, récits d’hommes ayant appartenu aux milices ultranationalistes des corps francs, un certain type d’homme, que Theweleit appelle l’« homme soldat », et que nous appelons plus communément « fasciste » – notamment son rapport plus qu’ambivalent à l’autre sexe, à la révolution socialiste et aux Juifs, le tout dans ce qu’il appelle lui-même une « psychanalyse de la terreur blanche », renouvelant l’étude sur le fascisme dans une optique qui ne porte pas encore le nom d’« études de genre » et initiant ce qu’on ne tardera pas à appeler la Täterforschung (qu’on pourrait hâtivement traduire par « études sur les bourreaux »). En France, la traduction du livre paraît en 2016 sous le titre Fantasmâlgories. Avant cela, le livre sera traduit dans de nombreuses langues, dont l’anglais, dans les années 1980-1990 aux États-Unis, où l’ouvrage connaît(ra) un certain succès, pavant sa voie triomphale de ce côté-ci du Rhin en 2008 par le truchement de Jonathan Littell qui, dans Le Sec et l’humide, s’inspire très largement des thèses theweleitiennes (cf. le personnage de Maximilien Aue dans Les Bienveillantes). Par la suite, Theweleit creusera la question, ébauchée dans Fantasmâlgories, du « sacrifice des femmes » dans les sociétés patriarcales. D’abord dans son cycle (toujours en cours) Buch der Könige (« le livre des rois »), qui étudie la production artistique sous le rapport de l’artiste à ce qu’il appelle la « femme médiale » ; tâche qu’il poursuivra dans la tétralogie POCAHONTAS, entamée en 1999 par les tomes I & IV (PO & TAS), poursuivie en 2013 par le tome II (CA), et parachevée en 2020 par le tome III (HON) ; tétralogie qui étend la question du « sacrifice des femmes » à l’histoire de la colonisation, de la Grèce antique à l’Amérique moderne, de Médée à Pocahontas.
Et c’est justement de Pocahontas dont il sera question dans le passage ici traduit : Theweleit décèle dans Avatar de James Cameron, sorti en salles quelques années plus tôt, ce qu’il nomme le « complexe de Pocahontas » : cette tendance à sublimer la colonisation en nouant son récit au mythe du sauvetage du colonisateur par la princesse autochtone. Ici, dans Avatar, la version dernier cri de Pocahontas, riche en twists et retournements, où la colonisation est ailleurs… Le passage se situe plus précisément à la fin du tome II, CA (2013), qui cherche à replacer l’histoire de Pocahontas dans la longue série des filles de roi (légendaires ou attestées) de la « mythologie grecque ». Là, une trentaine de filles de rois des régions pré-hellénistiques donneront naissance, après avoir été olympiennement violées, à tous les héros demi-dieux de la Grèce primitive, de Thésée à Persée, Héraclès, etc. Les pères de ces filles de roi perdent en général leur terre et leur vie, tandis que la progéniture demi-divine de leur fille donne le cadre héroïque de la culture grecque des premiers temps. L’accaparement des terres par les immigrants se fait par le biais des corps de ces filles de roi, dont le destin est de devoir s’unir au « colonisateur » ; de Médée, en passant par Europe, Léda et Alcmène, puis, plus tard et sur d’autres rivages, à Malinche et Pocahontas.
Pour comprendre les allusions à Pocahontas & Smith, il n’est pas inutile de faire un bref détour par le tome I, PO (dont la traduction française devrait sortir fin 2023 chez L’Arche éditeur) : Theweleit s’y propose de reconstituer la Pocahontas historique en archétype du colonialisme et de la violence patriarcale : de son fameux (et prétendu) sauvetage du capitaine John Smith, en passant par son enlèvement par les Anglais, son baptême sous le nom chrétien de Rebecca, son mariage avec le planteur de tabac John Rolfe (union dont sera issu leur fils métis, Thomas Rolfe), jusqu’à sa mort à Gravesend, au bord de la Tamise, au début du voyage qui devait la ramener en Amérique. Entre son geste secourable et sa mort, il y aura eu son aide aux Blancs et la culture du premier tabac nord-américain au goût des Anglais ; son histoire comme « mère originelle de tous les Américains », telle que les arts américains l’ont conçue au cours des siècles suivants, ainsi que l’histoire en images de l’« indianité » de 1600 à nos jours, révèlent le recyclage des vaincus dans le système de domination des vainqueurs.
Disclaimer : l’écriture de Theweleit (sa traduction en l’occurrence) peut être déroutante. Écriture teintée d’une certaine oralité et d’une érudition à la désinvolture toute post-moderne : associations tous azimuts ; références en cascades, se croisant souvent, fusionnant parfois ; déhiérarchisation des niveaux de culture mêlant littérature, musique, cinéma en un style foisonnant et choral, faisant dialoguer Ovide & James Cameron, ou encore Shakespeare et Bob Dylan, en des Giant Steps enjambant allègrement temps et espace.
Christophe Lucchese
Traduction de Christophe Lucchese, avec l’aimable autorisation de L’Arche éditeur et agence théâtrale.
Edition originale: Klaus Theweleit, Buch der Königstöchter- von Göttermännern und Menschenfrauen. Mythenbildung vorhomerisch, amerikanisch, © 2013, 2020 MSB Matthes & Seitz Verlagsgesellschraft mbH, Berlin.
Tous droits réservés sur la version française.
Il n’aura pas fallu attendre 2017[11][11] Le livre paraît initialement en 2013 en Allemagne (N.d.T.)., les 400 ans de la mort de Pocahontas, si l’on voulait savoir ce qu’imaginerait le « monde occidental » pour l’occasion. La réponse est arrivée bien plus tôt, bien plus précisément et avec plus de force que n’auraient pu le rêver les prévisions basées sur le principe de plausibilité. Elle nous est venue par le cinéma. AVATAR est le nom du film par lequel le nouveau Jamestown s’est déversé en écrasant tout sur son passage dans les rétines du monde occidental dès la fin de l’année 2009 : J.S. sont les initiales de son personnage principal, Jake Sully (alias John Smith), dans ce film-Pocahontas réalisé par le ciné-colonisateur en quête perpétuelle de nouveaux continents James Cameron, conquistador professionnel sis à Hollywood, CA.
AVATAR – comme les masques informatiques ; fait par un réalisateur qui, se languissant d’un cinéma disparu, a voulu refaire un vrai film d’Indiens et s’est aperçu que ce n’était pas possible. Plus du moins avec des Indiens en costume, avec des prairies, avec des chevaux sans selle, avec des acteurs emplumés, avec des Indiens en train de charger qui se font descendre en série comme des pigeons par des Blancs ; good gracious, qui pourrait bien vouloir voir ça ; personne, si ce n’est une poignée d’avocats amérindiens. James Cameron voulait quand même faire un film d’Indiens, l’ultime, le dernier, le premier ; un film avec Pocahontas & John Smith et aussi avec une vraie mad affair ; or pas possible justement avec les bons vieux Redskins et leurs Wounded Knees blessés.
Mais peut-être bien possible après tout, à condition que le continent nouvellement découvert se trouve sur une autre planète ; à des années-lumière au fin fond de galaxies inexplorées ; ce n’est possible que dans un film de science-fiction ; et il ne faut pas que les Indians soient de simples Indiens, des humains en costumes ; non, mais des êtres vraiment étrangers, d’une beauté extraterrestre. Aujourd’hui, de tels êtres – personne ne le sait mieux que les modeleurs d’images humaines de Hollywood – ne peuvent être que des êtres créés électroniquement. Des êtres étrangers tout droit sortis d’ordinateurs.
Mais pas le genre d’aliens qui, à force de fouir dans nos entrailles d’Alien I à IV (avec une contribution de Cameron pour l’opus II) ont fini par nous en immuniser ; non, il doit s’agir d’une autre espèce, de créatures anthropomorphes inconnues ; des humains-chats générés par ordinateur souples comme des dieux, à la peau bleue, un peu zébrée, aux oreilles pointues dressées et aux magnifiques yeux vert jaune ; armés d’arcs et de flèches non moins magnifiques. Et la plus belle d’entre tou.te.s, Neytiri – Cameron nous laisse longuement la regarder seule arpenter nuitamment ses terres enchanteresses – ne s’appelle pas Pocahontas, elle est Pocahontas.
Elle apparaît à l’image, elle entre en scène pour tuer l’un des envahisseurs, J.S., Jake Sully ; mais une chose étrangement flottante choit lentement – dans une 3D enchanteresse – sur l’arc qu’elle tend, sorte de filandre magnifiée ; la marque de la Grande Déesse de la tribu des Peaux-Bleues sur cette planète sauvage (comme nous l’apprenons), la faisant renoncer à l’acte meurtrier ; et déjà, la seconde d’après, elle devient la sauveteuse de J.S. : des créatures monstrueuses, insoupçonnées, sorties des sous-bois nocturnes de la planète merveilleuse, attaquent le Blanc sans défense et l’auraient inévitablement tué si elle n’avait pas été là et tenu sa main protectrice sur lui. Les monstres sauvages de la forêt lui obéissent au doigt et à l’œil, lui mangent dans la main, ils se retirent dans l’obscurité nuiteuse et J.S., Jake Sully, regarde avec étonnement et reconnaissance dans les yeux de cet créature filiforme, qui a tout l’air d’être féminine (une sorte de bikini en seconde peau cache ses seins sous-dimensionnés) ; des yeux enchanteurs, non, ensorceleurs, vert jaune, fendus en amande comme ceux de la Médée asiatique, se posent sur lui non sans malice.
Pourquoi fait-elle ça ? Pourquoi l’aide-t-elle ? D’abord pour se payer sa poire. « Mais stupide, ignorant comme un enfant », lui réplique-t-elle. Mais là n’est pas la raison de son acte. C’est sa déesse qui le lui a signifié. Et elle s’y tient. Ces Neo-sci-fi-Indians sont, comme nous n’allons pas tarder à l’apprendre, très religieux ; ce sont des créatures de la nature au sens d’éco-êtres ; leur déesse vit dans un arbre sacré, ou plutôt elle est cet arbre sacré ; ces Na’vis – c’est comme ça qu’ils s’appellent (homophone de Navy et diminutif inversé de Natives) – ne font rien qui puisse aller à l’encontre des enseignements de cette Grande Déesse/de la nature. Nous sommes au beau milieu d’un éco-paradis (généré par ordinateur).
Pourquoi peut-elle, la Poca-chat bleue, lui parler, à J.S., le US boy blanc, l’ex-marine, le type de la Navy ? Parce qu’elle – ces colonisateurs américains sont sur la planète des Na’vis depuis un petit moment – n’en est pas à son premier contact avec eux ; tous négatifs ; elle parle leur langue par bribes. Deuxièmement, parce que celui à qui elle sauve la vie nuitamment dans la jungle ne lui apparaît pas comme le Jake Sully qu’il est en réalité : à savoir un soldat américain paralysé des jambes, un homme en fauteuil roulant, qui doit effectuer une mission spéciale pour les forces de sécurité de la base américaine sur cette planète. C’est justement pour ça qu’il a reçu le corps d’un des indigènes ; les Américains blancs hautement technicisés peuvent fabriquer artificiellement ce genre de choses dans leur base sur la planète alien. Ce n’est que dans ce corps artificiel « indien » que Jake Sully est également maître de ses jambes, qu’il est un humain-chat bleu comme sa sauveteuse indienne[22][22] Page 618 : Les spécialistes en science-fiction ont remarqué que la construction de Cameron avec Jake Sully en handicapé semble s’inspirer d’une histoire de 1957 de Poul Anderson, Call Me Joe. Un scientifique en fauteuil roulant y contrôle à distance un corps artificiel qui doit explorer la surface de Jupiter. Ce n’est certainement pas le seul recoupement du film de Cameron avec des histoires de science-fiction du même acabit ; ce genre de motifs sont free-floating et disponibles à la demande. Mais cela n’a rien à voir avec la facture d’Avatar. Le twist de l’histoire est aussi différent. Le gars handicapé dans Avatar est un soldat estropié de l’armée d’occupation américaine sur la planète étrangère “Pandora”, qui ne peut plus remplir sa mission auprès des Na’vis locaux. Mais sous son masque informatique d’autochtone, d’avatar, il le peut. Il s’agit d’un seul et même personnage, dans des circonstances techniques différentes ; qui passe ensuite dans le camp des Indians. C’est le renversement décisif au niveau de l’histoire : Jake Sully/John Smith devient un Indien ; et Pocahontas/Neytiri reste en vie en qualité de Loving Indian Girl et d’archère aguerrie.. On appelle ce genre de natifs fabriqués par les envahisseurs américains des avatars ; ils donnent leur titre au film. L’Indienne sait tout ça. Ce n’est pas le premier Américain sous cette forme qui atterrit dans leur jungle (où poussent, outre des animaux hyper-exotiques jamais vus, de merveilleuses plantes inconnues) ; les Na’vis indigènes reconnaissent ces fake corps ; et elle, Poca, l’aurait tué sur-le-champ s’il n’y avait pas eu l’intervention de la Grande Déesse Eywa ; c’est cette délicate particule blanche en suspension dans l’air de la nuit qui arrête sa main bandant l’arc. Pocahontas doit aimer J.S. ; Cameron remplit cette mission mytho-historique au millimètre près.
Qu’est-ce qu’il vient faire là ? Que viennent faire là les Américains, blancs et noirs, reconnaissables dans le film sans doute possible en US-Américains modernes exerçant une occupation militaire ; hautement technicisés, armes dernier cri, le nec plus ultra des systèmes informatiques. « We can » (et même tout) – tel est leur habitus. C’est aussi l’habitus du film. La moindre scène est technologiquement fagotée et va jusqu’aux limites des frontières du faisable. Nous savons faire. Tout ce que nous voulons. Chaque image comme nous la voulons. Et la moindre planète alien telle que nous la voulons. D’un claquement de doigt, notre puissance de feu peut rayer de la surface de « Pandora » en l’espace de quelques heures ces Peaux-Bleues de Na’vi, pas plus nombreux que les tribus powhatans de Wahunsenaca en 1607.
Ainsi en irait-il si les militaires avaient seuls la voix au chapitre dans cet avant-poste américain situé en territoire étranger aux confins de l’immensité sidérale. S’il n’y avait pas de département scientifique. Il mène des recherches sur les populations extraterrestres. Et a déjà bien avancé (vers la fin du film, quelqu’un tient un livre devant la caméra sur lequel on peut lire THE NA’VI en gros). Les scientifiques, mélange de généticiens, de biologistes moléculaires, d’électroniciens et d’ethnologues, veulent préserver la population étrangère. À la tête de l’équipe de recherche, une professeure : la femme-galion de James Cameron, Sigourney Weaver ; poids lourd de tous les films Alien. Par quoi il est clairement entendu qu’elle a son mot à dire dans la hiérarchie de l’occupation américaine sur la lointaine planète Pandora.
Sans son contrepoids, le chef de la sécurité militaire aurait déjà anéanti les Natives. La raison pour laquelle les militaires et le haut commandement politique de la base spatiale coloniale veulent combattre les Na’vis n’est pas un secret : ils sont assis sur la ressource la plus rare et la plus précieuse de toutes les galaxies connues, appelée Unobtanium (= l’inaccessible ; nom courant pour ce genre de ressources dans la littérature SF). C’est précisément sous leur village, près de l’arbre sacré de leur Grande Déesse que se trouvent les plus grands gisements. Il faut donc qu’ils dégagent. Et la question est de savoir comment. À coups de bombes, préconisent les militaires. Non, nous pouvons les convaincre de s’en aller, rétorquent les scientifiques. Et telle est la mission de J.S., Jake Sully, métamorphosé en Na’vi. Il doit aller à leur rencontre, gagner la confiance des Natives et les convaincre de quitter d’eux-mêmes leur village central ; faute de quoi ils risquent tous de mourir. Une guerre américaine d’un genre moderne pour les matières premières donc, sous-tendue par des intérêts opposés dans le camp des Américains. Voilà pour la constellation de base.
Mais ça grouille d’inversions de la constellation historique Pocahontas/Smith telle que nous la connaissons ; allusions, citations et inversions de motifs littéraires-filmiques. La plus marquée d’entre toutes : au lieu du « changement de camp » de l’Indienne plus baptême, il y a chez Cameron le changement de camp de Jake Sully/John Smith (plus « baptême » = initiation aux coutumes des Na’vis). Ce n’est pas l’Indienne, mais J.S., le Blanc, qui est le transfuge dans le conte anticolonial de Cameron. Une fois passés les rites initiatiques, il devient un Indien patenté. Contre l’ouverte méchanceté de ses compatriotes il prend la tête des indigènes pour combattre les envahisseurs américains. Dans Avatar, ce sont les Américains les aliens ; usurpateurs qui occupent des pays pacifiques et détruisent leurs cultures par convoitise de leurs ressources. À la fin du film, alors que les Américains, vaincus, battent en retraite, on les qualifie directement d’aliens ; politically correct en sens inverse. Cameron ne rejoue donc pas encore (et autrement) le thème des aliens juste avec le personnage de Sigourney Weaver ; Sigourney Weaver, porteuse de l’alien-monstre dans les premiers films, devient une personne saine, raisonnable et normale, qui s’écarte positivement des méchants congénères et pactise avec les autochtones, les Indians non-méchants, à l’instar de J.S. (Jake Sully/John Smith).
Par ailleurs les Na’vis sont les véritables religieux du film ; tandis que les G. I. n’ont que railleries et moqueries pour la magie de la Grande Déesse. « Kocoum » aussi est de la partie, le fils du chef de la « tribu », promis à la fille du roi comme époux ; mais assistant d’abord impuissant à la manière dont sa promise tombe amoureuse de l’étranger sous forme indienne, de J.S., Jake Sully, le rival peau-bleue, et se lie formellement à lui au cours d’une nuit magique enchanteresse, autrement dit avec l’approbation de la Grande Déesse Eywa. Mais Sully se réconciliera avec Kocoum ; ils lutteront côte à côte contre les Americans technologiques (« Kocoum & Jake Sully/Kevin Costner, – qui dansent avec les loups contre les usurpateurs blancs »).
Cameron et son équipe auront pris plaisir au jeu des inversions et des citations, le pain quotidien des réalisateurs, acteurs, scénaristes et costumiers. La tournure que prend l’histoire à la fin du film montre à quel point Cameron suit avec Avatar la ligne dramatique d’un western indien : mettant en scène une pure épreuve de force entre le bien et le mal, entre J.S. l’Indien, nu, et le commandant en chef américain, à l’abri d’un blindage dans un robot de combat. Comme on pouvait s’y attendre, comme on pouvait le prévoir et comme d’habitude, la chance pugilistique penche du côté du mal ; J.S. le Peau-Bleue est vaincu ou pas loin de l’être, quand revoilà Pocahontas volant à la rescousse qui décoche deux flèches emplumées dans le poitrail momentanément à découvert du Yankee de général ; et l’une d’elles en plein dans son vilain cœur de conquistador.
Dans ses passages purement féeriques où J.S. apprend « la culture » des Na’vis de sa maîtresse « Pocahontas », en parallèle de quoi les deux corps tombent amoureux aussi nécessairement qu’irrésistiblement, le film montre des choses jusqu’alors jamais vues ; des moments d’une beauté renversante dans une 3D fantastique. Parmi les animaux, il y a des dinoiseaux qui volent dans un monde primitif, hyperélégants et peints comme par Niki de Saint Phalle, sur lesquels les Indians de cette étrange planète voguent/volent dans les airs en virevoltant : pur plaisir de s’abandonner à la contemplation de leurs vols ; moments où l’on oublie presque la puissance technologique sur laquelle s’assoit le film Avatar pour nous mettre sous les yeux ces moments d’une nature/planète première pré-civilisationnelle à l’état d’une corporéité divine-animale vierge et apparemment inviolable. Toutes les invraisemblances de belles séquences de mouvements, dont on pensait (dont en tout cas je pensais) que les films d’animation, au mieux, extrêmement bien dessinés, parviendraient à créer l’apesanteur nécessaire pour inviter l’œil voyant et la psyché flottante à faire abstraction de toute vraisemblance physique, sont ici technologiquement produites et réussies. La technologie informatique d’Avatar dépasse aisément – et « aisément » est décisif – toute possibilité de jeu d’acteur et même les possibilités presque illimitées de l’animation graphique de la construction des personnages et des mouvements. On en viendrait presque à dire que même les images de rêve n’arrivent pas à suivre. C’est là que se trouvent les plus belles créatures vivantes. Transporté, Georg Seeßlen : « Quand on a vu Avatar, on a vu tout ce que le cinéma populaire est actuellement en capacité et en volonté de faire. »
Avatar nous présente cependant ses spectacles technologiques-électroniques, le sommet des images calculées à ce jour au cinéma, l’art informatique le plus technologiquement brillant – et c’est là que commencent les objections – sous l’apparence de divers actes ésotériques. Des actes ésotériques qui visent très ouvertement à faire sortir de leurs grottes tous les croyants de la terre « qui croient » (encore) en quelque chose quelque part pour les attirer dans les salles de cinéma ; (objectif fixé : audience record, qui n’a pas tardée). L’humanité-monde est attirée dans le cadre d’un récit où la technique est le mal, alors que l’animal-humain naïf-primitif-religieux est le bien ; le bien qui triomphe de tout le matériel de guerre hautement technologique – à coups d’arcs et de flèches.
Est-ce possible – me demandé-je au bout d’un moment – est-ce possible de vendre aux gens d’aujourd’hui, aux cinéphiles racornis des quatre coins de la planète, un tel miracle d’arc et de flèches en ce début d’année 2010 ? À croire que oui. Nous voyons avec étonnement les Peaux-Bleues s’élancer du haut de leurs falaises suspendues sur leurs ptérosaures (la neuvième merveille du monde d’influence magrittienne) et précipiter dans le vide une tripotée d’hélicoptères de combat américains finissant leur course telles d’énormes boules de feu. Nous voyons une phalange de rhinocéros géants dotés d’une sorte de poutre transversale, un bélier large de plusieurs mètres sur le museau, clairement pompé des requins-marteaux, foncer avec panache dans les robots de combat américains. Les nouveaux chevaliers américains, apparemment invulnérables, vêtus de fer et équipés d’armes à feu, sont balayés par la force primitive de sur-animaux préhistoriques, joliment organisés en bataillons de combat sous l’effet des forces de la Grande Déesse Eywa ; la onzième, la douzième et la treizième merveille du monde ne se font pas attendre. Autant de monstruosités (primitives), incrustées dans la dramaturgie de films d’Indiens. En voilà un qui galope devant nos fusils ; le monde primitif triomphe, les natifs triomphent, la religion primitive triomphe ; les Indiens chevauchant des oiseaux triomphent… Mort aux colonialistes ! (« Les Américains hors du Vietnam ! »… de l’Iran !… de l’Afghanistan !) ; et par-dessus tout, une autre charge gigantesque d’ésotérisme, d’images & de sons : un échange magique de corps, une résurrection magique, la résurrection du noble sauvage de Jake Sully/John Smith – – –
– – – sauf que pas une seule des images magiques de cette orgie-anti-technologie ne serait réalisable sans la technologie informatique la plus sophistiquée du monde ; sans le dernier cri en matière de traitement (de retouche) d’image électronique, sorti des studios de James Cameron, le techno-freak, à L.A. Si ça c’est pas pervers – je veux dire vraiment tordu – alors je ne sais pas ce que ce mot veut dire. Ce qui ne serait pas grave. Les « perversions » sont le moteur de nombreux arts ; ils ont toujours de la place pour toutes sortes de tours et de vertiges. Les arts qui ne tournent pas ou ne tordent pas la sensation du corps manquent du plus important, manquent de la force de la transgression. Ici, on vit (« moi », je vis ; comment et avec quelle partie du corps ?) quelque chose comme un renversement du processus de transgression en son contraire. Le corps répond par des sentiments de dégoût. Jamais un film ne m’a autant tiraillé les entrailles, ne m’a « retourné l’estomac ». Le corps se rebelle contre cette tentative de tout gober ; bien qu’enthousiasmé par certaines scènes, leur technologie miraculeuse, je me débats, incrédulement soulevé dans la perception que ça ne peut pas être vrai : célébrer le monde primitif naïf des Indiens galactiques et leur idéologie « anticolonialiste » en utilisant exclusivement la technologie la plus technologiquement avancée, donc aussi potentiellement la plus belliqueuse, la plus impérialiste qui existe sur terre – et à laquelle le film s’adonne dans son mode de fabrication. Au niveau de l’histoire, c’est le monde primitif qui l’emporte ; « John Smith » change de front et l’emporte à la tête des guerriers écolo-ésotériques chevauchant des dinoiseaux bariolés contre les envahisseurs modernes surarmés. Là où la même technologie, avec laquelle le film génère ses images-en-survol, mène dans les réalités hors du cinéma, à l’intérieur de tous les engins de guerre américains, chaque seconde dans le monde ses guerres pour les matières premières ou menace des parties de la Terre de telles guerres.
On peut et on doit naturellement argumenter – et le film joue aussi là-dessus – que l’affrontement n’a pas lieu qu’entre des « Indiens » et la « haute technologie militaire », mais aussi entre deux technologies différentes : l’industrie lourde (= ancienne ; guerrière ; colonialiste) contre technologie informatique (nouvelle ; pacifique ; écologique). En clair : Apple serait un Indien écologique venu de l’espace. De même que l’iPod dans les mains des jeunes d’aujourd’hui est naturellement un pirate, un médiatechnologique non guerrier. Il y aurait de quoi s’amuser au cinéma avec une telle fusion esthétique entre écologie, peuple primitif, espace et technologie électronique : si seulement elle flottait sur les ailes d’une ironie artistico-ludique. Mais dans Avatar de Cameron, elle se présente comme une charge complète de sérieux à l’état pur. À en couper le souffle. Et faire exploser la pensée. Une fois qu’on l’a retrouvée, plus tard, on s’entend répondre, contraint aussi à un « discours sérieux » (pour remettre l’estomac dans une position supportable) : en dehors du cinéma, chers amis, domine une toute autre fusion ; à savoir la coopération de ces éléments que le film met en concurrence.
Dans les drones américains, bombes volantes sans pilote qui trouvent leurs cibles humaines en Afghanistan et ailleurs (« War On Terror »), l’industrie aéronautique électronique la plus moderne et l’ancienne industrie métallurgique sont parfaitement réunies. Aucune de ces machines à tuer ne vole sans la technologie à laquelle les images de contes de fées d’Avatar doivent leur existence, l’électronique dans une enveloppe métallique. Arrivées au « but », elles explosent, mortelles et rien moins que ludiques. Dans Avatar, cette technologie vole pour permettre le mariage de la fille du roi écologique de la “planète lointaine” avec le soldat américain (= colonisateur) Jake Sully/John Smith, converti en homme de la nature. Leur union magique sous la pluie de fleurs de la Grande Mère Eywa (après la victoire de l’arc et des flèches sur la technologie des drones américains) scelle la nouvelle pureté d’un monde sauvé (la Terre + les galaxies restantes) ; avec en prime le flot continu des chants religieux, électro-grégoriens, se déversant des haut-parleurs de la salle de cinéma.
It’s so hard to go on! Submergé par la charge de perversions absurdes en 3D, le corps finit dans les cordes (du fauteuil de cinéma) et jette l’éponge… “Le plus grand succès cinématographique de tous les temps”… des pharaons à Obama… on dirait que le nouveau spectateur, l’homme nouveau de Cameron, est comme un enfant qui, le cœur et le cerveau et les quatre fers ligotés à son jeu vidéo, s’exclame : « Mort à tous les ordinateurs… Vive la nature… J’aime l’Indienne… l’intergalactique aux yeux en amande… et son Dieu le Grand Arbre »… sur quoi il masturbe le joystick… et consulte les offres spéciales pour updater sa Playstation… déjà proche de la rédemption… tous les dieux deviennent frères… tou.te.s les Dieux/Déesses… tous les banquiers aussi… et tous les guerriers… & toutes les filles deviennent sœurs… ah, Grande Mère Ey-war, descendant doucement du ciel tel un été indien-galactique… conçue par ordinateur… bientôt en 4D.
* * *
La preuve que Cameron n’a pas fait preuve d’ironie ou mis en scène d’une quelconque autre manière ambiguë, sur l’une des voies habituelles de la comédie, on la trouve dans ses interviews : « J’aimerais faire voyager les spectateurs dans au “pays des enfants”, c’est-à-dire leur redonner leur émerveillement enfantin. Cette planète inventée, “Pandora”, peut nous redonner à tous un nouveau respect pour la nature sur Terre. Car ce n’est pas la technique, ni la 3D, ni les effets spéciaux qui sont importants ici, mais l’histoire. Cela inclut par exemple aussi le message écologique du film. C’était important pour moi. » Un tel “message” écolo dans la bouche d’un homme qui aime se qualifier de « techno-freak » (et le démontre brillamment avec Avatar), vous retourne une fois de plus l’estomac. Personne ne peut être aussi “naïf”, et surtout pas dans cette branche ; pour un film qui se vante d’avoir englouti les plus hauts coûts de production de tous les temps (et un budget publicitaire presque aussi important). Cameron : « Je suis un peu nerveux en ce qui concerne la campagne marketing du film : nous n’atteignons pas le segment féminin du public comme nous le devrions. Nous qui connaissons le film, nous savons que c’est un film émotionnel, un film qui marche bien auprès des femmes qui se trouvent dans la salle – des choses comme ça me donnent du souci. »
… le souci est certainement (plus que) sincère.
Ce que fait donc factuellement Cameron, c’est mettre toute l’électronique de guerre moderne d’Avatar dans les habits de Greenpeace. « Message » : le méchant Américain d’aujourd’hui, accapareur de matières premières, disparaîtra de la surface de la Terre quand les opprimés et les sous-développés de tous les pays auront évolué vers l’Indien primitif, dans l’âme duquel bip-bipent toutefois les ordinateurs dernier cri ; une forme queer-sophistiquée de “transhumanisme”. Des ordinateurs qui croient naturellement en Dieu, qui ne causent pas de dégâts à l’environnement ni d’autres dommages d’ailleurs : des ordinateurs fondamentalistes-pacifistes. Le potentiel meurtrier des technologies les plus modernes se présente à nous sous la forme de fervents humanoïdes de la nature peau-bleues venus de l’espace réclamant la paix pour leur planète. Cameron aspire effectivement – par le truchement du corps de la fille du roi Pandora aux yeux de chat – à une sorte de surveillance électro-écologique planétaire (comme le super-vilain aspire à la domination planétaire dans les comics de super-héros).
Dans la terminologie d’une ancienne psychologie – la psychanalyse d’Anna Freud –, on appelle identification à l’agresseur ce à quoi Avatar incite le public. Le potentiel d’agression de l’ensemble des nouvelles technologies est caché dans l’homme naturel nouveau, rendu méconnaissable sous les traits de l’Indien galactique et descendu en nous sous la forme de ces méduses flottantes qui, dans le procédé 3D de Cameron, naviguent dans l’espace du spectateur et flottent en nous comme des virus venus d’un monde magique de l’au-delà ; rien de moins qu’un lavage de cerveau. Leur fonctionnement suggère que l’humanité qui va au ciné, partout sur la planète, est prête à se faire remplacer par des êtres technologiques à la condition que ceux-ci – que l’« homme nouveau » tant désiré – n’apparaissent plus dans l’utopie (historiquement négativisée) du robot, de l’être machinique métallique, mais comme une nouvelle nature venue de l’espace : dans Avatar, en « Indien » animal-humain, en humain galactique primitif (généré par ordinateur). Le film doit entièrement sa forme au délire technologique qu’Avatar combat au niveau de l’histoire. C’est peut-être là le secret de son succès mondial. Nous, l’humanité technomondiale moderne, sommes prêts à accepter la mort et le diable (en 3D) pour peu qu’ils viennent à nous sous la forme d’anges électroniques de paix de l’âge de pierre.
Pour générer de telles images cinématographiques, les nouvelles technologies doivent naturellement changer de lieu de résidence principale ; elles doivent quitter les corps des missiles et des chars, les engins de guerre lanceurs de bombes et les fusils automatiques dans lesquels elles sont (pour la plupart) chez elles ; et upgrader les ordinateurs des studios pour nous enchanter à la féerie d’images cinématographiques jamais vues. L’« homme nouveau » que vise Cameron n’aura plus alors besoin, à en croire le message pan-œcuménique du film, de la guerre.
Mais avant : « C’est la lutte finale ! » ; cet appel se répète nonobstant (au cinéma) automatiquement. Dans Avatar, c’est la lutte finale avec tous les moyens, y compris ceux du vieux film d’Indiens : une demi-heure de fracas du combat enragé avec des Néo-Indiens sur des chevaux primitifs qui démolissent du robot d’acier, sur fond assourdissant de bombardement symphonique mêlant attaque de western, fanfare de guerre hollywoodienne et bouillie ésotérique d’orgue qui martyrise encore les conduits auditifs des jours après. L’attaque technologique, déguisée en déesse de la paix, se présente en grande puissance synesthésique. L’âme entièrement calculée du spectateur de cinéma, « notre âme » convertie, doit avaler ces images et cette bande-son comme le Nouveau Réel libérateur. C’est précisément pour de telles opérations que les dieux informatiques hollywoodiens utilisent la Nouvelle Religiosité, en vogue de par le monde, comme le démontre Avatar de manière impressionnante. The Return of the Vanishing American (Le Retour du Peau-Rouge en bon français), que Leslie Fiedler a décrit sous les traits de l’avènement historique “du hippie”, se voit ainsi technologiquement achevé. Le hippie psychotropisé et son ésotérisme bouddhiste se sont évanouis, sur toute la planète, dans l’« ordinateur » indien – qui hurle, à en donner le vertige, avec des extraterrestres primitifs, faisant preuve de la plus grande foi avec ça. (Peu importe foi “en quoi”. Disons à la foi diabolique.)
C’est ainsi que l’“ordinateur indien” triomphe dans ses cavernes magiques spéciales, qu’on appelait autrefois cinémas, qui n’en sont néanmoins plus. Du moins, ce qui y est montré n’est plus un film. Avatar est fait de et en bits de silicium. Ses caméras sont des ordinateurs. La profondeur de champ n’est pas un produit de la lentille, ni une affaire d’œil. Elle est calculée et sous-pesée pour nous conduire dans un espace qui n’est pas un espace. La 3D avale paradoxalement l’espace cinématographique : avec Avatar, le cinéma se transforme en un théâtre de marionnettes animé par ordinateur. La 3D restaure la scène à l’italienne, ou Guckkastenbühne en allemand, littéralement « scène de la boîte à zieuter » ; nous regardons dans un diorama de musée high-tech. Un « aquarium en eaux profondes », dit ma femme pendant le film à propos de la faune grouillante en 3D (sans savoir que Cameron travaille depuis longtemps sous l’eau). À ce propos, Cameron a fait remarquer que dans les profondeurs de l’océan, il est très facile de se sentir sur une autre planète[33][33] Les aquariums en eaux profondes – tout le monde les apprécie, partout dans le monde. Et a accès à cette « autre planète », tous les jours – à portée de doigts sur son PC..
Outre les eaux profondes, l’espace dans Avatar est un espace informatique sur moniteurs. Dans le cinéma 3D de Cameron, l’écran, qu’on nomme encore Leinwand en allemand (« toile »), n’est rien d’autre qu’un moniteur. Le vaisseau spatial-cinéma tout entier se trouve transformé en un ordinateur géant à l’intérieur duquel nous sommes bombardés de charges électroniques qui nous changent en composantes de ses entrailles ; nous électronisent physiquement. Soit exactement ce pour quoi ce terme a été inventé dans le jargon d’Internet : Avatar signifie double électronique, c’est le masque d’une figure humaine qui, dans l’avatar, doit enfin cesser d’être une figure en tant que telle. Alors seulement la paix régnera. C’est précisément cette créature qui ouvre les yeux dans la dernière image de la Genèse intergalactique de Cameron. Et nous regarde, yeux bleus, yeux de chat, en silence. Se réveillant à l’ère de la post-humanité. Le dernier homme, le monstre, l’alien, a fait long feu.
* * *
Qui aurait cru – je n’aurais pas cru – que Pocahontas & John Smith nous apparaîtraient encore une fois dans le plus-cinéma électronique en tant que couple indien de Peaux-Bleues – car Jake Sully renaît en Indien dans la dernière scène du film – ; un couple qui, en l’an 2010, avec la pétulance de la jeunesse, boute belliqueusement les colonialistes américains high-tech et leur technologie supérieure en matière d’aviation & d’armement hors de la Virginie natale de Pocahontas – appelée ici Pandora – ; et ce, en réinstallant acoustiquement toutes les natives religions que la planète Terre ait jamais entendues chanter.
Cameron and his computers had some very mad affaires
HE GIVES US FEVER …?? … Fever when she kisses? … fever when she holds us tight… (et plus tight que jamais en 3D). Un frisson fiévreux dans un tour de force informatique qui nous raconte que la technologie guerrière américaine peut être vaincue par les peuples primitifs de l’espace, archers nonpareils de l’âge de pierre ; que cette technologie guerrière serait potentiellement écologique si seulement elle était utilisée correctement ; et que l’électronique la plus moderne conduit pour ainsi dire véritablement à une nouvelle/ancienne religiosité[44][44] Ce qui, soit dit en passant, réjouit particulièrement les industries musicales ; car sous couvert de spiritualité, toutes les immondices musicales bouillonnantes peuvent être diffusées parmi les humains ; dans ce domaine toutefois, ça fait longtemps que l’âge de pierre a triomphé..
Ainsi va donc The True Story of Pocahontas en 2009 ; la contribution un peu tardive du Hollywood électronique pour les 400 ans de la fondation de Jamestown, Virginie. Avec quelque retard, car il aura fallu du temps pour que les merveilles du cinéma numérique se hissent à ce niveau stratosphérique. Il serait intéressant de voir comment Little Bear & Silver Star[55][55] Little Bear & Silver Star, auteurs amérindiens d’un livre basé sur la transmission orale de l’histoire de la colonisation en Virginie mettant à mal la version officielle de Pocahontas, voir Dr. Linwood “Little Bear” et Angela L. Daniel “Silver Star”, The True Story of Pocahontas. The Other Side of History, Fulcrum Pub., Goldern, Colo., 2007 et Klaus Theweleit, POCAHONTAS, tome II, « Pocahontas Revisited, The True Story » (N.d.T.). digèrent ce nouveau raid. Cameron et son équipe ont dû créer quelques innovations pour leur True Story, rien de moins qu’un Nouveau Monde (technologique) avec un tout nouveau John Smith et une toute nouvelle Pocahontas galactique. (Et pas juste une [dés]habillée à la playboy comme dans le film Pocahontas de Terrence Malick en 2005[66][66] Dans le spectacle sentimental inepte The New World de Terrence Malick, 2005, où un John Smith en rut, debout dans les roseaux avec Pocahontas, pose ses mains les hanches d’icelle au son du deuxième mouvement du concerto pour piano en la majeur de Mozart, tandis que la flamboyante photographie de calendrier illumine d’or le ciel vespéral de « Virginia » (Good Old Fucking Country). Au début du film, l’ouverture de L’Or du Rhin. Irene Bedard, mannequin américain pour la Pocahontas de Disney, apparaît chez Malick dans le rôle de la mère de Pocahontas.
Page 638 : La voix de la Pocahontas de Disney est celle d’Irene Bedard, actrice américaine d’origine indienne. Dans The New World de Terrence Malick, elle interprète la mère de Pocahontas. Irene Bedard fait l’objet d’un débat public depuis que sa nièce Alia Davis a révélé dans une lettre ouverte aux médias son destin de femme maltraitée et abusée sexuellement par son mari pendant 17 ans, qui n’est restée pendant toutes ces années avec son mari, qui contrôlait également tous ses engagements, que pour leur jeune fils. Sa nièce Alia Davis écrit :
« He had to have total control over her and their child. It was because of her son, Quinn, that she did not leave. She felt she had to endure all of the abuse for his sake. If she left her abuser, he would follow her, and, she feared, use and possibly harm their son to force her to come back to him. She felt ashamed, embarrassed, humiliated, and powerless. »
En sus, il était présent sur tous les lieux de tournage et lui a gâché de nombreux boulots. (Entre-temps, longs procès pour abus et droit de garde).
Les informations proviennent du site Internet womanist-musings.com/2010/12/irene-bedard-open-secret-of-domestic-violence. Amenant les auteur/rices de cette page à faire ce commentaire :
« Native American women experience the highest rate of violence of any group in the United States. A report released by the Department of Justice, American Indians and Crime, found that Native Americans suffer violent crime at a rate three and a half times greater than the national average. [Pure estimation, chiffres habituellement bien plus élevés] « As women of color, Native Americans experience not only sexual violence, but also institutionalized racism. Alex Wilson, a researcher for the Native American group Indigenous Perspectives, found a high level of tension between law enforcement and Native American women, who report numerous encounters where the police treated the women as if they were not telling the truth. […] It is impossible to eliminate the history of colonialism when examining this situation.
When First Nations women serve the efforts of colonialism, they are constructed as Indian Princesses, and when they ignore or resist the colonial project, they are often referred to as lazy squaws, who exist simply to prey upon the system. That the desire has been to eradicate Indigenous people and steal their property is conveniently often obscured or outright ignored, in many discussions on how they interact with social organizations like the police force, or the legal system. If an organization is predicated in the belief that Whiteness is the superior entity and exists to reify rules or laws written by White people, how is it possible for people of color, or more specific, Indigenous women to ever achieve equality. »
Le texte de 2010 constate que les femmes natives américaines (= « l’Indienne ») sont aujourd’hui statistiquement trois fois et demie plus souvent victimes de violences sexuelles aux États-Unis que les membres de n’importe quel autre groupe ethnique ; et il prouve que le terme Indian Princess (= fille du chef ; = prostituée) reste le mot normal pour la femme indienne adaptée ; tandis que la femme rebelle est considérée comme une squaw paresseuse vivant des allocs. Alors que les faits de l’accaparement des terres et des tentatives d’extermination pure et simple de la population indienne sont ignorés de tous : l’accaparement des terres d’Amérique était un fait de droit biblique ; le cop américain moyen ne se sent pas moins divin que l’Américain ; c’est le truc par lequel l’Holocauste américain peut être jusqu’à aujourd’hui nié et est nié. Tout ça était la volonté de Dieu et nous l’avons exécutée. Il y a aussi peu de “mauvaise conscience” que chez l’Allemand moyen à propos du meurtre des Juifs sous le régime nazi. Ce n’était peut-être pas la “volonté de Dieu”, mais c’étaient juste d’autres gens qui l’ont fait : les aliens qui avaient occupé l’Allemagne ont depuis disparu dans l’espace. ).
Mais Malick comme Cameron, sur ce point les deux se rejoignent, s’en tirent complètement sans le personnage de John Rolfe ni le fils rouge blanc de Pocahontas, Thomas Rolfe ; suivant en cela complètement la trace du mythe fondateur virginien traditionnel. La Love Story Pocahontas/Smith triomphe chez les deux… pas tragique dans Avatar, comme dans Titanic de Cameron… là, bien sûr, inéluctablement. Ici, en revanche, la New America de l’espace en volcan ésotérique… le numérique faisant feu de tout bois… pour faire oublier le numérique. Une fille de roi en femme-chat électronico-primitive, hyper-religieuse, qui revendique son territoire originel contre la menace d’une technologie invasive – une victoire dans la célébration de laquelle disparaît, au passage, tout l’holocauste américain contre les “Indiens”.
S’ensuit un constat (quelque peu surprenant) : de la mainmise colonialiste des Argonautes grecs sur le Caucase à la micro-électronisation du monde et de notre monde perceptif, l’accaparement des terres sur lesquelles on louche se fait par le biais du corps des filles de roi ; de Jason à James Cameron. Au niveau de l’art ou de la propagande, sans « Médée », sans « Pocahontas », pas de New Worlds ; pas même dans les ramifications les plus raffinées des Silicon Valleys modernes[77][77] Et Obama n’est-il pas lui aussi une adorable marionnette noire sur batteries ?. Même le cinéma intergalactique des temps modernes, électronisé sur des ailes de dinosaures, continue de tirer les énergies pour ses trajectoires en high orbit du recyclage artistique du branchement clandestin sur ces corps de femmes. Une adaptation dont le corps de la fille du roi en 2010 – c’est le saut quantique électronique – sort toutefois en vie comme personnage de fiction. Elle n’a pas besoin d’être empoisonnée ou éliminée d’une manière ou d’une autre… juste commutée… redéfinie… les nouvelles technologies informatiques réécrivent aussi le corps des filles du roi.
De sorte que même le conte de fées techno le plus branché de 2010 est chanté sur l’air de la « Fille du roi, vous la plus extra, ouvrez-moi »… Neytiri… sur les ailes de l’enchanteresse Médée… dans les chaussures de Malinche, la trans-poseuse… dans le canoë de la pionnière Sacajawea. Didon… Iracema[88][88] Iracema est la « Pocahontas brésilienne », personnage principal du roman éponyme (1865) du « poète national » brésilien José de Alencar. Avec Martim, d’origine portugaise, elle fonde la nouvelle population ; le nouveau peuple métissé du Brésil (pour la version mexicaine duquel les Mexicains ont le fier mot de « la raza ». Pour eux, la « race » est le métissé). « Iracema » est (par ailleurs) une anagramme d’America (du Sud). Des figures féminines similaires – si on les tourne un peu dans tous les sens – peuvent être trouvées dans l’annexion des Canaries à l’Espagne, de Madagascar à l’Empire allemand, de l’ouverture du Japon par le commodore Matthew C. Perry, l’annexion d’Hawaï comme État fédéral aux États-Unis, etc. etc. L’objectif de ce travail n’était pas de présenter une série de motifs avec les noms des « princesses » à chaque fois impliquées. Il s’agissait de mettre en évidence les traits principaux de l’accaparement des terres via le corps de la « fille du roi » comme trait fondamental de l’histoire coloniale eurasiatique-américaine (et trait fondamental de l’écriture, de la peinture, du design et du cinéma masculins) ; comme le trait fondamental de cette (ces) histoire(s) : des premières constructions navales à la numérisation. Chanson : Yes, I Was Born About Ten Thousand Years Ago – still going strong…… Pocahontas : rediviva… & les films Cléopâtre de toutes les latitudes et longitudes… ne voulant pas prendre fin : ouvrez-moi !
Mais Cameron ne louche plus sur les portes verrouillées… les portes de chambre verrouillées… même pas les conduits vaginaux interdits… les portes génératrices de héros. Ce qui est visé, ce sont les paupières… les conduits auditifs… les boucles des sacs à main (derrière lesquelles se trouvent les bourses pour les billets d’entrée). Sont visés les relais d’allumage des connexions neurobiologiques… l’accaparement de terres cérébrales… les connexions synaptiques, flambant neuves. Bien possible que le « colonisateur » ne sache même pas quelle terre il veut prendre… quelle nouvelle terre il cherche donc. Mais il a son vaisseau… ses appareils électroniques… ses ordinateurs veulent voler… en film 3D… en drones… en Mother’s Little Helper dans chaque foyer… vers Jupiter et au-delà. La « fille du roi » poursuit sa route… à moins qu’elle ne soit un jour victime du quota féminin… la all-over-princess cosmologique.
Cameron : « Le plus important, avec Avatar, était de montrer au public quelque chose qu’il n’avait encore jamais vu. » Il y est arrivé, comme prévu (même s’il montre l’archi connu dans les schémas du genre). L’effet : le public, au creux des fauteuils avec pop-corn & coca, finit dans les cordes ; mis K.-O. par la puissance des technologies déployées. Des technologies qui annoncent la victoire d’une nouvelle nature-rationalité écologique. Mais, comme il ne peut en être autrement avec les victoires : c’est un occupant qui triomphe. On halète, au bord de l’extinction physique-cérébrale, comme des poissons derrière un masque à oxygène.
Bien possible que Cameron, en réalisateur planifiant le succès au box-office, n’ait rien de tout ça en tête. Mais ce qu’il a sciemment voulu et continue à vouloir, c’est être le faiseur du « plus grand nombre d’entrées de tous les temps ». Dont la planification, faisant feu de tout bois, n’est pas sans rappeler – dans toutes ses stratégies de domination – l’accaparement colonial des terres ; accaparement des terres corporelles qui remplacent les anciennes conquêtes territoriales colonialistes. Avec le déplacement fondamental qui en résulte, à savoir que ces « occupations » ne se produisent pas comme guerres, mais comme divertissement (du moins dans les parties du monde raccordées aux réseaux électroniques). La guerre tue les corps ; le divertissement génère de nouveaux corps ; des corps qui paient. Le nouveau corps technologique compte parce qu’il paie. Partout dans le monde, les corps qui ne paient pas meurent. Les corps qui peuvent payer ne meurent (plus) dans les guerres ; ils sont colonisés électroniquement et participent au divertissement (révolutionnaire). Tous avatars confondus, jamais le colonialiste (le « loup ») ne s’est introduit avec plus de raffinement, d’exigence, de jeu – à un tel niveau de sophistication technique –, dans la bergerie : en électro-geek qui fait des cadeaux[99][99] À ceci près qu’il me paraît impossible de savoir où se dirige ou doit se diriger le corps bio-électronique en pleine construction (veut et doit se diriger lui-même et le monde). Les oiseaux de mauvais augure fulminant sur l’abrutissement total par l’électronisation et les écrans sont en tout cas ce qui se fait à peu près de plus stupide dans le traitement de ces questions..
Tandis que dans les doigts sur les claviers d’ordinateur bidouillent gaîment en chœur et encore les pattes des traditionnels super vilains… Captain Jason John Jake Sully Smith… incarnation de tous les morts-vivants… tous immortels (humanoïdes)… du bord de la mer Noire aux pilotes de Jamestown et cartographes de la traversée du Mayflower… Amerigo Vespucci & Amigos… Piloto Mayor de toutes les caravelles post-Colomb… Goldfinger Cortés & les doigts de diamant des rois expansionnistes et de leurs flottes… de Charles Quint et Philippe II aux apolloniens de la NASA… des peintres de la Renaissance aux ingénieurs vidéo ailés des images de synthèse… séductions qui parviennent – processus artistique élaboré – à (toujours) dissimuler les technologies les plus modernes dans le corps de princesses natives sexy… créant des mannequins barbares asiatiques et africains… tout l’assortiment de l’Indienne à l’éco-gamine.
Pour l’instant, encore des histoires pour les gens qui croient à l’Indien dans l’être humain… à l’écologie dans le drone… aux Lumières dans la surveillance… du moment que tout n’est que divertissement… en 3, 4, ou 5D.
Des « lignes de front » ? Depuis longtemps disparues. Difficile de distinguer ami, ennemi, amant.e.s, aimé.e.s, agresseur ou protecteur, inventeur ou colonisateur. Tout semble défait, saisi, dans la figure des disciples de la technologie… douze jeunes pirates autour de la table… attendant le Sauveur ?
(… qu’Andy Warhol, prévoyant, avait heureusement déjà promu au grade de multiple de haut rang).
Le capital ? Cochon comme à l’accoutumée ; mais veut/doit être sauvé lui-même ; pour pouvoir montrer ses bons côtés, enfin. Pas grave. Angela Merkel est-elle une Pocahontas de l’Est pacifiquement arraisonnée, qui assure la survie des banquiers de l’Ouest sur l’East River, le Tibre, la Tamise, la Seine et la Spree ? Ses chichis avec la chanson Angie des Stones (contre laquelle ces derniers se sont insurgés) le laisse penser… le presbytère protestant crache toujours au bassinet… quand ce ne sont pas des œuvres et des princesses, ce sont des anges… Angela Merkel… Gudrun Ensslin…
Mais : où est l’ennemi ? Si je comprends bien Ian Morris (& Albert Einstein), seule une (des) coopération(s) suprasystémique(s) mondiale(s) empêchera(ont) la Terre de perdre au cours des cent prochaines années tous ses littoraux au profit de cette même mer…
… mais alors à quoi bon tous les beaux colonialismes ?
En tout cas, James Bond et ses exégètes philosophiques partent en retraite… le glossiste-léniniste (e)S(c)lavoj Žižek… bredouilleurs de tous les pays, débrouillez-vous… et réembrouillez-vous… ça n’ira pas sans embrouille… mais il faut que ce soit sans ennemi… seulement sans ennemi on pourra faire baisser la concentration de CO2… sans interminable baroud cameronien (= grec ancien = ancien-léninien)… faut arrêter cette merde… tout le monde sait pourquoi… même s’ils ne le savent pas encore… (ne veulent pas le savoir).
Ou bien ?
Ou bien ?