Porto/Post/Doc, 2023
Bonaventure
Cette année, le Porto/Post/Doc organisait son premier Critics Lab, soit un rassemblement de jeunes critiques venus d’horizons divers, invités à passer une semaine à réfléchir à la critique de cinéma aujourd’hui. L’auteur de ces lignes fut un de ces rats de laboratoire, joyeusement mené de discussions en discussions et de séances en séances. Ce compte-rendu sera donc autant un compte-rendu du festival que de ce Critics Lab. Et les remerciements du Post-Scriptum en sont peut-être, secrètement, la partie la plus importante, tant ce texte est écrit la tête dans les souvenirs d’une semaine faite de dialogues enthousiasmants, de verres levés, de faux pas hilarants et de belles rencontres dans les bars, les ruelles et les salles de cinéma de la « deuxième plus grande ville du Portugal ».
Dès notre arrivée, nous fumes conviés à une projection organisée dans le cadre d’une carte blanche proposée à Alessandro Comodin, dont les films L’été de Giacomo et Les aventures de Gigi la loi étaient présentés : il choisit Les Naufragés de l’île de la Tortue de Jacques Rozier. Une première séance qui était, pour nous, membres du Lab, comme une inside joke ; nous étions les naufragés, le festival était l’île, Jean-Arthur Bonaventure et Bernard Dupoirier étaient nos modèles. Mais c’était aussi une première expérience de la liberté de programmation du festival : a priori consacrés au cinéma documentaire contemporain, les différents programmes étaient ouverts à des films de tous genres, de tous temps et de tous lieux. Ou une autre manière de mettre en pratique l’adage cinéphile qui dit que tout film est un documentaire – adage particulièrement approprié aux joyeux camps de vacances que sont les films de Rozier, il est vrai.
Un programme de 8 films était ainsi consacré aux artistes du passé. Son nom éloquent, Where Are Our Storytellers? (One Andam os Nossos Contadores De Histórias?), est aussi enthousiasmant que permissif : il s’agissait d’un choix de documentaires contemporains et de films plus anciens consacrés à des artistes – auquel s’ajoutait une projection de la Trilogie de Beyrouth de Jocelyne Saab, dont les films étaient présentés presque au même moment, en France, au Centre Pompidou. Si les documentaires contemporains restaient assez conventionnels – de Werner Herzog, Radical Dreamer, qui se contente de rejouer l’auto-hagiographie désormais bien connue du cinéaste allemand à Nam June Paik: Moon Is The Oldest TV, hommage complet et très réussi au grand artiste coréen, dont le film saisit bien l’originalité et l’importance –, les films du passé apportaient avec eux une audace formelle totalement vivifiante. Ce fut notamment le cas de Candy Mountain de Robert Frank et Rudy Wurlitzer, dont le casting est déjà une promesse : en traversant l’Amérique du Nord pour un motif plutôt arbitraire (retrouver un fabricant de guitares légendaire), on croise Tom Waits, Bulle Ogier, David Johansen (des New York Dolls), Joe Strummer (de The Clash)… Scène après scène, ces rencontres sont comme des clous plantés dans le tombeau d’un fantasme d’une Amérique parallèle, sublime, vernaculaire – et de la musique qui y émergea, le blues et son enfant dégénéré que sera le rock’n’roll.
*
Face aux audaces formelles du passé, celles de Rozier et de Frank, les films de la compétition internationale faisaient souvent pâle figure, coincés dans une idée très académique du documentaire contemporain. Ainsi de Landshaft de Daniel Kötter, qui se maintenait dans un dispositif historio-géographique faussement inévitable lorsque l’on filme ces régions aux frontières dangereusement invisibles (en l’occurrence, celle entre le Haut-Karabakh et l’Azebaïjan). Landshaft est un film extrêmement théorique, exclusivement théorique même, que l’on a l’impression de devoir observer avec une feuille de route et une bibliographie (surtout des textes de l’école de Francfort, disons). Sentiment assez désagréable d’un film dont les idées – portant sur les liens complexes entre nationalisme et capitalisme, entre l’exploitation de la terre et le traçage des frontières – sont très affûtées mais que la mise en scène et le montage ne font qu’évoquer. Faut-il regarder Landshaft avec un livre sur les genoux ? Difficile de ne pas penser à d’autres films qui s’ouvraient aussi sur des dispositifs théoriques mais qui les ouvraient finalement afin d’en faire des expériences plus sensibles : Si le vent tombe de Nora Martirosyan, qui avait génialement fictionnalisé les enjeux de la région en y inventant l’enjeu central de la création d’un aéroport international ; ou bien les documentaires de Harun Farocki, qui se défaisaient de leur froideur par l’humour, la poésie, l’amour presque enfantin de la collection d’images, fussent-elles terribles.


Between Revolutions (Între revoluții), déjà en train de devenir un classique de festivals (plusieurs dizaines de projections festivalières en moins d’un an), frôle aussi cet académisme contemporain, mais par une voie opposée. Vlad Petri y propose une sorte d’analyse comparée de la Roumanie et de l’Iran de la fin des années 70 aux années 90 ; la chute du régime soviétique puis de Ceaușescu d’un côté, l’arrivée au pouvoir de l’ayatollah Khomeini et la déception des espoirs de liberté de l’autre. Pour tisser ces deux mouvements historiques ensemble, le cinéaste invente cependant un dispositif intégralement fictionnel, bien que basé sur des archives des services de renseignements roumains : des échanges de lettres entre deux femmes, une iranienne et une roumaine, qui se sont connues le temps de quelques années d’études à Bucarest. On entend ainsi, lues en voix off, des lettres fictives, écrites par l’autrice Lavinia Braniște, alors que défilent devant nous des images d’archives de ces deux moments historiques ; la chute d’un régime, l’avènement d’un autre. Le dispositif, finalement assez convenu, fonctionne si l’on considère ce film comme un pur fantasme ; le fantasme d’une histoire d’amour qui traverserait les révolutions, le fantasme d’un événement historique que l’on vivrait de l’intérieur en l’interprétant immédiatement comme tel (on pense à nouveau, inévitablement, à Farocki et aux Vidéogrammes d’une révolution), le fantasme de toute fiction peut-être. Cette énergie du fantasme, dans tous les sens du terme (comme désir et comme rêve), est la richesse du film – et, à la longue, la limite d’un récit trop flottant, trop peu organisé.
L’attribution du Grand Prix du Jury à To Books and Women I Sing (A los libros y a as mujeros canto) témoigne sans doute du bol d’air qu’a pu constituer ce film plus ludique et singulier. Dans ce premier long-métrage, la documentariste María Elorza part d’une anecdote personnelle, en apparence anodine (un entretien avec une mère et sa fille à propos de l’effondrement de la bibliothèque familiale), pour se diriger, de lien tissé en lien tissé, vers une histoire alternative de la littérature. Mais plutôt qu’une enquête historique, il faudrait parler d’une enquête anthropologique qui s’intéresse à un motif paradoxal, celui de la lectrice. Motif paradoxal car alors que la lecture est une activité plutôt associée aux femmes, comme en témoigne un abondant corpus pictural (que le film cite), la littérature, elle, fut longtemps une question que le masculin tenta de garder comme domaine réservé. L’enchevêtrement des sujets et des métaphores, volontairement chaotique – on passe de cette anecdote familiale à Proust, des fascismes du XXe siècle aux ouvrières lisant à voix haute dans les fabriques – vise à faire exister, le temps du film, par une sorte de convention heureuse, un réseau de femmes lectrices qui supplanteraient, par leur intelligence, leur mémoire, leur voix, la création littéraire même, qui reste du côté des hommes (on cite plus volontiers Virgile, Proust, Dante, Rilke et Borges que, disons, Virginia Woolf).

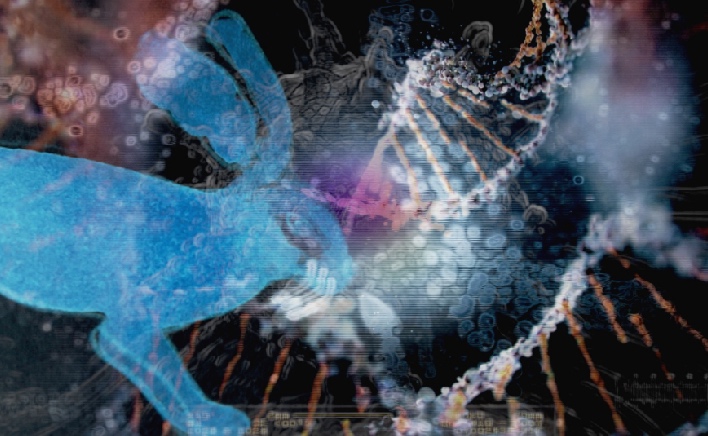
Les premiers mots prononcés dans While the Green Grass Grows, le dernier film de Peter Mettler (en fait une partie d’un long cycle de films qui devrait s’étendre sur plus de douze heures), sont aussi les mots d’une mère à un parent : « You know my life story », demande une vieille dame ; « Not really », répond un fils. Sous forme de journal filmé (où les lieux et la date des images s’inscrivent littéralement, sous forme d’écriture manuscrite, à l’image), Mettler revient notamment sur la vie de ses parents, immigrés suisses au Canada ; leur retour en Suisse, au crépuscule de leur vie, semble être le moteur du film, comme s’il s’agissait pour lui d’une occasion de les interroger sur leur passé et sur l’héritage qu’il pourrait en retenir. Mais While the Green Grass Grows ne se laisse pas résumer aussi facilement, tant il change sans cesse de récit, de direction, de structure ; alors qu’il débute comme un sobre journal filmé à la Mekas (certaines envolées poétiques de la voix off sont dignes du cinéaste lituanien), certaines séquences de superpositions d’images évoquent le cinéma de Pat O’Neill, et d’autres encore celui de Jean-Claude Rousseau (notamment celle où il se filme, dans un chalet presque vide, assis face à un piano). Des noms qui viennent en tête pour essayer de circonscrire un film qui glisse toujours entre les mains, à l’image de la réalité qu’il filme ; aux deux tiers du film, tout à coup, la pandémie de COVID frappe ; fini, ces images des vertes vallées suisses, ce sont désormais des intérieurs canadiens que le film occupera ; et alors que le confinement dure, l’horizon du film de Mettler se voit à nouveau ouvert par des images envoyées par ses étudiant·e·s. La durée même du film (l’épisode que nous en avons vu durait près de trois heures) vise la dislocation ; pile à la moitié, une citation de Kurt Vonnegut recouvre l’écran : « It is an illusion we have here on Earth that one moment follows another one, like beads on a string, and that once a moment is gone it is gone forever. »
*
Ma connaissance de l’histoire coloniale du Portugal est, je dois l’admettre, relativement limitée. Mais une nation qui a existé si fort à travers le cinéma a avec elle la gloire de transmettre son histoire grâce à lui. Je pense à un film en particulier : Non, ou la vaine gloire de commander de Manoel de Oliveira, qui traverse deux millénaires d’histoire portugaise, mais qui s’ouvre et se clôt sur la guerre de libération contre l’occupant portugais en Angola. Ma carte mentale des colonies portugaises s’arrêtait donc à ces incroyables scènes de guerre, auxquelles on peut éventuellement ajouter le souvenir d’un Cap Vert colonial, rappelé à ma mémoire par les films de Pedro Costa. Or, tout au long du festival, d’autres films, plus ou moins réussis, ont colorié d’autres pays sur la carte du monde : des territoires insulaires à l’ouest de l’Afrique, la Guinée-Bissau, le Mozambique.
Sujet qui fut abordé, d’abord, par un film assez faible – Lindo, de Margarida Gramaxo (programmé dans la compétition nationale Cinema Falado). Tourné pendant plusieurs années sur l’île de Principe (moitié d’un état dont je n’avais jamais entendu parler, la République de Sao Tomé-et-Principe, situé au large du Gabon et de la Guinée Équatoriale et possession coloniale du Portugal jusqu’en 1975), il raconte la vie d’un groupe de chasseurs de tortues que le gouvernement local « reconvertit » dans la protection de cette espèce – dans le même temps, la question de la régulation de la pêche se pose. Plutôt raté, le film a l’ambition (trop grande, peut-être) de mettre en fiction les contradictions entre la vie sociale et culturelle et les enjeux économiques de ce petit archipel ; malheureusement, et en dépit d’images sous-marines absolument magnifiques, ces questions sont mises sur la table avec un didactisme fastidieux et très artificiel. D’une certaine manière, la scène délicieusement ironique des Naufragés de l’île de la Tortue de Rozier, où les deux héros rejouaient, en un seul plan et avec une grande ironie, des siècles d’horreur extractiviste et d’hypocrisie colonialiste, dépassait déjà la critique qui est seulement esquissée ici.
Une fois de plus, les films du passé étaient plus inspirants. On put voir ainsi, le même jour, deux projections de documentaires de patrimoine, récemment restaurés. Le premier, Catembe, réalisé par Manuel Faria de Almeida en 1965, est tristement célèbre : il s’agit du film le plus durement censuré par la dictature portugaise de Salazar. Durant originellement près d’une heure et demie, il n’en reste aujourd’hui que 45 minutes – le résultat final fut malgré tout considéré comme trop sensible, et le film fut totalement invisibilisé. Le plus surprenant, quand on découvre cette œuvre démembrée, est son inscription dans le cinéma de son époque. Le dispositif, quasi essayiste, évoque en effet le cinéma de Rouch ou de Marker, qui s’intéressaient, au même moment, aux mêmes enjeux coloniaux. Catembe débute par un micro-trottoir dans les rues de Lisbonne à propos de la vie à Lourenço Marques (le nom colonial donné à Mabuto, la capitale du Mozambique) avant de raconter une semaine de vie quotidienne dans la capitale coloniale, à travers des interviews, des archives, et des prises de vue dans la ville, en particulier sur ses plages. La carte postale coloniale, inévitable, est cependant exposée avec une ironie particulièrement flagrante, que le montage ne cesse de souligner et d’appuyer, sans même parler de l’ironie et de la gêne à peine cachée des intervenants, notamment ce journaliste des médias nationaux qui, lorsqu’il apparaît, concède immédiatement qu’il lui est difficile de s’exprimer en toute liberté.


Montré à sa suite, Acto dos Feitos da Guiné est en quelque sorte le chapitre suivant de cette histoire coloniale : Fernando Matos Silva, personnage historique du cinéma portugais, réalisateur mais aussi assistant, en a tourné les premières images en 1969, lorsqu’il est envoyé, dans le cadre de son service militaire, en Guinée-Bissau, en tant que membre du service des archives de l’armée portugaise. En plus des images opératoires, strictement militaires, il tourne, avec une petite caméra, en noir et blanc, d’autres images, auprès des habitants du pays. Dix ans plus tard, la Révolution des Œillets passée et l’empire colonial démantelé, il se lance dans un montage de ses propres images, d’archives des mouvements révolutionnaires, et de mises en scène « contemporaines », composant ainsi un « film de voyage trans-historique ». Très marqué par une vision marxiste-léniniste particulièrement théorique et orthodoxe, tantôt charmante, tantôt vieillie, Acto dos Feitos da Guiné raconte, un peu à la manière du Non de Oliveira, toute l’histoire du Portugal depuis une lunette volontairement réduite et déformante, mais qui, par la déformation même qu’elle opère, vise à révéler les structures profondes, presque psychanalytiques, de la pensée coloniale et de sa subsistance après l’indépendance. C’est aussi ce moment de la pensée que le film figure : une période où les derniers pays colonisés s’extirpaient de leurs chaînes, où une pensée tiers-mondiste critiquait déjà le néo-colonialisme, où un autre avenir était envisagé pour ces pays libérés.
Fernando Matos Silva, qui présentait la séance, est un vieux monsieur. Il n’a cependant rien perdu de sa verve révolutionnaire, que l’on sentait dans son introduction du film. Il parlait en portugais – je n’en ai, par conséquent, pas compris grand chose. Mais il y a des mots qui se disent à peu près pareil dans toutes les langues : fascisme, colonialisme, mémoire. Si, en une semaine de festival, l’auteur de ces lignes est passé par un dépaysement sensible – la langue, la friture, le vin liquoreux et l’étrange brume qui se lève dans les rues la nuit –, ce fut aussi l’occasion d’un dépaysement plus cérébral ou culturel : celui du constat d’un pays qui, bien que les forces réactionnaires y progressent (comme partout), n’a pas la même tendance à refouler, voir à renier son histoire coloniale. Le retour en France, au moment où le gouvernement entamait la défense de sa « loi Immigration » (le mot « Asile » semble avoir, sans surprise, disparu), fut une belle gueule de bois.





