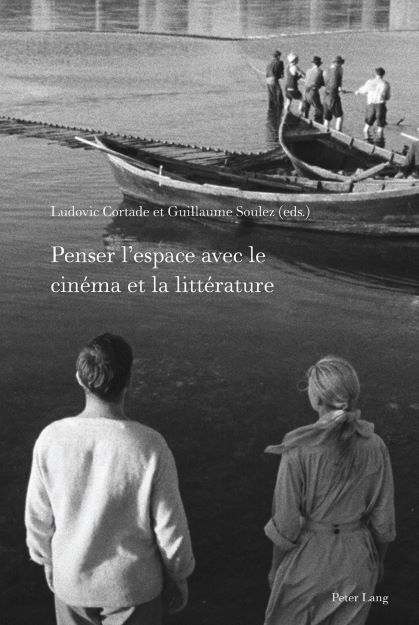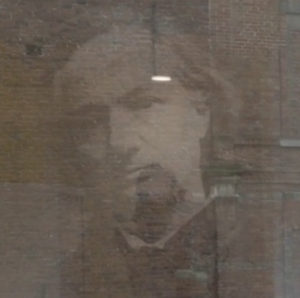Que retenir de l’espace ?
Sur "Penser l'espace avec le cinéma et la littérature" de Ludovic Cortade et Guillaume Soulez (dir.)
D’emblée, un cadre est posé : il s’agit de faire du cinéma et de la littérature non pas des sujets d’étude – on parlera peu ici des spécificités spatiales de l’un, de l’autre ou des deux – mais des compagnons de route, des guides savants sur les voies d’une pensée de l’espace. Il faut, pour saisir la cohérence de l’ouvrage, partir d’une définition minimale de ce dernier : une distance entre deux entités, un point A et un point B. Sur la ligne imaginaire qui relie A à B, certains posent une frontière. Entre les deux, les relations sont alors pauvres, les espoirs maigres : un mur empêche toute forme de créativité. D’autres, plus ambitieux, évoquent le limen, le seuil, par lequel A et B deviennent libres d’échanger ; l’espace aux contours jadis fixes devient instable. Il s’agit ici, pour chaque auteur, d’étudier des zones de dialogues, espérés ou établis, entre plusieurs entités : tour à tour, différentes régions géographiques, différentes œuvres, différents corps, objets, lieux, médiums ou degrés de réalité sont ainsi mis en regard. Ce ne sont pourtant pas ces échanges hétérogènes et foisonnants qui fondent l’originalité de l’ouvrage, mais plutôt les espaces fuyants, désincarnés qu’on y découvre. Les articles proposés pourraient, chacun singulièrement, passer par ce même trajet : glisser du constat d’une démission à la tentative réflexe de révéler ce que celle-ci génère ailleurs. L’ambition de l’ouvrage pourrait être alors d’identifier ce que le cinéma et la littérature parviennent à retenir de l’espace : non pas à garder en mémoire, mais à sauver de la disparition.
L’ouvrage s’inaugure par une série d’articles au sein desquels les réalités matérielles se délitent et mêlent leurs frontières avec des mondes virtuels : mondes retrouvés du passé, mondes imaginaires et doublures du réel. Jeanne Etelain voit dans « la Zone », l’espace fictif créé par Tarkovski dans Stalker, l’une des effigies de Gaïa. Elle décrit un espace mouvant en perpétuelle transformation, à l’opposé de l’espace euclidien, de cet arrière-fond passif et stable des actions humaines que l’on a coutume de prendre comme repère. L’autrice identifie les procédés cinématographiques qui dotent l’espace de son propre point de vue : mouvement fluide de caméra, travail du son, angle de prise de vue rendent perceptible une présence mystérieuse et inédite. La « Zone », parfaitement autonome, n’offre aux personnages aucune prise : impossible pour eux d’y parcourir deux fois le même chemin ou de la cartographier, ni même de l’appréhender à l’aide des lois naturelles connues jusqu’alors. Comme l’énonce explicitement l’autrice, il ne s’agit pas de penser l’espace dans le cinéma, mais avec lui : à l’heure où se multiplient les pensées de l’Anthropocène, Tarkovski permet de concevoir, grâce au concret des images, une spatialité alternative dotée de ses propres déterminations, échappant au contrôle de l’humanité. Plus loin, avec Antje Ziethen, c’est à nouveau de la confrontation entre l’espace physique et ses doublures imaginaires qu’émergent des pensées alternatives émancipées des discours dominants : les « geographic metafictions » de la littérature postmoderne qu’elle étudie parodient nos savoirs spatiaux en les mêlant indistinctement à des intertextes fictifs. Elles révèlent ainsi que les espaces réels, tout comme ceux qu’inventent la littérature et le cinéma, sont des constructions humaines autant que des outils de domination. Parmi les nombreux penseurs cités, Edward Said aide à comprendre ces allers-retours entre fiction et réalité : pour lui, l’Orient a été créé par l’Occident afin de renforcer son pouvoir. Les métafictions géographiques acquièrent toute leur importance dans le contexte de la littérature postcoloniale. L’exemple le plus développé de l’article est celui du roman de Bernardine Evaristo, Blonde Roots, qui renverse le rôle des Africains et des Européens dans la traite des esclaves. Une carte, au début du roman, mêle lieux réels et imaginaires : l’Aphrika y est située au Nord de l’Europe ; la capitale de Great Ambossa, une île au large de sa côte ouest, est nommée Londolo. Géographies et toponymies gardent une forme de référentialité, une trace du réel mais le détournent, le parodient, et font de la réorganisation de l’espace un outil de dénonciation.
Si ces glissements spatiaux génèrent des pensées alternatives, postcoloniales ou proches de l’écologie politique, les écarts creusés entre la réalité et ses doubles ne sont pas dénués de mélancolie. Emmanuelle André s’attache à souligner les particularités des images télévisuelles diffusées sur les écrans du monde entier en 1969, lors des premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune. Plutôt que de souligner la puissance américaine et les promesses de ses technologies, cette retransmission en direct semble d’emblée appartenir au passé : elle est l’occasion d’un questionnement de l’homme sur ses origines, les « limites de sa propre temporalité ». Analysant les images de Moonwalk One (Theo Kamecke, 1972), l’autrice identifie un écart entre les prouesses techniques mises en œuvre alors et la mauvaise qualité des images télévisuelles, renvoyant « Apollo au passé ». L’image qu’il reste du voyage manque ainsi son actualité. Cet astronaute qui marche sur la Lune rappelle d’abord les hommes qui, du fond de leurs grottes préhistoriques, ont marqué leur territoire pour la première fois. Scrutant sur l’écran un espace jamais parcouru auparavant, les téléspectateurs découvrent ensuite une visibilité nouvelle comme l’a fait bien avant eux le premier public du cinématographe. C’est enfin à des perceptions évanouies qu’ont fait écho les premiers pas de Neil Armstrong, poupin dans son scaphandre : celles des bébés marchant pour la première fois. L’espace qui échappe à la retransmission télévisuelle, c’est bien cet astre que les Américains rêvaient de conquérir ; à sa place, l’humanité redécouvre des sensations appartenant à un passé immémorial.
La deuxième partie de l’ouvrage est moins consacrée aux textes et aux images qu’aux médias eux-mêmes : si le titre évoque des « stratigraphies en mouvement », c’est sans doute parce qu’on s’efforce là de redéfinir leurs fondements respectifs, quitte à ébranler leurs anciennes bases. Il ne sera donc plus question de domaines propres, bien identifiés, mais d’une constellation de moyens d’expression ouverts les uns aux autres, en constant dérobement et reformation. Ce que Guillaume Soulez déterre, ce sont les origines orales de la lecture, éloignant la littérature des domaines du livre et du texte. Ouverte à de multiples lectures au double sens du terme, l’œuvre lue à voix haute n’est pas pourvue d’un sens unique à découvrir, contenu, gravé, vérifiable dans un texte autonome et fermé. L’auteur en appelle à l’émancipation d’une « lecture-fixation » qui contraint la libre interprétation au profit d’un « lire-prononcer », d’une lecture interactive et en mouvement qui favorise la discussion. Dans un contexte de généralisation des écrans, nouveaux supports communs du texte et de l’image, cette vision renouvelée de la lecture ouvre des voies pour le rapprochement de la littérature et du cinéma : il s’agit, en prenant en exemple deux films de Duras, de « sortir d’une relation texte-image appauvrie », de « défaire l’image de son pouvoir d’illustration de la voix », et de « souligner l’énonciation comme évocation, profération, parole… ». Mathias Kusnierz adopte, lui, une « perspective géomédiatique », évoquant la « circumnavigation [de la poésie moderne] au sein d’une géographie des médias toujours plus vaste, où chaque espace ouvre sur un nouvel inconnu ». Il s’agit là de ne plus concevoir l’espace poétique comme une territoire clos, situé par rapport aux autres espaces de création, mais au contraire d’inventer de nouveaux supports, éphémères et instables. L’espace se constitue ainsi progressivement, en fonction de passages, « de déplacements et de dépassements plutôt que de positions », bannissant toute forme de frontière. Non plus apanage du livre, le poème est libre d’investir des médias pour lui inédits, à l’instar de l’informatique dans le cas de First Screening de bpNichol (1984). Ici, la poésie se dématérialise ; sur l’écran d’ordinateur, les caractères défilent, permutent : « le texte comme objet écrit est désormais indissociable du mouvement qui le fait apparaître ». L’auteur propose la définition d’un espace aux contours sans cesse remis en jeu, déterritorialisé et imprévisible, transgressant toute forme de catégorie instituée. Mais on apprend aussi, grâce à Maylis Laureti, que cette construction inachevable trouve écho dans le combat commun de la littérature et du cinéma face à un « impossible lieu » : Robert Bober et Georges Perec, l’un avec un film, l’autre avec un texte, partent à la recherche d’un espace qui n’offre aucune prise. La rue Vilin que Perec essaie de décrire dans Les Lieux lui résiste : y ayant habité enfant, il ne retrouve en la visitant aucun souvenir. La rue n’est pas investie par sa mémoire, elle n’est pas un lieu tel que l’écrivain le définit, approprié et intime, mais un espace « à conquérir » avec lequel il n’a encore aucune relation. La rue résistera aussi au réalisateur d’En remontant la rue Vilin (1992) : celui-ci, entamant son projet filmique après la démolition de la rue, est confronté à un « manque à filmer ». Ce que l’autrice de l’article étudie, ce sont surtout les attitudes de Perec et de Bober face à cet espace pauvre, bien plus que l’identification des spécificités de chacun de leur médium : leur insistance, le renouvellement de plusieurs tentatives, la tentation de l’exhaustivité, sont autant d’essais à tâtons pour appréhender cet espace spectral, habité par des fantômes.
Le dernier mouvement du livre peine à trouver son principe unificateur, tant parce que les « Géographies de contact » travaillent en réalité l’ensemble de l’ouvrage que parce que les contacts dont il s’agit ici sont ambivalents : si des œuvres dialoguent au-delà de multiples frontières, le récit, lui, est souvent celui d’un espace qui se manque, qui se perd. Comme si, pour qu’il y ait contact quelque part, il fallait un dérobement ailleurs ; comme si l’espace, toujours, devait d’une manière ou d’une autre préserver son évanescence. Le personnage de La Noire de…, tant dans le roman d’Ousmane Sembène que dans le film réalisé par l’auteur lui-même, est tiraillé entre deux pays : le Sénégal, où la jeune fille est heureuse et maîtrise son environnement, et la France, qui l’enferme progressivement entre les murs de la maison dont elle s’occupe. Nicolas Estournel évoque alors une « politique de la surface », l’impossible pénétration de l’espace par le personnage et l’impossible dialogue entre les deux pays. À l’exception de la figure d’un masque, qui dans le film vient matérialiser l’affrontement des espaces, ici les œuvres se rencontrent ; mais le personnage, lui, reste irrémédiablement à distance. Thérèse Raquin est elle aussi un personnage à qui l’espace échappe, sur qui celui-ci va jusqu’à exercer une emprise cauchemardesque (Élise Cantiran). C’est dans le traitement des déterminismes spatiaux que l’adaptation cinématographique de Charlie Stratton diffère du roman de Zola, ajusté qu’il est à une autre aire culturelle : le réalisateur américain explique la pesanteur des lieux par la présence de personnages sombres, psychologise les espaces et autorise leur contrôle par le personnage ; les espaces romanesques, quant à eux, restent intrinsèquement négatifs, objectifs, et n’offrent aucune prise à Thérèse. Ailleurs, la ville qui rapproche deux œuvres, deux artistes, est aussi celle que l’on quitte (Marc Cerisuelo) : Nantes, « ville intermédiaire » entre Gracq et Demy mais aussi entre deux époques de la vie, ville de laquelle on s’échappe à un moment ou à un autre, ville des concordances entre des textes et des images, mais aussi « espace mental » de l’adolescence, auquel on revient comme par rituel après l’avoir abandonné.
Au cœur de cette dernière partie, ce qu’il faut enfin tâcher de retenir : des indéterminations, ébranlements et mises en suspens qui ont jalonné l’ouvrage doivent naître des espaces communs, des espaces de discussion. Avec Aurélie Chatton et son étude croisée des textes de Wajdi Mouawad et Édouard Glissant, on apprend que « l’opacité du lieu sauve le divers », que de l’indétermination des espaces diégétiques, de leur imprécision, de l’errance des personnages émerge le « Tout-Monde », le monde archipélique ouvert aux échanges contre le monde continental fait de blocs et de frontières, d’une vision généralisée et unique des choses. L’évanescence des différents espaces parcourus dans l’ouvrage, la difficulté à les penser, à les délimiter et à s’en emparer rencontre donc, finalement, cette utopie littéraire et cinématographique de l’émergence d’un lieu commun à partir duquel penser toutes les dissemblances, les hétérogénéités, comme une somme de points, ou une immense constellation.