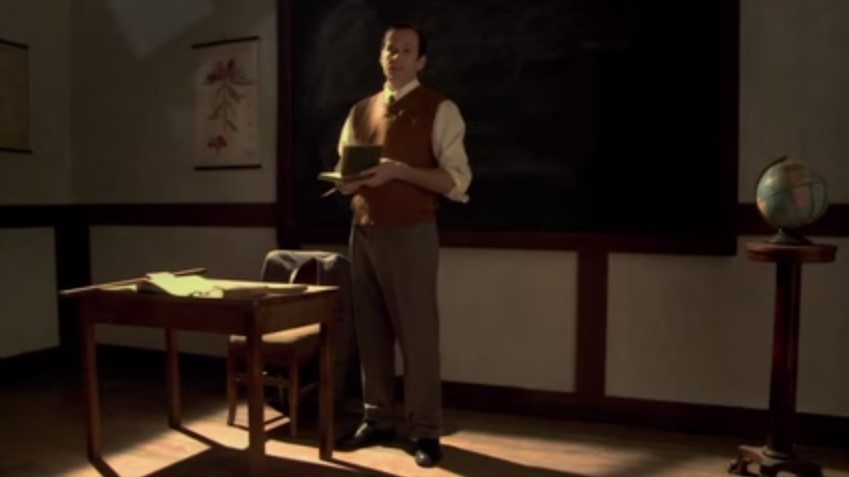Raoul Ruiz, Poétique du cinéma
En enseignant, en apprenant (le cinéma), fragments d'un livre à venir
Ce huitième chapitre de la Poétique du cinéma de Raoul Ruiz conclut l’édition chilienne (Poetica del cine, Editorial Sudamericana, 2000), mais n’est pas présent dans l’édition française. Nous avons pris la liberté de le traduire, à la suite d’une “note bibliographique” restée également inédite en France.
Arrivé à ce stade j’ai cru comprendre que : a) Au cinéma, seulement une partie des recettes, idées et automatismes du métier sont effectivement transmissibles. Et quoique l’évolution des techniques s’oriente vers un savoir-faire susceptible d’être intégralement transmis, nous sommes encore loin de l’avoir atteint – ce qui est aussi bien. L’un des aspects de l’enseignement du cinéma n’est plus de transmettre, mais d’éviter la transmission de ses propres stylèmes égologiques (néologisme peut-être un peu lourd, mais clair), je veux dire, le passage des éléments autobiographiques du film, qui sont en fait intransmissibles. En disant « autobiographique », je ne pense pas aux références à la vie personnelle du réalisateur, mais au film tapi derrière le film, cette espèce d’aura auto-référentielle.
Juan Emar décrit dans son roman Umbral (vol. 4, chapitre 3) le processus de fabrication d’un tableau comme la rencontre, le dialogue et le duel entre le « génie du peintre » et le « génie du tableau ». Un lieu commun de l’art poétique veut que le poème soit plus intelligent que le poète (Waldo Rojas), ou encore que l’office du poète consiste à suivre le poème là il voudra le mener (Garcia Lorca). Derrière cette métaphore se cache la même intuition : toutes les œuvres d’art sont des mondes autonomes, et pour cette raison ne sont que partiellement tributaires des dons de leur auteur. Tous les grands romans sont autobiographiques, dit Carlos Fuentes. Derrière chacun de ces romans une existence réelle subsiste, une vie personnelle bat, mais l’auteur n’est pas la personne en tant que telle, sinon un être innommé, un Golem fait de mots, de références, de cristallisations d’expériences multiples, dont l’existence est aussi réelle que celle de l’auteur, et dont la discrétion, la pudeur et le secret intime sont d’autant plus grands. Quelle est alors la part transmissible du savoir cinématographique ? Pour simplifier, je dirais que l’on peut transmettre tout ce qui est réductible en exemples, en exercices, en expériences et en jeux. En somme, tout ce qui dans les grandes lignes est antérieur à la réalisation du film. De façon plus claire encore, je dirais qu’il s’agit de fixer les automatismes que tous les cinéastes possèdent quoique parfois sans le savoir.
b) La mystification du cinéma a eu pour effet de surcharger l’acte de filmer d’un tas de rituels inutiles. Les éliminer est une tâche aussi difficile qu’indispensable. En premier lieu, il y a les formalités protocolaires qui précèdent chaque prise : les ordres « martiaux » du genre Caméra !, Action !, Silence sur le plateau !, Que personne ne bouge !, Éteignez ces téléphones !, Arrêtez la circulation !, Assez de photos !… ; ensuite, la cérémonie consistant à transmettre aux acteurs les instructions de dernière minute, saupoudrées de propos aussi affectueux que menaçants.
Dans la plupart des cas, l’acteur a déjà une idée claire, sans être forcément précise, de ce qu’il doit faire. Au lieu d’essayer de le dissuader, il faut au contraire compter sur ce manque de précision : d’elle dépendra tout l’intérêt de son travail. Surchargé d’instructions, il est très possible que l’acteur se distraie et perde ce vide mental indispensable pour donner vie à ce qu’il doit faire, ou alors qu’il fasse exactement ce qu’on lui demande. Ainsi privé de la possibilité de se surprendre lui-même, il n’arrivera à surprendre personne. La manie de prendre en photo tout ce qui a lieu autour du tournage mériterait un chapitre entier : les acteurs avant et après le maquillage, les essais, les décors. Sans parler de l’enregistrement en vidéo des scènes qui seront ensuite filmées.
Bien que le cinéma soit l’art de dominer, reconduire et, enfin, capturer ce débordement de signes qu’est le monde réel par l’intermédiaire de la caméra, mener à bien cette entreprise exige d’atteindre un équilibre entre voir et prévoir. Si nous devons nous saturer de tous types de matériaux protofilmiques, l’on court cependant le risque de bloquer le passage entre nos prévisions et ce que nous avons sous les yeux au moment de filmer. Prévoir est avant tout une opération mentale consistant à combiner des choses et des événements propres au film avec d’autres qui lui sont extérieurs – choses vues ailleurs, rêvées ou imaginées. Mais c’est dans le film, et nulle part ailleurs, que cette prévision doit s’actualiser. La prévision est ainsi un ensemble de séquences constamment interchangeables, chacune d’elles pouvant prendre corps dans le film, mais en aucun cas avant qu’il ne soit terminé. L’espacement indispensable dont dépend cet art combinatoire qu’est la prévision se perd généralement sous un amas de photos et de cassettes vidéo. La gêne que produisent tous ces matériaux superflus rend rigides et mécaniques les prévisions, dont l’unique contribution finale serait de donner l’impression que le film est terminé avant d’avoir été fait.
c) Les réflexions théoriques et autres considérations esthétiques faites à propos des exercices, ou bien autour des films en cours de réalisation, sont toujours réductrices, en plus d’être décourageantes pour les apprentis cinéastes trop sensibles, généralement les plus intéressants. Tout ce que fait un étudiant est intéressant, que ce soit techniquement correct ou non. Les erreurs et les échecs dévoilent d’ailleurs souvent la « marque de fabrique », le trait personnel. Souvenons-nous de Morelli, le premier à avoir appliqué aux tableaux de la Renaissance italienne une technique d’authentification fondée sur le trait personnel. Morelli cherchait justement ces points de détail répétés d’œuvre en œuvre, mais sans grand intérêt thématique ou pictural, comme une certaine forme d’oreilles ou de mains, grâce auxquels l’auteur, avec une insistance quasi maniaque, se manifeste dans ses toiles. J’essaie de la même manière de découvrir dans le travail de mes étudiants des récurrences inutiles, qu’elles concernent des objets, des gestes ou des mouvements de caméra ; quand ces trois éléments se combinent toujours de la même façon, l’on peut dire que le trait personnel est fixé. Si je vois là une tâche prioritaire, ce n’est pas parce que tel trait serait plus important, ou plus digne d’intérêt d’un point de vue esthétique, mais parce que, tout comme Morelli, je pense que ce trait est indispensable pour insuffler de la vie au monde que l’artiste se propose de créer. Au bout d’un certain temps, celui-ci n’aura pas plus d’importance que la signature au bas d’une peinture ou qu’un tic décoratif. Quoiqu’il en soit, il s’agit pour le novice de trouver une façon de marquer le territoire où il devra élever des villes imaginaires et dicter sa loi.
Quant aux dangers de la critique théorique précoce, je me souviens d’une anecdote récente où je pus, comme on dit, briller involontairement. Un étudiant avait présenté en cours, en guise d’exercice, un bref film : l’on y voyait sa maison, occupée par quelques personnes, et des plans de paysage. Il expliqua que la fenêtre représentait la frustration sexuelle, l’arbre la confusion des sentiments, les allées et venues des gens, la peur de la mort. Sans plus de commentaires, je lui demandai de continuer à filmer. Une semaine plus tard, il revint avec un nouveau film : un jeune homme prend un café, le regard fixé sur le dos d’un autre étudiant. Ce dernier quitte la cafeteria pour aller dans un parc, où se trouve une grande peinture murale. Puis le premier étudiant sort à son tour et, promenant son regard dans toutes les directions, finit par l’arrêter sur un point de la peinture. Apparaît alors dans la fresque l’image d’un jeune habillé exactement comme le second étudiant. L’explication fut la suivante : l’étudiant qui tournait le dos représentait la répression de tendances homosexuelles, et la disparition du second étudiant dans la peinture la réification de son humanité par le regard de l’autre. Cette fois, je me permis de célébrer ce que j’estimais être une bonne idée cinématographique, c’est-à-dire le fait d’habiller le second étudiant avec les vêtements du personnage de la peinture. La semaine suivante, le même apprenti m’apporta un exercice qu’il avait appelé « Le baptême ». L’on y voyait un étudiant jouant au piano un thème répétitif, tandis qu’un autre étudiant l’épiait par une porte. Le premier alors se lève, et jette un regard vers trois autres personnages endormis avant d’aller aux toilettes, toujours suivi par l’espion. Soudain, le premier étudiant s’évanouit ; l’autre étudiant s’approche et urine sur lui. L’auteur m’expliqua cette fois que la musique représentait la confusion mentale du protagoniste, les dormeurs l’indifférence de la société, et l’espion les désirs homosexuels réprimés. Le mépris était représenté par la transcription littérale de l’expression anglaise « to piss off ». Je lui fis remarquer que cette expression n’existait pas dans toutes les langues. Pour que la scène puisse être compréhensible au Chili, il aurait fallu que le protagoniste défèque sur l’espion. Ma critique s’arrêta sur ce point, mais non celle des autres étudiants, exaspérés. Non sans une certaine violence, ils étaient d’avis que les images étaient incohérentes et pouvaient aussi bien être comprises comme une allégorie de la guerre du Vietnam, de la mort du Christ ou du problème de l’inflation au Brésil. L’auteur écouta ces critiques avec autant d’attention que d’affliction et remercia ses condisciples dans un murmure. Mon intervention suivante consista à critiquer les critiques, qui supposaient un système narratif où chaque figure humaine devait incarner un personnage sujet à de multiples volitions, mais organisé autour d’une seule. J’essayai de leur faire remarquer que ce système narratif était aussi allégorique que les exercices qu’ils critiquaient. Il y eut de ma part une certaine exagération, bien entendu, dans le fait de conseiller à l’étudiant, en somme, de poursuivre ses obsessions, après quoi je l’invitai à déjeuner. C’était un enfant d’exilés. A table nous parlâmes de l’exil et de l’obsession des exilés pour les labyrinthes : nous parlâmes aussi d’Orson Welles, de cuisine et de vin, et de ses éventuels rapports avec la facture industrielle du cinéma. Deux semaines plus tard, il revint avec un exercice assez étrange : l’on voyait sa maison, sa famille, la maison d’en face et rien de plus. Par simple habitude, je lui demandai ce que tout cela signifiait. Rien, me répondit-il. Il avait simplement voulu montrer sa maison. Lors de la présentation des exercices de fin d’année, il apporta un court-métrage de dix minutes, composé d’un seul et presque irréprochable plan-séquence. La caméra allait et venait d’une chambre à l’autre, croisant à chaque fois quelques personnages. Le mouvement de la première partie du plan-séquence était suffisamment clair et précis pour nous permettre de recomposer mentalement l’espace du rez-de-chaussée d’une maison typiquement nord-américaine. Mais ensuite, par les déplacements de certains personnages dos à la caméra, grâce aussi aux déplacements de certains meubles, le même espace devenait autre, au point de rendre méconnaissable le plan mental que nous avions fait au début. Le mouvement initial se répétait une troisième fois en accentuant les procédés décrits. De plus en plus incertain, l’espace intérieur devenait un labyrinthe. C’était la preuve que l’assembleur d’allégories était devenu cinéaste : pour un certain temps, son trait personnel serait le labyrinthe. Quant à moi, je venais de m’apercevoir d’une chose : les mouvements de caméra des exercices antérieurs avaient tous en commun de nous faire perdre nos repères spatiaux. Sans que je m’en sois rendu compte, le trait personnel de l’auteur était présent dès le début.
Quelques jours plus tard, il me raconta qu’après les critiques sévères de ses camarades, il avait été sur le point d’abandonner l’école. Non parce qu’il les avait trouvées dures, mais justement parce qu’il les avait trouvées justes. Je me souvins alors de la phrase d’un collègue : Les critiques positives sont rarement justes, les négatives toujours.
d) En dernière instance, la transmission d’un savoir se fait toujours en l’absence de témoins, en secret, par le travail individuel avec les élèves. Si le professeur-réalisateur est en activité, le meilleur moyen pour entrer en matière sera de mettre les étudiants au courant de certains problèmes concrets qui se sont posés à lui dans ses travaux récents, ainsi que de ceux qu’il devra affronter lors de ses prochains projets de réalisation. Aussi peu attaché à l’enseignement que puisse être le professeur, et aussi prosaïque soit-il en tant que réalisateur, il sera toujours à sa portée de transmettre plus d’une astuce inédite à partir de l’explication d’un simple plan-séquence. La partie la plus stimulante du travail, en tout cas, sera toujours d’imaginer et de faire réaliser aux apprentis des exercices qui comportent quelque problème théorique et, dans un second temps, au lieu d’accompagner ce travail pratique de commentaires et de corrections, de le réaliser soi-même, au risque de tomber dans d’évidentes erreurs, et même, en s’appliquant à les commettre ouvertement. La possibilité de la critique théorique et de la critique tout court sont à ce prix. L’objectif premier est de donner confiance à l’apprenti, et ensuite de semer dans son esprit des doutes salutaires. L’idée est que, si à la première occasion le maître commet des erreurs triviales, la réputation de labeur difficile qui accompagne le cinéma se trouvera amplement justifiée. Pour quelqu’un qui se lance, tout paraît évident et facile. C’est seulement plus tard que le jeune réalisateur s’aperçoit que les ressources expressives de son premier film se sont réduites comme peau de chagrin ; que ces moyens ont tout à coup l’intensité infantile de la toute première expérience, et que poussé par l’enthousiasme suffocant, non dépourvu de stupeur, de voir naître une première œuvre par la simple mise en fonctionnement de cette machine diabolique qui fait elle-même presque tout le travail, l’on remet au public quelque chose que, par un excès d’attention, l’on était très loin de soupçonner avoir mis dans le film.
L’on dit qu’il n’y a pas de premier film tout à fait mauvais, ce qui n’est pas faux, à la condition tout de même que le cinéaste possède ne serait-ce qu’un soupçon d’inspiration. Cette dernière n’étant pour tous les arts, en fin de compte, que l’intuition subite de la totalité de l’œuvre et de ses effets, elle est d’autant plus nécessaire au cinéma, peut-être à cause du grand nombre d’opérations protocolaires que nécessite un tournage. Cette curieuse forme de lucidité émotionnelle conduit souvent l’artiste à simplifier, ici et là, à la dernière minute, à ajouter une exclamation à la fin de telle ou telle phrase, à éliminer des jeux de lumière qu’il croyait nécessaires, ou un travelling prévu depuis la première version du scénario. Ces modifications minimes peuvent avoir pour effet de changer le film du tout au tout. C’est le moment où le film commence à mener sa propre existence. Le réalisateur est entré en contact médiumnique avec lui, et il accepte à présent ses exigences capricieuses comme qui se plie aux heures de sommeil d’un bébé.
Au niveau du second film, le cinéaste devra faire appel aux ressources qu’il croit posséder, pour découvrir qu’en fin de compte il n’en manque pas. Rien ne l’empêche d’inventer de nouveaux ornements, de multiplier les tics stylistiques, mais ce faisant il s’apercevra que pour autant qu’il rajoute des moyens il n’obtiendra pas plus d’effets, et qu’il faudra plus de temps au nouveau-né pour pousser son premier cri. Notre artiste n’a pas compris que ce qu’il appelle moyens n’est en aucun cas un ensemble d’effets neutres mis au service d’une intrigue. Les travellings, gros plans, jeux de clair-obscur, etc., sont le film avant le film. Tout comme une molécule d’ADN ne ressemble pas à un lapin, une partition ne possède pas non plus la faculté de chanter ; la première contient le lapin et la seconde, les instructions qui rendront la chanson possible. Chaque nouveau film exige ainsi de nouveaux moyens, bien que ceux-ci puissent n’être qu’une nouvelle mouture des anciens. Si nous reprenons l’exemple de la partition, ce que le jeune cinéaste est en train de faire se résumerait à orchestrer la même mélodie, sans se soucier de son exécution musicale.
Husserl soutient qu’avant de percevoir un phénomène, nous construisons des noèmes, des structures désirantes à travers lesquelles nos perceptions prennent forme. Il semblerait qu’une chose semblable se produise au moment de l’intuition d’un film. Au début nous ressentons intensément la présence de mouvements de caméra et d’images interchangeables qui viennent les combler. Il s’agit de rythmes visuels intuitifs, comme la danse abstraite de spectres non identifiables qui se remplacent les uns les autres vertigineusement, jusqu’au moment où une cristallisation inespérée se produit qui installe face à nous une image mobile sortie d’on ne sait où.
Une petite digression : dans un curieux essai sur le cubisme, Hintikka qualifiait de « réalistes » les œuvres de ce mouvement, en ce sens qu’au lieu de représenter un objet identifiable, elles reproduisent le processus même de la connaissance qui consiste à construire une image dudit objet à partir de différentes perspectives. Cette idée, à laquelle nous devrons revenir à propos du « mapping », est fort stimulante. Mais poursuivons pour le moment avec les avatars de l’enseignement du cinéma.
Nous disions que le jeune cinéaste découvre qu’il ne peut faire un nouveau film en recyclant les moyens utilisés pour sa première œuvre. Il devra attendre qu’une structure faite de mouvements de caméra et d’articulations d’images sans images viennent à son secours. (Nous avons souvent dans les rêves des impressions de ce genre : nous voyons un visage aux traits changeants, ensuite un paysage sans contour, et entre ces images nous nous mouvons avec une mollesse totale ; sauf qu’en ce qui concerne les images qui nous occupent ici, les structures, les rythmes et les successions assurant le passage de l’une à l’autre donnent une impression de solidité). Lesdites images sont des continents articulés, animés d’un dynamisme propre.
Ce n’est pas la description d’une opération magique. L’intuition des structures obtenues en articulant les mouvements de caméra, structures inhabitées ou semi-habitées, et qui à peine perçues évoquent ou convoquent des images, n’est utile qu’au terme d’un long travail d’imagination sur le sujet, ou les sujets se rapportant à l’idée d’un film : travail de documentation, élaboration de dossiers, collecte d’informations diverses, exercices sur les objets, énumérations d’objets, accumulation de situations, visites de reconnaissance sur les lieux prévus pour le tournage.
Il faut un énorme travail pour arriver à la première image germinale, qui est à la fois image et structure. Mais avant d’examiner quelques-unes des péripéties possibles d’une telle aventure, je dois revenir à l’assertion qui sert d’ouverture à ces deux paragraphes. Ses résonances peuvent paraître quelque peu archaïques. En dernière instance, la transmission du savoir-faire cinématographique (certains ajouteront qu’il en va de même pour celle des arts et de la philosophie) s’effectue sans intermédiaire du maître à l’apprenti, et seul à seul. Je dois, avant tout, limiter la portée de cette assertion. « Seul à seul » signifie que celui qui possède le savoir-faire doit l’adapter à la manière de comprendre de son apprenti, et que ce processus a quelque chose de singulièrement intime. Panofski écrivit une curieuse épitaphe sur la tombe d’Ernst Kantorowicz :
Maître de ses maîtres,
disciple de ses disciples,
ami de ses amis,
il aima la vie,
il ne redouta pas la mort.
Abstraction faite de la tendance sentimentale de cette épitaphe, la phrase disciple de ses disciples mérite que nous nous y arrêtions. Une vieille superstition pédagogique prétend que l’enseignement de maître à élève a pour condition l’apprentissage mutuel. Cela est vrai au moins sur un point : personne ne reçoit un savoir de la même manière. Pour certains, il suffit d’une formule succincte suivie d’un exemple facile à réaliser. D’autres ont besoin de commencer par une série d’exercices qui leur permettront d’arriver à une formule partielle, suivie elle-même de nouveaux exercices jusqu’à la compréhension et la maîtrise des thèmes enseignés. C’est seulement alors que les étudiants seront en mesure de les reproduire. Il y en a d’autres encore qui comprennent tout à l’envers. Il faut alors leur dire le contraire de ce que l’on est censé leur transmettre. Quoi qu’il en soit, personne n’est capable d’assimiler au même moment la même connaissance. Pour discerner la bonne occasion, le maître doit amener l’élève à lui apprendre une chose que lui-même, tout professeur qu’il est, ignore : le fonctionnement d’un ventilateur, par exemple, ou de n’importe quel autre artefact trivial et quotidien. Cela pourra, en révélant la façon d’enseigner de l’élève, laisser entrevoir sa manière d’apprendre. L’on sait bien que tout cuisinier qui se respecte tend à oublier une partie de la recette au moment de la donner à autrui. La même chose se produit avec la transmission d’une connaissance qui comporte un important aspect pratique ; dans la façon d’occulter il y a toujours une logique, qui souvent s’accompagne d’une touche de malignité.
Entre exilés, l’on racontait l’histoire suivante : un étranger débarque dans un village allemand et demande son chemin à un passant qui parle sa langue. Le passant l’informe qu’il doit aller tout droit, puis tourner légèrement à gauche, et encore à gauche, puis, arrivé au pont, continuer tout droit jusqu’à une petite place, avant de tourner à droite au troisième coin de rue, etc. Dès les premières indications, l’étranger se rend compte qu’il est incapable d’en retenir les détails. Par courtoisie, il écoute cependant attentivement son interlocuteur, puis le remercie et se dispose à partir. C’est alors que le passant, saisissant fermement l’étranger par le bras et avec un sourire menaçant, lui assène : Voulez-vous me répéter ce que je viens de vous dire, s’il vous plaît ?
Tous, plus ou moins, nous nous sommes livrés à ce jeu un peu sadomasochiste, mais peu auront remarqué ses virtualités didactiques. Si le maître accepte de jouer l’étranger et laisse l’élève assumer le rôle du passant, il pourra alors savoir d’où procède le faux savoir de l’élève. Soit dit en passant, quand l’apprenti a mal appris, il tend à mettre trop d’emphase dans tout ce qu’il exprime, en plus d’être incapable de trouver un chemin qui conduise d’une formulation à l’autre ; il s’avère incapable, surtout, de reformuler ses connaissances.
Il existe encore une autre manière, souvent efficace, de découvrir les automatismes qui modèlent la capacité d’apprentissage d’un élève. Celle-ci consiste à partager avec lui des souvenirs biographiques. Il ne s’agit pas nécessairement de souvenirs intimes, sinon ceux, anodins, qui nous restent de l’enfance ou d’un voyage récent. Il subsiste encore chez bon nombre de jeunes – bien que toute une frange de schémas narratifs courants se trouve infestée de paradigmes industriels – la volonté et le goût de faire valoir des manières de raconter, des manières de voir et des microstructures susceptibles d’apporter un point de départ, un certain nombre de séquences terminales, avec des développements un peu plus complexes et plus riches. A l’encontre de cette idée chère à de nombreuses personnes, je ne crois pas que l’on puisse énumérer les situations dramatiques, ni qu’il soit très utile d’entreprendre leur répertoire. Tout le monde se souvient des trente-six situations dramatiques compilées par Polti. Quiconque a fait l’effort de réfléchir un peu à ce sujet a pu constater que souvent, lesdites situations se contiennent les unes les autres, en plus d’être toujours complémentaires. C’est ce qui arrive, par exemple, avec la persécution et l’énigme, avec la menace et la vengeance. L’ensemble qu’elles constituent rappelle inévitablement les listes hétérogènes et exhaustives confectionnées par les rhétoriciens chinois de l’époque classique, à savoir, les vingt manières de saluer l’empereur, les vingt-six manières d’entamer un poème, ou bien les huit traits basiques en peinture. Il est toujours utile, sans doute, de connaître les séquences germinatives et de savoir les distinguer les unes des autres, mais celles-ci ne sont pas toujours assimilables à des situations dramatiques. Une séquence germinale est une structure très simple, incomplète, et qui peut être complétée par des faits nouveaux, qui a leur tour deviendront autant de péripéties ; ces dernières reproduisent « en plus grand » et de façon récurrente la séquence initiale.
Tous les récits ne possèdent pas de séquence germinale. Le cinéma peut même parfaitement s’en passer. C’est néanmoins au cinéma que sa fonction apparaît la plus évidente, puisqu’une telle image est le résultat de la juxtaposition d’images et de sons à laquelle viennent parfois s’ajouter des mots appartenant à un langage vivant ; dit d’une autre manière, des éléments qui sont tous de nature à la fois synchronique et diachronique. Les premiers arrêtent l’expansion narrative, les seconds la favorisent, mais c’est toujours l’un des deux qui s’impose par rapport à l’autre. Quand l’expansion narrative s’arrête, il faut ajouter au film des éléments diachroniques : étendre le champ visuel, déclencher une nouvelle action ou ajouter des textes. Mais si l’on pousse l’abstraction trop loin, c’est-à-dire, si on le fait au détriment de l’épaisseur (l’on dit que les images manquent d’épaisseur quand elles sont perçues comme simple support des faits narrés), il faut donner plus de poids aux faits que l’on veut montrer, en les chargeant d’images dont les éléments prédominants sont ceux qui tissent le récit. C’est cela qui se produit, par exemple, avec les relations internes dans lesquelles l’effet polysémique joue plus dans le sens « centrifuge » que dans le sens « centripète » ; c’est-à-dire, dans le premier cas, faisant appel à d’autres images possibles qui seraient aux aguets, plus clairement que dans le second cas, suggérant ces événements qui se referment sur l’image. Tel est l’exemple du flacon de purgatifs sur l’autel, pendant la messe solennelle, cité dans le premier chapitre. Ce simple élément peut remplir les deux fonctions signalées. D’une part, il sert à attirer notre attention sur l’image de l’autel, dans la mesure où ce flacon est ici un objet discordant. D’autre part, cet élément perturbe tellement le spectateur qu’il acquiert une présence suffisamment puissante pour être immédiatement reconnu lorsqu’il revient à la fin du film ; en lui nous découvrons aussi « l’arme du crime », puisque nous saurons que ce flacon ne contient pas un purgatif, mais une dose de poison. Tout aussi clair serait pour nous le fait que le mot « Phillips », écrit sur l’étiquette, n’est pas seulement une marque commerciale, mais justement la clé kabbalistique du film. J’appelle « shift » cet élément qui sert à changer de niveau narratif et à relier les événements dispersés le long du film, en leur conférant une lecture linéaire, séparément des faits proprement filmiques.
Mais je me rends bien compte que je bondis déjà vers les derniers chapitres de ce livre, où j’essaierai justement de parler de structures. Pour en revenir à la transmission des « secrets de cuisine », je voudrais simplement ajouter que les formules nous servant à mémoriser nos savoirs ne sont pas légion. Dans l’idéal, chacun aurait les siennes. En général, je ne fais rien d’autre que de modifier légèrement celles appliquées par l’élève ; j’essaie de les rendre plus précises, d’élargir leur portée, bien qu’il soit très souvent préférable de les conserver avec toute leur imprécision, leur mystère et leur intimité – autant d’aspects nécessaires à la pratique libre et souveraine de tous les arts, et du cinéma en premier lieu.
La réflexion en quatre points à travers laquelle j’ai essayé d’aborder les principaux obstacles à l’enseignement du cinéma pourrait s’intituler « Warning ».
Je n’ai probablement pas été aussi explicite qu’il l’aurait fallu, mais il me semble facile de déduire de mes propos que, mis à part quelques extrapolations théoriques et dérives fabulistes, les observations, conseils et exercices mentionnés découlent d’une théorie centrale. Tout au moins procèdent-ils d’un corpus d’idées et d’intuitions sur le cinéma en tant qu’art que j’espère cohérent. Je ne peux qu’insister sur ce point, car les manières de comprendre le cinéma sont nombreuses et aucune ne manque d’intérêt. Le cinéma peut être pensé comme industrie, technique de vices et vertus de notre époque, radiographie des dysfonctionnements du corps social (possibilité qui met immédiatement en branle les réflexes universitaires paranoïaques jusqu’à l’obsession), ou encore comme « politique des sens », etc.
Plus modestement, le cinéma dont il est ici question recouvre ce genre d’œuvres audiovisuelles dans lesquelles les auteurs ont cherché une extrême complexité en un minimum de temps et d’espace. En raison de cette option initiale, leurs contenus filmiques sont aussi riches que variés, et possèdent l’autonomie suffisante pour mériter que l’on voie en eux un « monde » construit à partir de rien au moyen de symboles.
Avant de fermer ce chapitre, je vais essayer d’exposer succinctement les principaux avatars d’une théorie générale qui, pour ainsi dire, s’est forgée seule à mesure des tournages et autres exercices qui m’ont occupé ces trente dernières années. Vous connaissez déjà son point de départ, qui est surtout une profession de foi : au cinéma, l’image détermine toujours la narration.
Que devons-nous entendre par « image » ? Quand je parle d’image, il me vient toujours à l’esprit – et je pense que c’est inévitable – une première distinction. Est image tout ce que capture la caméra, en vrac, sans discrimination, et qui dans notre esprit tend à s’organiser sous la forme d’une dichotomie : un élément central et un contexte, un thème et des variations, une expression et des ornements, selon le vocabulaire de Croce ; ou bien, selon celui de Benjamin, le conscient et l’inconscient ; ou encore, l’évidence et le dilemme, etc. Quand l’image se met en mouvement, ces dichotomies tendent à s’imbriquer, favorisant une multiplicité de lectures. Tel est le type d’images cher à Bazin : un fragment de réalité qui est langage du monde et non sur le monde, recelant davantage de signes que nous ne sommes en mesure d’en percevoir, une image dont il ne reste plus qu’à croire qu’elle a été faite « sans l’intervention ni la volonté de l’homme ». Fruit de l’intervention directe de la Providence, et sans que sa qualité en termes de convention artistique ait la moindre importance, cette image non manufacturée et parfaite ne tolère pas d’être modifiée (essayer serait déjà un sacrilège !).
En second lieu, l’on peut comprendre par « image » la juxtaposition d’un nombre très réduit d’icônes qui nous donnent l’impression d’être devant une image à la manière de Bazin. Je pense à un objet quelconque, reconnaissable sans effort, et qui se détache sur un fond également perceptible et nommable : une chaise appuyée contre un mur, par exemple. J’étais sur le point de parler d’ « atomes visuels », mais, dissuadé à temps par l’emploi hétérogène qui est fait des références atomistes dans la théorie de la vision, je préfère parler d’ « images simples ».
Il n’est pas difficile de vérifier qu’une image, dans l’acception de Bazin, est toujours réductible à une image simple, grâce aux dichotomies mentionnées antérieurement. En même temps, une image simple contiendra toujours suffisamment d’éléments pour être considérée comme une image « bazinienne » : un crayon posé sur le bord d’une table, par exemple, montre la juxtaposition de deux objets non simples, mais l’espace que tous deux suggèrent leur permet de constituer une image douée d’expression et d’ornement, de thème et de contexte, de concret et de poudreux, etc.
Aussi claires que soient les idées que l’on a en commençant un film, il conviendra toujours de partir d’enchaînements, d’associations d’images simples, de concaténations et d’aimantations, etc., de sorte que nous voyons croître le film par arborescences, par agencements en forme de réseau ou de trame. Chacune de ces figures offre des possibilités propres qui peuvent se combiner à l’envi, selon le dessein des figures elles-mêmes ou du film. Afin de développer ce corpus d’images, je propose que nous nous arrêtions sur ce que l’on nomme « paradigme récursif », en prenant le vocable « paradigme » au sens de Thomas Kuhn. L’on sait bien que cet auteur l’utilise dans le double sens de panoplie d’opinions inconscientes et, dans un emploi plus traditionnel, d’exemple à suivre. Faire appel à un paradigme récursif veut dire ici, en premier lieu, progresser dans le film, réellement ou mentalement, en donnant du sens à l’enchaînement de couples d’objets, dont l’un assumera par rapport à l’autre la fonction de fond. Cela implique ensuite de faire en sorte que, contre ce fond, se détachent successivement de ces couples d’objets (situation latente) d’autres paires, et ce jusqu’à obtenir des combinaisons toujours plus complexes, cela sans omettre la possibilité de revenir souvent en arrière. Il s’agit, bien sûr, de ne pas perdre le fil, mais aussi de découvrir à chaque fois de nouveaux fils conducteurs.
La lecture du premier chapitre de ce livre devrait suffire pour comprendre l’idée de développement récursif d’un thème. En l’absence d’un point de départ suffisamment solide, et d’un but un tant soit peu défini, l’on ne pourrait porter trop loin une combinatoire quelconque. Normalement son orientation est donnée par l’idée que l’on se fait du film en tant que système de jeux fermé et déjà achevé. C’est alors que doit intervenir le paradigme stratégique, sous la forme d’une intuition de ces jeux prévus ; jeux qui se sont instaurés entre ensembles d’images librement articulés, suivant une démarche récursive. Une fois le film terminé, on verra en quelque sorte deux films : un film-histoire et un film-géographie. A un moment donné, ce dernier occupera le centre d’attention de tout le film ; mais à un autre moment il constituera seulement son fond. Quant au film-histoire, il faut préciser ce que nous entendons ici par « histoire ». Il ne s’agit pas du contenu narratif du film, sinon de son climat de fabulation, son espace fictionnel et sa temporalité multiple. Je crois avoir découvert quelques idées sur la manière de mettre en scène cette histoire centrale, ou, pour le dire autrement, cette histoire « théâtrale », en l’intégrant suffisamment dans le corpus audiovisuel pour que les spectateurs les moins intéressés par la « cuisine » cinématographique puissent la suivre tranquillement.
J.-P. Rabaud Saint-Etienne, député girondin, protestant et helléniste, décapité pendant la Terreur, affirmait dans son Essai sur la Grèce que la plupart des mythes grecs émanaient soit de la description des paysages, soit du mouvement des planètes. Je ne me souviens plus si c’était dans cette œuvre, dans L’origines des mythes et / ou des religions de Charles Dupuis, ou dans une quelconque spéculation sur le Déluge Universel due à Nicolas Boulanger, que je trouvai une définition du théâtre, pour moi suggestive. D’où qu’elle vienne, cette définition me permit d’éclaircir l’idée d’intégration de l’action dramatique pure dans la trame d’arabesques et de fables qui composent ce monde visuel qu’est en fin de compte le film : Le théâtre, ce sont ces actions des hommes où l’astronomie et la géographie entrent en contact. Dans les lignes qui suivent j’essaierai de donner consistance à cette idée.
Les hommes primitifs (cette fiction dix-huitièmiste), contemplant le ciel étoilé, remarquèrent le mouvement des astres ; peu à peu, ils découvrirent des répétitions, des cycles. Certains crurent voir des figures proches de leur monde quotidien : voici un crabe, plus loin un taureau, et plus loin, des rats, des guerriers à cheval, des rapports sexuels, des ustensiles divers. Au moins l’un des observateurs, celui dont la lignée traversera les siècles jusqu’à s’incarner en un certain Hamlet, vit fixée dans le firmament l’image de son père, Orvelde, mort dans une bataille entre les mains de son beau-père, et précipité depuis un sommet au fond de l’abîme. Ce nomade ingénu imaginé par les hommes des Lumières dût découvrir pendant ses transhumances de chasseur, que ses proies suivaient aussi un parcours cyclique, et qu’en les poursuivant, il décrivait lui aussi le même mouvement. Il dût conclure que les travaux des jours et des hommes n’étaient pas très différents des événements célestes. Cette découverte dût lui suffire pour se considérer lui-même comme une étoile incarnée. L’analogie entre les avatars de ses déplacements terrestres et les cycles astronomiques ne tarda pas à se former dans son esprit. Puis il attribua aux astres et à ses configurations tutélaires des péripéties semblables aux siennes. Tel est, semble-t-il, le sens qu’il faut donner à l’assertion surprenante de Dupuis, selon laquelle le mythe succède toujours au savoir scientifique, et ne le précède jamais.
Si nous suivons la traversée des âges effectuée par l’homme qui observait les étoiles avant d’en rêver, il est probable qu’en assimilant son existence aux astres il ait dû remarquer le relatif décalage entre leur mouvement et ses déplacement dans les plaines préhistoriques. Il dût aussi intimement éprouver cette discordance comme une infraction à sa profonde soif d’harmonie. Le philosophe contemporain Garcia Bacca suggère, à la suite de Boèce, que la musique abstraite a pu naître à cette époque en descendant du ciel. Pour célébrer la découverte de la musique, le premier musicien aurait composé deux ou trois mélodies qu’il aurait ensuite chantées en s’accompagnant de coups rythmiques produits par un fémur frappé contre les parois de sa caverne. D’une manière ou d’une autre, il comprit rapidement – à ce qu’on dit – que modifier le cours des étoiles pour l’adapter à celui de l’aventure de sa vie terrestre était une tâche bien au-dessus de ses forces. Il choisit alors de modifier le récit des longues expéditions de chasse de son peuple. Tout alors déboucha dans le mythe ; au lieu de chanter « pendant de longues journées nous descendîmes par la vallée sur les traces de cerfs et de buffles », il disait : Tout au long de trois années, d’abord, puis de quatre (les deux cycles de Sirius), nous survolâmes les cimes des montagnes jusqu’à trouver l’oiseau dont la poitrine recouvre le dessin de trois-cent soixante cerfs et de huit buffles. Notre homme ayant déjà incorporé à son alimentation des herbes et des tubercules, le jus de quelques végétaux exposés au soleil un certain temps lui ouvrit entièrement les portes des expériences magiques. Avec celles-ci vint la connaissance des cycles agraires, ainsi que la conscience de la succession des saisons, dont ils voulurent – à ce qu’on dit – accompagner la scansion par des fêtes destinées à marquer le passage de l’une à l’autre. Dire fête équivaut à dire sexe et dire sexe équivaut à dire conflit. Fête plus sexe égalent danse, et la danse attire l’accompagnement de chants et de rythmes, sans compter que tout cela, bien entendu, concernait de très près le mouvement. Les primitifs tardifs que nous sommes en train d’évoquer ont dû se souvenir de leur lointain ancêtre astronome, ce premier positiviste, dont l’activité se limitait à vérifier le mouvement régulier des planètes et éventuellement à établir leur prévision. Ils trouvèrent qu’il était bon de lui rendre hommage en imaginant un jeu unique, et ensuite des jeux multiples : les « jeux planétaires ». Tous réunis dans un espace pas plus grand que le stade de Maracana, chaque joueur choisissait son étoile, et pendant toute la nuit, à l’aide d’un bâton et d’un os de buffle, il suivait sa trajectoire dans le ciel par un tracé au sol. Le lendemain ils découvrirent que, sans faire un grand effort d’imagination et en négligeant quelques incohérences, le dessin de tous ces trajets correspondait au territoire sur lequel ils plantaient et cueillaient, chassaient et luttaient. Tel est, à ce qu’il semble, l’origine du sentiment patriotique, qui eut pour fille la patrie (appelée au début « matrie »).
Un ami anthropologue nord-américain, ou, ce qui est presque la même chose, un sportif, participa récemment à ce jeu astronomique. Il m’expliqua qu’il était difficile d’en venir à bout, parce qu’en dehors du risque certain d’attraper un torticolis, le fait de passer la nuit entière les yeux rivés sur son étoile provoquait chez le joueur toutes sortes d’hallucinations ; en dehors du désir impérieux de raconter des histoires et de hurler sans raison, le joueur est aussi la proie d’une haine irrévocable envers les avions. Rien de plus gênant, en effet, pour le bon déroulement du jeu, que l’irruption soudaine d’un appareil Iberia ou d’un Varing. Un autre ami, malien cette fois, a une opinion différente à ce sujet. Les avions, dit-il, ont dans son pays un statut intermédiaire entre l’étoile filante et le satellite artificiel, et certains joueurs qui les incarnent, comme d’autres le font avec les étoiles, se mettent en les voyant passer à courir en criant Air Afrique ! ou Air France ! sans que cela ne perturbe personne.
Sur ce point, nos néo-primitifs, inventeurs du théâtre, devraient se rendre compte que rien n’empêche la prolongation de ces jeux tout au long d’une année ou d’un siècle. Ils comprendraient que tous les actes de la vie, jusqu’aux plus insignifiants, pourraient concerner le mouvement des planètes et le cycle des saisons, ce par quoi ils viennent simplement d’inventer la religion. Doués d’un esprit économique, certains ne tarderaient pas à calculer que ces jeux, au contraire, pourraient se synthétiser en deux ou trois heures, avec un nombre de joueurs ne dépassant pas la centaine, et un espace pas plus grand que la surface du fronton de la pelote basque. La participation de tous les autres se verrait en même temps réduite au rôle moins épuisant de spectateurs, ce qui tout compte fait rendrait le jeu plus amusant pour les uns et pour les autres. Pour résumer, une nouvelle source de plaisir vient de naître, parce que, soit dit en passant, en mélangeant la consommation de jus fermentés et le sexe ils avaient déjà inventé le plaisir. Le résultat final de tout cela est le théâtre.
L’homme primitif qui sommeille en moi me souffle à l’oreille le défi de mélanger imaginairement les deux évolutions, et le cinéma que je propose est ma réponse. Dans les chapitres qui suivront un jour je traiterai du comment…