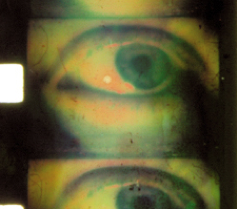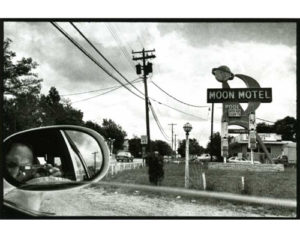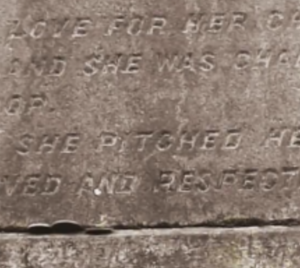Raymond Bellour
Dans la compagnie des œuvres (extraits)
Les éditions Rouge Profond ont publié ce vingt septembre Dans la compagnie des œuvres, ouvrage né d’entretiens entre Raymond Bellour et deux collaborateurs de la revue. Guy Astic a bien voulu que nous en publions un extrait, ce pour quoi nous le remercions chaleureusement.
Alice Leroy et Gabriel Bortzmeyer : Faisons un point de méthode. Il y a, dans votre écriture, dans la manière dont vous tissez ensemble l’analyse serrée et le travail conceptuel, ce qu’il faudrait appeler une logique d’inférence : vous ne partez jamais de problèmes englobants, de notions totalisantes, et celles qui se construisent au fur et à mesure de votre écriture ne font jamais, sinon seulement a posteriori, l’objet d’une analyse systématique – elles se formulent plutôt dans un mouvement continu de retour et de différenciation. Les singularités sont reines, points de départ de tout discours. Et en même temps le travail d’analyse tend à les épuiser tant et si bien que cette casuistique devient, à terme, le moyen d’établir des modèles généraux d’approche. L’analyse des Oiseaux fournit ainsi une matrice analytique pour l’ensemble du cinéma classique américain. On aimerait donc déplier avec vous ce rapport assez rare entre le singulier et le général, et toutes les procédures d’induction et de projection qu’il met en jeu.
Raymond Bellour : Je suis heureux que vous souleviez ce point car la justesse de ce que vous dites me paraît cerner une façon d’être et de faire qui explique une part de souffrance attachée au plaisir que je prends à mon travail. Je m’intéresse à beaucoup de problèmes qu’on peut dire généraux, et des plus variés, chez les autres, et j’ai souvent cherché, à travers des lectures critiques, à les cerner, à les préciser. Mais dès qu’il s’agit de ce que je pourrais appeler «mes » problèmes, ils ne me viennent que sous la forme obscure de fascinations éprouvées de façon si vive envers des œuvres qu’il me devient vital de devoir y répondre sans même pouvoir pressentir à quoi m’engage le désir de vouloir les éclairer, parfois jusque dans leur moindre détail. J’en ai pris une conscience plus claire au cours de nos entretiens quand j’ai eu à vous répondre tant sur mes analyses de films américains que sur ma passion excessive pour les cinq mille pages de la tétralogie de Dumas. La douleur, si je peux dire, en même temps que le plaisir, évidemment, viennent de l’obligation de voir sourdement monter une idée d’ensemble d’un foisonnement de données qui ne paraissent pas a priori coordonnables entre elles mais qui le deviennent par l’insistance du bricolage auquel elles se trouvent soumises. Il y a là un vrai phénomène d’aimantation – on pourrait dire de petit déclic hypnotique – sans lequel je ne peux à proprement parler jamais envisager un vrai travail. D’où ma difficulté, souvent, à le programmer, tant je sais mal jusqu’où il va m’entraîner. Et la difficulté, ensuite, vient de ce qu’il faut, si l’on peut dire, rentabiliser les égarements du détail par des sauts vers l’idée générale, avec la peur, toujours, qu’il demeure un irrémédiable entre-deux tant le saut d’un niveau à l’autre relève plus d’un pari projectif que d’apparences de preuve – car de toute façon, dans nos domaines, les preuves ont toujours quelque peu des allures de fiction.
J’ai fini par me demander si cette façon de faire, quand elle est poussée à l’extrême, comme dans le cas de Mademoiselle Guillotine, ne finit pas par altérer la recevabilité des hypothèses. J’ai en effet été frappé et en un sens « déçu » que ce livre n’ait reçu aucun véritable accueil, en particulier de la part des historiens et des psychanalystes, comme s’il était trop farfelu pour les uns et trop offensant pour les autres. Si bien qu’il semble avoir été écrit, comme dirait Mallarmé, « en vue de plus tard ou de jamais ».
A. L. et G. B. : Il y a comme une dimension d’autoportrait dans ces textes. On a déjà eu l’occasion de parler de l’écriture comme une forme d’autobiographie déguisée, de la subjectivité inscrite en filigrane dans l’écriture, mais il nous semble que vos textes manifestent ici plus exactement une forme d’autoportrait en creux de l’analyste. Le texte sur La Mort aux trousses se clôt sur la mention du «désir fasciné de l’analyste » – expression récurrente tout le long du livre, et qu’on retrouve jusque dans Le Corps du cinéma où vous en appelez à un «désir de savoir». L’expression penche pour une part vers Blanchot et son idée de l’écriture placée sous la « fascination de l’image », et pour une autre vers Lacan qui ouvrait le livre XI du Séminaire sur le désir de l’analyste – en l’occurrence, Freud. Vous faites d’ailleurs dans l’introduction de Mademoiselle Guillotine un (auto-)portrait de l’analyste en meurtrier : «L’acte critique le plus simple, le plus usuel aussi, celui de la “critique”, du compte rendu, suppose une distance, un premier meurtre de l’objet. Mais une distance minime, où le corps de l’objet, à peine fracturé, est restitué sous la forme d’un tout imaginaire à son destinataire, comme à son émetteur qui se repaît de cette intimité. À l’opposé, toute véritable analyse de détail porte à l’extrême le meurtre de l’objet: par un retournement inévitable, elle va jusqu’à s’instituer elle-même comme un nouveau corps où l’intimité maximale entretenue avec l’objet devient la condition d’un certain processus de connaissance. » À la recherche de quel savoir l’analyste s’aventure-t-il? En réponse à quel désir ?
R. B. : Quand j’affirme que l’analyste tue l’objet, il me semble que, dans le cas du film, c’est particulièrement net dans la mesure où il l’arrête. L’arrêt sur image est le geste premier: il faut suspendre le défilement des images, tuer en quelque sorte le film pour pouvoir l’analyser. De façon plus générale, c’est bien connu, tout acte critique suppose un certain meurtre de l’objet; mais en même temps, ce meurtre est la condition de sa résurrection : le texte critique n’a d’autre vocation que de faire revivre l’objet en le dotant de dimensions nouvelles, d’un autre corps peut-être. C’est ce processus de mise à mort et de résurrection qui fonde la nature du geste critique. Quant à la question du désir de savoir, il répond à mes yeux, pour le cinéma, à une expérience qui a eu lieu pendant la projection. Mécanisme étrange que la projection quand on y réfléchit : on se trouve enfermé dans une salle, ceint par l’obscurité, face aux images, le plus souvent pendant une heure et demie ou deux heures. Arrive toujours à tel ou tel moment « une image » par laquelle on se trouve saisi – un plan, une configuration de plans, une figure, ou tout autre chose. Cette expérience, on peut soit l’oublier à la sortie du cinéma, soit tenter de l’éclairer. Pour moi, elle détermine le désir d’écriture, c’est-à-dire le désir d’aller vers le film pour comprendre ce saisissement vécu durant la projection.
Je disais à propos de Dumas que ma fascination pour ce livre, Joseph Balsamo, que j’avais lu vers treize ou quatorze ans, était liée à la scène dans laquelle Balsamo hypnotise Andrée de Taverney pour la conduire dans la chambre rouge – une scène d’une sensualité extrême tant la possession de la femme, acte symbolique du romantisme, s’y joue comme un acte quasiment sexuel (Dumas va jusqu’à écrire : « Et il posa une verge d’acier sur la poitrine frémissante de la jeune femme »). Cette scène, disons primitive, ne m’a jamais quitté. Je tends à lui assigner l’origine de mon désir d’écriture sur Dumas. Ce désir naît ainsi, au moins pour moi, de chocs éprouvés au moment de la lecture ou de la vision des œuvres. Le cinéma en fournit un exemple idéal précisément parce qu’il est un objet de fuite : on ne tient pas le film au fur et à mesure qu’il défile sur l’écran, on ne peut pas arrêter son cours (c’était au moins le cas dans les longs débuts de mon travail sur le cinéma). C’est pourquoi l’expérience de la projection en salle, avec l’attention flottante qu’elle requiert et la réalité de la durée qu’elle engage, me paraît si essentielle à l’expérience du spectateur de cinéma – si relative qu’elle puisse paraître aujourd’hui où il est devenu si simple d’arrêter le film.
A. L. et G. B. : C’est en somme un retour sur l’émotion de cinéma, moins pour la neutraliser que pour l’amplifier ?
R. B. : Absolument. Nous parlions tout à l’heure de la difficulté propre à la description des films, il me semble qu’en elle se manifeste aussi la volupté particulière consistant à retrouver par l’écriture l’émotion de la projection, ce saisissement qui est toujours passé trop vite pour qu’on puisse véritablement le comprendre.
A. L. et G. B. : N’y a-t-il pas alors une dimension proprement psychanalytique de l’écriture, qui apparaît presque, selon vos termes, comme un processus convoquant une mémoire refoulée où se mêlent des scènes originaires, des images traumatiques et sans cesse aussi le désir de retrouver une émotion perdue?
R. B. : Ce n’est pas parce que je refuse à la psychanalyse une position de rétroversion historique supposant que de tout temps les sujets humains auraient été soumis à l’Œdipe et à la castration que je minimise pour autant le travail extraordinaire de Freud sur le rêve, la mémoire, l’oubli et la réminiscence, tout ce qui innerve si magnifiquement les trois grands livres de ses débuts (L’Interprétation du rêve, Psychopathologie de la vie quotidienne, Le Mot d’esprit dans ses rapports avec l’inconscient). C’est qu’il y a dans la psychanalyse deux choses différentes, si liées semblent-elles: d’un côté, la logique des processus, d’autre part l’attribution de ces processus à des complexes d’origine. Autant on peut continuer à penser que la logique des processus demeure absolument déterminante, autant on peut s’interroger sur l’Œdipe et la castration comme instances universelles de la subjectivité. Félix Guattari, par exemple, avait la plus grande admiration pour ces trois grands livres de Freud dont je viens de citer les titres, dans lesquels il voyait à l’œuvre une gamme extraordinaire de processus qu’il pouvait retravailler à l’intérieur de sa propre vision sans se trouver assigné à la fatalité de l’Œdipe et de ce qu’il suppose. Freud a été le plus merveilleux descripteur qui soit de toutes ces modalités expressives et mémorielles, quelles que puissent être les raisons parfois excessives qu’il leur prête. L’arrêt sur image et la description qu’il induit sont les gestes propres qui permettent à l’analyste de cinéma de qualifier ces mêmes processus. J’ai consacré au début de L’Entre-images quelques pages à ce geste de l’arrêt sur image sur la table de montage et au mécanisme mémoriel qu’il enclenche. Arrêter le défilement des images, c’est en quelque sorte une perversion : on découvre des choses insensées, parfois tout autre chose que ce qu’on cherchait. J’avais alors en mémoire ces images de l’incendie du château à la fin de Rebecca, le film de Hitchcock où Mrs Danvers est en train de périr dans les flammes au milieu des poutres enchevêtrées qui s’effondrent. Certains photogrammes sont proprement hallucinants, et la réalité produite par l’arrêt sur image m’avait alors sidéré une seconde fois par rapport au souvenir déjà si fort que j’avais gardé de la scène.
Extrait p. 97-101.